Instruments Internationaux Relatifs Aux Droits De L'homme
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

La Indagatoria Del Pasado De Virgilio Rodríguez Beteta (1885-1967): Un Acercamiento a Su Contribución En La Historiografía Guatemalteca De Inicios Del 1 Siglo Xx
Revista Expedições: Teoria da História & Historiografia Dossiê LA INDAGATORIA DEL PASADO DE VIRGILIO RODRÍGUEZ BETETA (1885-1967): UN ACERCAMIENTO A SU CONTRIBUCIÓN EN LA HISTORIOGRAFÍA GUATEMALTECA DE INICIOS DEL 1 SIGLO XX José Edgardo Cal Montoya2 RESUMEN: Virgilio Rodríguez Beteta (1885-1967) fue miembro fundador y primer vicepresidente de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala en 1923. Su amplia trayectoria política, diplomática y periodística se desarrolló a la par de una indeclinable dedicación a la investigación histórica. Desde su presencia en los círculos gubernamentales, se constituyó en una figura central de la vida cultural e intelectual del país hasta su fallecimiento. Aunque su <<indagatoria del pasado>> esté referida a la recuperación de una <<historia nacional>> identificada con la monumentalidad maya y colonial, sus escritos carecen hasta hoy de una valoración sobre su influencia y aporte para el desarrollo de la historiografía guatemalteca, en la que, hasta el día de hoy, son una referencia obligada para el estudio de la Historia política e intelectual del periodo colonial y republicano. PALABRAS CLAVE: Historiografía guatemalteca. Virgilio Rodríguez Beteta. Sociedad de Geografía de Historia de Guatemala. VIRGILIO RODRÍGUEZ BETETA'S INVESTIGATION ON THE PAST (1885-1967): A GLIMPSE OF HIS CONTRIBUTION TO TWENTIETH CENTURY GUATEMALAN HISTORIOGRAPHY ABSTRACT: Virgilio Rodríguez Beteta (1885-1967) was a co-founding member and first Vice-President of the History and Geography Society of Guatemala on 1923. His wide political, diplomatic and journalistic career was developed next to a persistent dedication to historic research. Since his participation in governmental circles, he became a main actor on the cultural and intellectual life of the country until his death. -

Biografía Política Guatemala
BIOGRAFÍA POLÍTICA de Francisco Villagrán Kramer GUATEMALA / Francisco Villagrán Kramer BIOGRAFÍA POLÍTICA de GUATEMALA -los pactos políticos de 1944 a 1970- .', , . ~ ,'.. (" :," ~-; ~ : : ",:' ..1, ,. _ l 3L~ ~ Z? ,)..:+ \, 'a ,~Dt:5 V712 Villagrán Kramer, Francisco Biografía política de Guatemala: los pactos políticos de 1944 a 1970. 2da. edición Guatemala: FLACsq, 1993. S04p. 1. Políticos - Guatemala. 2. Historia Guatemala. 3. Análisis histórico. Publicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, programa Guatemala.. Diseño 'de portada: Rossina Cazali Grabado: Juan Antonio Franco Los criterios expresadosen esta obra son de la exclusiva responsa bilidad de su autor.. Este libro se publica gracias a la colaboración de Swedich Ageney for Research Co-operation wíth developing countries (SAREC). Impreso en Impresos Industriales, 1994 3a. calle 3-17, zona 9, Guatemala, C. A. Teléfonos: 316624 - 314369 FAX: 316328 ÍNDICE PRIMERA PARTE Presentación XIII Nota liminar XVII Capítulo I 1 La Revolución de Octubre de 1944 I Preludio revolucionario 1 11 Capitulación del Partido Liberal Progresista 11 111 La Junta Revolucionaria y los principios de la revolución 15 IV La Constituyente de 1945 y el acuerdo político con el ejército 25 Capítulo n 45 El primer gobierno de la revolución y el pacto del barranco I El programa inicial 46 11 El pacto del barranco 49 III Proyección institucional de la revolución 53 IV Proceso electoral prematuro y politización del ejér cito 63 V Asesinato del jefe de las fuerzas armadas 68 VI Epílogo 80 Capitulo m 87 El gobierno de Jacobo Arbenz, los pactos de caballeros y su renuncia Introducción 87 I El espectro de la confrontación política e ídeoló gica 91 11 El "pacto de caballeros" y el compromiso de unificación 103 11I La "operación exito" y el segundo "pacto de caba 113 lleros" IV Concertación en el exterior 116 V El frente interno. -

Sexafoliar Informativo Del Museo Nacional De Historia
Cristi Viviana García Gómez Sexafoliar Informativo del Museo Nacional de Historia Lic. Marco Tulio Rodas Asesor Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Humanidades Departamento de Arte Guatemala, octubre 2015 Sexafoliar Informativo del Museo Nacional de Historia ÍNDICE Índice Introducción CAPÍTULO 1………………………………………………………………………. 1 Diagnóstico………………………………………………………………………… 2 1.1. Datos Generales de la Institución…………………………………………. 2 1.1.1 Nombre de la Institución ………………………………………………….. 2 1.1.2 Tipo de Institución…………………………………………………………. 2 1.1.3 Ubicación Geográfica……………………………………………………… 2 1.1.4 Origen, fundadores y organizadores…………………………………….. 2 1.1.5 Eventos destacados……………………………………………………….. 3 1.1.6 Edificio………………………………………………………………………. 4 1.1.7 Medidas del Edificio ……………………………………………………..... 6 1.1.8 Visión Institucional…………………………………………………………. 6 1.1.9 Misión Institucional…………………………………………………………. 6 1.1.10 Marco Legal de la Institución……………………………………………. 6 1.1.11 Objetivos…………………………………………………………………… 7 1.1.12 Estructura Organizacional………………………………………………. 9 1.1.13 Recursos…………………………………………………………………... 10 1.1.13.1 Humanos………………………………………………………………… 10 1.1.13.2 Materiales……………………………………………………………….. 13 1.1.13.3 Financieros……………………………………………………………… 13 1.2 Procedimientos o técnicas utilizadas para efectuar el diagnóstico……... 14 1.2.1 Observación………………………………………………………………… 14 1.2.2 Entrevista……………………………………………………………………. 14 1.2.3 Encuesta……………………………………………………………………. 14 1.2.4 Matriz FODA………………………………………………………………... 15 1.3 Lista de carencias, ausencia y deficiencias………………………………. -
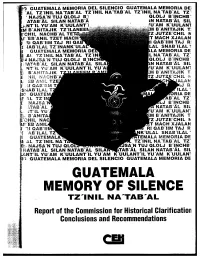
Guatemala Memory of Silence: Report of the Commission For
_. .... _-_ ... _-------_.. ------ .f) GUATEMALA MEMORIA DEL 51LENCIO GUATEMALA MEMORIA DE: "<" 'AL TZ'INIL NA'TAB'AL TZ'INIL NA'TAB'AL TZ'INIL NA'TAB'AL TZ" , C NAJSA'N TUJ QLOLJ B'I QLOLJ B'INCHB': 'ATAB'AL 51LAN NATAB'A ~N NATAB'AL SIL ~NT'IL YU'AM K'UULANTl , U'AM K'UULANl . Nt B'ANITAJIK TZ'ILANEE .. ' B'ANITAJIK T: . 'CHIL NACHB'AL TE JUTZE'CHIL N , r 'EB'ANIL TZET MAC MACH XJALAN '~l QAB'IIM TAJ RI QA I QAB'IIM TAJ R! ~ ~AB'llAl TZ'INANK'ULA LAL SNAB'ILAL 1 I GUATEMALA MEMORIA LA MEMORIA DE · E Ai.. TZ'ENil NA'TAB'AL TZ'IN L NA'TAB'Al TZ' : i,& (~A~SA'N TUJ QLOLJ B'INC QLOLJ B'INCHB' i ~A'!"4B'Al SllAN NATAB'AL SI NATAB'Al Sil , NT'H.. YU'AM K'UULANT'IL YU 'AM K'UUlAN1 .. i B'Ar~rrAJiK T M B'ANITAJIK T. I~ HH. Nt~,.CHB' Z JU 'CHH_ ~ gi! EB'fU\BL T'Z ALAN fJ ,H QAS'nM . J R ~Sr"AB';lAL LAl i ,tlG GUATE, RIA DE :~F ,~l TZ'! B'Al TZ' ~ NAJSA' B'INCHB' B4TAB'AL NATAB'AL Sil l" \'jT'il YU' 'AM K'UULANi ~tri' B'ANIT M B'ANITAJIK T J'CHIL N Z JUTZE'CHIL " fl~'EB'ANI MACH XJALAN tJ '11 QAB'E! RI QAB'IIM TAJ R s~ ',4B'ElAl K'ULAL SNAB'ILAl· ~l GUATEMA MALA MEMORIA DE {~ At TZ'INIL NA TZ'INll NA'TAS'Al TZ' ii~,~ NAJSA'N TUJ QLO TUJ QLOLJ B'INCHB' ~ NATAB'AL 51LAN NATAB 51 B L SILAN NATAB'AL SIL <; NT'IL YU'AM K'UULANT'IL YU'AM ULANT'IL YU'AM K'UULAN-I · 10 GUATEMALA MEMORIA DEL 51LENCIO GUATEMALA MEMORIA DE GUATEMALA MEMORY OF SILENCE ·,I·.· . -

Luchas Sociales Y Partidos Políticos En Guatemala
LUCHAS SOCIALES Y PARTIDOS POLÍTICOS EN GUATEMALA Sergio Guerra Vilaboy Primera edición, 2016 Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala (ECP) Centro de Estudios Latinoamericanos “Manuel Galich” (CELAT) de la ECP Cátedra “Manuel Galich”, Universidad de La Habana (ULH) ISBN Presentación de la edición guatemalteca Para la Escuela de Ciencia Política (ECP) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), es una gran satisfacción reeditar un libro que, aunque se escribió hace más de treinta años, no ha perdido su vigencia y, además, ahora se actualiza mediante un apéndice que vuelve a poner en evidencia el rigor científico de su autor, el historiador y profesor cubano, Sergio Guerra Vilaboy. A este libro le fue otorgado el Premio Ensayo, de la Universidad de La Habana, en 1983, lo cual expresa la calidad analítica que está en la base del lúcido enfoque que el autor hace de las dinámicas sociales y partidis- tas de nuestra sociedad, cuando recrea momentos decisivos de nuestro proceso conformador como un país que lucha por ser soberano en el marco de la hegemonía y la dominación geopolítica continental de Es- tados Unidos. Para la ECP, publicar una investigación científica como esta en un mo- mento de crisis de Estado (posiblemente la peor de los últimos treinta años) implica contribuir a la generación de un necesario pensamiento crítico que sirva de base para poder ver de nuevo con esperanza hacia el futuro. Nuestra Escuela, por medio de su Centro de Estudios Latinoa- mericanos “Manuel Galich”, reedita este libro necesario con la esperan- za de que, por medio del ejercicio responsable de las ciencias sociales, nuestros estudiantes y profesores desarrollen su criticidad analítica y su organicidad con los intereses de nuestras mayorías. -

Programmatic Political Competition in Latin America: Recognizing the Role Played by Political Parties in Determining the Nature of Party-Voter Linkages
Programmatic Political Competition in Latin America: Recognizing the Role Played by Political Parties in Determining the Nature of Party-Voter Linkages A Dissertation SUBMITTED TO THE FACULTY OF UNIVERSITY OF MINNESOTA BY Kevin Edward Lucas IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY David J. Samuels October 2015 © Kevin Edward Lucas, 2015 Acknowledgements While researching and writing this dissertation, I benefited greatly from the assistance and support of a seemingly endless list of individuals. Although I extend my most sincere gratitude to every single person who in one way or another contributed to my completion of the pages that follow, I do want to single out a few individuals for their help along the way. It is very unlikely that the unexpected development of programmatic party-voter linkages in El Salvador would have made it onto my radar as a potential dissertation topic had the Peace Corps not sent me to that beautiful yet complicated country in June 2001. During the nearly five years I spent living and working in La Laguna, Chalatenango, I had the good fortune of meeting a number of people who were more than willing to share their insights into Salvadoran politics with the resident gringo . There is no question in my mind that my understanding of Salvadoran politics would be far more incomplete, and this dissertation far less interesting, without the education I received from my conversations with Concepción Ayala and family, Señor Godoy, Don Bryan (RIP), Don Salomón Serrano ( QEPD ), and the staff of La Laguna’s Alcaldía Municipal . -

Presidents of Latin American States Since 1900
Presidents of Latin American States since 1900 ARGENTINA IX9X-1904 Gen Julio Argentino Roca Elite co-option (PN) IlJ04-06 Manuel A. Quintana (PN) do. IlJ06-1O Jose Figueroa Alcorta (PN) Vice-President 1910-14 Roque Saenz Pena (PN) Elite co-option 1914--16 Victorino de la Plaza (PN) Vice-President 1916-22 Hipolito Yrigoyen (UCR) Election 1922-28 Marcelo Torcuato de Alv~ar Radical co-option: election (UCR) 1928--30 Hipolito Yrigoyen (UCR) Election 1930-32 Jose Felix Uriburu Military coup 1932-38 Agustin P. Justo (Can) Elite co-option 1938-40 Roberto M. Ortiz (Con) Elite co-option 1940-43 Ramon F. Castillo (Con) Vice-President: acting 1940- 42; then succeeded on resignation of President lune5-71943 Gen. Arturo P. Rawson Military coup 1943-44 Gen. Pedro P. Ramirez Military co-option 1944-46 Gen. Edelmiro J. Farrell Military co-option 1946-55 Col. Juan D. Peron Election 1955 Gen. Eduardo Lonardi Military coup 1955-58 Gen. Pedro Eugenio Military co-option Aramburu 1958--62 Arturo Frondizi (UCR-I) Election 1962--63 Jose Marfa Guido Military coup: President of Senate 1963--66 Dr Arturo IIIia (UCRP) Election 1966-70 Gen. Juan Carlos Onganfa Military coup June 8--14 1970 Adm. Pedro Gnavi Military coup 1970--71 Brig-Gen. Roberto M. Military co-option Levingston Mar22-241971 Junta Military co-option 1971-73 Gen. Alejandro Lanusse Military co-option 1973 Hector Campora (PJ) Election 1973-74 Lt-Gen. Juan D. Peron (PJ) Peronist co-option and election 1974--76 Marfa Estela (Isabel) Martinez Vice-President; death of de Peron (PJ) President Mar24--291976 Junta Military coup 1976-81 Gen. -

Aspectos Doctrinales De Los Tratados
i UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES “ANÁLISIS DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE SUSCRIBE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA” ERICK ROBERTO MOLINA SANDOVAL GUATEMALA, MARZO DE 2018 i ii UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES “ANÁLISIS DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE SUSCRIBE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA” TRABAJO DE GRADUACIÓN PRESENTADO POR: ERICK ROBERTO MOLINA SANDOVAL Previo a optar al Grado Académico de LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES GUATEMALA, MARZO DE 2018 ii iii AUTORIDADES DE LA FACULTAD, ASESOR Y REVISOR DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN DECANO DE LA FACULTAD: LIC. LUIS ANTONIO RUANO CASTILLO SECRETARIO DE LA FACULTAD: LLM. OMAR ABEL MORALES LURSSEN REVISOR: LIC. EVERT OBDULIO BARRIENTOS PADILLA ASESOR: LIC. NERY HUMBERTO BOJORQUEZ GARCÍA iii iv iv v v vi vi vii REGLAMENTO DE TESIS Artículo 9°. RESPONSABILIDAD Solamente el estudiante, asesor y revisor serán los responsables ante terceros, del contenido y desarrollo de los trabajos de graduación, quienes deberán hacer del conocimiento del Decanato cualquier anomalía que se diere en el proceso de su elaboración. vii viii I N D I C E i. Introducción -------------------------------------------------------------------------------------- Pág. C A P I T U L O I L A D I P L O M A C I A 1. Aspectos históricos -------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Durante la colonia --------------------------------------------------------------------------------- -

Gobernantes De Guatemala
GOBERNANTES DE GUATEMALA Notas aclaratorias: 1. Gaínza era el Jefe Político Superior de la Diputación Provisional de Guatemala y al declararse la independencia de Guatemala perma- neció en el poder. 2. Filísola lo sustituyó por ser el enviado de Iturbide cuando Centro América se anexó a México. 3. Molina y Rivera Cabezas son miembros del primer Gobierno Provisional; Valle y Arce del segundo Gobierno Provisional, ambos establecidos por la Asamblea Nacional Constituyente. 4. A partir de Díaz Cabeza de Vaca se inician los Jefes de Estado de Guatemala, que después de 1847 recibieron el títu- Gabino Gaínza Vicente Filísola lo de Presidentes. 15 set. 1821 - 23 junio 1823 23 junio 1822 - 8 julio 1823 Pedro Molina Antonio Rivera Cabezas José Cecilio del Valle Manuel José Arce 10 julio - 4 octubre 1823 octubre 1823 - setiembre 1824 Alejandro Díaz Cabeza de Vaca 8 set - 8 oct. 1824 Mariano Zenteno abril - agosto 1829 Juan Barrundia oct. 1824 - 6 set. 1826 Pedro Molina Cirilo Flores 30 ago. 1829 - 9 mar. 1830 6 - 13 setiembre 1826 Manuel José Arce Mariano Aycinena y Piñol set. 1826 - marzo 1827 1º mar. 1827 - 13 abril 1829 Gregorio Márquez pocos días febrero 1831 Francisco Javier Flores 28 febrero - 28 ago. 1831 Antonio Rivera Cabezas Mariano Gálvez Juan Antonio Martínez 9 mar. 1830 - 10 feb. 1831 28 ago. 1831 - 2 feb. 1835 2 feb. - 25 marzo 1835 52 Mariano Gálvez mayo 1835 - 2 feb. 1838 Pedro José Valenzuela 2 feb. - 28 julio 1838 Mariano Rivera Paz Carlos Salazar Mariano Rivera Paz julio 1838 - 30 enero 1839 30 enero - 12 abril 1839 12 abril 1839 - dic. -

Reforma-Liberal.Pdf
REFORMA LIBERAL La época liberal es un periodo que históricamente abarca desde la revolución liberal hasta la caída del dictador Jorge Ubico. En esta época podemos darnos cuenta la incorporación definitiva de Guatemala al comercio internacional, ya que es precisamente en el siglo XIX, que la economía guatemalteca se inserta definitivamente en el mercado mundial con la exportación del café. La Reforma Liberal de Guatemala fue el resultado del crecimiento y desarrollo de la burguesía revolucionaria: a través de ella se abren paso importantes medidas que tratan de crear un Estado moderno, reviviendo las aspiraciones revolucionarias de Morazán y Gálvez. El triunfo alcanzado por García Granados y Justo Rufino Barrios, hace posible la instauración de un régimen que promueve el desarrollo económico, político y cultural de Guatemala, derribando las barreras establecidas por el gobierno conservador de los 30 años. LIBERALISMO El liberalismo supone que las personas prefieren la abundancia a la pobreza. Está dirigido a mejorar las condiciones materiales de la sociedad. Su propósito es reducir la pobreza y la miseria a través de la libertad. Este sistema social es el que más beneficios ha traído a la humanidad en la historia. Libertad es la ausencia de coerción de individuos sobre individuos, lo que significa que a nadie se le permite recurrir a la fuerza ni al fraude para obligar o inducir a otro a hacer lo que no desea. Un sistema basado en la libertad propicia un mayor desarrollo de los individuos y de su potencial, también propicia la productividad. El liberalismo se fundamenta en los siguientes principios: Respeto a la propiedad individual, gobierno limitado, libertad económica y libertad de conciencia. -

The Politics of Exile in Latin America
This page intentionally left blank The Politics of Exile in Latin America The Politics of Exile in Latin America addresses exile as a major mech- anism of institutional exclusion used by all types of governments in the region against their own citizens, while at the same time these govern- ments often provided asylum to aliens fleeing persecution. The work is the first systematic analysis of Latin American exile on a continental and transnational basis and on a long-term perspective. It traces variations in the saliency of exile among different expelling and receiving countries; across different periods; with different paths of exile, both elite and massive; and under authoritarian and democratic contexts. The project integrates theoretical hindsight and empirical findings, analyzing the importance of exile as a recent and contemporary phe- nomenon, while reaching back to its origins and phases of development. It also addresses presidential exile, the formation of Latin American communities of exiles worldwide, and the role of exiles in shaping the collective identities of these countries. Mario Sznajder holds the Leon Blum Chair in Political Science at the Hebrew University of Jerusalem. He is also Research Fellow at the Truman Research Institute for the Advancement of Peace. Among his works are the books The Birth of Fascist Ideology (with Zeev Stern- hell and Maia Asheri), Constructing Collective Identities and Shaping Public Spheres: Latin American Paths (coedited with Luis Roniger), and The Legacy of Human Rights Violations in the Southern Cone: Argentina, Chile and Uruguay (with Luis Roniger). He has also pub- lished numerous articles on Fascism, democracy, and human rights. -

1 Multinational Corporations and the Politics Of
1 Multinational Corporations and the Politics of Vertical Integration: The Case of the Central American Banana Industry in the Twentieth Century Marcelo Bucheli Assistant Professor of Business History Department of Business Administration College of Business University of Illinois at Urbana-Champaign 350Wohlers Hall 1206 South Sixth Street Champaign, IL 61820 United States of America 1+ (217) 244-0208 E-mail: [email protected] 2 Multinational Corporationsand the Politics of Vertical Integration: The Case of the Central American Banana Industry in the Twentieth Century Abstract I combine the methodologies and theoretical achievements of business history, international business, and political science to study the politics of vertical integration of multinational corporations operating in the primary sector in underdeveloped countries. By doing a long-term study of United Fruit Company’s operations in Central America, I argue that multinationals with an overwhelming political and economic power in the host country are capable of integrating within its structure not only the different stages of the value chain, but also the host country’s polities. The degree of political integration depends on the host country’s dependence on the multinational, the existence of political opposition, the political and economic relations between the home and the host country, and the company’s capability to generate economic stability to the host country. The article studies the conditions that permit the integration of local polities and the conditions that can to the collapse of this integration. Keywords: Banana Industry, Business History, Central America, Multinational Corporations, Political Economy, Vertical Integration 3 INTRODUCTION No issues have generated more dialogue between business historians and management scholars than the study of the development of the multidivisional enterprise and the rise of large vertically integrated enterprises.