La Commission De La Capitale Nationale Et L'île De Hull
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

MISEENGARDE Résultats De Recherches
M I S E E N G A R D E Résultats de recherches Le présent fichier est constitué de pages dactylographiées qui ont été numérisées en janvier 2006. Quoique nous ayons appliqué la reconnaissance de caractères (OCR), les résultats de recherches peuvent être incomplets et variés selon la qualité typographique du texte. LA CITE DE HULL ANNEE 1970 - 1971 MAIRE MARCEL D'AMOUR Quartier Laurier Julien Groulx Quartier Montcalm J. Edmond Bériault Quartier Frontenac J. Alexis Maurice Quartier Tétreau J. René Villeneuve J Quartier Wright Jean-Marie Séguin Quartier Lafontaine Jean-Yves Gougeon Quartier Dollard Fernand Mutchmore Quartier Vanier Gilles Rocheleau GERANT J. Aimé Desjardins, Ing. - XLIII - CANADA Prnvince de Québec HULL Proposé par le Comité Exécutif: District de Hull ET RESOLU que conformément à la re- commandation CE-70-399, faite par le Comité Exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 avril 1970, ce conseil approuve le règlement SEANCE DU 5 MAI 1970 no. 1108 modifiant le règlement 578, concer- nant le zonage en vue de détacher certains lots A une assemblée régulière du conseil de la de la zone RB-14 et de les rattacher à la zone cité de Hull, tenue au lieu ordinaire des séances RH-4. dudit Conseil, à I'Hôtel de Ville de ladite Cité, mardi, le 5 mai 1970, à huit heures de I'après- Suivant les dispositions de l'article 426 du midi, à laquelle sont présents: - chapitre 193 des statuts refondus de Québec 1964, loi des cités et villes, une assemblée M. le président J. Edmond Bériault, au publique des électeurs municipaux propriétaires fauteuil, Son Honneur le Maire Marcel D'A- d'immeubles imposables est convoquée et sera mour et les échevins J. -

Government 95
Government 95 Minister responsible for Energy, Hon. Guy Minister of Cultural Affairs and Minister of Joron Communications, Hon. Louis O'Neill Minister of Consumer Affairs, Co-operatives Minister of Natural Resources and Minister of and Financial Institutions, Hon. Lise Payette Lands and Forests, Hon. Yves Bérubé Minister of Agriculture, Hon. Jean Garon Minister of Industry and Commerce, Hon. Minister of Social Affairs, Hon. Denis Lazure Rodrigue Tremblay Minister of Municipal Affairs, Hon. Guy Tardif Minister of Tourism, Fish and Game, Hon. Minister of Labour and Manpower, Hon. Yves Duhaime Pierre-Marc Johnson Public Service Minister and Vice-Président of Minister of Immigration, Hon. Jacques Couture the Treasury Board, Hon. Denis De Belleval Minister of Public Works and Supply, Hon. Jocelyne Ouellette. Ontario 3.3.1.6 The government of Ontario consists of a lieutenant-governor, an executive council and a Législative Assembly. In April 1974 the Honourable Pauline McGibbon took office as lieutenant-governor. The Législative Assembly is composed of 125 members elected for a statutory term not to exceed five years, At the provincial élection June 9, 1977, 58 Progressive Conservatives, 34 Libérais and 33 New Democrats were elected to the province's 3Ist Législature. In addition to the regular ministries are the following provincial agencies: the Niagara Parks Commission, the Ontario Municipal Board, Ontario Hydro, the St. Lawrence Development Commission, the Ontario Northland Transportation Commis sion, the Liquor Control Board and the Liquor Licence Board. Under the provisions of the Législative Assembly Act (RSO 1970, c.240 as amended) each member of the assembly is paid an annual indemnity of $15,000 and an expense allowance of $7,500. -

C-6 CANADA YEAR BOOK the Hon. Hedard Robichaud, April 22, 1963
C-6 CANADA YEAR BOOK The Hon. Hedard Robichaud, April 22, 1963 The Hon. Leonard Stephen Marchand, The Hon. Roger Teillet, April 22, 1963 September 15, 1976 The Hon. Charies Mills Drury, April 22, 1963 The Hon. John Roberts, September 15, 1976 The Hon. Maurice Sauve, February 3, 1964 The Hon. Monique Begin, September 15, 1976 The Hon. Yvon Dupuis, February 3, 1964 The Hon. Jean-Jacques Blais, September 15, 1976 The Hon. Edgar John Benson, June 29, 1964 The Hon. Francis Fox, September 15, 1976 The Hon. Leo Alphonse Joseph Cadieux, The Hon. Anthony Chisholm Abbott, February 15, 1965 September 15, 1976 The Hon. Lawrence T. Pennell, July 7, 1965 The Hon. lona Campagnolo, September 15, 1976 The Hon. Jean-Luc Pepin, July 7, 1965 The Hon. Joseph-Philippe Guay, November 3, 1976 The Hon. Alan Aylesworth Macnaughton, The Hon. John Henry Horner, April 21, 1977 October 25, 1965 The Hon. Norman A. Cafik, September 16, 1977 The Hon. Jean Marchand, December 18, 1965 The Hon. J. Gilles Lamontagne, January 19, 1978 The Hon. Joseph Julien Jean-Pierre Cote, The Hon. John M. Reid, November 24, 1978 December 18, 1965 The Hon. Pierre De Bane, November 24, 1978 TheRt. Hon. John Napier Turner, December 18, 1965 The Rt. Hon. Charles Joseph (Joe) Clark, June 4, 1979 The Rt. Hon. Pierre Elliott Trudeau, April 4, 1967 The Hon. Flora Isabel MacDonald, June 4, 1979 The Hon. Joseph-Jacques-Jean Chretien, April 4, 1967 The Hon. James A. McGrath, June 4, 1979 The Hon. Pauline Vanier, April II, 1967 The Hon. -

Journal Des Débats
journal des Débats Le jeudi 20 mars 1980 Vol. 21 — No 96 Table des matières Questions orales des députés L'avenir des commissions scolaires 5361 Grève des cols bleus de Montréal 5363 Habitations à loyer modique 5365 Conflit de travail dans les raffineries de l'est de Montréal 5366 Les permis de travail dans la construction 5367 Les centres d'accueil de la région 04 manquent de ressources 5368 Motion non annoncée Membres des commissions scolaires 5369 Question de privilège Article de journal erroné 5369 Mme Jocelyne Ouellette 5369 Recours à l'article 34 M. André Raynauld 5370 Avis à la Chambre 5370 Travaux parlementaires 5371 Motion privilégiée relative à la question devant faire l'objet d'une consultation populaire sur une nouvelle entente avec le Canada Reprise du débat sur la motion principale, les trois motions d'amendement et la motion de sous-amendement 5374 M. Marc-André Bédard 5374 M. Gérard-D. Levesque 5376 M. Rodrigue Biron 5379 M. Patrice Laplante 5380 M. Jean Garon 5380 Mme Solange Chaput-Rolland 5382 M. Guy Chevrette 5383 M. Julien Giasson 5384 Mme Lise Payette 5386 M. John Ciaccia 5387 M. Claude Charron 5388 M. Rodrigue Tremblay 5389 Mme Thérèse Lavoie-Roux 5389 M. Camil Samson 5391 M. Michel Le Moignan 5392 M. Claude Ryan 5395 M. René Lévesque 5398 Mise aux voix de la motion d'amendement de M. Le Moignan 5401 Mise au voix de la motion d'amendement de M. Biron 5402 Mise aux voix de la motion de sous-amendement de M. Tremblay 5402 Mise aux voix de la motion d'amendement de M. -

L'assemblée Nationale Du Québec
PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC DU 5 NOVEMBRE 1980 AU 12 MARS 1981 SIXIÈME SESSION TRENTE ET UNIÈME LÉGISLATURE Président L'HONORABLE CLAUDE VAILLANCOURT TABLE DES MATIÈRES PAGE Proclamations: Convocation de la sixième session de la 31e Législature . V Dissolution de la 31e Législature VII Élections générales IX Résumé des travaux de la session XI Procès-verbaux de l'Assemblée nationale 1 Précis des décisions rendues par le Président 288 Liste des membres du Conseil exécutif et des adjoints parlementaires .. 293 Liste alphabétique des circonscriptions électorales 299 Liste alphabétique des membres de l'Assemblée nationale 303 Index des Procès-verbaux 307 III PROCLAMATIONS (Convocation) [L.S.] Canada Province de JEAN TURGEON Québec ÉLISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi. À nos très aimés et fidèles membres de l'Assemblée nationale du Québec, SALUT: PROCLAMATION ATTENDU QUE, pour diverses considérations, il est à propos de convo- quer la Législature de la province de Québec pour l'expédition des affaires, Nous vous convoquons par les présen- tes pour le cinquième jour de novembre 1980, à quinze heures, et, en consé- quence, vous mandons et ordonnons de vous assembler à cette date, au palais législatif, en la ville de Québec, pour y expédier les affaires de la province et y examiner, discuter et décider les ques- tions qui vous seront soumises. V EN FOI DE QUOI, NOUS VOUS avons fait rendre nos présentes lettres paten- tes et à icelles apposer le grand sceau de la province de Québec. -

Ex LIBRIS UNIVERSITATIS ALBERTENSIS I ¿ T O F Pe, P*J P7l 1777- 7^ Gouvernement Du Québec Public Accounts for the Fiscal Year Ended March 31, 1978
Ex LIBRIS UNIVERSITATIS ALBERTENSIS I ¿ t o f Pe, P*J P7l 1777- 7^ gouvernement du Québec public accounts for the fiscal year ended March 31, 1978 volume 2 details of expenditure Published in accordance with the provisions of section 71 of the Loi de l’administration financière (Financial Administration Act) (1970 Statutes, Chapter 17) Received MAÏ 2? 1575 RECTOR 4 Gouvernement ELLOR du Québec Ministère des Finances ISSN 0706-2850 ISBN 0-7754-3205-9 Legal deposit, 1s' quarter, 1979 Bibliothèque nationale du Québec UNIVERSITY LIERARY UNIVERSITY OF Al BFRTA TABLE OF CONTENTS SECTION LIST OF SUPPLIERS AND BENEFICIARIES 1 LIST OF CAPITAL ASSETS 2 1-1 SECTION LIST OF SUPPLIERS AND BENEFICIARIES For each category of expenditure, except for "Transfer expen With regard to the category "Transfer expenses", the list of ses", the list of suppliers or beneficiaries is issued by department beneficiaries is published, in certain cases, grouped by program according to the following publishing limits and criteria: or by element of program and, in other cases, grouped by department, and this, according to the following limits and crite a) Salaries, wages, allowances and other remuneration: ria: — Ministers, Deputy Ministers and Public Officers of equiva — By electoral district: complete listing; lent rank: complete listing; — By electoral district and beneficiary: complete listing; — Managerial Staff (managers, assistant managers and civil servants of equivalent rank): complete listing; — By beneficiary only: $8 000 and over. — Any allowance: $8 000 -

C005 1987 1 Janvier-Mars
725 L. LJ .. : ,r :'r :,4:' Procès-verbal d'une assembl&lrffi~d~è~.qrr:f~ 1 Communauté régionale de 1'0utabUais, @ridi Maison du Citoyen, 25, rue Laurier, Hull, Québec, 1987, à 13:30 heures, sous la présidence de Messi NO da résolution Président et Gaétan Cousineau, vice-président. ou annotation MM. Pierre Ménard, Président Gaétan Cousineau, vice-président, maire de la ville de Gatineau Louis Simon Joanisse, conseiller de la ville de Gatineau Camilien Vaillancourt, conseiller de la ville de Gatineau Jacques Vézina, conseiller de la ville de Gatineau Mme Constance Provost, maire de la ville dlAylmer MM. André Touchet, conseiller de la ville d9Aylmer, remplaçant du conseiller Marc Robillard Vincent Hendrick, maire de la municipalité de Hull-Ouest Pierre Champagne, maire de la municipalité de l'Ange-Gardien Réginald Scullion, maire de la ville de Buckingham Lucien Bouchard, maire de la ville de Masson Marcel Lavigne, maire de la municipalité de Pontiac Cartier Mignault, conseiller de la ville de Hull Fernard Nadon, conseiller de la ville de Hull, remplaçant du conseiller Raymond Ouimet Lucien Landry, maire de la municipalité de Val-des-Monts SONT ABSENTS: MM. Marc Robillard, conseiller de la ville dlAylmer (motivée) Hervé Leblanc, maire de la municipalité de La Pêche Gérald Brazeau, maire de la municipalité de Notre-Dame-de- la-Salette (motivée) Raymond Ouimet, conseiller de la ville de Hull Michel Légère, maire de la ville de Hull Claude Lemay, conseiller de la ville de Hull Roger Blais, Président-directeur général de la S.A.O. (motivée) ( EST EGALEMENT PRLSENT: M. Léonard Joly, Secrétaire . -

The Cinema of the Quiet Revolution: Quebec‟S Second Wave of Fiction Films and the National Film Board of Canada, 1963-1967
The Cinema of the Quiet Revolution: Quebec‟s Second Wave of Fiction Films and the National Film Board of Canada, 1963-1967 Eric Fillion A Thesis in The Department of History Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts (History) at Concordia University Montreal, Quebec, Canada March 2012 © Eric Fillion, 2012 CONCORDIA UNIVERSITY School of Graduate Studies This is to certify that the thesis prepared By: Eric Fillion Entitled: The Cinema of the Quiet Revolution: Quebec‟s Second Wave of Fiction Films and the National Film Board of Canada, 1963-1967 and submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts (History) complies with the regulations of the University and meets the accepted standards with respect to originality and quality. Signed by the final Examining Committee: ___________________________________ Chair Dr. Barbara Lorenzkowski ___________________________________ Examiner Dr. Graham Carr ___________________________________ Examiner Dr. Nora Jaffary ___________________________________ Supervisor Dr. Ronald Rudin Approved by: ___________________________________ Dr. Norman Ingram Chair of Department _____________ 2012 ___________________________________ Dean of Faculty iii ABSTRACT The Cinema of the Quiet Revolution: Quebec‟s Second Wave of Fiction Films and the National Film Board of Canada, 1963-1967 Eric Fillion Film historians situate the birth of le cinéma québécois in the late 1950s with the emergence – within the National Film Board of Canada (NFB) – of an Équipe française whose Direct Cinema revolutionized documentary filmmaking. The grand narrative of Quebec national cinema emphasises the emancipating qualities of this cinematographic language and insists that it contributed to a collective prise de parole and Quebec‟s ascension to modernity. -
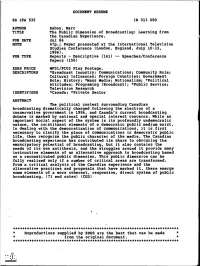
The Public Dimension of Broadcasting: Learning from the Canadian Experience
DOCUMENT RESUME ED 294 535 IR 013 080 AUTHOR Raboy, Marc TITLE The Public Dimension of Broadcasting: Learning from the Canadian Experience. PUB DATE Jul 86 NOTE 47p.; Paper presented at the International Television Studies Conference (London, England, July 10-12, 1986). PUB TYPE Reports - Descriptive (141) -- Speeches/Conference Papers (150) EDRS PRICE MF01/PCO2 Plus Postage. DESCRIPTORS *Broadcast Industry; Communications; Community Role; Cultural Influences; Foreign Countries; Government Role; History; *Mass Media; Nationalism; *Political Attitudes; Programing (Broadcast); *Public Service; Television Research IDENTIFIERS *Canada; *Private Sector ABSTRACT The political context surrounding Canadian broadcasting dramatically changed following the election of a conservative government in 1984, and Canada's current broadcasting debate is marked by national and special interest concerns. While an important social aspect of the system is its profoundly undemocratic nature, the constituent elements of a democratic public medium exist. In dealing with the democratization of communications, it is first necessary to clarify the place of communications in democratic public life, then recognize the public character of the media. The Canadian broadcasting experience has contributed its share to obscuring the emancipatory potential of broadcasting, but it also contains the seeds of its own antithesis, and the struggles around it provide many instructive elements of an alternative approach to broadcasting based on a reconstituted public dimension. This public dimension can be fully realized only if a number of critical areas are transformed. From a critical analysis of the Canadian experience and the alternative practices and proposals that have marked it, there emerge some elements of a more coherent, responsive, direct system of public broadcasting. -

Canadian Churches Against Apartheid
In Good Faith: Canadian Churches Against Apartheid http://www.aluka.org/action/showMetadata?doi=10.5555/AL.SFF.DOCUMENT.canp1b10040 Use of the Aluka digital library is subject to Aluka’s Terms and Conditions, available at http://www.aluka.org/page/about/termsConditions.jsp. By using Aluka, you agree that you have read and will abide by the Terms and Conditions. Among other things, the Terms and Conditions provide that the content in the Aluka digital library is only for personal, non-commercial use by authorized users of Aluka in connection with research, scholarship, and education. The content in the Aluka digital library is subject to copyright, with the exception of certain governmental works and very old materials that may be in the public domain under applicable law. Permission must be sought from Aluka and/or the applicable copyright holder in connection with any duplication or distribution of these materials where required by applicable law. Aluka is a not-for-profit initiative dedicated to creating and preserving a digital archive of materials about and from the developing world. For more information about Aluka, please see http://www.aluka.org In Good Faith: Canadian Churches Against Apartheid Author/Creator Pratt, Renate Contributor Tutu, Archbishop Desmond M. (preface), Hutchinson, Roger (foreword) Publisher Wilfrid Laurier University Press, Canadian Corporation for Studies in Religion Date 1997 Resource type Books Language English Subject Coverage (spatial) Canada, South Africa Coverage (temporal) 1975-1990 Source ES Reddy Rights By kind permission of Renate Pratt and Wilfred Laurier University Press. Description Part one, 1975-80: Prelude to action - 1. -

Radio-Canada and Quebec Society 1952 - 1960
Elemen ts for a Social His tory of Te levision: Radio-Canada and Quebec Society 1952 - 1960 hy André Michel Couture A Thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts. Department of History McGill University, Montreal July 1989 (c) André Michel Couture J Abbrevjated Title A Social History of Televisionl Radio-Canada Rnd Quebee 1952-1960 ( ABSTRACT An examination of claims that te1evision "caused" Quebec' s Quiet Revolution leads to the formulation of a method to study the social history of television. The relationship between television and society is found in the dynamics of the social institution of te1evision. Radio- Canada' s role in 1950s Quebec was as a tribune and a forum for the new petite bourgeoisie. The dynamics of the production of the programme Les Idées en Marche, a colloborative effort of Radio-Canada and Institut Canadien d'Education des Adultes (ICEA), reveals how it was a tribune. Radio-Canada's role as a forum is shown through the professionalization of te1evision p.coduction dernonstrated by the 1958 te1evision news and the 1959 Radio-Canada producers' strike. It is shown that te1evision in 1950s was used by Quebec's new elite for its own ends and that those in political power came to rea1ize the new medium's significance. The dynamics of this social institution of te1evision reflect a society soon to be born. 1 RESUME Une ana lyse de l' hypothèse suivant laquelle la télévision est la "cause" de la Révolution Tranquille nous mène à une méthode d'étude de l'histoire sociale de la télévision. -

Rt. Hon. John Turner Mg 26 Q 1 Northern Affairs Series 3
Canadian Archives Direction des archives Branch canadiennes RT. HON. JOHN TURNER MG 26 Q Finding Aid No. 2018 / Instrument de recherche no 2018 Prepared in 2001 by the staff of the Préparé en 2001 par le personnel de la Political Archives Section Section des archives politique. -ii- TABLE OF CONTENT NORTHERN AFFAIRS SERIES ( MG 26 Q 1)......................................1 TRANSPORT SERIES ( MG 26 Q 2) .............................................7 CONSUMER AND CORPORATE AFFAIRS SERIES (MG 26 Q 3) ....................8 Registrar General.....................................................8 Consumer and Corporate Affairs.........................................8 JUSTICE SERIES (MG 26 Q 4)................................................12 FINANCE SERIES (MG 26 Q 5) ...............................................21 PMO SERIES ( MG 26 Q 6)....................................................34 PMO Correspondence - Sub-Series (Q 6-1) ...............................34 Computer Indexes (Q 6-1).............................................36 PMO Subject Files Sub-Series (Q 6-2) ...................................39 Briefing Books - Sub-Series (Q 6-3) .....................................41 LEADER OF THE OPPOSITION SERIES (MG 26 Q 7)..............................42 Correspondence Sub-Series (Q 7-1) .....................................42 1985-1986 (Q 7-1) ...................................................44 1986-1987 (Q 7-1) ...................................................48 Subject Files Sub-Series (Q 7-2)........................................73