Picaper Ces Nazis Qui Ont Echappe a La Corde.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Grubbing out the Führerbunker: Ruination, Demolition and Berlin's Difficult Subterranean Heritage
Grubbing out the Führerbunker: Ruination, demolition and Berlin’s difficult subterranean heritage BENNETT, Luke <http://orcid.org/0000-0001-6416-3755> Available from Sheffield Hallam University Research Archive (SHURA) at: http://shura.shu.ac.uk/24085/ This document is the author deposited version. You are advised to consult the publisher's version if you wish to cite from it. Published version BENNETT, Luke (2019). Grubbing out the Führerbunker: Ruination, demolition and Berlin’s difficult subterranean heritage. Geographia Polonica, 92 (1). Copyright and re-use policy See http://shura.shu.ac.uk/information.html Sheffield Hallam University Research Archive http://shura.shu.ac.uk Grubbing out the Führerbunker: Ruination, demolition and Berlin’s difficult subterranean heritage Luke Bennett Reader in Space, Place & Law, Department of the Natural & Built Environment, Sheffield Hallam University, Norfolk 306, Howard St, Sheffield, S1 1WB, United Kingdom. [email protected] Abstract This article presents a case study examining the slow-death of the Berlin Führerbunker since 1945. Its seventy year longitudinal perspective shows how processes of ruination, demolition and urban renewal in central Berlin have been affected by materially and politically awkward relict Nazi subterranean structures. Despite now being a buried pile of rubble, the Führerbunker’s continued resonance is shown to be the product of a heterogeneous range of influences, spanning wartime concrete bunkers’ formidable material resistance, their affective affordances and evolving cultural attitudes towards ruins, demolition, memory, memorialisation, tourism and real estate in the German capital. Keywords Ruin – Demolition – Bunkers – Subterranean – Berlin – Nazism – Heritage – Materiality 1 On 30th April 1945 Adolf Hitler committed suicide in the Führerbunker, a reinforced concrete structure buried 8.5 metres beneath the ministerial gardens flanking the Reich Chancellery in central Berlin. -

Der Letzte Befehl.Pdf
Über den Autor: Armin D. Lehmann, geboren 1928 bei München, wohnte bis 1943 mit seiner Familie in Breslau. Nach dem Krieg arbeitete er zunächst als freier Journalist für Zeitungen in Süddeutschland, bevor er 1953 in die USA auswanderte. Dort war er bis zu seiner Pensionierung in der Tourismusbranche tätig. Seine Erfahrungen in Nazi-Deutschland und seine Begegnungen mit Menschen aller Kontinente haben Armin D. Lehmann zum überzeugten Pazifisten gemacht. ARMIN D. LEHMANN DER LETZTE BEFEHL Als Hitlers Botenjunge im Führerbunker Aus dem Englischen von Bernd Rullkötter unter Mitarbeit des Autors BASTEI LÜBBE TASCHENBUCH Band 61568 1. Auflage: Mai 2005 Vollständige, korrigierte Taschenbuchausgabe der im Gustav Lübbe Verlag erschienenen Hardcoverausgabe Bastei Lübbe Taschenbücher und Gustav Lübbe Verlag in der Verlagsgruppe Lübbe Titel der Originalausgabe: Hitlers Last Courier: A Life in Transition Copyright © 2000 by Armin D. Lehmann Published by arrangement with Xlibris Corporation, Philadelphia, USA Copyright © 2003 für die deutschsprachige Ausgabe by Verlagsgruppe Lübbe GmbH &. Co. KG, Bergisch Gladbach Textredaktion: Dr. Anita Krätzer, München Strichzeichnungen im Text: Reinhard Borner, Hückeswagen Register: Barbara Lauer, Bonn Die Anhänge B und C wurden mit freundlicher Genehmigung von Dr. Michael Buddrus entnommen aus: Michael Buddrus, Totale Erziehung für den totalen Krieg. Hitlerjugend und nationalsozialistische Jugendpolitik, 2 Teile, München: K. G. Saur 2003 (© K. G. Saur) Umschlaggestaltung: HildenDesign, München (www.hildendesign.de) Umschlagmotive: Corbis, Düsseldorf Satz: Bosbach Kommunikation & Design GmbH, Köln Druck und Verarbeitung: Ebner & Spiegel GmbH, Ulm Printed in Germany ISBN 3-404-61568-9 Eingescannt mit OCR-Software ABBYY Fine Reader Sie finden uns im Internet unter www.luebbe.de Der Preis dieses Bandes versteht sich einschliesslich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. -

Military History Anniversaries 1 Thru 15 May
Military History Anniversaries 1 thru 15 May Events in History over the next 15 day period that had U.S. military involvement or impacted in some way on U.S military operations or American interests May 01 1778 – American Revolution: The Battle of Crooked Billet begins in Hatboro, Pennsylvania » On 1 JAN John Lacey was appointed brigadier-general and given command of a large body of militia with the aim of interrupting British supply lines, especially those reaching Philadelphia. Crooked Billet was the Headquarters of Lacey, and became the target of the British commander in Philadelphia, Gen. William Howe. Lacey had been charged with patrolling the area north of Philadelphia, between the Delaware and Schuylkill Rivers, with responsibility for warning Valley Forge of attacks, checking British foraging raids, and preventing local trade with the British. Most of the enlistments of the few troops he had were due to expire shortly. Promised, and desperately needed, reinforcements were slow arriving or simply not coming. The British dispatched a joint force of British troops and Hessians on 30 APR and they surprised the American forces whose commander was still in bed. The British had surprised the Americans and attempted to cut them off with a "pincer" type movement. Bands of Loyalists and British horsemen grew increasingly bold, and their raids into Lacey's sector were becoming more frequent. On 1 MAY, during the morning, Lacey found his camp near the Crooked Billet Tavern virtually surrounded by the British. Though outnumbered, Lacey rallied his troops during the initial attack and was able to withdraw to a nearby wooded area and make a stand. -

Skruger2006.Pdf (1.625Mb)
Die letzten Tage Adolf Hitlers --- Eine Darstellung für das 21. Jahrhundert in Oliver HIRSCHBIEGEL s Der Untergang by Stefanie Krüger A thesis presented to the University of Waterloo in fulfillment of the thesis requirement for the degree of Master of Arts in German Waterloo, Ontario, Canada, 2006 © Stefanie Krüger 2006 Author’s declaration for electronic submission of a thesis I hereby declare that I am the sole author of this thesis. This is a true copy of the thesis, including any required final revisions, as accepted by my examiners. I understand that my thesis may be made electronically available to the public. iii Abstract The film Der Untergang (2004), directed by Oliver HIRSCHBIEGEL and written and produced by Bernd EICHINGER , is based on Joachim FEST ’s historical monograph Der Untergang (2002) and Traudl JUNGE ’s and Melissa MÜLLER ’s Bis zur letzten Stunde (2003). Taking place in April, 1945, the movie depicts the last days of Adolf Hitler and his staff in the ‘Führerbunker’. The appearance of the film sparked wide-spread controversy concerning the propriety of Germans illuminating this most controversial aspect of their history. Specifically, the debate centred on the historical accuracy of the film and the dangers associated with the filmmakers’ goal of portraying Hitler not as a caricature or one-sided figure but rather as a complete human being whose troubles and human qualities might well earn the sympathy of the viewers. After surveying a variety of films that portray Adolf Hitler, the thesis analyses Der Untergang by focusing first on the cinematic and narrative aspects of the film itself and then on the figure of Hitler. -

Joseph Goebbels 1 Joseph Goebbels
Joseph Goebbels 1 Joseph Goebbels Joseph Goebbels Reich propaganda minister Goebbels Chancellor of Germany In office 30 April 1945 – 1 May 1945 President Karl Dönitz Preceded by Adolf Hitler Succeeded by Lutz Graf Schwerin von Krosigk (acting) Minister of Public Enlightenment and Propaganda In office 13 March 1933 – 30 April 1945 Chancellor Adolf Hitler Preceded by Office created Succeeded by Werner Naumann Gauleiter of Berlin In office 9 November 1926 – 1 May 1945 Appointed by Adolf Hitler Preceded by Ernst Schlange Succeeded by None Reichsleiter In office 1933–1945 Appointed by Adolf Hitler Preceded by Office created Succeeded by None Personal details Born Paul Joseph Goebbels 29 October 1897 Rheydt, Prussia, Germany Joseph Goebbels 2 Died 1 May 1945 (aged 47) Berlin, Germany Political party National Socialist German Workers' Party (NSDAP) Spouse(s) Magda Ritschel Children 6 Alma mater University of Bonn University of Würzburg University of Freiburg University of Heidelberg Occupation Politician Cabinet Hitler Cabinet Signature [1] Paul Joseph Goebbels (German: [ˈɡœbəls] ( ); 29 October 1897 – 1 May 1945) was a German politician and Reich Minister of Propaganda in Nazi Germany from 1933 to 1945. As one of Adolf Hitler's closest associates and most devout followers, he was known for his zealous orations and deep and virulent antisemitism, which led him to support the extermination of the Jews and to be one of the mentors of the Final Solution. Goebbels earned a PhD from Heidelberg University in 1921, writing his doctoral thesis on 19th century literature of the romantic school; he then went on to work as a journalist and later a bank clerk and caller on the stock exchange. -
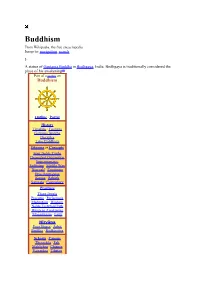
Buddhism from Wikipedia, the Free Encyclopedia Jump To: Navigation, Search
Buddhism From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search A statue of Gautama Buddha in Bodhgaya, India. Bodhgaya is traditionally considered the place of his awakening[1] Part of a series on Buddhism Outline · Portal History Timeline · Councils Gautama Buddha Disciples Later Buddhists Dharma or Concepts Four Noble Truths Dependent Origination Impermanence Suffering · Middle Way Non-self · Emptiness Five Aggregates Karma · Rebirth Samsara · Cosmology Practices Three Jewels Precepts · Perfections Meditation · Wisdom Noble Eightfold Path Wings to Awakening Monasticism · Laity Nirvāṇa Four Stages · Arhat Buddha · Bodhisattva Schools · Canons Theravāda · Pali Mahāyāna · Chinese Vajrayāna · Tibetan Countries and Regions Related topics Comparative studies Cultural elements Criticism v • d • e Buddhism (Pali/Sanskrit: बौद धमर Buddh Dharma) is a religion and philosophy encompassing a variety of traditions, beliefs and practices, largely based on teachings attributed to Siddhartha Gautama, commonly known as the Buddha (Pāli/Sanskrit "the awakened one"). The Buddha lived and taught in the northeastern Indian subcontinent some time between the 6th and 4th centuries BCE.[2] He is recognized by adherents as an awakened teacher who shared his insights to help sentient beings end suffering (or dukkha), achieve nirvana, and escape what is seen as a cycle of suffering and rebirth. Two major branches of Buddhism are recognized: Theravada ("The School of the Elders") and Mahayana ("The Great Vehicle"). Theravada—the oldest surviving branch—has a widespread following in Sri Lanka and Southeast Asia, and Mahayana is found throughout East Asia and includes the traditions of Pure Land, Zen, Nichiren Buddhism, Tibetan Buddhism, Shingon, Tendai and Shinnyo-en. In some classifications Vajrayana, a subcategory of Mahayana, is recognized as a third branch. -

Ullrich Otto Giorni a Maggio 11153-2.Indd
Storie / Feltrinelli VOLKER ULLRICH 1945. Otto giorni a maggio Dalla morte di Hitler alla fine del Terzo Reich Traduzione di Marina Pugliano, Elena Sciarra, Valentina Tortelli Titolo dell’opera originale ACHT TAGE IM MAI Die letzte Woche des Dritten Reiches © Verlag C.H. Beck oHG, München 2020 Traduzione dal tedesco di MARINA PUGLIANO, ELENA SCIARRA, VALENTINA TORTELLI © Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano Prima edizione in “Storie” maggio 2020 Stampa Grafica Veneta S.p.A. di Trebaseleghe - PD ISBN 978-88-07-11153-2 www.feltrinellieditore.it Libri in uscita, interviste, reading, commenti e percorsi di lettura. Aggiornamenti quotidiani razzismobruttastoria.net 1945. Otto giorni a maggio Premessa Il 7 maggio 1945 lo scrittore Erich Kästner annotava sul suo diario: “La gente si muove confusa per le strade. La breve pausa nella lezione di storia li rende nervosi. Il vuoto tra il non più e il non ancora li irrita”.1 Questo libro affron- ta proprio la fase compresa tra il “non più” e il “non anco- ra”. Il vecchio ordine era ormai crollato: alla tirannia na- zionalsocialista stava per subentrare un nuovo ordine dettato dalle potenze occupanti, che però non si era ancora instaurato. Per molti contemporanei le giornate fra la mor- te di Hitler, il 30 aprile, e la resa incondizionata della Ger- mania, il 7-8 maggio, costituirono una cesura biografica profonda, la tanto citata “ora zero”,2 in cui il tempo parve letteralmente fermarsi. “È così strano vivere senza giorna- li, senza calendario, senza ora esatta, senza l’ultimo del mese,” annotava una berlinese il 7 maggio. “Un tempo sen- za tempo, che scorre via come l’acqua, le cui lancette sono per noi unicamente gli uomini con le loro uniformi.”3 La sensazione di vivere in una specie di “tempo di nessuno” conferì a quei primi giorni del maggio 1945 la loro impron- ta peculiare.4 Furono giorni, dopotutto, anche di intensa drammati- cità. -
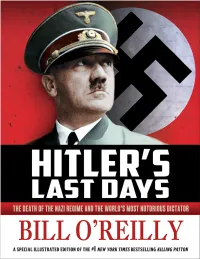
Hitlers-Last-Days-By-Bill-Oreilly-Excerpt
207-60729_ch00_6P.indd ii 7/7/15 8:42 AM Henry Holt and Com pany, LLC Publishers since 1866 175 Fifth Ave nue, New York, New York 10010 macteenbooks . com Henry Holt® is a registered trademark of Henry Holt and Com pany, LLC. Copyright © 2015 by Bill O’Reilly All rights reserved. Permission to use the following images is gratefully acknowledged (additional credits are noted with captions): Mary Evans Picture Library— endpapers, pp. ii, v, vi, 35, 135, 248, 251; Bridgeman Art Library— endpapers, p. iii; Heinrich Hoffman/Getty— p. 1. All maps by Gene Thorp. Case design by Meredith Pratt. Library of Congress Cataloging- in- Publication Data O’Reilly, Bill. Hitler’s last days : the death of the Nazi regime and the world’s most notorious dictator / Bill O’Reilly. — First edition. pages cm Includes bibliographical references and index. ISBN 978-1-62779-396-4 (hardcover) • ISBN 978-1-62779-397-1 (e- book) 1. Hitler, Adolf, 1889–1945. 2. Hitler, Adolf, 1889–1945— Death and burial. 3. World War, 1939–1945— Campaigns— Germany. 4. Berlin, Battle of, Berlin, Germany, 1945. 5. Heads of state— Germany— Biography. 6. Dictators— Germany— Biography. I. O’Reilly, Bill. Killing Patton. II. Title. DD247.H5O735 2015 943.086092— dc23 2015000562 Henry Holt books may be purchased for business or promotional use. For information on bulk purchases, please contact the Macmillan Corporate and Premium Sales Department at (800) 221-7945 x5442 or by e-mail at specialmarkets@macmillan . com. First edition—2015 / Designed by Meredith Pratt Based on the book Killing Patton by Bill O’Reilly, published by Henry Holt and Com pany, LLC. -

The Itinerary
HARALD SANDNER HITLER THE ITINERARY Whereabouts and Travels from 1889 to 1945 VOLUME I 1889–1927 Introduction Where exactly did Hitler reside from the time of his birth on 20 April 1889 in the Austrian village of Braunau am Inn, then part of Austria-Hungary, until his suicide on 30 April 1945 in Berlin at a time when the Third Reich was almost entirely occupied? This book is a nearly exhaustive account of the German dictator’s movements, and it answers this question. It !rst o"ers a summary of all the places he lived and stayed in, as well as his travel details, in- cluding information about the modes of transport. It then puts this data in its political, military and personal/private context. Additional information relating to the type of transportation used, Hitler’s physical remains and the destruction he left behind are also included. Biographies on Hitler have researched sources dating back to the period between 1889 and 1918. Such biographers – especially in more recent times – were able to as- sess new material and correct the mistakes made by other authors in the past. Prominent examples include Anton Joachimsthaler (1989, 2000, 2003, 2004) and Brigitte Hamann (2002, 2008) ades of Hitler’s life. Hitler became politically active in 1919. Sources from the early years are scarce and relatively neutral. However, soon after that, the tone of the sources is in#uenced heav- ily by the political attitudes of contemporary journalism. Objective information waned, and reports were either glori!ed or highly disapproving. References to travel, the means of transport used, etc do exist to some degree, but are often also contradictory. -

Download the Reich Chancellery and Fuhrerbunker Complex: An
THE REICH CHANCELLERY AND FUHRERBUNKER COMPLEX: AN ILLUSTRATED HISTORY OF THE SEAT OF THE NAZI REGIME DOWNLOAD FREE BOOK Steven Lehrer | 214 pages | 18 Apr 2014 | McFarland & Co Inc | 9780786477333 | English | Jefferson, NC, United States Main Navigation The Besseringen B-Werk is the only completely preserved fortification bunker located in the Siegfried Line; a kilometer The Reich Chancellery and Fuhrerbunker Complex: An Illustrated History of the Seat of the Nazi Regime system built between 19 and featured more than 18, bunkers, tunnels and tank traps. The third breakout attempt from the Reich Chancellery was made around on 2 May, and Bormann managed to cross the Spree. Pickup not available. First edition. A little more than twenty years later, in autumnhe directed his dynamic forces against the Soviet Union, and in December, the Germans were at the gates of Moscow and Leningrad. Pricing policy About our prices. Berlin: Berlin Story Verlag. The elaborate underground concrete bunker complex was designed to be a temporary air-raid shelter for Hitler, his family and his guards. Five plates of architectural drawings and floor plans including one large folded concludes the "Baukunst" section. Other parts of the Chancellery underground complex were uncovered, but these were ignored, filled in, or resealed. The Race for Paradise Paul M. Eric Chaim Kline, Bookseller. Photography and Cinema, David F. Academic Skip to main content. Increased bombing of Berlin led to expansion of the complex as an improvised permanent shelter. At age thirty inAdolf Hitler had no accomplishments. Ramsey, Winston ed. Inside the Third Reich. This is a thoughtful and well-balanced read on a complex subject. -

La Chute, Chef D'œuvre Nécessaire Ou Choquante
La Chute, chef d’œuvre nécessaire ou choquante réhabilitation ? Un article d’Histony sur Veni Vidi Sensi La Chute, chef d’œuvre nécessaire ou choquante réhabilitation ? Aujourd’hui, tout le monde connaît La Chute et la légendaire prestation de Bruno Ganz en Hitler. Pas forcément pour le film lui-même, certes ; mais plusieurs des scènes de grande colère du dictateur ont été maintes fois détournées à coups de sous-titres, lui permettant de s’indigner des problèmes de stationnement dans les rues de Tel-Aviv, de rencontrer Jacquouille la Fripouille, ou encore, récemment, de s’emporter contre les Enfoirés pour leur chanson Toute la vie. Désormais entrées dans la culture collective, au point que l’acteur lui-même reconnaît en interview trouver cette créativité positive, ces parodies avaient pourtant fait scandale et poussé les producteurs à tout faire pour les faire supprimer. Le personnage d’Adolf Hitler reste en effet un sujet sensible, et s’il peut être cathartique de lui faire dire n’importe quoi, certains continuent à serrer les dents en jugeant qu’il est des sujets sur lesquels on ne peut pas rire. Mais bien avant les parodies, à sa sortie, La Chute faisait polémique sur des questions bien plus sérieuses. Fallait-il représenter Hitler ainsi ? Le film n’humaniserait-il pas ainsi le Mal ? Tout cela pose un grand nombre de questions auxquelles je vais essayer de répondre. Hitler rendu sympathique : salutaire ou odieux ? J’étais en seconde lorsque La Chute est sorti, et je me souviens des scandales provoqués par le simple fait de la diffusion de l’affiche du film dans les rues : le retour du dictateur sur les murs des villes françaises n’était en effet pas du goût de tous. -

Himmlers Cook Free
FREE HIMMLERS COOK PDF Franz-Olivier Giesbert | 352 pages | 04 Jun 2015 | ATLANTIC BOOKS | 9781782394129 | English | London, United Kingdom Himmler's Cook by Franz-Olivier Giesbert, Paperback | Barnes & Noble® Founded Himmlers Cook Skip to content. Quick links. At Wolfsschanze he prepared meals daily. Manziarly was a dietician-cook for Hitler's special diets. She was the successor to dietician-cook Frau von Exner, dismissed at the time of the Wolfsschanze reconstruction in when it was discovered that she was one-quarter Jewish. Martin Bormann was given order to "arianize" her family line and Frau von Exner survived the war. From which source do you Himmlers Cook it? I would appreciate any further informations like personal dates and details. You do not have the Himmlers Cook permissions to view the files attached to this post. See "Women in the Reich" for my entry for Constanze Manziarly today. Cooked at FHQ "Wolfsschanze". His boss was Kannenberg. No further information known. Helene Maria von Exner b. Came from Viennese medical family. After Real gymnasium trained at Vienne University as dietician-cook. She was recommended by Antonescu to Hitler, who employed her from Martin Bormann was ordered to Himmlers Cook her lineage. This was easier to do in Austria than Germany and involved switching old birth certificates. Georg Winter 1. She discovered the body of Geli Raubal Died Source does not mention 14 or 7. Hitler's half-sister by his father. From 3. Christa Schroeder said that Angela Raubal was an excellent cook, particularly for her apple pies. When Hitler bought the house on She left the Obersalzberg She had no further relationship with Hitler except to celebrate his birthdays in Berlin, although in April she travelled to Berchtesgaden where Schaub made her a present ofReichsmarks Himmlers Cook Hitler which she managed to keep secret from the Allies.