Jean-Marie Ançay 0
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
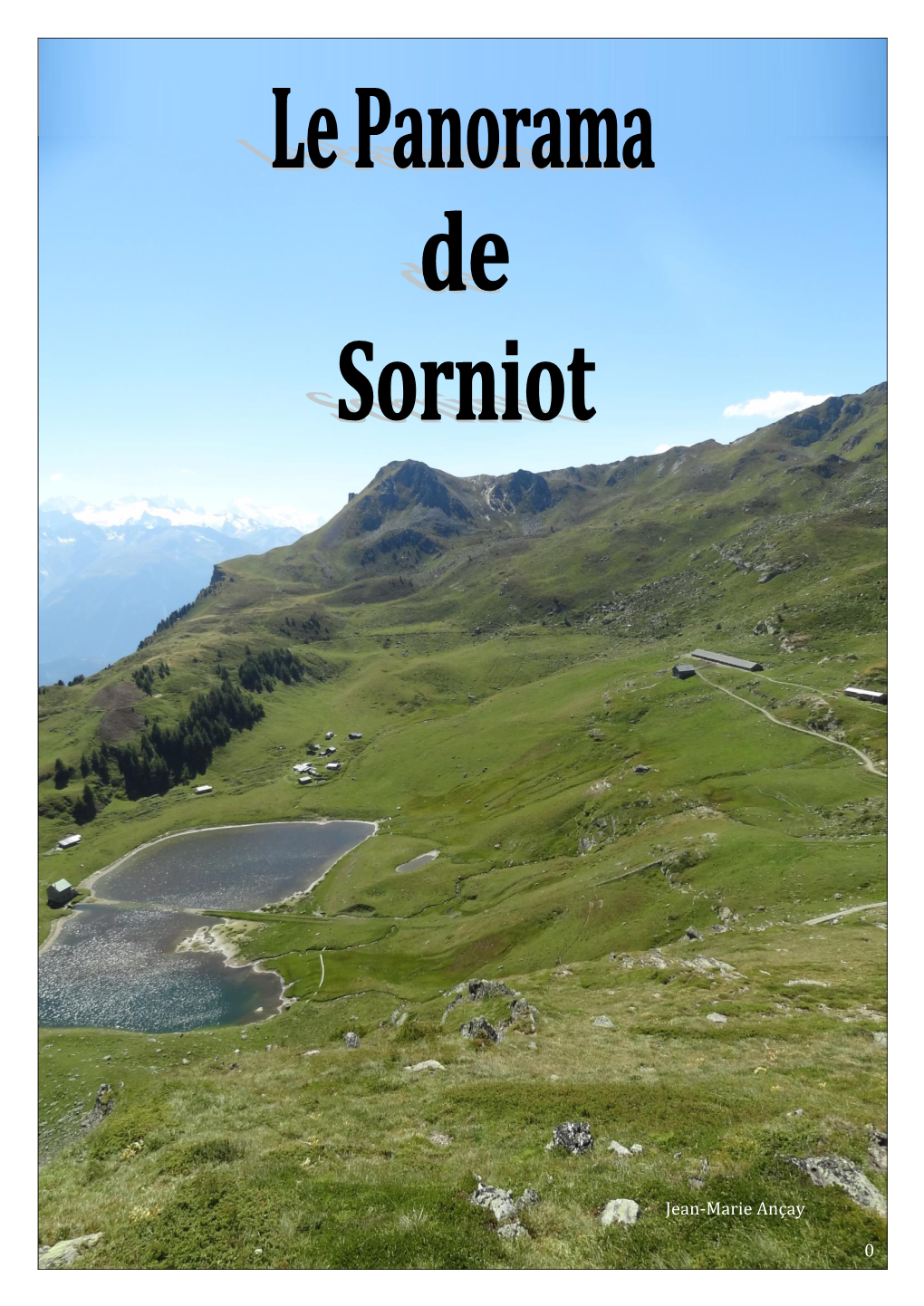
Load more
Recommended publications
-

Kolonialität Und Geschlecht Im 20. Jahrhundert
Patricia Purtschert Kolonialität und Geschlecht im 20. Jahrhundert Postcolonial Studies | Band 33 Patricia Purtschert ist Philosophin und Kulturwissenschaftlerin sowie Co-Lei- terin des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung an der Uni- versität Bern. Patricia Purtschert Kolonialität und Geschlecht im 20. Jahrhundert Eine Geschichte der weißen Schweiz Publiziert mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förde- rung der wissenschaftlichen Forschung Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deut- schen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution-NonCommerci- al-NoDerivs 4.0 Lizenz (BY-NC-ND). Diese Lizenz erlaubt die private Nutzung, gestat- tet aber keine Bearbeitung und keine kommerzielle Nutzung. Weitere Informationen finden Sie unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de Um Genehmigungen für Adaptionen, Übersetzungen, Derivate oder Wiederverwen- dung zu kommerziellen Zwecken einzuholen, wenden Sie sich bitte an rights@tran- script-verlag.de Die Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz gelten nur für Originalmaterial. Die Wiederverwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet mit Quellen- angabe) wie z.B. Schaubilder, Abbildungen, Fotos und Textauszüge erfordert ggf. wei- tere Nutzungsgenehmigungen durch den jeweiligen Rechteinhaber. © 2019 transcript Verlag, Bielefeld Umschlaggestaltung: Maria Arndt, Bielefeld Umschlagabbildung: Bild 1: Werbung für Lux-Seife (Ausschnitt), Quelle: Schweizer Illustrierte Zeitung 1932(7); Bild 2: Bergsteiger Peter Diener, Quelle: Titelbild Schweizer Illustrierte Zeitung 1960(26) Lektorat: Petra Schäfter, textetage Satz: Justine Buri, Bielefeld Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar Print-ISBN 978-3-8376-4410-4 PDF-ISBN 978-3-8394-4410-8 https://doi.org/10.14361/9783839444108 Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff. -

Wołanie 29-2001 Listopad
2 SPIS TREŒCI: 1. Historia alpinizmu czêœæ druga str. 3 Jerzy Hajdukiewicz 2. Spotkanie na szczycie str. 23 Andrzej Waligórski 3. Pusto w górach str. 25 Juliusz Wys³ouch 4. Górami pisane str. 28 Kazimierz Przerwa - Tetmajer Od maja 1987 roku ukaza³o siê 29 zeszytów Wo³ania Opracowanie: Polskie Towarzystwo Tatrzañskie, Oddzia³ Kraków, Cz³onek Wspieraj¹cy TOPR. Adres dla korespondencji: Andrzej S³ota, 30-150 Kraków, Armii Krajowej 83/131. Telefony: 012 638-01-54, e-mail: [email protected] Lokal: Dom Kultury „Podgórze” ul. Krasickiego 18/20. Dy¿ury Towarzystwa odbywaj¹ siê co dwa tygodnie we wtorki, w godzinach 18 - 19.30 Redaktor: Andrzej S³ota, zespó³ redakcyjny: Barbara Morawska-Nowak, Maciej Mischke. Wp³aty na rzecz Towarzystwa mog¹ byæ dokonywane na rachunek: PTT, Zarz¹d G³ówny, PKO I/O Kraków, nr. 10202892-162809-270-1-111 WO£ANIE PTT, Zarz¹d G³ówny, PKO I/O Kraków, nr. 10202892-162942-270-1-111 Emblemat na ok³adce rysowa³a Zofia Nowak Nr. 25 (29) Sk³ad komputerowy: Andrzej S³ota PL ISSN 0660-8679 Kraków, listopad 2001 Do druku oddano: 28 listopada 2001 3 4 WO£ANIE (Bernina); pierwsz¹ drogê na wschodniej œcianie Mont Blanc otwieraj¹ Moore, Walker i G. S. Matthews z M. i J. Andereggami Magazyn dla cz³onków Polskiego Towarzystwa przechodz¹c ostrogê Brenva, a w niczym nie ustêpuj¹ tym czynom Tatrzañskiego dwa œwietne zwyciêstwa Edwarda Whympera, równie¿ w masywie Mont Blanc: Aiguille Verte i Grands i cz³onków wspieraj¹cych TOPR Jorasses, z przewodnikami M. Crozem, Chr. Almerem i F. -

Bassin Des Dranses
Évaluation de la durabilité de la gestion des ressources en eau dans la région lémanique Le bassin des Dranses Août 2010 AUTEURS : Jérôme Porchet1, biologiste Claude Ganty1, géologue Isabelle Gudmundsson1, géologue Thierry Bigler1, juriste Olivier Goy1, géographe Raphaëlle Juge1 et 2, hydrobiologiste-écologue Jean-Bernard Lachavanne1 et 2, hydrobiologiste-écologue 1 Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL) 2 Laboratoire d'Ecologie et de Biologie Aquatique, Université de Genève Comité scientifique : Remerciements Cette étude a été rendue possible grâce à la confiance et à l'en- Jean-Bernard Lachavanne, thousiasme d'un grand nombre de personnes d'horizons et de mo- Hydrobiologiste-écologue, tivations diverses, mais néanmoins toutes conscientes de l'impor- Laboratoire d’Ecologie et de Biologie tance croissante de l'eau en tant que facteur de bien-être et de dé- Aquatique (LEBA), Université de veloppement socio-économique. Il n'est malheureusement pas Genève possible ici de toutes les remercier individuellement, tant la liste serait grande. Raphaëlle Juge, Hydrobiologiste-écologue, Nous tenons à remercier tout spécialement la banque Pictet & Cie, Laboratoire d’Ecologie et de Biologie la Loterie Romande (sections genevoise, vaudoise et valaisanne), Aquatique (LEBA), la Fondation Hans Wilsdorf et les Services Industriels de Genève Université de Genève pour leur confiance et leur soutien financier sans lequel l’étude n’aurait pas pu être effectuée. Régis Caloz, Sans le concours des collaborateurs des divers services des admi- Hydrologue, nistrations communales, cantonales et fédérales ainsi que ceux Ecole Polytechnique Fédérale des bureaux d'ingénieurs qui nous ont assistés dans notre quête de Lausanne (EPFL) de données, cette étude n'aurait pas été possible. -

Section Genevoise Section Genevoise
Section Genevoise Avril 2018 En balade, en trek ou en voyage culturel, BULLETIN DE LA SECTION GENEVOISE DU CLUB ALPIN SUISSE découvrez le Bhoutan avec Tirawa 94e année – Numéro 4 – Rédaction: LoRetta de Luca. Mise en page: UlRich Wacek. Publicité: JoSée ClaiR joSee.claiR@ gmail.com. Couverture: Colomby – Photo: Michel Wicki. Impression: MoléSon Im pReSSionS. Tirage: 2200 exem plaiReS. Curieux des traditions de ce pays bouddhique ou amateurs de grandes ©CAS – Section gene voise 2018. TouS dRoitS RéSeRvéS pouR touS payS. ambiances himalayennes, il y en a pour tous les goûts... Changements d’adresse et numéros non distribués: A envoyeR au SecRétaRiat de la Section GenevoiSe du CAS, Avenue du Mail 4, 1205 Genève, [email protected]. Communications: TouteS leS communicationS pouR le bulletin du Chemins secrets du Bhoutan (16 jours) moiS pRochain doivent paR ve niRavant le 5 de chaque mois chez LoRetta de Luca [email protected] et UlRich Wacek [email protected]. PaSSé cette date, elleS SeRont obli gatoiRe ment RenvoyéeS au moiS Suivant.Local et secrétariat: Une immersion dans la culture bhoutanaise au fil de randonnées vous emmenant Avenue du Mail 4, 1205 Genève, tél. 022 321 65 48, [email protected] . OuveRt le meRcRedi de 14 h 00 à 18 h 00 et de villages en monastères. le jeudi de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00. Compte de chèqueS poStaux de la Section: 12-1172-8. Présidente Marche: facile. Départs 2018: 21 avril, 17 octobre, 16 novembre de la Section: Yolande CoeckelbeRgS.Bibliothèque: OuveRte aux mêmeS hoRaiReS que le SecRétaRiat. -

Cat 42 Final.P65
Top of the World Books Catalogue 42: November 2010 Mountaineering Bates, Robert H. The Love of Mountains is Best: Climbs and Travels from K2 to Kathmandu. 1994 Randall, Portsmouth, 1st, 8vo, pp.xv, 493, photo Alpinist #32 Autumn 2010. #25559, $9.99 frontis, 8 color & 144 bw photos, 12 maps, 5 sketches, photo eps, dec blue Sarmineto, Foraker, Karakoram, and much more! cloth; inscribed by Bates, dj fine, cloth fine. #9492, $89.- Alexander, Eric. The Summit: Faith Beyond Everest’s Death Zone. 2010 Bob Bates has provided us with a terrific book covering his entire career, from US, 1st, 8vo, pp.223, 72 color & 15 bw photos, drawing, appendix, wraps; the first ascent of Mt. Lucania with Bradford Washburn, to K2 in 1938 and 1953 signed, new. #25611, $14.99 with Charles Houston, to Ulugh Muztagh. This book is a must read, with maps Alexander presents a powerful story of guiding people with disabilities to six of and sketches by Dee Molenaar. the Seven Summits. Here are his accounts of Ama Dablam (2000 with Erik —. Mountain Man: The Story of Belmore Browne - Hunter, Explorer, Weihenmayer), Everest (2001 with Erik Weihenmayer), Elbrus & Mt Cook Artist, Naturalist and Preserver of our Northern Wilderness. 1991 Amwell (2002), Pisco (2003), Kilimanjaro (2004, 2007), Aconcagua & Denali (2005), Press, Clinton, 2nd, 4to, pp.xvii, 424, 33 color illus, 98 bw photos, sketches, 4 and Vinson (2006). Intertwined throughout is Eric’s strong faith in God and life maps, appendix, gilt dec brown cloth, slipcase; slipcase fine, cloth new. lessons gained with his expeditions. #23623, $59.- Ardito, Stefano, ed. -

Montagne & Mestieri
Montagne360 La rivista del Club alpino italiano novembre 2017 € 3,90 MONTAGNE & MESTIERI Jo Nesbø, Mike Kosterlitz, Silvia Metzeltin e gli altri: non solo alpinismo #DESTINAZIONEK2 Da Torino alla seconda montagna del pianeta utilizzando i mezzi pubblici MOUNTAIN WILDERNESS Trent'anni dalla fondazione: storia e obiettivi di un'associazione che ripensa la montagna del Club alpino italiano n. 62/2017. Poste Italiane Spa, sped. in abb. Post. - 45% art. 2 comma 20/b - legge 662/96 Filiale di Milano. Prima immissione il 27 ottobre 2017 2017 ottobre il 27 immissione Prima 662/96 Filiale di Milano. - legge 20/b 2 comma - 45% art. Post. in abb. sped. Spa, Italiane Poste 62/2017. n. del Club alpino italiano 3,90. Rivista mensile Rivista 3,90. € Montagne360. Novembre 2017, 2017, Novembre Montagne360. Offerta riservata solo ai Soci EDITORIALE orizzonti e orientamenti CLUB ALPINO ITALIANO Fedeltà e riconoscenza P Abbonati di Vincenzo Torti* con lo sconto di oltre il Socie e Soci Carissimi, quando si parla delle attività che ci vedono impegnati, siamo soliti riferirci glo- balmente al “Cai”: il Cai che progetta, il Cai che realizza, il Cai che è presente, il Cai che dovrebbe… In questo modo esprimiamo il nostro sentirci compatti, solidali e ricompre- si in una dimensione fortemente identitaria. Ma questo non deve mai far di- menticare che, dietro tutto ciò, vi sono sempre donne e uomini di ogni età, dai più piccoli ai meno giovani, che silenziosamente, ma fattivamente, dedicano energie ed entusiasmo per realizzare obiettivi che, poi, diventano patrimonio P 6 numeri di di tutti noi. Ed è per questo che, in giorni nei quali, a un primo bilancio dei dati associa- Meridiani Montagne tivi, si riscontra una ulteriore e importante crescita del corpo sociale, vorrei intrattenermi con voi su un dato che mi sembra particolarmente significativo e a soli meritevole di qualche riflessione. -

Pinnacle Club Journal
© Pinnacle Club and Author All Rights Reserved THE PINNACLE CLUB JOURNAL No. 22 1991-1993 © Pinnacle Club and Author All Rights Reserved THE PINNACLE CLUB JOURNAL 1991-1993 No. 22 Edited by Dee Gaffney © Pinnacle Club and Author All Rights Reserved THE PINNACLE CLUB JOURNAL 1990-1993 THE PINNACLE CLUB Founded 1921 OFFICERS AND COMMITTEE - 1993 President MARGARET CLENNETT 17 Orchard Lane, Prestwood Bucks. HP160NN Vice President STELLA ADAMS Hon. Secretar\ CATHY WOODHEAD The Anchorage, 15 Ty Mawr Road Deganwy, Gwynedd LL31 9UR Hon. Treasurer SALLY KEIR Hon. Meets Secretary MARY WATERS Hon. Membership Secretary LOUISE DICKIE Hon. Hut Secretary RHONA LAMPARD Hon. Librarian SUE LOGAN Hon. Editor DEE GAFFNEY Hon. Auditor FERN LEVY Committee Mandy Glanvill Marlene Halliwell Val Hennelly Helen Jones Elaine McCulloch (dinner organiser) Suzanne Pearson Key Proudlock (co-opted) © Pinnacle Club and Author All Rights Reserved THE PINNACLE CLUB JOURNAL CONTENTS Idylls in the Winds Margaret Clennett................5 A Nice Walk Jane Stedman.......................9 Nepal 1992: A Life of Luxury Shirley Angell.................... 11 The Forbes Arete - My first alpine steps Penny Clay......................... 15 Time in the Sun Kate Webb......................... 18 A Solo Traverse of the Welsh 3000 foot Mountains Gill Ollerhead ....................23 Hot ? Rock Annabelle Barker...............28 Trudy's First Tour Marguerite .........................31 Arrampicato con Gloria Angela Soper .....................34 By Klepper in the Charlottes Ann Wheatcroft .................37 It is better to travel hopefully.. Sally Macintyre .................40 The Adventures of Buffalo Bill and the Armpit Hoppity Rabbit ..................43 Rock Climbing in the Dauphine Stella Adams......................46 The Tale of the Middle-Aged Mariners Mary Waters ......................48 Mice, Megaphones and Muscles (Half Dome the Slow Way) Hilary Lawrenson ..............50 On Location Gwen Moffat .....................54 Cwm Dyli Hydro Station F. -

Taternik 3 1973
Taternik 4t « s 7 a http://pza.org.pl TREŚĆ Lata blaski i cienie (J. Nyka) . 145 Żabi Mnich — w aspekcie wycho wawczym (B. Jankowski, J. Kur- czab i A. Paczkowski) . 147 Po co chodzisz po górach? Odpo wiada: Sergiusz Sprudin . 143 Kazimierz Andrzej Jaworski (J.A. Szczepański) 149 Zima 1972—73 w Alpach (J. Nyka) 150 Masyw Mont Blanc — lato 1973 (J. Kurczab) 152 Polki na filarze Eigeru (W. Rut kiewicz) 155 Zielone łąki Alpiglen (D. Gellner) 157 Lato 1973 w Dolomitach (J. Kalla) 180 Castello delie Nevere (W. Sas- -Nowosielski) 161 Obóz FAKA w Dolomitach (A. Li- zoń-Łukaszewska) .... 162 O skałkach — z optymizmem (W. Sas-Nowosielski) 163 Obóz w Kaukazie Zachodnim (K. Zdzitowiecki) 164 Nowe sukcesy w Adyłsu (A. Zyzak) 165 Drogą Kensickiego na Pik Szczu- rowskiego (K. Głazek) . 167 Nową drogą na Uszbę (G.I. Sza- lajew) 169 Jubileusz Mount Everestu (L. Wrób lewski) 170 Polacy w Hindukuszu w 1973 roku (J. Wala) 171 Gliwiczanie w Spluga delia Pręta (T. Rojek) 173 Koło Szczecińskie ma 20 lat (T: Re waj) 174 Skalne drogi w Tatrach .... 176 Co nowego w Tatrach? . 179 Różne góry, różne lata .... 180 Wyprawy w góry egzotyczne . 181 Speleologia 182 Wypadki i ratownictwo .... 183 Z życia organizacyjnego .... 184 Ochrona przyrody gór .... 185 Sprzęt i ekwipunek 186 Z piśmiennictwa 189 Z Tatr i Zakopanego 190 W skrócie 190 Listy do Redakcji 191 Na okładce: W skałkach Fot. Szymon Wdowiak Obok: Na północnej grani Uszby Fot. Uwe Jensen (NRD) http://pza.org.pl Taternik ORGAN KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO ROCZNIK XLIX • WARSZAWA 1973 • NR 4 (221) Lata blaski i cienie 1 oto mamy za sobą kolejny wielki sezon filarem Eigeru (szczegóły wewnątrz nume polski w górach świata. -

Manless Rope Team: a Socio-Technical History of a Social Innovation
The International Journal of the History of Sport ISSN: (Print) (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/fhsp20 Manless Rope Team: A Socio-Technical History of a Social Innovation Cécile Ottogalli-Mazzacavallo & Eric Boutroy To cite this article: Cécile Ottogalli-Mazzacavallo & Eric Boutroy (2020): Manless Rope Team: A Socio-Technical History of a Social Innovation, The International Journal of the History of Sport, DOI: 10.1080/09523367.2020.1794833 To link to this article: https://doi.org/10.1080/09523367.2020.1794833 Published online: 05 Aug 2020. Submit your article to this journal Article views: 4 View related articles View Crossmark data Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=fhsp20 THE INTERNATIONAL JOURNAL OF THE HISTORY OF SPORT https://doi.org/10.1080/09523367.2020.1794833 Manless Rope Team: A Socio-Technical History of a Social Innovation Cecile Ottogalli-Mazzacavallo and Eric Boutroy UFR STAPS, University Claude Bernard Lyon 1, Lyon, France ABSTRACT KEYWORDS While women have been known to climb mountains since the Manless; mountaineering; nineteenth century, mountaineering is still perceived by many as non-mixed group; social a ‘bastion of virility’. Yet, from the post-First World War period innovation; rope team until today, French women mountaineers have discovered and organized a novel and atypical experience: climbing in manless rope teams to meet their unsatisfied social needs for independ- ence, equal rights, and acknowledgment of their capacities. A socio-technical history of the innovative manless rope team reveals three distinctive periods, characteristic of the different waves of feminism. -

In Memoriam 2010, However Most of the Books Shortlisted Have Been Reviewed in Either This Volume Or 2009
402 T h e A l p i n e J o u r n A l 2 0 1 0 / 1 1 The Boardman Tasker Prize for Mountain Literature Space constraints in this two-year volume of the AJ prevent us following recent practice and reproducing the speeches of jury chairmen for 2009 or In Memoriam 2010, however most of the books shortlisted have been reviewed in either this volume or 2009. The prize of £3000 commemorates the lives of Peter Boardman and Joe Tasker and is given to the author or co-authors of an original work that has made an outstanding contribution to mountain liter- ature. On 17 May 1982 Boardman and Tasker were last seen on Mount The Alpine Club Obituary Year of Election Everest attempting to traverse The Pinnacles on the unclimbed north-east (including to ACG) ridge at around 8250m. Their deaths marked the end of a remarkable era Chris Astill 1985 in British mountaineering. Patrick (Paddy) Boulter 1972 The winners, shortlists and judges for 2009 and 2010 were as follows: Roger Childs 1997 Robert (Bob) Creswell 2007 2009 Robin Day 1968 John Edwards 1982 Winner: Beyond the Mountain by Steve House, Patagonia Books, USA Nawang Gombu Hon 1998 (Vertebrate Publishing in UK) Alistair Gordon 1993 Alfred Gregory 1952 (Hon 2004) Others shortlisted: Eileen Healey LAC 1947 Cairngorm John by John Allen, Sandstone Press Mike Hewson 1994 Hooker & Brown by Jerry Auld, Brindle & Glass, Canada Frederick Hill 1975 The Longest Climb by Dominic Faulkner, Virgin Books Peter Hodgkiss 1988 Revelations by Jerry Moffatt, Vertebrate Publishing John Kempe 1952 Deep Powder and Steep Rock -

Leggi Estratto Del Libro
Raymond Lambert L’HOTEL DELLA MORTE LENTA Le Parusciole Raymond Lambert, l’uomo che guardava in alto di Alberto Paleari Una decina d’anni fa, o forse più, in uno di quei pomeriggi temporaleschi che capitano spesso in estate sul Bianco, ciondolavo da una finestra all’altra della sala da pranzo del rifugio del Réquin, spiando l’arrivo di una schiarita tra gli scrosci di pioggia che batteva- no di traverso sui vetri. Gilbert, il custode, mi rassicurava: “demain c’est le grand beau”. In quel periodo andavo spesso al Réquin, e con Gilbert, che oltre a fare il custode era anche guida di Chamonix, ero abbastanza in confidenza: l’avevo anche incontrato un paio di volte in montagna, sulle Aiguilles, sempre con un suo cliente di Argéntière che faceva il pittore. Io non ero tanto tranquillo: più in alto quella piog- gia era neve e grandine e temevo che le fessure della via Rénaudie, che dovevo salire il giorno dopo, si in- crostassero di verglas. Ma Gilbert continuava a rassi- curarmi e, credo per farmi star fermo (gli dava fastidio quel continuo mio andare avanti e indietro, o forse più che a lui dava fastidio alla moglie, una maniaca dei pavimenti lucidati a cera, la quale per entrare nel ri- fugio voleva che si mettessero le pattine) prese un libro 5 da una vetrinetta chiusa a chiave che fungeva da bi- blioteca e mi disse di leggerlo, io che ero uno scrittore: quello sì che era un bel libro di montagna! Come facesse a sapere che ero uno scrittore non lo so, però ci rimasi anche un po’ male, la sua ultima affermazione sembrava mancante della conclusione: mica i tuoi. -
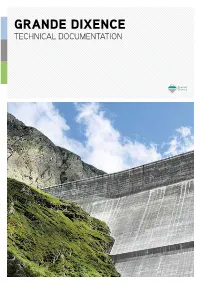
Grande Dixence Technical Documentation Grande Dixence Technical Documentation Contents the Grande Dixence 5 Hydroelectric Complex 6-17
GRANDE DIXENCE TECHNICAL DOCUMENTATION GRANDE DIXENCE TECHNICAL DOCUMENTATION CONTENTS THE GRANDE DIXENCE 5 HYDROELECTRIC COMPLEX 6-17 GRANDE DIXENCE 8 PANORAMIC VIEW OF THE FACILITIES 10 LONGITUDINAL PROFILE 16 COLLECTING WORK 18-57 Z’MUTT PUMPING STATION 20 STAFEL PUMPING STATION 32 FERPÈCLE PUMPING STATION 40 AROLLA PUMPING STATION 50 STORAGE 58-75 THE GRANDE DIXENCE DAM 60 PRODUCTION 76-99 FIONNAY POWER PLANT 78 NENDAZ POWER PLANT 86 BIEUDRON POWER PLANT 94 INFORMATION 100-104 GRANDE DIXENCE SA PARTNERS 102 GRANDE DIXENCE SA SHAREHOLDING PORTFOLIO 103 CONTACTS 104 THE GRANDE DIXENCE HYDROELECTRIC COMPLEX Grande Dixence is not only the tallest gravity dam in the world, it is also a masterpiece of technical sophistication and daring devoted entirely to energy. Standing shoulder to shoulder with the highest mountains in Switzerland's Valais region, the structure is the keystone of a vast hydroelectric complex which includes five pumping stations, over 100 km of headrace tunnels cut into the rock and three power plants. Come and discover the Grande Dixence complex! The Grande Dixence dam in the Val des Dix (VS) GRANDE DIXENCE Grande Dixence is not only the tallest gravity dam in the world, it is also 9 HYDROELECTRIC COMPLEX a living legend. Level with the highest mountains in the Valais, this structure is a mas- terpiece in technical skill and audacity channelled into energy. At first sight, you will be astounded by the 285 m of concrete towering above you; once you reach the top of the facility, the stunning view of the Lac des Dix and the valley will take your breath away.