Télécharger L'extrait
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
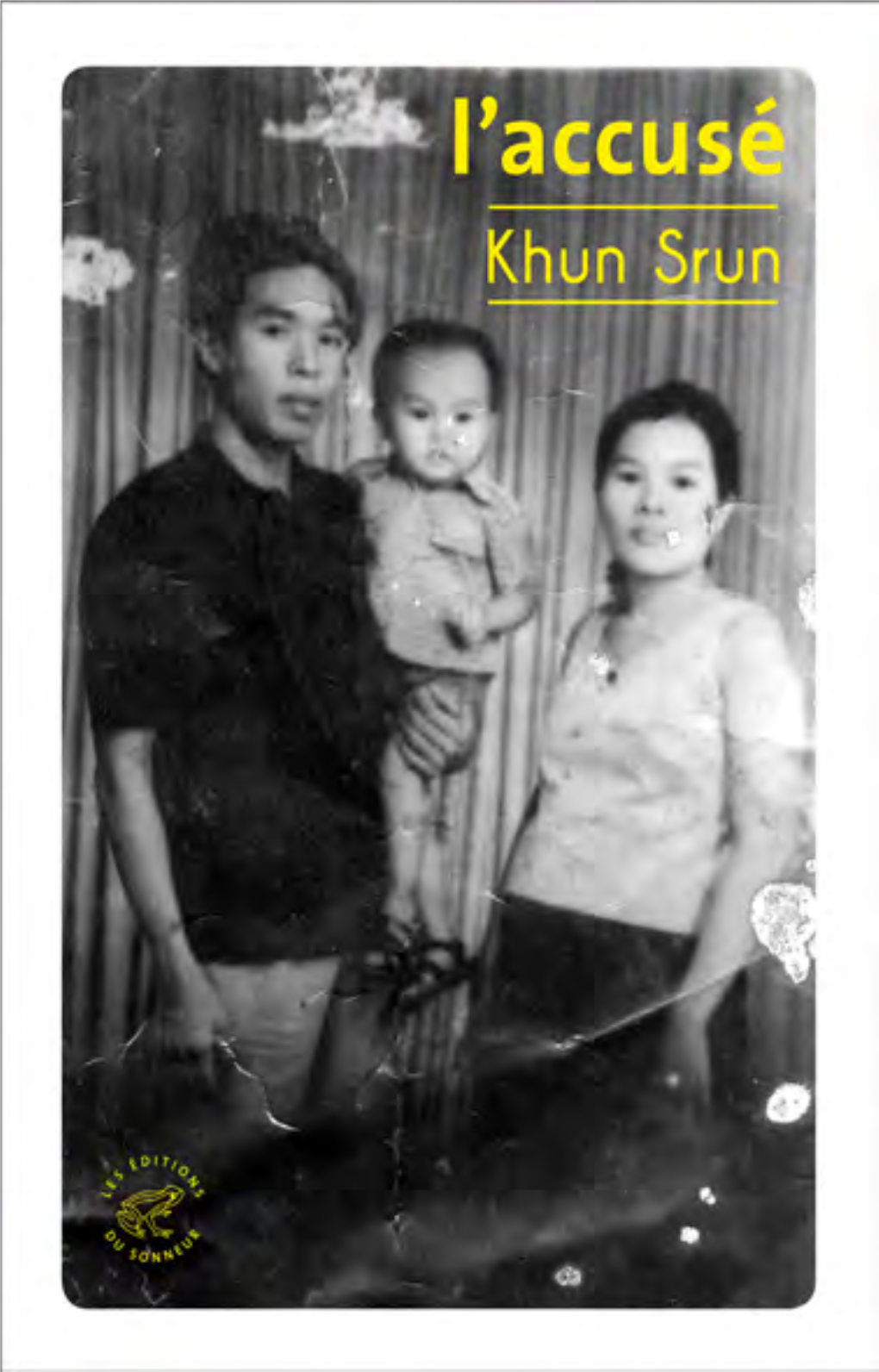
Load more
Recommended publications
-

Title <Literature, Film and Culture in Southeast Asia> Twelve Sisters: A
<Literature, Film and Culture in Southeast Asia> Twelve Title Sisters: A Shared Heritage in Cambodia, Laos, and Thailand YAMAMOTO, Hiroyuki; BOONKHACHORN, Trisilpa; TUDKEAO, Chanwit; PHOLLURXA, Khamphuy; VAN, Sovathana; PAL, Vannarirak; HASHIMOTO, Sayaka; Author(s) OKADA, Tomoko; HIRAMATSU, Hideki; UABUMRUNGJIT, Chalida; DOUNG, Sarakpich; LUANGMOVIHANE, Dethnakhone; BOUANDAOHEUANG, Athidxay Citation Thailand P.E.N. Center. (2020): i-99 Issue Date 2020-09 URL http://hdl.handle.net/2433/256030 ©2020 YAMAMOTO Hiroyuki for selection and editorial material. Individual chapters, the contributors. All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic, mechanical, or Right other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher. Type Book Textversion publisher Kyoto University Literature, Film and Culture in Southeast Asia Twelve Sisters: A Shared Heritage in Cambodia, Laos, and Thailand Edited by YAMAMOTO Hiroyuki Thailand P.E.N. Center This edition published September 2020 by Thailand P.E.N. Center 2 Phichai Rd., Dusit District, Bangkok 10200 [email protected] ©2020 YAMAMOTO Hiroyuki for selection and editorial material. Individual chapters, the contributors. All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including -

Modern Short Stories – People's Experiences and Memories Recorded by Novelists
odern Short Stories – people’s experiences M and memories recorded by novelists by OKADA, Tomoko mkdl´sBVézáenH BuMmanGñkRsavRCavEdl:ncab´GarmµN¾eZVIkar elak Xun Rs)un elak em¨A sMNag nig elak sun sTÆarI sikSanUvkzaTMenIb ‘KWCaer]gRbelamelakxøI>’ EdlGñkniBnÆExµrd*l|I CaedÍm . eQaHxµ Hø :nEtgmnsmu ybd& vtí nþ ¾ ExrRkhmµ ngi eRkaysmybd& vtí nþ¾ elak GkadaU :nbkERbsaédrbsñ G´ knñ Bni ExÆ renaHµ CaPasaCbnu¨ enH . ehtenHehu yI :nCa bNitÐ GUkada tUm¨UkU :nseRmc ehy:ne:HBI mu pSaynË vkzaTU enM bExI rGsµ enH´ naqañ M 2001 . edaymankar eZVIbriyayGMBIsñaéd rbs´GñkniBnÆExµr dUcCa elak suTÆ b)Ulin CyóbtY mæ rbsÖ m´ lnU Zi i CvÍ téddí U ‘Daido Life Foundation’ . At the end of the 1930’s under the French Protectorate, so- Whatever you order me, I will do it (1969) is his only collection called modern literature was born in Cambodia. The new of short stories. In “Communication”, the first of four sto- wave of literature was written in prose and described every ries in the collection, Polin expresses the mentality of a day life that was familiar to the common reader. These works serious young man who cannot communicate with persons were different from the classics that were written in verse near him without fretting about it. The hero narrator feels and depict super natural heroes who inhabit splendid courts alienated and creates an ideal world in his imagination, while and the heavenly places. his “other” cannot talk comfortably even with a person in his office. “Order me, Honey” and “Whatever you order Since independence from France, the political systems in me, I will do it” deal with husbands whose behavior dis- Cambodia have changed many times. -

Women, Sexuality and Politics in Modern Cambodian Literature
WOMEN, SEXUALITY AND Introduction POLITICS IN MODERN CAMBODIAN Modern prose literature of Cambodia emerged as a result of Western influence LITERATURE: in the 1940s, with the sentimental novel as THE CASE OF SOTH the dominant genre. After independence, POLIN'S SHORT STORY 1 the Cambodian novel and short story underwent tremendous growth. Almost 2 one thousand works were created between Klairung Amratisha 1953 and 1975, and many new types of writing such as political, philosophical, Abstract historical, adventurous as well as erotic texts appeared. In the active community of This essay aims to explore the political writers in Phnom Penh during the late messages found in the work of Soth Polin, 1960s and, at the start of the 1970s, Soth one of Cambodia’s influential writers in Polin was considered one of the most the 1970s. Soth’s short story, Sramol Pt ī influential figures. His writings were Oey..Khluon Ūn Rahaek [My Dear highly controversial and very popular Husband…My Body Was Torn Apart] among the reading public. His novels and illustrates how Cambodia was in a state of short stories can be categorised into many physical and moral decay during the groups: philosophical, political and Vietnam War as a result of attacks from pornographic writings. This article aims to Vietnamese Communists and American explore the relationship between these influence over the Cambodian leaders three different aspects as seen through the during the Vietnam War. In Soth’s stories, sexual behaviour of Soth's women pornographic, philosophical and political characters in one of his short stories, elements are artistically interwoven. -

Writing the Postcolonial City: Phnom Penh and Modernity During Sangkum Reastr Niyum, 1955-1970
Writing the Postcolonial City: Phnom Penh and Modernity during Sangkum Reastr Niyum, 1955-1970 by Siti Galang Keo A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Peter B. Zinoman, Chair Professor Kerwin Klein Professor Penelope Edwards Summer 2019 Abstract Writing the Postcolonial City: Phnom Penh and Modernity during Sangkum Reastr Niyum, 1955-1970 by Siti Galang Keo Doctor of Philosophy in History University of California, Berkeley Professor Peter B. Zinoman, Chair This dissertation examines novels, essays, films and songs of the Sangkum Reastr Niyum period, 1955-1970, to explore the layers of meanings Cambodians held of Phnom Penh. After the Geneva Accords in 1954, Phnom Penh emerged as the capital city of a newly independent nation-state, the Kingdom of Cambodia. The city under French colonial rule was secondary to Hanoi and Saigon, but once Indochina dissolved, its population exponentially increased. Phnom Penh was at the center of Cambodia’s road networks, its banking system, and was home to the best universities and schools. The many jobs and opportunities attracted rural migrants to the city. The population boom was one of the many ways Phnom Penh transformed. Norodom Sihanouk, then the head of state, made Phnom Penh the epicenter of government modernization projects. Under his watch, the capital transformed from being a marshy, provincial hub into an exciting scene of cosmopolitan innovation. Urban Cambodians combined ideas from Le Corbusier with traditional Khmer architectural details to design their “modern” buildings. -

SEAM Holdings List – August 2011 Cambodia
Cambodia Cambodia CALL # = MF-10289 SEAM reel 021 item 01. TITLE = 1000 jours de résistance nationale : le drame d'une guerre imposée à un peuple pacifique . IMPRINT = Phnom Penh : Khmer Republic, 1973. SERIES = Great Collections Microfilming Project. Phase I, John M. Echols Collection. NOTE = On spine: Une rétrospective historique de la République khmère. NOTE = Special issue of French edition of Khmer Republic, Sept. 1973. OCLC # = 20036084. CALL # = MF-10289 SEAM reel 016 item 23. TITLE = L'Agression vietcong et nord-vietnamienne contre la République Khmère : nouveaux documents. IMPRINT = Phnom-Penh : Ministère de l'information, 1971. SERIES = Great Collections Microfilming Project. Phase I, John M. Echols Collection. OCLC # = 20035736. CALL # = MF-10289 SEAM reel 017 item 12. TITLE = The Armed struggle and life of the Khmer people in the liberated areas in pictures. IMPRINT = [n. p.] N.U.F.C. Press (National United Front of Cambodia) 1971. SERIES = Great Collections Microfilming Project. Phase I, John M. Echols Collection. NOTE = At head of title: The Kingdom of Cambodia. OCLC # = 20034963. CALL # = MF-10289 SEAM reel 123 item 3. TITLE = L'Art dans le parler. IMPRINT = [Phnom Penh? 1968?]. SERIES = Great Collections Microfilming Project. Phase I, John M. Echols Collection. NOTE = Title and text in Khmer; added title in French. OCLC # = 21464553. CALL # = MF-10289 SEAM reel 028 item 03. TITLE = Banque nationale du Cambodge. IMPRINT = [Phnom-Penh, 1955?]. SERIES = Great Collections Microfilming Project. Phase I, John M. Echols Collection. NOTE = In Cambodian and French. OCLC # = 20035949. CALL # = MF-10289 SEAM reel 028 item 11. AUTHOR = Banque nationale du Cambodge. TITLE = Statuts. IMPRINT = [Phnom-Penh, E. -

Mmemm3000emmkmmmmmem
DOCUMENT RESUME ED 299 347 UD 026 400 AUTHOR Marston, John, Comp. TITLE An Annotated Bibliography of Cambodia and Cambodian Refugees. Southeast Asian Refugee Studies Occasional Papers Number Five. INSTITUTION Minnesota Univ., Minneapolis. Center for Urban and Regional Affairs. PUB DATE Dec 87 NOTE 125p. AVAILABLE FROMSoutheast Asian Refugees Studies Project, 330 Hubert H. Humphrey Center, 301 19th Ave. South, Minneapolis, MN 55455 (*4.50). PUB TYPE Reference Materials Bibliographies (131) EDRS PRICE MFOI/PC05 Plus Postage. DESCRIPTORS Annotated Bibliographies; *Asian History; Austro Asiatic Languages; Books; Cambodian; *Cambodians; *Cultural Background; Ethnography; *History; Modern History; Periodicals; *Political Issues; *Refugees IDENTIFIERS *Cambodia; Thailand ABSTRACT This 578-eltry annotated bibliography is intended for use by people who work with Cambodian refugees in the United States, as well as anyone interested in Cambodian history, politics, and culture. It consists primarily of books and journal articles on Cambodia and Cambodians available in the University of Minnesota library system or that are part sf the Southeast Asian Refugees Studies (SARS) Project collection. The largest number of entries pertain to the recent history of Cambodia. Included are materials representing a wide range of political viewpoints, and when possible have indicated political bias in the annotations. Some annotations also include references to other works that dispute or criticize the work cited. Broad subject categories are the following: (1) General Works on Cambodia; (2) Ethnography; (3) Antiquities; (4) Other Arts and Culture; (5) Cambodian Literature and Literature about Cambodia; (6) Language and Dictionaries; (7) History--General; (8) History before 1954; (9) History 1954-1970; (10) History 1970 to Present--General; (11) Refugees in Thailand; (12) Cambodians in Countries of Resettlement; and (13) Bibliographies. -

Pseudotransformational Leadership, Leadership Styles, and Emotional Intelligence
Pseudotransformational leadership, leadership styles, and emotional intelligence: a comparative case study of Lon Nol and Pol Pot By TITLE PAGE Hok Roth A Dissertation Submitted to the Faculty of Mississippi State University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Public Policy and Administration in the Department of Political Science and Public Administration Mississippi State, Mississippi December 2016 Copyright by COPYRIGHT PAGE Hok Roth 2016 Pseudotransformational leadership, leadership styles, and emotional intelligence: a comparative case study of Lon Nol and Pol Pot By APPROVAL PAGE Hok Roth Approved: ____________________________________ Gerald A. Emison (Director of Dissertation) ___________________________________ Dragan Stanisevski (Committee Member) ___________________________________ Brian D. Shoup (Committee Member) ___________________________________ P. Edward French (Committee Member / Graduate Coordinator) ___________________________________ Rick Travis Interim Dean College of Arts & Sciences Name: Hok Roth ABSTRACT Date of Degree: December 9, 2016 Institution: Mississippi State University Major Field: Public Policy and Administration Major Professor: Gerald A. Emison Title of Study: Pseudotransformational leadership, leadership styles, and emotional intelligence: a comparative case study of Lon Nol and Pol Pot Pages in Study: 408 Candidate for Degree of Doctor of Philosophy The purpose of this dissertation is to help explain how and why two revolutionary national leaders of Cambodia–Lon Nol and Pol Pot, particularly the latter–had spectacular failures and became pseudotransformational leaders. It aims to build a proposition or theory that revolutionary leaders in the public sector, particularly of undemocratic regimes, tend to become pseudotransformational leaders when a) they lack certain components of emotional intelligence (EI) and/or b) adopt certain leadership styles and use them inappropriately. -

Southeast Asian Diaspora in the United States
Southeast Asian Diaspora in the United States Southeast Asian Diaspora in the United States: Memories and Visions Yesterday, Today, and Tomorrow Edited by Jonathan H. X. Lee Southeast Asian Diaspora in the United States: Memories and Visions, Yesterday, Today, and Tomorrow Edited by Jonathan H. X. Lee This book first published 2015 Cambridge Scholars Publishing 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2015 by Jonathan H. X. Lee and contributors All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-6364-5, ISBN (13): 978-1-4438-6364-3 For my son, Owen Edward Jinfa Quady-Lee TABLE OF CONTENTS Acknowledgements ..................................................................................... x Editorial Board .......................................................................................... xii About the Editor ....................................................................................... xiv About the Contributors .............................................................................. xv Preface ....................................................................................................... xx Foreword ................................................................................................ -

An Annotated Bibliography of Cambodia and Cambodian Refugees
MJ.093 An Annotated Bibliography of Cambodia and Cambodian Refugees CJfJoutheas! As1tl11 <iR.tjugee CJfJ1ufJies Occasional Papers Number Five Compiled by John Marston An Annotated Bibliography of Cambodia and Cambodian Refugees Compiled by John Marston Southeast Asian Refugee Studies Occasional Papers Number Five Southeast Asian Refugee Studies Project, Center for Urban and Regional Affairs University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 1987 SOUTHEAST ASIAN REFUGEE STUDIES Occasional Papers Series Editor: Bruce T. Downing Number One: A Bibliography of the Hmong (Miao) Compiled by Douglas P. Olney Number Two: White Hmong Language Lessons By Doris Whitelock Number Three: White Hmong Language Lessons By David Strecker and Lopao Vang Number Four: Training Southeast Asian Refugee Women for Employment: Public Policies and Community Programs, 1975-1985. By Sarah R. Mason A publication of the Center for Urban and Regional Affairs 330 Hubert H. Humphrey Center 301 19th Avenue South University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 55455 1987 Publication No. CURA 87-2 Cover design by Ra Bony, a sixteen-year-old Cambodian soldier who wrote about his picture for a child psychologist visiting camps on the Thai-Cambodian border: "These are two ancient mountain warriors of Angkor Wat. I remember seeing them in a book while I was in school before the Pol Pot regime. The teacher said that at one time they had both been inside a single body, but because one was good and the other evil, they broke apart and have been fighting each other ever since. See, they are tied at the wrists and cannot escape. I think Cambodia is still like this. -

Total Coverage of Cambodia in Eight Major Western Newspapers, 1975-80*
Appendix: Total coverage of Cambodia in eight major western newspapers, 1975-80* 192 * .... r \.,) lJ> -.J 00 g 'l'Z .,,0 0 (5 ~ 0 ~ 0 ~ 0 0 8 April -~ u. H~ .. ~r October ~~. ~ January . ~ a. April ------------- - ~ J:l July ~ 0< October * ~ January !"r April !"r July ~ October -~ ~ ~ January 00 ~ April l July ....2 October ~ :0 January ~ -.J ~ '" April §' July ~ October 5" :0 January r gg !" April ~ <::> July ~ S October Total number ofarticles * r w ~ ..." ~~ 0 § 8 8 8 8 8 ..... April ~ ..." June Mayaguez incident H August f\" '1l~ October OQ'r- December ~ 00' :0 , S -...J February :s 0\ "tI April ------------------ 2 :- June Bjork visit/Japanese captured ~ August Q< October .... December * j February I April June !'"r August ~ October -~ December ~ .... --~- - --------- ~ February ~ 00 I:: April ~ June August ~1'\' ~ October C) .... December ------ \0 ~ -...J February VN invasion \0 ~ April ~ June August ~ October ---------- ~ Famine reports .... December r gg\0 February !'" April ~ ---------------- C VN cross Thai border ::t August ~ October December Notes Notes to the Introduction I. Kimmo Kiljunen (ed.), Kampuchea: Decade of Genocide, Report ofa Finn ish Inquiry Commission (London, 1984), p. 33. 2. For in-depth examinations of the effects of the Second Indo-China War in Cambodia and Vietnam and Western responses to it, see, for example, William Shawcross, Sideshow (London, 1986); Richard A. Falk (ed.), The Vietnam War and International Law (Princeton, NJ, 4 vols, 1969-76); Clarence R. Wyatt, Paper Soldiers: The American Press and the Vietnam War (New York, 1993); R. B. Smith, An International History ofthe Vietnam War (London, 3 vols, 1983-91); George C. Herring, America's Longest War (New York, 1986). -

Hommes Et Histoire Du Cambodge Regroupe Des Articles Sélectionnés Des Histo- Riens, Des Chercheurs Du CNRS, Des Journalistes Et Des Médias
SAKOU SAKOU SAMOTH SAMOTH Les élites sont liées intimement à l’histoire qui est une science de la connais- HOMMES ET HISTOIREDUCAMBODGE ;ndpp&tNh;y&Y:)ı:YamK‰d) sance du passé en s’appuyant sur des documents. Hommes et Histoire du Cambodge regroupe des articles sélectionnés des histo- riens, des chercheurs du CNRS, des journalistes et des médias. HOMMES ET HISTOIRE DU CAMBODGE La biographie des souverains, des politiciens, des écrivains et des scientifiques cambodgiens, morts ou vivants dans ce livre, reflète une partie de l’Histoire du Cambodge : 120 élites khmères Ang Duong, Ang Chan I, Barom Reachea V, Barom Reachea VI Barom Reachea III, Biv Chhay Leang, Bun Chan Mol, Chan Nak Chan Youran, Chau Sèn KoSal, Chau Séng, Chau Xéng Ua, Chea Sim Chey Chettha II, Chey Chettha III, Chhean Vam, Chéng Héng Chhéng Phon, Chuon Nath, Chuth Khay, Chhuk Méng Mao, Dap Chuon Diego Veleso et Bias Ruiz, Douc Rasy, Pauline Dy Phon, Hell Sumpha Héng Samrin, Hou Youn, Hang Thun Hak, Hun Sèn, Ho Tong Lip Huy Kan Thoul, In Tam, Ieng Sary, Iêuv Koeus, Kân, Kang Kek Ieuv Keuk Boun Pong, Kem Sokha, Kéng Vann Sak, Khieu Samphân Khieu Thirith, Khing Hoc Dy, Khim Tit, Khin Sok, Kram Ngoy, Léng Ngeth Long Seam, Lon Nol, Lon Non, Long Boreth, Long Bunruot, Nhok Thèm Nong, Norodom, N. Yukanthor, N. Suramarit, N. Sihanouk, N. Sihamoni N. Chantaraingsei, N. Ranariddh, N. Kantol, Nhiek Tioulong Nhiek Bun Chhay, Nou Hach, Nou Kân, Nuon Khoeun, Prey Chea Ind Oum Chheang Sun, Pen Sovan, Penn Nouth, Phul Tes, Pho Proeung Phung Ton, Pol Pot, Ponhea Yat, Prah Barom Reachea Prah Mahinda Reachea, Ros Chantrabotr, Rim Kin, Sarin Chhak San Yun, Sakou Samoth, Sam Sary, Sam Rainsy, Sisowath S. -

Common Worlds and Uncommon Lives Across Nineteenth–Century Cambodia
Travelers, Dreamers, Adventurers and Agitators: Common Worlds and Uncommon Lives Across Nineteenth–Century Cambodia by Thibodi Buakamsri A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in South and Southeast Studies in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Penelope Edwards, Chair Professor Peter Zinoman Professor Khatharya Um Summer 2018 Copyright © 2018 Thibodi Buakamsri Abstract Travelers, Dreamers, Adventurers and Agitators: Common Worlds and Uncommon Lives Across Nineteenth-Century Cambodia by Thibodi Buakamsri Doctor of Philosophy in South and Southeast Asian Studies University of California, Berkeley Professor Penelope Edwards, Chair If there is a space for ordinary people in the history of Cambodia, that space has been on the ground, beneath kings and monuments, in the distant background of glory and tragedy. Ordinary people remain placeless, nameless, voiceless, and invisible. But they existed. This thesis aims to redress such élitist historiography by introducing a different historical narrative that is fragmentary and episodic narratives of ordinary people. It explores the role of flesh-and-blood individuals, and the worlds they lived in and imagined, in Cambodia in the nineteenth-century, a period of radical change that remains comparatively unexamined, especially prior to the establishment of the French Protectorate in 1863. The thesis excavates archival sources, including testimonial narratives and local literature, and pieces together such shards and fragments into vivid narratives of ordinary people who lived at the fringes of society yet traversed vast stretches of Cambodian territory. It is a quilt of the life-stories of individuals –of Khmer, Siamese, Vietnamese, and Chinese descent– who traveled, dreamed, adventured and agitated in order to make their lives better in the here-and-now felt and material world.