Le Rapport Au Format
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
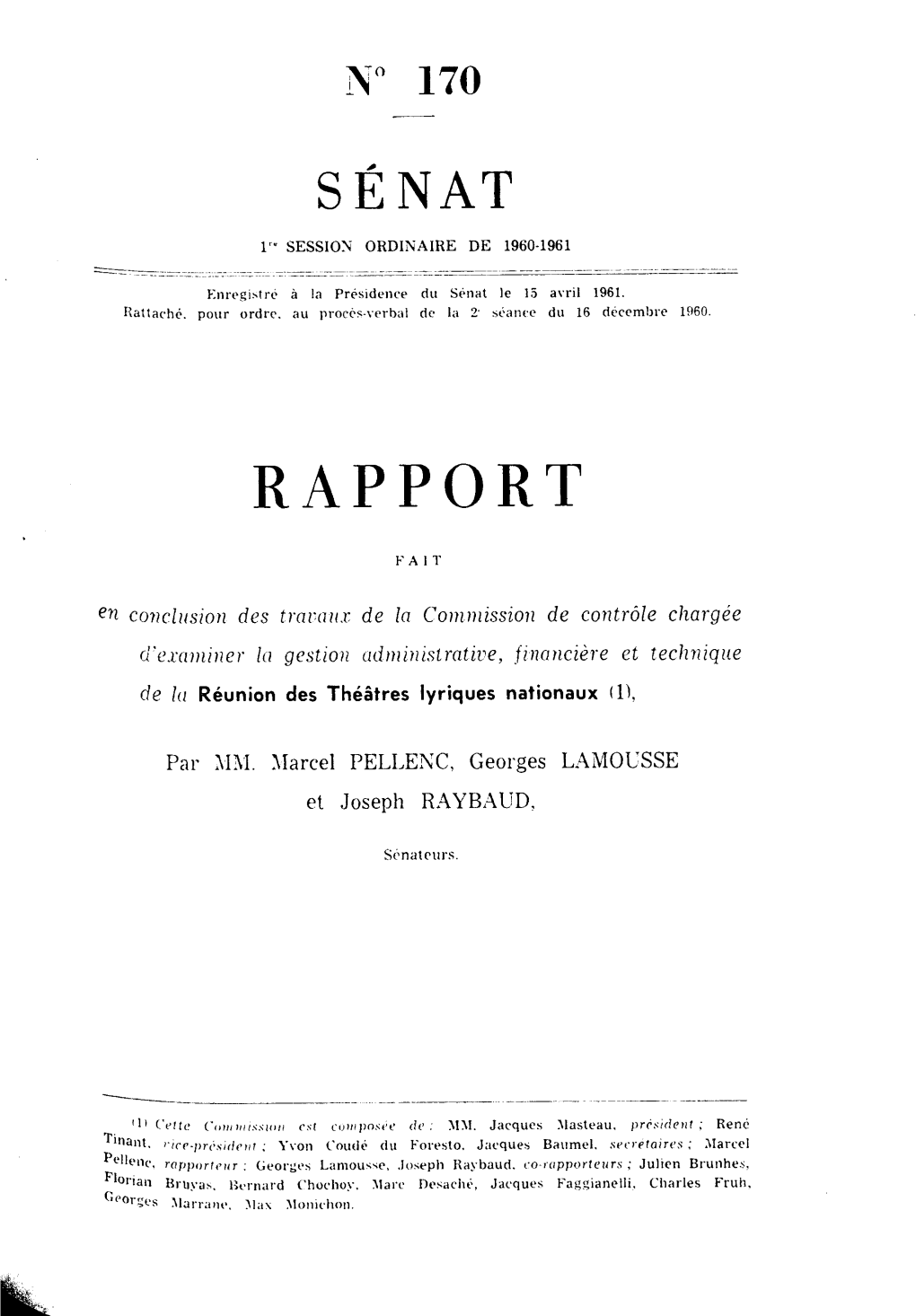
Load more
Recommended publications
-

Opera & Ballet 2017
12mm spine THE MUSIC SALES GROUP A CATALOGUE OF WORKS FOR THE STAGE ALPHONSE LEDUC ASSOCIATED MUSIC PUBLISHERS BOSWORTH CHESTER MUSIC OPERA / MUSICSALES BALLET OPERA/BALLET EDITION WILHELM HANSEN NOVELLO & COMPANY G.SCHIRMER UNIÓN MUSICAL EDICIONES NEW CAT08195 PUBLISHED BY THE MUSIC SALES GROUP EDITION CAT08195 Opera/Ballet Cover.indd All Pages 13/04/2017 11:01 MUSICSALES CAT08195 Chester Opera-Ballet Brochure 2017.indd 1 1 12/04/2017 13:09 Hans Abrahamsen Mark Adamo John Adams John Luther Adams Louise Alenius Boserup George Antheil Craig Armstrong Malcolm Arnold Matthew Aucoin Samuel Barber Jeff Beal Iain Bell Richard Rodney Bennett Lennox Berkeley Arthur Bliss Ernest Bloch Anders Brødsgaard Peter Bruun Geoffrey Burgon Britta Byström Benet Casablancas Elliott Carter Daniel Catán Carlos Chávez Stewart Copeland John Corigliano Henry Cowell MUSICSALES Richard Danielpour Donnacha Dennehy Bryce Dessner Avner Dorman Søren Nils Eichberg Ludovico Einaudi Brian Elias Duke Ellington Manuel de Falla Gabriela Lena Frank Philip Glass Michael Gordon Henryk Mikolaj Górecki Morton Gould José Luis Greco Jorge Grundman Pelle Gudmundsen-Holmgreen Albert Guinovart Haflidi Hallgrímsson John Harbison Henrik Hellstenius Hans Werner Henze Juliana Hodkinson Bo Holten Arthur Honegger Karel Husa Jacques Ibert Angel Illarramendi Aaron Jay Kernis CAT08195 Chester Opera-Ballet Brochure 2017.indd 2 12/04/2017 13:09 2 Leon Kirchner Anders Koppel Ezra Laderman David Lang Rued Langgaard Peter Lieberson Bent Lorentzen Witold Lutosławski Missy Mazzoli Niels Marthinsen Peter Maxwell Davies John McCabe Gian Carlo Menotti Olivier Messiaen Darius Milhaud Nico Muhly Thea Musgrave Carl Nielsen Arne Nordheim Per Nørgård Michael Nyman Tarik O’Regan Andy Pape Ramon Paus Anthony Payne Jocelyn Pook Francis Poulenc OPERA/BALLET André Previn Karl Aage Rasmussen Sunleif Rasmussen Robin Rimbaud (Scanner) Robert X. -

EDISON CYLINDERS Blue Amberols Are Housed in Fine Quality Reproduction Edison Orange Boxes Or in Original Boxes
EDISON CYLINDERS Blue Amberols are housed in fine quality reproduction Edison orange boxes or in original boxes. Wax cylinders are in padded boxes, either original or appropriately protective. Any mold on wax cylinders is always described. All grading is visual and refers to the cylinders rather than the boxes. 4354. 2-M 17139. CÉCILLE MERGUILLIER [s]. DOMINO NOIR: Un fée (Auber). Just about 1-2. $40.00. 4355. 2-M 15897. FRANZISKA KRUG-ELFGEN [s]. SCHLARAFFENDLAND: Walzerlied (Schleif- fahrt). Just about 1-2. $40.00. 4356. 2-M 18070. PIERRE CORNUBERT [t]. LA DAME BLANCHE: Ah! quel plaisir d’être soldat (Boieldieu). Just about 1-2. $75.00. 4353. 4-M Wax Amberol B-152. LEO SLEZAK [t] STÄNDCHEN (Schubert). Just about 1-2. $75.00. 4351. 4-M Wax Amberol B-165. FLORENCIO CONSTANTINO [t]. TOSCA: Recondita armonia (Puccini). Just about 1-2. $75.00. 4348. 4-M Wax Amberol B-166. BLANCHE ARRAL [s]. MIGNON: Polonaise (Thomas). Just about 1-2. $40.00. 4350. 4-M Wax Amberol B-174. ADELINA AGOSTINELLI [s], ATTILIO PAROLA [t]. LA BOHÈME: O soave fanciulla (Puccini). Just about 1-2. $75.00. 4349. 4-M Wax Amberol 30044. MARIE RAPPOLD [s]. CHANSON PROVENÇALE (Dell’Acqua) Just about 1-2. $40.00. 4352. 4-M Wax Amberol 844. HENRI SCOTT [bs]. O’ER THE FRESH GREEN FIELDS (Chami- nade). Just about 1-2. $20.00. 4363. 4-M Blue Amberol 2388. CLEMENTINE DE VERE SAPIO [s], VERNON ARCHIBALD [b]. ROSE OF THE MOUNTAIN TRAIL (Brennan). Archibald sings the main tune about Rose, who we hear vocalizing in the distance on the Mountain Trail. -

Les P'tites Michu
Collection « Opéra français / French opera » Editorial direction: Alexandre Dratwicki / Palazzetto Bru Zane Project management: Camille Merlin / Palazzetto Bru Zane Editorial consulting: Carlos Céster Design: Valentín Iglesias English translations by Charles Johnston © 2018 Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française San Polo 2368 – 30125 Venice – Italy bru-zane.com Digital edition of the book: © 2021 Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française Physical edition printed in Spain (ref. bz 1034 ) Legal deposit: Madrid, October 2018 – m-33137-2018 isbn : 978-84-09-05607-1 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the copyright owners and the publisher. Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française a pour vocation The vocation of the Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française la redécouverte et le rayonnement international du patrimoine musical français du is the rediscovery and international promotion of the French musical heritage of the grand xi x e siècle (178 0- 1920). Il s’intéresse aussi bien à la musique de chambre qu’au period 178 0- 1920. Its interests range from chamber music to the orchestral, sacred répertoire symphonique, sacré et lyrique, sans oublier les genres légers qui caractérisent and operatic repertories, not forgetting the lighter genres characteristic of the ‘esprit « l’esprit français » (chanson, opéra-comique, opérette). Installé à Venise dans un français’ (chanson, opéra-comique, operetta). The Centre was inaugurated in 2009 palais de 1695 restauré spécifiquement pour l’abriter, ce centre, inauguré en 2009, est and has its headquarters in a Venetian palazzo dating from 1695 specially restored une réalisation de la Fondation Bru. -

View Catalogue
J & J LUBRANO MUSIC ANTIQUARIANS © Marilyn Horne Museum and Exhibit Center, University of Pittsburgh at Bradford Autographs, Prints, & Memorabilia From the Collection of Marilyn Horne Part II: M-Z 6 Waterford Way, Syosset, NY 11791 USA Telephone 516-922-2192 [email protected] www.lubranomusic.com CONDITIONS OF SALE Please order by catalogue name (or number) and either item number and title or inventory number (found in parentheses preceding each item’s price). Please note that all material is in good antiquarian condition unless otherwise described. All items are offered subject to prior sale. We thus suggest either an e-mail or telephone call to reserve items of special interest. Orders may also be placed through our secure website by entering the inventory numbers of desired items in the SEARCH box at the upper right of our homepage. We ask that you kindly wait to receive our invoice to insure availability before remitting payment. Libraries may receive deferred billing upon request. Prices in this catalogue are net. Postage and insurance are additional. New York State sales tax will be added to the invoices of New York State residents. We accept payment by: - Credit card (VISA, Mastercard, American Express) - PayPal to [email protected] - Checks in U.S. dollars drawn on a U.S. bank - International money order - Electronic Funds Transfer (EFT), inclusive of all bank charges (details at foot of invoice) - Automated Clearing House (ACH), inclusive of all bank charges (details at foot of invoice) All items remain the property of J & J Lubrano Music Antiquarians LLC until paid for in full. -

Vegetable Insecticide Update
Vegetable Insecticide Update J. Holopainen Celeste Welty Extension Entomologist January 2017 Topics • Insecticides –New products –New uses –Cancelled products • Pests of concern • Results of recent trials • Information resources New product, 2017: Trident • Biological insecticide • B.t.t. = Bacillus thuringiensis tenebrionis • Colorado potato beetle, larvae only –Most effective on 1st instar larvae –Apply when eggs hatching –Must be ingested by beetles –Good coverage needed • a.i. same as ‘M-One’ & ‘Novodor’ • Made by Certis New product, 2016: BeetleGONE! • Biological insecticide • B.t.g. = Bacillus thuringiensis galleriae • Targets adults (!) & larvae: –Japanese beetle –Asiatic garden beetle –Pepper weevil • Must be ingested • Cease feeding within hours • Good coverage needed • Made by Phyllom BioProducts Coming soon? Spear • Biological insecticide • Registered: Spear T –For greenhouse use only –For thrips control • Not yet registered: –Spear O –Spear C –Spear P • Thrips, caterpillars, beetles, weevils • By Vestaron Corp. Closer & Transform • Re-established October 2016 –registered May 2013 –suspended Sept. 2015 –cancelled November 2015 • A.I.: sulfoxaflor (‘Isoclast’) • IRAC group 4C: –‘cousins’ of neonicotinoids (4A) –different subgroup than Admire sulfoxaflor Product Crop Pest Closer brassica leafy veg, plant bugs cucurbits, aphids fruiting veg, leafy veg, leafhoppers leaves of root/tuber crops whiteflies Transform potato plant bugs root/tuber (radish, beet, carrot) aphids beans (succulent) leafhoppers whiteflies New uses • Agri-Mek -

Opéras & Oratorios
CD (en rouge Opéra Magazine) Opéras & oratorios A Quiet Place Nagano (Decca) 141/80 Abencérages (Les) Giulini (Gala) 268/69 - Maag (Arts) 11/74 Abu Hassan Weil (DHM) 285/73 Aci e Galatea (Naumann) Bernius (Orfeo) 276/69 Acide Huss (Bis) 41/75 Acis and Galatea (Haendel) Christie (Erato) 238/71 - Haïm (Virgin) 280/69 - McGegan (Carus) 42/79 - Butt (Linn) 42/79 Acis y Galatea (Literes) Lopez Banzo (Deutsche Harmonia Mundi) 257/68 Actéon O’Dette/Stubbs (CPO) 63/78 Adelaide di Borgogna Carella (Opera Rara) 15/72 - Acocella (Naxos) 136/76 Adelia Neschling (Ricordi) 244/73 - Kuhn (RCA) 23/73 Adelson e Salvini Rustioni (Opera Rara) 130/80 Admetus Lewis (Ponto) 299/106 Adriana Lecouvreur Rossi (Hardy Classic) 251/60 - Masini (Gala) 251/61 - Masini (Myto) 251/61 - Gavazzeni (Myto) 273/68 - Del Cupolo (VAI) 296/79 - Bonynge (Decca) 12/77 - De Fabritiis (Testament) 107/76 Adriano in Siria Biondi (Fra Bernardo) 106/81 - Adamus (Decca) 122/75 Adrien Vashegyi (Ediciones Singulares/Palazzetto Bru Zane) 98/81 Affaire Makropoulos (L’) Mackerras (Decca) 02/13 - Mackerras (Chandos) 24/77 Agrippina Malgoire (Dynamic) 290/84 - Jacobs (Harmonia Mundi) 67/71 Ägyptische Helena (Die) Krips (RCA) 243/64 - Korsten (Dynamic) 265/70 Aida Molajoli (VAI) 258/68 - De Sabata (Eklipse) 258/68 - Keilberth (Preiser) 258/68 - Beecham (Arkadia) 258/68 - Panizza (Walhall) 258/68 - Pelletier (GOP) 258/68 - Serafin (EMI) 258/68 - Karajan (Arkadia) 258/68 - Cleva (Myto) 258/68 - Schröder (Myto) 258/68 - Barbirolli (Legato) 258/68 - Gui (Bongiovanni) 258/68 - Questa (Cetra) 258/68 -
André Messager
ANDRÉ MESSAGER ans la période qui va de 1880 à 1920 le théâtre lyrique en D France a connu son plein épanouissement : de Gounod à Saint-Saëns et à Reyer, en passant par l'école de Massenet. Parmi les animateurs de cette époque florissante il faut placer en haut rang André Messager sous son triple aspect de compositeur, de directeur et de chef d'orchestre. Sa brillante carrière est un exemple rare. Comme son ami Gabriel Fauré, il fut élève de l'Ecole Nieder- meyer où il entra dès l'âge de quinze ans. Arrivant de Montluçon où il avait reçu déjà une solide formation de l'organiste Albrecht, il devient l'élève de Gigout pour l'orgue, d'Adam Laussel et de De Bériot (qui fut le fils de la Malibran) pour le piano et pour la composition il fut celui de Camille Saint-Saëns, dont il a été, je crois bien, le seul véritable disciple. En 1875, âgé de vingt-deux ans il remporte le Grand prix de la Ville de Paris avec une symphonie en la mineur et majeur qui fut donnée avec succès aux Concerts Colonne, en première audition. Cette symphonie alerte, bien écrite, dans l'esprit de Haydn plutôt que de Mozart, j'ai eu la chance d'en retrouver le manuscrit il y a quelques années et de la faire publier par la Maison Choudens : elle a été une véritable révélation pour beaucoup de musiciens. On aurait pu croire que Messager deviendrait un symphoniste : il en fut tout autrement. L'éditeur Enoch lui demanda d'achever et d'orchestrer une opérette que laissait inachevée le compositeur Firmin Bernicat François les bas bleus. -

L'opéra Comique Et Ses Trésors
L’Opéra Comique et ses trésors Parcours de l’exposition par Agnès Terrier Le Centre national du costume de scène célèbre le Tricentenaire de l’Opéra Comique en 2015 en présentant une Les trésors de l’Opéra Comique sont nombreux : ses d’Offenbach, les créatures sorties de l’imagination du centaine de ses plus beaux costumes dans l’exposition L’Opéra Comique et ses trésors. Dans la ville natale d’Antoine costumes bien sûr, conservés au CNCS ou dans poète illustrent le thème de l’adaptation littéraire, si Dauvergne, l’un de ses premiers compositeurs, l’Opéra Comique vient raconter à Moulins son histoire mouvementée, les réserves du théâtre. Son répertoire assurément, féconde dans le répertoire lyrique. Dans la deuxième fait revivre son art du spectacle et présente les chefs-d’œuvre de son répertoire. constitué de milliers d’œuvres dont les titres les plus salle, la gracieuse Manon de Massenet mène un fameux de l’art lyrique français. Son théâtre aussi, cette carrousel de costumes caractéristiques des grandes Plan de l’exposition : salle Favart située au cœur de Paris, joyau de la Belle- périodes de l’histoire nationale. L’Opéra Comique s’en Époque. est souvent emparé de façon pittoresque, pour flatter le SALLE 4 SALLE 1 SALLE 9 SALLE 12 Ciboulette Giulietta SALLE 7 SALLE 8 Carmen Thérèse sentiment patriotique. La troisième salle entoure une Un théâtre pour la Poètes et Zémire et Jean Perier Impressions Travestis et socitété personnages Azor d’Espagne burlesques En cette année 2015 où l’Opéra Comique célèbre petite bohémienne, Mignon, de ces types européens qui son Tricentenaire, le CNCS s’est donné pour défi de ont figé tant d’images nationales dans le théâtre français. -

View Printable Playbill
Three Hundred Fifty-Seventh Program of the 2015-16 Season _______________________ Indiana University Ballet Theater presents its 57th annual production of Peter Ilyich Tchaikovsky’s The Nutcracker Ballet in Two Acts Scenario by Michael Vernon, after Marius Petipa’s adaptation of the story “The Nutcracker and the Mouse King” by E. T. A. Hoffman Michael Vernon, Choreography Andrea Quinn, Conductor C. David Higgins, Set and Costume Design Patrick Mero, Lighting Design The Nutcracker was first performed at the Mariinsky Theatre of St. Petersburg on December 18, 1892. ____________ Musical Arts Center Thursday vening,E December Third, Seven-Thirty O’Clock Friday Evening, December Fourth, Seven-Thirty O’Clock Saturday Afternoon, December Fifth, Two O’Clock Saturday Evening, December Fifth, Seven-Thirty O’Clock Sunday Afternoon, December Sixth, Two O’Clock music.indiana.edu Thursday, December 3, 2015 | 7:30 p.m. Act I Prologue Urchins . Delachaise Cusack, Julia Irmscher, Elaina LaFollette, Jacqueline Smith Passerby . Morgan Buchart Maids . Colleen Buckley and Danielle Cesanek Tradesperson . Alexandra Willson Party Scene Clara . Aika Noguchi Fritz . David Baumann Herr Drosselmeyer . Christian Claessens Frau Silberhaus . Raffaella Stroik Herr Silberhaus . Colin Ellis Grandmother . Magaret Andriani Grandfather . Eli Downs Adult Guests . Caroline Atwell, Scout Inghilterra, Abigail Kulwicki, Ryan McCreary Julian Goodwin-Ferris, Nicholas Gray, Antonio Houck, Darren Hsu Child Guests . Katie Apple, Abby Arvin, Essie Cheng, Tara Ganguly, Sophia Ramlo, Alexandria Robbins, Faith Stimson, Ivy Yoder Columbine Dolls . Alexandra Hartnett and Bethany Green Harlequin Doll . Andrew Copeland Dream Scene Baby Mice . Alison Bowman, Stella Ham, Siena Johnson, Anastasia Sugimoto The Battle Nutcracker . Tyler Dowdy Soldiers . Alaena Cimmer, Stephanie Cimmer, Isha Harbaugh, Koel Harbaugh, Aubrie Hubbard, Julia Irmscher, Addison Keller, Elaina LaFollette, Sophia Noel, Anton Rose-Nichols, Jacqueline Smith, Kate Williamson Officers . -

3-2019 Vocal, A-Fan, Pp. 20-53
78 rpm VOCAL RECORDS “FAMOUS BARITONE ” Russian Artistotipia records (1910-15 period) bore an oval area on the upper portion of the label which would present a portrait of the artist. The item below has three stars in place of the artist portrait (see illustrated labels section), who is identified on the label (in Russian) as “famous baritone”. I sent tapes in 1989 to Aida Favia-Artsay and Syd Grey for help in identification. Aida, in a letter to be included with the record, said “I know he is Giraldoni”. I didn’t think so, and she replied, “While I am convinced you have one of the most delightful rarities, you seem to be set on deprecating its intrinsic (and monetary) value. Oh well – after all it’s your record.” On the other hand, Syd Grey wrote, “It is not a mystery baritone but is confirmed as (George) Baklanov. Jim Dennis and I have done work on an Artistotipia catalogue and a friend in Kiev confirmed that it was Baklanov. He saw the files and it was stated that Baklanov was paid for the record. The reason was he had an exclusive Amour (Russian Gramophone) contract and couldn’t record for anyone else.” This letter is also included with the disc below. Who’s right ? … or it it yet some another baritone? Interestingly, Artistotipia records were usually recorded at about 70 rpm (although not mentioned on the label), presumably to make a somewhat longer playing item. 2540. 12” Artistotopia 417/418. RIGOLETTO: Cortigiani (Verdi) / BORIS GODOUNOV: Aria (Moussorgsky). 2. $60.00. -

André Messager: Les P’Tites Michu
andré messager: les p’tites michu André Messager: a biographical outline Christophe Mirambeau André Messager was born on 30 December 1853 at Montluçon, in the Allier département , into a bourgeois family with no musicians in it. Wishing to give their child a good education, the parents entrusted him to the Marist Brothers, whose curriculum included piano lessons. The Messagers suddenly found themselves ruined shortly before the Franco-Prussian War. Since young André had shown some talent for music and the piano, they obtained a scholarship that enabled them to send him to the famous École Niedermeyer, where he studied from 1869 until 1874 – including the war years, during which the school was evacuated to Switzerland. His teachers were Eugène Gigout (counterpoint), Adam Lausel (piano) and Clément Lauret (organ), and later Gabriel Fauré and Camille Saint-Saëns – two of the leading personalities of French music, to whom Messager was always to remain very close. He was only twenty- one when Fauré passed on to him his post as organist of Saint-Sulpice so that the older man could replace Saint-Saëns, who was frequently absent, at the Madeleine. Messager remained at Saint-Sulpice until 1880, when he moved on to the churches of Saint-Paul-Saint-Louis (1881) and Sainte- Marie-des-Batignolles (188 2- 84). While fulfilling his liturgical obliga - tions, he embarked on a career as a composer. His First Symphony , which won a prize in the competition of the Société des Auteurs and Compositeurs in 1876, was premiered at the Concerts Colonne on 20 January 1878; his 54 cantata Prométhée enchaîné won second prize at the Concours Musical de la Ville de Paris of 1877.