Annibal a Chamoux Azan 4
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
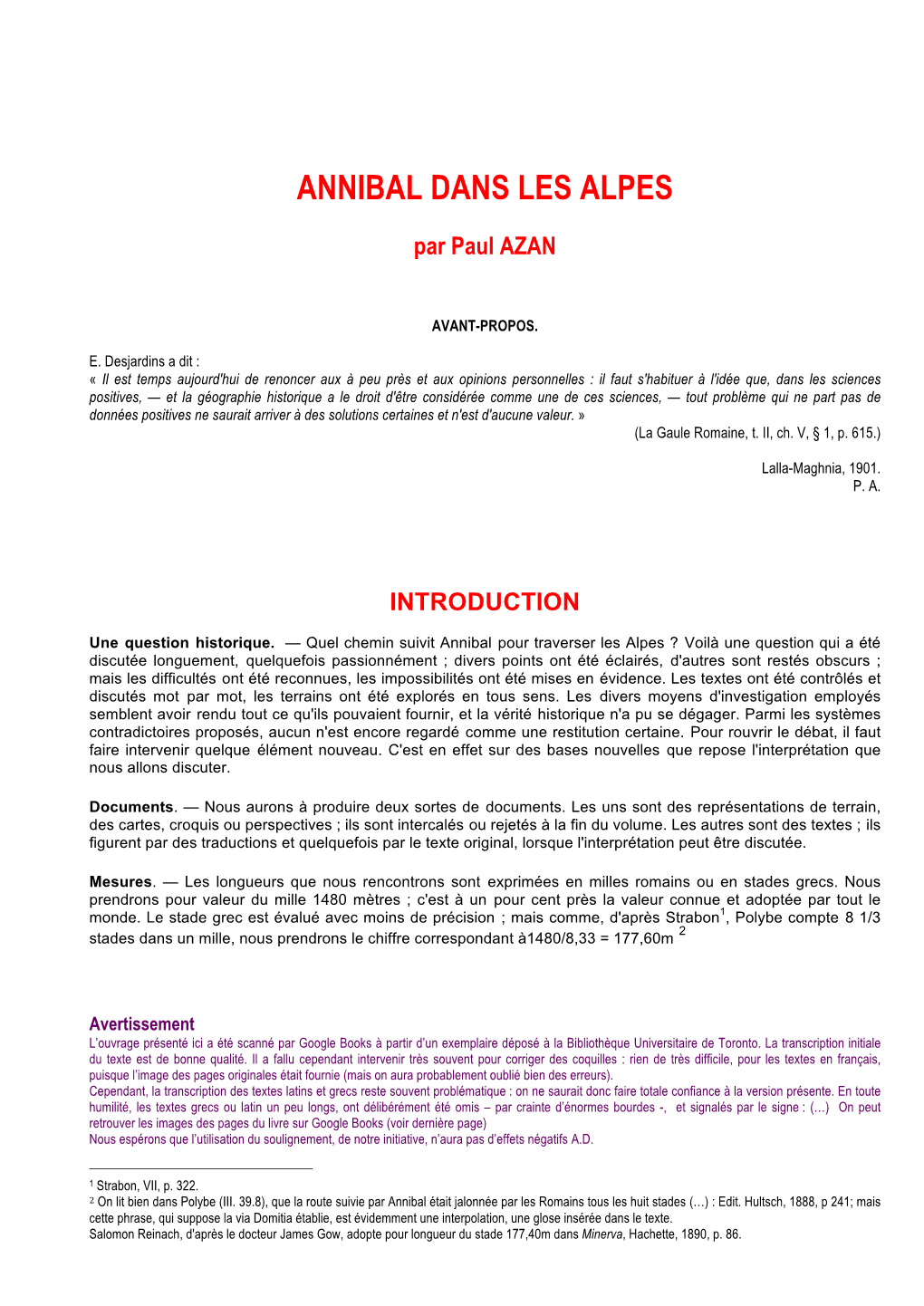
Load more
Recommended publications
-
Travaux Scientifiques
MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA NATURE Travaux Scientifiques du Parc National de la Vanoise Recueillis et publiés sous la direction de M. BARDEL Directeur du Parc National et P. OZENDA Correspondant de l Institut Professeur à l'Université de Grenoble Tome IV 1974 Cahiers du Pare National de la Vanoise 15, rue du Docteur-Jultiand 73000 - CHAMBÉRY - (France) COMPOSITION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DU PARC NATIONAL DE LA VANOISE Président ; *M, Paul VAYSSIERE, Professeur honoraire au Muséum National d'His- toire Naturelle, Vice-Président : *M. Philippe TRAYNARD, Professeur à l'Université de Grenoble, Vice- Président du C.A.F. Secrétaire : *M. Paul OZENDA, Correspondant de l'Institut, Professeur à l'Université de Grenoble. Wiembres du Comité : *M. Clément BRESSOU, Membre de l'Institut, Secrétaire général du Conseil National de la Protection de la Nature. M, Roger BUVAT, Membre de l'Institut, Professeur à l'Université de Marseille-Luminy. Mlle Camille BULARD, Professeur à l'Université de Nice. M. Paul BARRUEL, Attaché au Muséum National d'Histoire Naturelle. M. Roger BENOIST, Président de la Société d'Histoire Naturelle de la Savoie. M. Jean BOURGOGNE, Sous-Direcfeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. M:. Louis de CRECY, Ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Grenoble. M. Charles DEGRANGE, Professeur à l'Université de Grenoble. M. Philippe DREUX, Professeur à l'Université de Paris. M. François ELLENBERGER, Professeur à l'Université de Paris-Orsay. M. Pierre GENSAC, Maître de Conférences au Centre Universitaire de Savoie (Chambéry). M. Paul GIDON, Professeur au Centre Universitaire de Savoie (Chambéry) . -

Territoire De Maurienne Du Patrimoine Naturel
Mémento du patrimoine naturel Territoire de Maurienne Utilisez le sommaire ci-après pour naviguer dans le document ! Cliquez sur le numéro de page pour revenir au sommaire. Édito p. 1 Les clés p. 2 à 15 du patrimoine naturel Le patrimoine p. 16 à 86 naturel par commune Le patrimoine naturel p. 87 à 111 en chiff res Bibliographie p. 112 Édito Annexes p. 114 Précisions sur les zonages du patrimoine naturel Des sources glaciaires de l’Arc à sa confl uence avec l’Isère, en passant par les diff érentes vallées latérales qui s’enfoncent dans la montagne, le Pays de Maurienne dévoile la richesse de ses paysages, assise sur la diversité et la complexité de ses patrimoines naturel et géologique. Avec ses 150 000 ha de zones à forte valeur biologique, véritable atout pour les habitants et les visiteurs, le territoire représente 24 % de zones reconnues d’intérêt pour le département, dont un parc national, 4 sites classés en protection de biotope et 8 sites Natura 2000. Cet ouvrage vous off re de parcourir ce vaste territoire en vous contant l’essentiel du patrimoine naturel mauriennais. Un “essentiel” qui parfois se traduit par la présence d’espèces remarquables qui se trouvent à vos portes, à vos pieds. Mais un “essentiel” qui va au-delà, parce que la nature et l’homme dans la nature, ont un destin lié. Les grands enjeux mondiaux en matière de changements climatiques, de perte de biodiversité ou de ressources en eau peuvent se retrouver en modèle réduit, comme un échan- tillon représentatif, au niveau de nos bassins de vie. -

Schema Departemental Des Carrieres De La Savoie
PREFECTURE DE LA SAVOIE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DE LA SAVOIE Mars 2006 Société des Carrières de Bellecombe à Bellecombe en Bauges - Photo UNICEM TOME III : DOCUMENTS GRAPHIQUES SGR Rhône-Alpes SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DE LA SAVOIE TOME III : DOCUMENTS GRAPHIQUES SOMMAIRE CARTE ET LISTE DES CARRIERES EN ACTIVITE OU EN COURS DE REAMENAGEMENT CARTE DES RESSOURCES CONNUES EN MATERIAUX DE CARRIERES CARTES DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES Carte 1 – ESPACES PROTEGES OU ESPACES GERES : - liste des Forêt de protection du Département de la Savoie - liste des Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope - liste des Réserves Naturelles - liste des Réserves biologiques domaniales et réserves biologiques forestières - liste des Sites classés - liste des Sites en projet de classement - liste des ZPPAUP - liste des sites inscrits - liste des monuments historiques et de leurs abords Carte 2 – LES ENGAGEMENTS ET LES INVENTAIRES SCIENTIFIQUES INTERNATIONAUX, LES PARCS REGIONAUX - liste des Zones de Protection spéciale - liste des Zones d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) - liste des sites proposés à la Communauté Européenne au titre de la directive « Habitats » Carte 3 – AUTRES INVENTAIRES - liste de l'inventaire Régional des Tourbières (sites des tourbières et bassins versant associés - liste des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 et 2 (ZNIEFF) - liste des sites géologiques remarquables Carte 3 bis – ZNIEFF de type I en cours de validation du Département de la Savoie Carte 4 - FAUNE, -

Défense De La Maurienne En 1939-1940 : La Fortification, Investissement Rentable
Défense de la Maurienne en 1939-1940 : la fortification, investissement rentable Autor(en): Stroh, P.-G. Objekttyp: Article Zeitschrift: Revue Militaire Suisse Band (Jahr): 135 (1990) Heft 4 PDF erstellt am: 04.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-344992 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch DEFENSE DE LA MAURIENNE EN 1939-1940 La fortification, investissement rentable par le lieutenant-colonel P.-G. Stroh Le major J. J. Rapin' a traite un sujet connexe dans la RMS NT 9 de septembre 1977.11 exposait en particulier I 'action glorieuse du sous-lieutenant Prudhon et de ses hommes au fort ancien de la Petite-Turra du col du Grand-Mont-Cenis. -

Travaux Scientifiques
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ISSN 0180-961 X DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA NATURE Travaux du National de la Vanoise Recueillis et publiés sous la direction de C. PAIRAUDEAU Directeur du Parc National et P. OZENDA Membre de l'Institut Professeur à l'Université de Grenoble Tome XII 1982 Cahiers du Parc National de la Vanoise 135, rue du Docteur Julliand B.P. 105, 73003 CHAMBÉRY (France) ISSN 0180.961 X Parc National de la Vanoise, Chambéry, France, 1982 COMPOSITION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DU PARC NATIONAL DE LA VANOISE Président honoraire : M. Paul VAYSSIÈRE, Professeur honoraire au Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris. Président : M. Philippe TRAYNARD, Président honoraire de l'Institut National Polytech- nique de Grenoble. Vice-Président : M. Denys PRADELLE, Architecte.Urbaniste, Chambéry. Secrétaire : M. Paul OZENDA, Membre de l'Insfcitut, Professeur à l'Université l de Grenoble. Membres du Comité : M. Maurice BARDEL, Ancien Directeur du Parc National de la Vanoise, Ingénieur général du G.R.E.F. M. Roger BUVAT, Membre de l'Institut, Professeur à l'Université de Marseille- Luminy. M. Louis de CRECY, Ingénieur en chef du Génie Rural des Eaux et Forêts, Délégué aux actions R.T.M. M. Charles DEGRANGE, Professeur à l'Université l de Grenoble. M. René DELPECH, Professeur à l'Institut National Agronomique, Paris- Grignon. M. Philippe DREUX, Professeur à l'École Normale Supérieure, Paris. M. François ELLENBERGER, Professeur à l'Université de Paris-Orsay. M. René FONTAINE, Ingénieur général honoraire du Génie Rural des Eaux et Forêts, Evian. M, R.P. FRITSCH, Président de la Société d'Histoire Naturelle de la Savoie. -

Névache – Bardonecchia – Modane
COUV NEVACHE 11/01/07 16:37 Page 1 799 NÉVACHE – BARDONECCHIA – MODANE NÉVACHE – BARDONECCHIA – par MODANE J.-C. BARFÉTY, R. POLINO, D. MERCIER, R. CABY, J.-C. FOURNEAUX La carte géologique à 1/50 000 NÉVACHE – BARDONECCHIA – MODANE est recouverte par les coupures suivantes de la Carte géologique de la France à 1/80 000 : au Nord-Ouest : SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (N° 179) au Nord-Est : BONNEVAL – TIGNES (N° 179 bis) au Sud-Ouest : BRIANÇON (N° 189) Saint-Jean- Modane Lanslebourg de-Maurienne NÉVACHE La Grave Saint- BRGM Christophe- Briançon SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL en-Oisans B.P. 36009 - 45060 ORLÉANS CEDEX 2 - FRANCE COUV NEVACHE11/01/0716:37Page2 R. WYNS D. MARQUER,P.NEHLIG,ROSSI,J.THIERRY,VASLET, F. HANOT,P.LEDRU,J.LEMÉTOUR,MARCOUX, D. GRANDPERRIN,P.GUENNOC,F.GUILLOCHEAU, T. BAUDIN,M.BRUNEL,J.-L.DURVILLE,FAURE, Secrétaire Général Président COMITÉ DE LA CARTE GÉOLOGIQUE COMITÉ DELACARTE Les recommandationspourfaireréférence àcedocument : J.-M.LARDEAUX; SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL GÉOLOGIQUE SERVICE 20 cm se trouventenpage2delanotice 10 Km : D.JANJOU; DE LAFRANCE 19 BRGM 9 18 Vice-Président Membres 17 8 16 : J.DUBREUILH; : J.-P.BARBEY, 15 7 14 13 6 12 11 5 10 omissions qu’ilsaurontpuconstater. géologique national(SecrétariatdelaCartegéologique)leserreursou chelle 1/50 000 9 É Il seratenucomptedeleursobservationsdanslaprochaineédition. Les utilisateursdecettecartesontpriésfaireconnaîtreau 4 8 7 Achevé d’imprimerpar par OUDINImprimeur Dépôt légalN° 1832 Poitiers (France) 3 6 Décembre 2006 5 Texte vectorisé I O. U D I N S N R I O. U D I N S N O R M O M M M E E E V E M I V T 2 4 M N A . -

Animation Du Plan Pastoral Territorial De Maurienneerreur ! Signet Non Défini
Plan Pastoral dduudu TTeerritrritooTerritoireTerritoiireirere de Maurienne Etat des lieux et enjeux partagépartagéssss dduudu ddoommaiainneedomaine ppasasttoorralalpastoral Programme d’actions 20092009----2013202013132013 JJuinJuiinnu 220000992009 Réalisation : Crédits Photos : GIDA Haute Maurienne SEA de Savoie Un Préalable : la problématique des grands prédateurs La problématique prédation a été évoquée lors de toutes les réunions (locales et comités de pilotage). Elle constitue un facteur d’interrogation et d’inquiétude chez tous les acteurs et habitants de Maurienne cependant le comité de pilotage refuse qu’elle soit traitée au sein du Plan Pastoral Territorial de Maurienne. C’est pourquoi, le sujet des « prédateurs » est traité hors PPT. LLee loup présent depuis 1997 La présence du loup a été confirmée sur le département de la Savoie en septembre 1997 suite à une série d’attaques dans le secteur de la Haute-Maurienne. Depuis, sa présence a été confirmée et s'étend sur tout le département ainsi que sur les départements voisins. Bilan des attaques de grands prédateurs sur les troupeaux ovins-caprins années 2004-2008 (Source DDAF septembre 2008). L’ensemble des conclusions quant à l’origine de la prédation (essentiellement loup et lynx) n’est pas encore arrêté. Somme animaux tués, Somme animaux tués, Somme animaux tués, Somme animaux tués, Massif blessés et disparus 2005 blessés et disparus blessés et disparus 2007 blessés et disparus 2008 2006 34 19 64 dt 3bovins 92 Belledonne 33 273 498 dt 3 bovins 27 Encombres Lauzière 11 18 93 6 Beaufortain 29 dt 24 caprins et 1 bovin 11 Bauges Maurienne rive droite et gauche 543 287 235 dt 16 caprins et 3 bovins 230 de l'Arc Tarentaise, Vanoise 30 52 6 157 651 649 927 523 Total 150 victimes en 2 505 victimes en 1 30 victimes en 1 remarques dérochements dérochement dérochement 179 117 101 125 Nb attaques 71 50 66 57 Nb troupeaux concernés Sur le département de la Savoie, hormis l'année 2007 qui a vu le nombre de victimes fortement évoluer du à un dérochement, puis ce nombre se stabilise en 2008. -

PAPI D'intention Du Bassin Versant De L'arc
PAPI d’intention du bassin versant de l’Arc Syndicat du Pays de Maurienne Avril 2021 Dossier de candidature du PAPI d’intention de l’Arc – Syndicat du Pays de Maurienne – Avril 2021 SOMMAIRE 1 Préambule .................................................................................................. 5 2 Préliminaires .............................................................................................. 6 3 Présentation du territoire ........................................................................... 7 3.1 Caractéristiques physiques du bassin versant .............................................................................. 7 3.1.1 Cadre géographique .............................................................................................................. 7 3.1.2 Réseau hydrographique ........................................................................................................ 8 3.1.3 Climat .................................................................................................................................... 9 3.1.4 Géologie et hydrogéologie .................................................................................................. 13 3.1.5 Environnement et patrimoine naturel ................................................................................ 15 3.1.6 Population et évolutions démographiques ......................................................................... 18 3.1.7 Occupation du sol et activités humaines ........................................................................... -

BRAMANS COMMUNE DE VAL Réunion Du 17/09/2018
CENIS BRAMANS - COMMUNE DE VAL Réunion du 17/09/2018 RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME Réunion Publique de concertation n°1 – Diagnostic communal 1 SOMMAIRE 1.QU’EST-CE QU’UN PLAN LOCAL D’URBANISME ? 2.DIAGNOSTIC TERRITORIAL & ENJEUX DE LA COMMUNE 3.CAPACITÉS DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DE L’ESPACE BÂTI 4.ANALYSE PAYSAGÈRE & URBAINE 5.PATRIMOINE CULTUREL 6.EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (Partie Agnès GUIGUE) 7.SUITE DE LA PROCÉDURE AGENCE VIAL & ROSSI – PLU : Réunion Publique de concertation n°1 (Bramans) 17 septembre 2018 2 1 QU’EST-CE QU’UN PLAN LOCAL D’URBANISME ? 3 QU’EST-CE QU’UN PLAN LOCAL D’URBANISME ? Les évolutions des documents d’urbanisme Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains de 2000) en réaction à l’éclatement spatial, social et des fonctions urbaines création du Plan Local d’Urbanisme (PLU) avec 3 principes fondamentaux. Le PLU est l’expression d’un PROJET COMMUNAL, qui implique: • Des choix • Une justification de ces choix de développement et d’aménagement • Une volonté de mise en œuvre et de maîtrise du projet • Une réflexion à échéance temporelle plus courte Un fil conducteur: la réduction de la consommation de l’espace. AGENCE VIAL & ROSSI – PLU : Réunion Publique de concertation n°1 (Bramans) 17 septembre 2018 4 QU’EST-CE QU’UN PLAN LOCAL D’URBANISME ? Les évolutions des documents d’urbanisme Loi portant Engagement National pour l’Environnement (Grenelle) de 2010: • Dimension environnementale accrue des PLU: objectifs nouveaux de lutte contre les gaz à effet de serre, maîtrise de l’énergie, préservation des continuités écologiques, maîtrise de la consommation de l’espace.