La Maitrise Ès Arts (Histoire)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

An Engineer's Outline of RCN History, Part
An Engineer’s Outline of Canadian Naval History, Part III (1970-2014) Richard W. Greenwood L’histoire de l’ingénierie de la Marine canadienne dans l’ère après-RCN (« COMAR ») se caractérise principalement comme l’ère de la frégate de la classe Halifax. Grâce à la conception, l’intégration et la construction, le développement ultérieur et le déploiement, la frégate canadienne de patrouille a symbolisé la croissance et la maturation techniques de la marine canadienne, évoluant de la poursuite d’une voie indépendante de développement pour répondre aux exigences opérationnelles du service national, jusqu’à la coopération, l’interdépendance et l’interopérabilité face aux défis multi-nationales communes. A cette même époque, la marine a également démontré cette évolution à travers un certain nombre d’autres développements en matière de capacité, tels le remplacement des sous-marins, le lancement de programmes de remplacement des navires de réapprovisionnement, une capacité de présence dans l’Arctique, et un remplacement pour destroyers et frégates. Les leçons longues et dures apprises au cours de chacun de ces projets ont positionné la marine pour réussir matériellement en entrant dans son deuxième siècle. La fin du document comprend un sommaire de perspectives sur un siècle de l’ingénierie navale canadienne. In The RCN in Retrospect, the proceedings of the first of these Canadian naval historical conferences, Captain Jim Knox authored a 2-part paper entitled “An Engineer’s Outline of RCN History” covering the period 1910-68.1 This reviewed the technical history and experience of the RCN from 1910 up to integration and unification in the late-1960s, culminating in the transition of the Royal Canadian Navy into Maritime Command (MARCOM). -

Let's Go Skating
REUNION EDITION NEWS FROM ICE CAPADES ALUMNI January 2016 Let’s Go Skating Nathan Phillips Square – Toronto Rockefeller Center – New York City Rideau Canal – Ottawa Cosmopolitan Hotel – Las Vegas Our Alumni in the News How I Got There: Otto Jelinek As told to Lan Anh Vu Otto Jelinek is currently Canadian Ambassador to the Czech Republic. As a former refugee from Communism, he has a high-level track record. Jelinek was a world championship figure skater, winning the 1962 pairs title with his sister Maria. After becoming a world figure skating champion, Jelinek was also successful in his next venture as a skating goods manufacturer. That was followed by a political career with the Progressive Conservative Party of Canada that included a sequence of ministerial positions concerned with amateur sport, supply and services, and national revenue. Jelinek left politics in 1993 and moved to the Czech Republic and became chairman of Deloitte Central Europe, among other positions. Lan Anh Vu found some time in his busy schedule to talk to him about his professional journey, the challenges he faced and his advice for young people. My Career in Sports, Business, Politics and Diplomacy My sister and I never thought when we skated that one day we could be the world champions. We had the determination to do our best and work towards being the best in whatever we did. We went from competitive scaling to professional scaling, performing in a professional live show. This led to the opportunity to make some money in professional skating. I used that money to invest in business and manufactured figure and hockey skates. -

Our Alumni in the News
REUNION EDITION NEWS FROM ICE CAPADES ALUMNI July 2016 Our Alumni in the News Figure Skating Olympic silver medalist Elizabeth Manley shares her story of depression and resilience in Stratford By Laura Cudworth, The Beacon Herald Elizabeth Manley was guest speaker at the annual general meeting of the Stratford General Hospital Foundation this week. Laura Cudworth/The Beacon Herald It was an unforgettable moment for the whole country. Elizabeth Manley skating off the ice wearing a white cowboy hat thrown from the crowd after nailing the long program at the 1988 Olympics in Calgary. An effervescent blonde without an ounce of pretension, she beat out American Debi Thomas for the silver medal in figure skating and nearly knocked East German skater Katarina Witt off the top of the podium. Overall the Calgary Olympics were not the games the country had been hoping for. The games were nearing the end when Manley won the long program. She became Canada's Sweetheart in an instant. “I was an underdog. I wasn’t expected to win a medal. I feel the country was just kind of starting to fade off a little bit and I came out of nowhere and had this amazing skate. It doesn’t matter who I run into today they know exactly where they were sitting at that moment. I even had a lady in labour that held back just so she could see me skate. Some of the stories I’ve heard are just incredible.” But the road to get there was harder than anyone knew. Like all elite athletes she devoted herself to her sport but there were hurdles to overcome that made reaching the top even harder. -
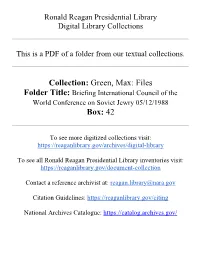
Collection: Green, Max: Files Box: 42
Ronald Reagan Presidential Library Digital Library Collections This is a PDF of a folder from our textual collections. Collection: Green, Max: Files Folder Title: Briefing International Council of the World Conference on Soviet Jewry 05/12/1988 Box: 42 To see more digitized collections visit: https://reaganlibrary.gov/archives/digital-library To see all Ronald Reagan Presidential Library inventories visit: https://reaganlibrary.gov/document-collection Contact a reference archivist at: [email protected] Citation Guidelines: https://reaganlibrary.gov/citing National Archives Catalogue: https://catalog.archives.gov/ WITHDRAWAL SHEET Ronald Reagan Library Collection Name GREEN, MAX: FILES Withdrawer MID 11/23/2001 File Folder BRIEFING INTERNATIONAL COUNCIL & THE WORLD FOIA CONFERENCE ON SOVIET JEWRY 5/12/88 F03-0020/06 Box Number THOMAS 127 DOC Doc Type Document Description No of Doc Date Restrictions NO Pages 1 NOTES RE PARTICIPANTS 1 ND B6 2 FORM REQUEST FOR APPOINTMENTS 1 5/11/1988 B6 Freedom of Information Act - [5 U.S.C. 552(b)] B-1 National security classified Information [(b)(1) of the FOIA) B-2 Release would disclose Internal personnel rules and practices of an agency [(b)(2) of the FOIA) B-3 Release would violate a Federal statute [(b)(3) of the FOIA) B-4 Release would disclose trade secrets or confidential or financial Information [(b)(4) of the FOIA) B-8 Release would constitute a clearly unwarranted Invasion of personal privacy [(b)(6) of the FOIA) B-7 Release would disclose Information compiled for law enforcement purposes [(b)(7) of the FOIA) B-8 Release would disclose Information concerning the regulation of financial Institutions [(b)(B) of the FOIA) B-9 Release would disclose geological or geophysical Information concerning wells [(b)(9) of the FOIA) C. -
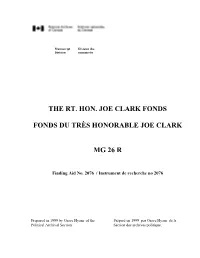
Complete Fa.Wpd
Manuscript Division des Division manuscrits THE RT. HON. JOE CLARK FONDS FONDS DU TRÈS HONORABLE JOE CLARK MG 26 R Finding Aid No. 2076 / Instrument de recherche no 2076 Prepared in 1999 by Grace Hyam of the Préparé en 1999 par Grace Hyam de la Political Archival Section. Section des archives politique. Table of Contents File lists, by series and sub-series: Pages R 1 MEMBER OF PARLIAMENT SERIES R 1-1 Member of Parliament, 1972-1976, Correspondence Sub-series .......... 1-22 R 1-2 Member of Parliament, 1972-1976, Subject files Sub-series ............ 23-45 R 1-3 Member of Parliament, 1983-1984, Sub-series ....................... 46-51 R 2 LEADER OF THE OPPOSITION, 1976-1979, SERIES R 2-1 Correspondence Sub-series ............................... 52-264 R 2-2 Subject Files Sub-series................................. 265-282 R 2-3 Staff - Jim Hawkes Sub-series............................ 283-294 R 2-4 Joe Clark Personal Sub-series ............................ 295-296 R 2-5 Staff - Ian Green Sub-series.............................. 297-301 R 2-6 Staff - Bill Neville Sub-series ............................ 302-304 R 3 PRIME MINISTER’S OFFICE SERIES R 3-1 PMO Correspondence Sub-series ......................... 305-321 R 3-2 PMO Correspondence - Indexes Sub-series ................. 322-323 R 3-3 PMO Subject files Sub-series ............................ 324-331 R 3-4 PMO Staff - Lorne Fox Sub-series ........................ 332-335 R 3-5 PMO Staff - Adèle Desjardins Sub-series................... 336-338 R 3-6 PMO Staff - Marjory LeBreton Sub-series .................. 339-341 R 3-7 PMO Communications Sub-series......................... 342-348 R 4 LEADER OF THE OPPOSITION, 1980-1983, SERIES R 4-1 Correspondence Sub-series ............................. -

Fédération Des Communautés Francophones Et Acadienne Du
Centre de recherche en civilisation canadienne-française Documents de travail 29 Ré perte ) i re nu méri q u e détaillé du fonds de la Fédération des francophones hors Québec RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS DE LA FÉDÉRATION DES FRANCOPHONES HORS QUÉBEC par Hélène Cadieux Documents de travail du Centre de recherche en civilisation canadienne- française Ottawa Centre de recherche en civi1isation canadienne-française Université d'Ottawa 1989 La collection «Documents de travail du Centre de recherche en civilisation canadienne-française» vise à assurer une diffusion limitée d'instruments de recherche portant sur le Canada français. Elle accueille plus particulièrement les travaux appartenant à la catégorie des guides, listes, catalogues, répertoires, inventaires ou index. Les documents faisant l'objet d'étude peuvent être manuscrits ou imprimés, sonores, visuels ou muséologiques. Les manuscrits destinés à cette collection sont soumis à l'évaluation d'un comité. Collection dirigée par Andrf Lapierre André LaRose Lu ie Page Copyright Ott îwa 1989 par le CRCCF Tous droits réservés pour tous les pays. La reproduction d'un extrait quelconque de ce livre, par quelque procédé que ce soit, tant électronique que mécanique, en particulier par photocopie et par microfilm, est interdite sans 1'autorisation écrite du CRCCF. RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS DE LA FÉDÉRATION DES FRANCOPHONES HORS QUÉBEC Dans la même collection: 1. Inventaire des chercheurs sur le Canada français à l'Université d'Ottawa. 2. Répertoire des chercheurs sur la vie française en Ontario. 3. Livres conservés au Centre de recherche en civilisation canadienne-française. 4. Inventaire des documents de l'Association canadienne-française d'Ontario, volume I. -

Canadian Figure Skating Championships Championnats Canadiens De Patinage Artistique
Canadian Figure Skating Championships Championnats canadiens de patinage artistique Canadian Figure Skating Championships Championnats canadiens de patinage artistique Men/hommes Senior Junior Novice 1905 1 Ormond B Haycock (Minto SC) 1906 1 Ormond B Haycock (Minto SC) 1907 No competition - Minto Skating Club rink destroyed by fire/Pas de compétition.La patinoire du Club de patinage Minto a été détruite par un incendie 1908 1 Ormond B Haycock (Minto SC) 1909 no competition/pas de compétition 1910 1 Douglas H Nelles (Minto SC) 1911 1 Ormond B Haycock (Minto SC) 2 J Cecil McDougall 1912 1 Douglas H Nelles (Minto SC) 1913 1 Philip Chrysler (Minto SC) 2 Norman Scott (Minto SC) 1914 1 Norman Scott (Montreal WC) 2 Philip Chrysler (Minto SC) 1915-1919 No competitions held due to World War I | Compétition annulée à cause de la Première Guerre mondiale 1920 1 Duncan Hodgson (Montreal WC) 2 John Machado (Minto SC) 3 Melville Rogers (Toronto SC) 1921 1 Norman Scott (Montreal WC) 2 Duncan Hodgson (Montreal WC) 3 Melville Rogers (Toronto SC) 19221 Duncan Hodgson (Montreal WC) 2 Melville Rogers (Toronto SC)} 3 John Machado (Minto SC) 1923 1 Melville Rogers (Toronto SC) 2 John Machado (Minto SC) 3 Norman Gregory (Montreal WC) 19241 John Machado (Minto SC) 2 Montgomery Wilson (Toronto SC) 3 Norman Gregory (Montreal WC) Canadian Figure Skating Championships / 1 Championnats canadiens de patinage artistique Canadian Figure Skating Championships Championnats canadiens de patinage artistique Men/hommes Senior Junior Novice 1925 1 Melville Rogers (Toronto -

ISU WORLD FIGURE SKATING CHAMPIONSHIPS ® 2012, Nice
ISU WORLD FIGURE SKATING CHAMPIONSHIPS® 2012 March 26 – April 1, 2012, Nice / France Protocol of the ® ISU World Figure Skating Championships 2012 including preliminary rounds organized by Fédération Française des Sports de Glace with the authorization of the International Skating Union held in Nice / France March 26 – April 1, 2012 The events of the Championships took place at the “Palais des Expositions” an artificial and heated indoor ice surface. Official ISU Sponsors ISU WORLD FIGURE SKATING CHAMPIONSHIPS® 2012 March 26 – April 1, 2012, Nice / France International Skating Union (ISU) Council President: Ottavio Cinquanta Italy 1st Vice President Figure Skating: David M. Dore Canada 2nd Vice President Speed Skating: Jan Dijkema Netherlands Members Figure Skating: Marie Lundmark Finland Junko Hiramatsu Japan Phyllis Howard U.S.A. Tjasa Andrée-Prosenc Slovenia Speed Skating: György Martos Hungary German Panov Russia Lan Li China Roland E. Maillard Switzerland ISU Director General Fredi Schmid Switzerland ISU Chair Sports Directorate Peter Krick Germany ISU Figure Skating Sports Director Krisztina Regöczy Hungary ISU Speed Skating Sports Director Hugo Herrnhof Italy Technical Committees Single & Pair Skating Chairperson: Alexander Lakernik Russia Members: Fabio Bianchetti Italy Rita Zonnekeyn Belgium Susan Lynch Australia Appointed Skater: Patrick Meier Switzerland Appointed Coach: David P. Kirby U.S.A. Ice Dance Chairperson: Halina Gordon-Poltorak Poland Members: Robert Horen U.S.A. Gilles Vandenbroeck France Alla Shekhovtsova Russia Appointed Skater: Sylwia Nowak-Trebacka Poland Appointed Coach: John Dunn Great Britain Synchronized Skating Chairperson: Christopher Buchanan Great Britain Members: Mika Saarelainen Finland Karen Wolanchuk USA Philippe Maitrot France Appointed Skater: Helena Johansson Finland Appointed Coach: Cathy Dalton Canada Official ISU Sponsors ISU WORLD FIGURE SKATING CHAMPIONSHIPS® 2012 March 26 – April 1, 2012, Nice / France ISU Event Officials ISU Representative: Mr. -

The Administrative Dilemmas of Government Communications
DRAFT for discussion only Not for publication without the permission of the author The administrative dilemmas of government communications David C.G. Brown, PhD School of Political Studies University of Ottawa Ottawa, Ontario Abstract Government communications with the public is a rare area of federal public administration that is found in both the public service and political spheres. This reflects its position on the cusp between politics and administration, nurturing both but belonging fully to neither. The situation is not new: there is evidence of politically driven communications activities throughout the past century, with government communications an important part of the federal response to major emergencies and periods of national stress but often mired in the swampy zone between information and propaganda and between public and partisan interests. As a result it has often operated in the shadows, with numerous abortive efforts to institutionalize the function in an effectively accountable manner, a point that the Gomery commission’s ahistorical perspective failed to recognize. The situation has been made more acute with the growing importance of information as a public resource and as a focus of public administration. The paper sketches current dilemmas about government communications from a public administration perspective. It discusses the historical evolution of the function and then reviews the resulting current institutional arrangements, which have unique and troubling aspects. A third section reviews four issues that arise from this situation: the challenge of operating on the cusp between politics and administration; the separation of government communications from service to the public and from Access to Information in the context of the 24-hour news cycle; and the complexity but also the weakness of the accountability regime for government communications. -

Maritime Engineering
National Defense Defence nationale MARITIME ENGINEERING (L dn GENIE MARITIME Canada April 1987 Avril A Modest Une proposition Proposal modeste ACSE Un ingenieur des systemes offers some de combat nous offre low-cost options des options economiques for upgrading pour 1'amelioration de la the combat capacite au combat capabilities ,«f' de nos destroyers propulses of the steamers a la vapeur .. page 22 ... page 22 Margaree MARITIME ENGINEERING JOURNAL r 1 MARITIME ENGINEERING IT du GENIE MARITIME APRIL 1987 AVRIL DEPARTMENTS/DEPARTEMENTS Editor's Notes/Notes de la Redaction 2 Letters/Lettres 4 Commodore's Corner/ Chronique du commodore 5 FEATURES/ARTICLES DISC—Integrated Software for Ship Design and Analysis by Cdr John N. Edkins and Hugh Templin 7 Evaluation of the Solar Saturn SHIPALT Director-General Package Maritime Engineering and bv Ahmed Abdelrazik 13 Maintenance Commodore D.R. Bo\lc Software Production Chaos by LCdr Roger Cyr 19 Low-cost Options for Upgrading Editor the Canadian Navy Capt(N) E.G.A. Bowkett by LCdr Roger Cyr 22 Technical Editors LCdr Richard B. Houseman (Naval NEWS BRIEFS/ Architecture) BULLETIN D'INFORMATION . 30 LCdr P.J. Lenk (Combat Systems) LCdr W.G. Miles (Combat Svstems) Lt(N) M. Bouchard (Marine Systems) Contributing Editors Cdr R.J. Rhodenizer (Halifax) Cdr F. W. Gibson (Esquimah) Production Editor MARITIME ENGINEERING JOURNAL JOURNAL DU GENIE MARITIME LCdr(R) B. McCullough ISSN 0713-0058 ISSN 0713-0058 Graphic Designer The Maritime Engineering Journal Le Journal du Genie maritime (ISSN Ivor Pontiroli DDDS 7-2 (ISSN 0713-0058) is an authorized unofficial 0713-0058) est une publication autorisee et periodical of the maritime engineers of the non-officielle des ingenieurs maritimes des Canadian Forces, and is published three times Forces canadiennes. -

Fonds André Plourde. – 1932 – 2012
F0047 FONDS ANDRÉ PLOURDE. – 1932 – 2012. - 3,95 m de documents textuels. – 9 photographies. – 11 affiches. – 26 plans. – 8 cartes. Notice biographique : Monsieur André Plourde naquit à Rivière-du-Loup le 12 janvier 1937. Après des études au cours Sciences et Commerce à l’École Mgr Taché, il débuta, en 1954, un emploi à la Banque Canadienne Nationale. L’année suivante, il fut engagé par l’entreprise Vitrerie Générale Inc. à titre de commis-vendeur. En décembre 1959, André Plourde épousa madame Marielle Gamache, qui lui donna trois enfants : Élaine, Alain et Éric. En mai 1965, il devint président-directeur général de la Vitrerie Générale Inc. Son implication au sein de cette entreprise s’étendra sur une période de 29 années. En 1972, M. Plourde fonda, en partenariat avec d’autres actionnaires, la compagnie Prelco Inc. Cette entreprise, située à Rivière-du-Loup, est spécialisée dans la fabrication du verre trempé. Durant la même période, il fut directeur de Glassec Inc., autre industrie de verre trempé, située à Cornwall en Ontario. De 1965 à 1983, en plus de son travail dans l’industrie manufacturière, André Plourde fit preuve d’une implication sociale marquée dans différentes sphères touchant au mieux être des gens de la région de Rivière-du-Loup. En 1965, il fut membre-fondateur du Club Lions de Rivière-du-Loup en plus de faire partie de l’organisation des Chevaliers de Colomb. D’ailleurs, l’année suivante, il occupa les fonctions de secrétaire-archiviste de ces mêmes Chevaliers de Colomb en plus d’être le secrétaire de L’Army & Navy de Rivière-du-Loup. -

2019-20 U.S. FIGURE SKATING MEDIA GUIDE Nathan Chen 2019 World Champion Vincent Zhou 2019 World Bronze Medalist TABLE of CONTENTS
2019-20 U.S. FIGURE SKATING MEDIA GUIDE Nathan Chen 2019 World champion Vincent Zhou 2019 World bronze medalist TABLE OF CONTENTS U.S. FIGURE SKATING U.S. Ladies Team .....................31 Marketing & Communications Staff ...... 2 U.S. Men’s Team ......................45 Media Credential Guidelines ............ 3 U.S. Pairs Team ......................63 Headquarters ..........................6 U.S. Ice Dance Team .................75 Figure Skating on Television ............ 7 HISTORY & RESULTS Streaming Figure Skating Online . .8 History of Figure Skating ..............88 Figure Skating by the Numbers .........9 World & U.S. Hall of Fame ............ 90 Figure Skating Record Book .......... 94 VIEWERS GUIDE TO FIGURE SKATING Olympic Winter Games ............... 102 Disciplines ............................ 10 World Championships ................108 Ladies & Men’s .........................11 World Junior Championships ......... 128 Pairs .................................12 Four Continents Championships ...... 138 Ice Dance ............................13 Grand Prix Final. .144 INTERNATIONAL JUDGING SYSTEM Junior Grand Prix Final ...............150 Overview .............................14 Skate America ....................... 156 Judges & Officials .....................15 U.S. Championships .................. 165 Program Components .................16 IJS Best Scores ...................... 185 Calculations ..........................17 U.S. Qualifying Best Scores ........... 189 Scales of Values (SOV) ................18 Skate America Best