Kabwit Mbind Jean Desire 20
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
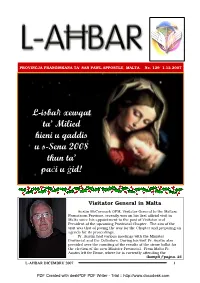
69 Dicembru 2007
PROVIN êJA FRAN ĀISKANA TA’ SAN PAWL APPOSTLU, MALTA. No. 129 1.12.2007 L-isba ħ xewqat ta’ Milied hieni u qaddis u s-Sena 2008 tkun ta’ pa ëi u āid! Visitator General in Malta Austin McCormack OFM, Visitator General to the Maltese Franciscan Province, recently was on his first official visit in Malta since his appointment to the post of Visitator and President of the upcoming Provincial Chapter. The aim of the visit was that of paving the way for the Chapter and preparing an agenda for its proceedings. Fr. Austin had various meetings with the Minister Provincial and the Definitors. During his visit Fr. Austin also presided over the counting of the results of the straw ballot for the election of the new Minister Provincial. From Malta Fr. Austin left for Rome, where he is currently attending the ikompli f’pa āna. 25 L-A{BAR DI êEMBRU 2007 1 PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Cardinale Betti receives the Cardinal’s hat Pope Benedict XVI presided over the solemn ceremony of the public Consistory at St. Peter’s Basilica on Saturday 24th November 2007. Immediately after the introductory hymn, Pope Benedict XVI read the formula for the creation of 23 new Cardinals, among whom was Brother Umberto Betti, OFM, who, deeply moved and in tears, received the Cardinal’s hat. The “celebrating” continued at the General Curia, where the new Cardinal, accompanied by his fellow Friars from the Province of Tuscany, not only met the government of the Order and the Fraternity of the General Curia but also the many guests present. -

117 Kardynałów Elektorów
Kardynałowie mog ący bra ć udział w konklawe w roku 2013 Kardynał Kraj 1. Santos Abril y Castelló Hiszpania 2. Geraldo Majella Agnelo Brazylia 3. George Alencherry Indie 4. Angelo Amato Włochy 5. Carlos Amigo Vallejo Hiszpania 6. Ennio Antonelli Włochy 7. Audrys Juozas Ba čkis Litwa 8. Angelo Bagnasco Włochy 9. Philippe Barbarin Francja 10. Jorge Mario Bergoglio Argentyna 11. Giuseppe Bertello Włochy 12. Tarcisio Bertone Włochy 13. Giuseppe Betori Włochy 14. Josip Bozani ć Chorwacja 15. Seán Brady Irlandia 16. Joao Braz de Aviz Brazylia 17. Raymond Leo Burke Stany Zjednoczone 18. Carlo Caffarra Włochy 19. Domenico Calcagno Włochy 20. Antonio Canizares Llovera Hiszpania 21. Juan Luis Cipriani Thorne Peru 22. Francesco Coccopalmerio Włochy 23. Thomas Christopher Collins Kanada 24. Angelo Comastri Włochy 25. Paul Josef Cordes Niemcy 26. José da Cruz Policarpo Portugalia 27. Raymundo Damasceno Assis Brazylia Kardynał Kraj 28. Godfried Danneels Belgia 29. Julius Riyadi Darmaatmadja Indonezja 30. Velasio De Paolis Włochy 31. Daniel DiNardo Stany Zjednoczone 32. Ivan Dias Indie 33. Timothy Dolan, Stany Zjednoczone 34. Dominik Duka Czechy 35. Stanisław Dziwisz Polska 36. Willem Jacobus Eijk Holandia 37. Francisco Javier Errázuriz Ossa Chile 38. Péter Erd ő, Węgry 39. Raffaele Farina Włochy 40. Fernando Filoni, Włochy 41. Francis George Stany Zjednoczone 42. Rubén Salazar Gómez Kolumbia 43. Oswald Gracias Indie 44. Zenon Grocholewski Polska 45. James Michael Harvey Stany Zjednoczone 46. John Tong Hon Chiny 47. Cláudio Hummes Brazylia 48. Walter Kasper Niemcy 49. Kurt Koch Szwajcaria 50. Giovanni Lajolo Włochy 51. Karl Lehmann Niemcy 52. William Joseph Levada Stany Zjednoczone 53. Nicolás de Jesús López Rodriguez Dominikana 54. -

Acta Apostolicae Sedis
An. et vol. XCV8 Septembris 2003 N. 9 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE Directio: Palazzo Apostolico – Citta` del Vaticano– Administratio: Libreria Editrice Vaticana ACTA IOANNIS PAULI PP. II LITTERAE DECRETALES quibus Petro a S. Iosepho Betancur sanctorum honores decernuntur. IOANNES PAULUS EPISCOPUS servus servorum dei ad perpetuam rei memoriam. « Ut filii lucis ambulate » (Eph 5, 8). Beatus Petrus a S. Iosepho Betancur, cum maxime optaret ut lucis fides in Novae Continentis gentes deferretur, in divinae Providentiae fiducia in- concusse nisus, Atlanticum oceanum transiit, ut illis incolis salutarem Christi nuntium comportaret, qui vera est lux quae illuminat cunctos homines (cfr Io 1, 9), quique eos sibi sociari vult. Dei Servus Ninguariae, quae una est e septem Fortunatis insulis, anno mdcxxvi ex humili piaque domo ortus est. Puer et adulescens parentes in agrorum operibus iuvit atque aetatis ex primis temporibus in precandi stu- dium liquide se inclinabat. Cum deteriores condiciones cognosceret in quibus Americae incolae versabantur, illuc accedere voluit eorum aerumnas levaturus itemque Evangelii Nuntium cum iis communicaturus. xxiii annos natus pro- fectus est: primum Cubam adiit, tum Honduriam, tum denique Guatimalam. Se impelli sensit ad sacerdotium adipiscendum, atque spiritalis moderatoris suasu necessaria studia sibi sumpsit. Humilis et in pietatis exercitia intentus ceterorum discipulorum sibi conciliavit aestimationem. Illo tempore ad sola- men aegrotis ferendum valetudinaria adire solebat. Licet animum in humanas disciplinas intenderet, ea quae sperabat non obtinuit ideoque a sacerdotii sus- cipiendi proposito recedere debuit, at non concidit animo. Precationes magis frequentavit, ut intellegeret ad quem vitae statum a Domino vocaretur. Vo- 562 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale cationem animadvertens ad vitam suam Christo consecrandam, mense Ianua- rioanni mdclv uti laicus Tertium Ordinem Franciscalem ingressus est, quem vitae operumque sanctitate collustravit. -

The Holy See
The Holy See JOHN PAUL IIANGELUSSunday, 28 September 2003 Dear Brothers and Sisters! 1. The beginning of the month of October is nearly here, the month of the Holy Rosary. In a particular way, I entrust to Our Lady the Consistory which I intend to hold on 21 October to celebrate the occasion of my 25th Year of Pontificate. Once again, over and above the set numerical limit, I will create some new Cardinals in this Consistory. 2. Among them, there are in the first place some of my Collaborators of the Roman Curia. They are the following: - Archbishop Jean-Louis Tauran; - Archbishop Renato Raffaele Martino; - Archbishop Francesco Marchisano; - Archbishop Julián Herranz; - Archbishop Javier Lozano Barragán; - Archbishop Stephen Fumio Hamao; - Archbishop Attilio Nicora. There are also 19 Pastors of local Churches. They are the following: - Archbishop Angelo Scola, Patriarch of Venice, Italy; - Archbishop Anthony Olubunmi Okogie of Lagos, Nigeria; - Archbishop Bernard Panafieu of Marseilles, France; - Archbishop Gabriel Zubeir Wako of Khartoum, Sudan; - Archbishop Carlos Amigo Vallejo, O.F.M., of Seville, Spain; - Archbishop Justin Francis Rigali of Philadelphia, United States of America; - Archbishop Keith Michael Patrick O'Brien of Saint Andrews and Edinburgh, Scotland; - Archbishop Eusébio Oscar Scheid, S.C.I., of São Sebastião do Rio de Janeiro, Brazil; - Archbishop Ennio Antonelli of Florence, Italy; - Archbishop Tarcisio Bertone, S.D.B., of Genoa, Italy; 2 - Archbishop Peter Kodwo Appiah Turkson of Cape Coast, Ghana; - Archbishop Telesphore Placidus Toppo of Ranchi, India; - Archbishop George Pell of Sydney, Australia; - Archbishop Josip Bozanic of Zagreb, Croatia; - Archbishop Jean-Baptiste Pham Minh Mân of Hô Chi Minh City, Vietnam; - Archbishop Rodolfo Quezada Toruño of Guatemala City, Guatemala; - Archbishop Philippe Barbarin of Lyons, France; - Archbishop Péter Erdö of Esztergom-Budapest, Hungary; - Archbishop Marc Ouellet, P.S.S., of Quebec, Canada. -

446 14-04-2005
Nº 446/14-IV-2005 SEMANARIO CATÓLICO DE INFORMACIÓN EDIC. NACIONAL A Dios A Ω SUMARIO Etapa II - Número 446 Adiós, Santo Padre 3-53-5 Edita: Fundación San Agustín. Testamento de Juan Pablo II Arzobispado de Madrid Delegado episcopal: Alfonso Simón Muñoz Redacción: Calle de la Pasa, 3. 6-13 28005 Madrid. Téls: 913651813/913667864 6-13 Fax: 913651188 Dirección de Internet: http://www.alfayomega.es Crónica del funeral por el Papa E-Mail: en la Plaza de San Pedro. [email protected] Los mocasines del pescador Director: Miguel Ángel Velasco Puente 14-19/24 Redactor Jefe: José Francisco Serrano Oceja 14-19/24 Director de Arte: Francisco Flores Domínguez Redactores: Homilía del cardenal Rouco Varela Anabel Llamas Palacios, en el funeral por Juan Pablo II, en Madrid. Juan Luis Vázquez, Escribe monseñor Antonio Cañizares: María Solano Altaba, Jesús Colina Díez (Roma) Ante todo, testigo de Jesucristo. Secretaría de Redacción: No ha sido elegido para sí... Rut de los Silos Antón Documentación: María Pazos Carretero Elena de la Cueva Terrer Internet: Beatriz Jaso Ollo -Imprime y Distribuye: Diario ABC, S.L.- 20-23 ISSN: 1698-1529 Depósito legal: M-41.048-1995. 20-23 Tú también haces Humor es amFor con h. realidad nuestro El adiós de nuestros lectores al Papa semanario Colabora con 28-3728-37 PUEDES DIRIGIR El Cónclave: TU APORTACIÓN ALAFUNDACIÓN Los cardenales que elegirán al Papa. SAN AGUSTÍN, Cómo votarán los cardenales. A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE ESTAS CUENTAS BANCARIAS: ¿Aceptas tu elección para Sumo Pontífice? Banco Popular Español: 0075-0615-57-0600131097 Caja Madrid: ...y además 2038-1736-32-6000465811 17 Editorial BBVA: 25 El Día del Señor 0182-5906-80-0013060000 26-27 La vida CajaSur: 38-39 El pequealfa 2024-0801-18-3300023515 40 Contraportada ADIÓS, SANTO PADRE 3 A 14-IV-2005 Ω Testamento de Juan Pablo II «En las manos de la Virgen lo dejo todo» Éste es el texto íntegro del Testamento del Papa Juan Pablo II. -

Acta Apostolicae Sedis
An. et vol. XCV 4 Decembris 2003 N. 12 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE Directio: Palazzo Apostolico – Citta` del Vaticano – Administratio: Libreria Editrice Vaticana ACTA IOANNIS PAULI PP. II LITTERAE DECRETALES quibus beato Ioanni Didaco Cuauhtlatoatzin Sanctorum honores decernuntur IOANNES PAULUS PP. II Ad perpetuam rei memoriam. — « Exaltavit humiles » (Lc 1, 52). Dei Patris contuitus ad humilem indigenam Mexicanum se convertit, nempe Ioannem Didacum, quem dono ditavit in Christo renascendi, beatae Mariae Virginis vultum contemplandi et sociatam praestandi operam pro Americanae Continentis evangelizatione. Ex quo aperte eruitur quam vera sint verba quibus Apostolus Paulus divinam edocet methodum salutem per- agendi: « Ignobilia mundi et contemptibilia elegit Deus, quae non sunt, ut ea, quae sunt, destrueret, ut non glorietur omnis caro in conspectu Dei » (1 Cor 1,28-29). Hic beatus, cui traditum nomen est Cuauhtlatoatzin, quod « aquila loquens » sibi vult, anno circiter mcdlxxiv in loco Cuauhtitlan natus est, apud regnum vulgo Texcoco. Adultus cum sit et matrimonio iunctus, amplexus est Evangelium et una cum uxore baptismali aqua est ablutus, sibi proponens vivere sub lumine fidei et secundum obligationes coram Deo et Ecclesia assumptas. Mense Decembri anno mdxxxi, cum iter faceret ad locum Tlate- lolco, in colle qui Tepeyac appellatur, apparentem sibi vidit veram Dei Ma- trem, quae mandavit illi ut ab episcopo Mexicano peteret templum in loco apparitionis aedificari. Sacer praesul, attentis indigenae instantiis, eviden- tem miri eventus probationem ab illo requisivit. Die xii mensis Decembris beatissima Virgo Maria Ioanni Didaco conspiciendam rursus se dedit, eum solamine affecit et iussit ut in fastigium collis Tepeyac se conferret, ibi flores colligeret et referret. -

Probabile) NOME E COGNOME NASCITA PROVENIENZA
NOME LATINO (probabile) NOME E COGNOME NASCITA PROVENIENZA Adrianus Juozas Audrys Juozas Backis 01/02/1937 Lituania Albertus Malcom Albert Malcom Ranjith Patabendige Don 15/11/1947 Sri Lanka Aloisius Lluis Martinez Sistach 29/04/1937 Spagna Aloisius Antonius Luis Antonio Tagle 21/06/1957 Filippine Andreas André Vingt-Trois 07/11/1942 Francia Angelum Angelo Comastri 17/09/1943 Italia Angelum Angelo Bagnasco 14/01/1943 Italia Angelum Angelo Scola 07/11/1941 Italia Angelum Angelo Amato 08/06/1938 Italia Antonius Antonio Canizares Llovera 10/10/1945 Spagna Antonius Antonios Naguib 07/03/1935 Egitto Antonius Maria Antonio Maria Vegliò 03/02/1938 Italia Antonius Maria Antonio Maria Rouco Varela 24/08/1936 Spagna Antonius Olubunmi Anthony Olubunmi Okogie 16/06/1936 Nigeria Atilius Attilio Nicora 16/03/1937 Italia Augustinus Agostino Vallini 17/10/1940 Italia Basilius Cleemis Baselios Cleemis Thottunkal 15/06/1959 India Béchara Petrus Béchara Boutros Rai 25/02/1940 Libano Carulus Carlo Caffarra 01/06/1938 Italia Carulus Karl Lehmann 16/05/1936 Germania Carulus Carlos Amigo Vallejo 23/08/1934 Spagna Casimirus Kazimierz Nycz 01/02/1950 Polonia Christophorus Christoph Schonborn 22/01/1945 Austria Claudius Claudio Hummes 08/08/1934 Brasile Conradus Kurt Koch 15/03/1950 Svizzera Crescentius Crescenzio Sepe 02/06/1943 Italia Daniel Nicolaus Daniel Nicholas DiNardo 23/05/1949 Stati Uniti d'America Dionisius Dionigi Tettamanzi 14/03/1934 Itra Dominicus Dominik Duka 26/04/1943 Repubblica Ceca Dominicus Domenico Calcagno 03/02/1943 Italia Donald Guglielmus -

Rapporto 2004 Sulla Libertà Religiosa Nel Mondo
QUADERNI DELLA CHIESA CHE SOFFRE Rapporto 2004 sulla Libertà Religiosa nel Mondo Rapporto 2004 sulla Libertà Religiosa nel Mondo A IUTO ALLA C HIESA CHE S OFFRE Q UADERNI DELLA C HIESA CHE S OFFRE A cura di - Edited by Attilio Tamburrini Editore - Publisher Aiuto alla Chiesa che Soffre Piazza San Calisto 16 - 00153 Roma Comitato di redazione Pierre Balanian (AsiaNews), padre Bernardo Cervellera (AsiaNews), Camille Eid, Marco Invernizzi, Andrea Morigi, Anna Pozzi, Monica Romano (AsiaNews), Anna Sanguinetti, Oscar Sanguinetti, Chiara Verna Coordinamento redazionale Andrea Morigi, Marco Invernizzi Segreteria di redazione Elvira Zito, Laura Fioravanti, Alessandro Noja Grafica Marco Silvestri Stampa Tipografia Città Nuova della P.A.M.O.M. Via San Romano in Garfagnana 23 - 00148 Roma © Aiuto alla Chiesa che Soffre Piazza San Calisto 16 - 00153 Roma È consentita la riproduzione parziale o integrale del testo pubblicato con obbligo di citazione della fonte. Tutte le informazioni riportate sono riferite di norma all’anno 2003. Fanno eccezione i fatti che hanno avuto rilevanti sviluppi fino alla data di andare in stampa. Immagine di copertina © Images.com/B. Budrovic La cartografia contenuta nella presente opera è di © GEOnext - De Agostini, 2004 ISBN 88-87567-10-7 Nel consegnare alle stampe questo sesto Rapporto sulla Libertà Religiosa nel Mondo, in primo luogo ci preme mettere in rilievo che questo lavoro va inserito nel quadro complessivo delle attività da noi svolte. “Aiuto alla Chiesa che Soffre” annualmente realizza circa 6.000 progetti in favore delle Chiese, ovunque esse siano minacciate o perseguitate. Esso, quindi, ha lo scopo precipuo di fornire una corretta descrizione del “territorio” nel quale ACS poi si trova concretamente a operare. -

Sacro Colegio Cardenalicio Actualizado
ECCLESIA DIGITAL www.revistaecclesia.com SACRO COLEGIO CARDENALICIO 28 de febrero de 2013 Luis Marín de San Martín, O.S.A. CARDENALES ELECTORES (117) ITALIA (28) * Angelo AMATO, S.D.B., (nacido el 8-6-39), 73 años, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, creado cardenal por Benedicto XVI en noviembre de 2010. Diácono de Santa Maria in Aquiro. Lema: Sufficit gratia mea. * Ennio ANTONELLI, (nacido el 18-11-36), 76 años, presidente emérito del Pontificio Consejo para la Familia, creado cardenal por Juan Pablo II en octubre de 2003. Presbítero del título de Sant’ Andrea delle Fratte. Lema: Voluntas Dei pax nostra. * Angelo BAGNASCO, (nacido el 14-1-43), 70 años, arzobispo de Génova, creado cardenal por Benedicto XVI en noviembre de 2007. Presbítero del título de la Gran Madre di Dio. Lema: Christus spes mea. * Giuseppe BERTELLO, (nacido el 1-10-1942), 70 años, presidente de la Pontificia www.sotodelamarina.com Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano y presidente del Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, creado cardenal por Benedicto XVI en febrero de 2012. Diácono de los Ss. Vito, Modesto e Crescenzia. Lema: Narrabo nomen tuum. * Tarcisio BERTONE, S.D.B., (nacido el 2-12-34), 78 años, secretario de Estado y camarlengo de la Santa Iglesia Romana, creado cardenal por Juan Pablo II en octubre de 2003. Obispo del título de la Iglesia suburbicaria de Frascati. Lema: Fidem custodire concordiam servare. * Giuseppe BETORI, (nacido el 25-2-1947), 66 años, arzobispo de Florencia, creado cardenal por Benedicto XVI en febrero de 2012. -

New Rehab Wing Dedicated in Freeport
ISSN: 0029-7739 $ 1.00 per copy THE OBSERVER Official Newspaper of the Catholic Diocese of Rockford Volume 78 | No. 13 http://observer.rockforddiocese.org FRIDAY MARCH 8, 2013 Don’t miss Mass Sunday. Michelle Lindeman, administrator of Presence St. Joseph Center, holds a giant, symbolic pair of scissors just before the actual ribbon cutting at St. Joseph Center’s new rehabilitation wing. She is surrounded by (from left) Msgr. William McDonnell, Bishop David J. Malloy, Freeport Mayor George Gaulrapp, Connie March, president and CEO of Presence Life Connections, Sister Clara Frances Kusek, CR, Charles Luecke and Sister Ev- elyn Vanboncoeur, SSCM, and, in the red coats, members of the Freeport Chamber of Commerce. New Rehab Wing Dedicated in Freeport Set your clocks BY AMANDA HUDSON dent of mission services, earlier News editor had called “holy ground.” ahead one hour “It’s a great time to be Catho- Saturday night. FREEPORT—In his com- lic,” Mayor Gaulrapp said. ments at the Blessing Ceremony He explained that his history of the new Presence (formerly Inside Provena) St. Joseph Center Re- with the facility began with habilitation Wing on Feb. 25, his orphaned father who was Students from Aquin Central Catholic Junior/Senior High School pro- Freeport Mayor George Gaul- raised on the St. Joseph cam- vided music at the dedication. Aquin is located across Galena Avenue rapp hinted at the extensive pus at the former St. Vincent from St. Joseph Center, and students often volunteer at the center. history of Catholic ministry on Home for Children. In May what Nancy Garcia, vice presi- 1905, when children began to be cared for in the once-Mayor April “in response to needs August Bergman home, the seen in the Freeport commu- original 15-acres at Galena nity,” said Michelle Lindeman, Ave. -

Le Saint-Siège
Le Saint-Siège JEAN-PAUL II ANGÉLUS Dimanche 28 septembre 2003 Très chers frères et sœurs !1. C'est bientôt le début du mois d'octobre, le mois du Saint Rosaire. Je confie en particulier à la Madone le Consistoire que j'entends tenir le 21 octobre prochain, à l'occasion de mon XXVe anniversaire de pontificat. En dérogeant encore une fois à la limite numérique établie, je créerai plusieurs nouveaux cardinaux.2. Parmi eux se trouvent avant tout certains de mes collaborateurs de la Curie romaine. En voici les noms : - Mgr Jean-Louis TAURAN ; - Mgr Renato Raffaele MARTINO ; - Mgr Francesco MARCHISANO ; - Mgr Julián HERRANZ ; - Mgr Javier LOZANO BARRAGÁN ; - Mgr Stephen FUMIO HAMAO ; - Mgr Attilio NICORA.Il y a ensuite 19 pasteurs de tout autant d'Églises locales. Leurs noms sont : - Mgr Angelo SCOLA, Patriarche de Venise (Italie) ; - Mgr Anthony OLUBUNMI OKOGIE, Archevêque de Lagos (Nigeria) ; - Mgr Bernard PANAFIEU, Archevêque de Marseille (France) ; - Mgr Gabriel ZUBEIR WAKO, Archevêque de Khartoum (Soudan) ; - Mgr Carlos AMIGO VALLEJO, Archevêque de Séville (Espagne) ; - Mgr Justin Francis RIGALI, Archevêque de Philadelphie (États-Unis d'Amérique) ; - Mgr Keith Michael Patrick O'BRIEN, Archevêque de Saint Andrews et Edimbourg (Écosse) ; - Mgr Eusébio Oscar SCHEID, s.c.i., Archevêque de São Sebastião do Rio de Janeiro (Brésil) ; - Mgr Ennio ANTONELLI, Archevêque de Florence (Italie) ; - Mgr Tarcisio BERTONE, Archevêque de Gênes (Italie) ; - Mgr Peter KODWO APPIAH TURKSON, Archevêque de Cape Coast (Ghana) ; - Mgr Telesphore Placidus TOPPO, -

Benedict, Me and the Cardinals Three Pdf, Epub, Ebook
BENEDICT, ME AND THE CARDINALS THREE PDF, EPUB, EBOOK William Meredith Morris | 437 pages | 30 Jun 2014 | ATF Press | 9781921511417 | English | Hindmarsh, SA, Australia Benedict, Me and the Cardinals Three PDF Book Yet as I looked at the man more closely, I saw that it was definitely him. Maybe his plans had changed again. Can I view this online? Archived from the original on 15 October Prefect emeritus of the Congregation for the Clergy. I had heard that he is a gossip, a social operator whose calendar is a blur of drinks and dinners with cardinals and archbishops, principessas and personal trainers. James Francis". The Vatican holds secrets so tightly that it can make Fort Meade look like a sloppy drunk. Marco Politi speculates that perhaps as many as 30 were eased out. During an impromptu press conference aboard the papal jet, en route from Rio de Janeiro to Rome after his first overseas trip, Francis was asked about the so-called gay lobby. The term could refer to a shadowy group like the Illuminati, whose members quietly exercise supreme power. Whether he received this privileged access from some friend or family member, or from a client, is impossible to say; to see a known rent boy in black leather on a private Vatican balcony does raise an eyebrow. Some such stories are better substantiated than others. Arlindo Gomes Furtado. Oswald Gracias. Prefect emeritus of the Congregation for the Causes of Saints. Aquilino, C. Archbishop emeritus of Khartoum. The book details the background and events which led to my being asked by Pope Benedict XVI to resign as Bishop of Toowoomba when I had a meeting with him in Rome on the 4th of June Denunciation and exposure have made gay priests figures of fascination—though less as people than as symbols— especially to the secular far left and the religious far right.