Texte De Jacques Marchand
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Wisdom of Géminiani ROULEUR MAGAZINE
The Wisdom of Géminiani ROULEUR MAGAZINE Words: Isabel Best 28 June, 1947 It’s the first Tour de France since the war; No one apart from Géminiani, Anquetil’s the year René Vietto unravels and loses his directeur sportif. You can see him in the yellow jersey on a 139k time-trial. The year background, standing up through the Breton schemer Jean Robic attacks—and sunroof of the team car. “There was no wins—on the final stage into Paris. But on more a duel than there were flying pigs,” this particular day, in a tarmac-melting Géminiani recalled many years later. heatwave, a young rider called Raphaël “When you’re at your limits in the Géminiani is so desperately thirsty, he gets mountains, you should never sit on your off his bike to drink out of a cattle trough, rival’s wheel. You have to ride at his side. thereby catching foot and mouth disease. It’s an old trick. With Anquetil at his level, Not the most auspicious of Tour beginnings Poulidor was wondering what was going for a second year pro. on. He thought maybe Jacques was stronger than him. Well, you can see, he 18 July, 1955 wasn’t looking great. Only, an Anquetil Another heatwave. This time on Mont who’s not in top form is still pretty good.” Ventoux. Géminiani is in the break, with the Swiss champion Ferdi Kübler and a French regional rider, Gilbert Scodeller. Ferdi A few snapshots from the 50 Tours de attacks. “Be careful, Ferdi; The Ventoux is France of Raphaël Géminiani. -

Jacques Ferran Interview UEFA Direct (French)
INTERVIEW INTERVIEW « Nous avons JACQUES FERRAN tenté un coup de poker, parce que nous étions bien incapables, aussi bien les clubs que le journal, d’organiser une compétition de cette importance. » « LANCER LA COUPE D’EUROPE ÉTAIT UN COUP DE POKER » Il y a plus de 60 ans, des journalistes du journal français L’Équipe lançaient l’idée d’une Coupe d’Europe des clubs. À 96 ans, Jacques Ferran n’a rien oublié de la fantastique aventure de ce qui est devenu la compétition interclubs la plus importante au monde. ans les années 50, la Quel a été le déclencheur ? plupart des membres Gabriel Hanot allait de temps en temps à fondateurs de l’UEFA l’étranger pour nourrir un peu notre journal étaient concentrés sur en semaine. En décembre 1954, il était les équipes nationales. allé voir jouer le champion d’Angleterre, DD’où vous est venue l’idée, à vous Wolverhampton, qui accueillait à Molineux et à Gabriel Hanot, journalistes à en matches amicaux des clubs de l’Est. Les L’Équipe, de créer une compétition Wolves avaient battu le Honved de Puskas interclubs à l’échelle européenne ? et Kocsis ainsi que le Spartak Moscou. Cela Au départ, la grande idée de Gabriel Hanot avait suffi à ce qu’un journaliste anglais écrive était que les clubs méritaient davantage que « Wolverhampton, champion du monde des ce qu’ils avaient. Dans l’ordre de l’époque, au clubs ». Gabriel Hanot, avec sa sagesse, sa journal, il y avait Jacques de Ryswick, chef de froideur et son humour habituel a écrit un rubrique, Gabriel Hanot, et moi-même qui était grand papier dans L’Équipe le lendemain en le petit dernier. -

1 - Géo Lefèvre Est Le Premier Directeur Délégué En 1903 Et 1904
9 septembre 2020 1 - Géo Lefèvre est le premier directeur délégué en 1903 et 1904 Témoignage de l’impétrant - Un homme protée Premier commissaire de course « Je ne reviens pas sur ce premier Tour de 1903. Il en a trop souvent été parlé. Mais aujourd'hui, mes 84 ans s'émerveillent encore du métier que Desgrange m'imposa: prendre le train -avec mon vélo- avant le départ des coureurs, aller les surprendre sur la route et en pleine nuit (la longueur des étapes, la moyenne peu élevée avec des bicyclettes lourdes et les pneus de l'époque, sur des routes non goudronnées, exigeaient un départ en fin de journée). Ainsi les coureurs devaient rouler de nuit. Les ayant contrôlés, il me fallait alors coller au peloton ou aux hommes de tête, particulièrement à surveiller, reprendre le train dès qu'une grande station me permettait de sauter dans un express ou un rapide et arriver à l'étape avant le premier des coureurs. Mais mon premier essai me vit, le temps de dégager mon vélo en gare de Lyon-Perrache et de sauter sur les pavés des quais de la Saône, arriver pour trouver Garin en train de se désaltérer ! » Géo Lefèvre. - Ceux que j'ai rencontrés (en 60 ans de vie sportive) .- Paris, éd. SOSP, 1962 .- 79 P (p 19) Géo Lefèvre, journaliste à L’Auto de 1901 à 1940 puis à L’Equipe de 1946 à 1955 Premier rédacteur cycliste « Après les arrivées, qui se succédaient pendant plusieurs heures, je devais rédiger la valeur d'une page de L'Auto, et transmettre ma copie au journal. -

Lanterne Rouge: the Last Man in the Tour De France Free
FREE LANTERNE ROUGE: THE LAST MAN IN THE TOUR DE FRANCE PDF Max Leonard | 272 pages | 04 Jun 2015 | Vintage Publishing | 9780224092005 | English | London, United Kingdom Lanterne rouge - Wikipedia Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date. For a better shopping experience, please upgrade now. Javascript is not enabled in your browser. Enabling JavaScript in your browser will allow you to experience all the features of our site. Learn how to enable JavaScript on your browser. NOOK Book. Froome, Wiggins, Mercks —we know the winners of the Tour de France, but Lanterne Rouge tells the forgotten, often inspirational, and occasionally absurd stories of the last-placed rider. We learn of stage winners and former yellow jerseys who tasted life at the other end of the pack; the breakaway leader who stopped for a bottle of wine and then took a wrong turn; the doper whose drug cocktail accidentally slowed him down; and the rider who was recognized as the most combative despite finishing at the back. Home 1 Books 2. Read an excerpt of this book! Add to Wishlist. Sign in to Purchase Instantly. Members save with free shipping everyday! See details. Overview Froome, Wiggins, Mercks —we know the winners of the Tour de France, but Lanterne Rouge tells the forgotten, often inspirational, and occasionally absurd stories of the last-placed rider. Product Details About the Author. About the Author Max Leonard is a writer and amateur cyclist. He has never knowingly come first-or Lanterne Rouge: The Last Man in the Tour De France anything. -

Le Tour De France
1 Local Culture Report: Le Tour de France Guillaume Lemaˆıtre Heriot-Watt University, Universitat de Girona, Universite´ de Bourgogne [email protected] I. INTRODUCTION The Tour de France is ”Grand Tour” equivalent of the Vuelta Espana or the Giro di Italia. However, the Tour de France is the most popular race in the world without hesitation. In the mind of racers, it is more important to win a Tour de France than a world championship. Win Tour de France shows polyvalent qualities of the winner. II. HISTORY A. Creation of the Tour de France The foundations of the Tour de France takes place on a national French scandal. At the end of the year 1984, Alfred Dreyfus who was captain in the French army at this time and by the way was Jew, was convicted to have given secret information to Germans. After several years and several justice judgements, it was proved that Alfred Dreyfus was not the author of the supposed high teason. However, France was separated in two parts: the dreyfusards and the antidreyfusards. The second important fact was that at this time, it was existing only one sport newspaper named ”Le Velo”. Pierre Giffard, the editor-in-chief, was politically committed and was writing in his sheet to denfend Dreyfus. However, his newspaper was financed through the advertisement by car industrials who were antidreyfusard. The Comte de Dion, who was the representative of car industrials, chose Henry Desgrange in order to create a rival newspaper named ”L’Auto-Velo”. A feature of this sheet is that it was published on a yellow paper which will be the colour of the leader jersey of the Tour de France. -

Alla Corrente
ALLA CORRENTE FAUSTO COPPI (1919–1960) From Saturday July 5th to Sunday July 27th, 2014, the 101st Tour de France will take place. This year it is made up of 21 stages and will cover a total distance of 3,664 kilometers (roughly 2,277 miles). It will begin in the United Kingdom (in Leeds), and will go through Belgium, Spain, and France before ending on the Champs-Élysées in Paris on July 27. Last July, Alla Corrente described the cycling exploits of one of Italy’s greatest cyclists, Gino Bartali (1914–2000). It also described his other role during World War II as a courier/spy for the Italian resistance, and his efforts to save Jews during the Italian Holocaust and German occupation. Since this is the July 2014 Bulletin and since there is much interest among Cenacolisti about the Tour, I thought it would be appropriate to offer this Alla Cor- rente about another Italian participant in several Tour races who won it in 1949 and in 1952. FAUSTO COPPI was an Italian cyclist and the major challenger to Gino Bartali in many cycling races, including the Tour de France. His successes earned him the title Il Campionissimo, or Champion of Champions. He was an all-round racing cyclist, excelling in both climb- ing and time trials, as well as being a great sprinter. Coppi was one of five children born to Domenico Coppi and Angiolina Boveri. Fausto was the fourth child, born September 15, 1919 in Castel- lania, Piedmont, Italy. His mother wanted to call him Angelo, but his father preferred Fausto; so he was named Angelo Fausto, but was known most of his life as Fausto. -

'Launching the European Cup Was a Gamble'
INTERVIEW INTERVIEW “We took a gamble, JACQUES FERRAN because there was no way we or the clubs could organise such a big competition.” ‘LAUNCHING THE EUROPEAN CUP WAS A GAMBLE’ More than 60 years ago, a group of journalists from L’Équipe had the idea of creating a cup competition for Europe’s clubs. Jacques Ferran, now aged 96, still remembers the fantastic adventure that led to the creation of the world’s greatest club competition as if it were yesterday. Back in the 1950s, most of UEFA’s What triggered that idea? founding members were focusing From time to time, Gabriel Hanot went abroad on national teams. How did you and during the week to pick up information for Gabriel Hanot, journalists working the newspaper. In December 1954 he went to for L’Équipe, come up with the watch the English champions, Wolverhampton idea of creating a European club Wanderers, who were playing a couple of competition? friendlies at Molineux against clubs from The starting point for Gabriel Hanot’s big idea Eastern Europe. Wolves beat Puskás and was his feeling that the clubs deserved more Kocsis’s Budapest Honvéd, as well as Spartak than they were getting. In terms of seniority at Moscow. That was enough for an English the newspaper, Jacques de Ryswick was head journalist to describe Wolves as the “world club of department at the time, then there was champions”. Gabriel Hanot, with his wisdom, Gabriel Hanot, and I was the most junior. But calmness and legendary humour, wrote a long it was Gabriel Hanot who first said that the article in the next day’s edition saying: “Before clubs did not have the standing or status they we can say that Wolves are the world club Jacques Ferran in his office at deserved. -
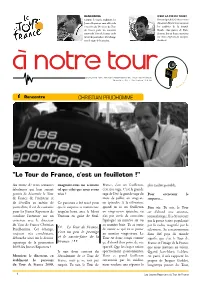
A Notre Tour 10 Web.Pdf
RENCONTRE C'EST LA FIN DU TOUR ! Comme le veut la tradition, les Ils sont âgés de 13 à 16 ans et ont Jeunes Reporters sont allés à la découvert durant trois semaines rencontre du Directeur du Tour les coulisses de la Grande de France pour un entretien Boucle. Aux portes de Paris, autour du Tour de France et du ils nous livrent leurs sensations métier de journaliste. Un échange sur leurs expériences uniques. sous le signe de la passion. Flashback ! e c n a r Numéro 10 - 25 Juillet 2009 F e d r u To du Rencontre CHRISTIAN PRUDHOMME "Le Tour de France, c'est un feuilleton !" Au terme de trois semaines imaginiez-vous un scénario France, c'est un feuilleton, plus tardive possible. fabuleuses qui leur auront tel que celui que nous avons c'est une saga. C'est la grande permis de découvrir le Tour vécu ? saga de l'été, la grande saga du Pour entretenir le de France de l'intérieur et mois de juillet, en vingt-et- suspense... de s'éveiller au métier de Ce parcours a été tracé pour un épisodes. A la télévision, journaliste, il est de coutume que le suspense se maintienne quand tu as un feuilleton Bien sûr. Tu sais, le Tour pour les Jeunes Reporters de jusqu'au bout, avec le Mont en vingt-et-un épisodes, tu est d'abord une aventure conclure l'aventure sur un Ventoux en guise de final. n'as pas envie de connaître journalistique. Il a été inventé entretien avec le directeur l'épilogue au numéro six ou par la presse écrite, popularisé du Tour de France Christian au numéro huit. -

L'équipée Belle
Il est des êtres qui gardent le sens de la liturgie. Mais leur attachement rituel, indomptable aux legs du passé, ne chasse pas en eux la soif d'innover, à condition que des paradoxes oiseux, nés d'une recherche de l'originalité à tout prix, ne viennent pervertir par avance le fruit de leur imagination. Leur univers passionnel est situé à des galaxies du caprice. Apôtre de l'énergie, sensible au souffle du rêve, Jacques Goddet est de ces hommes en qui le poids suprême de la tra- dition et l'appel inexorable de l'avenir cohabitent. Son sens de la création le tire vers le haut; cette exigence ne le lasse jamais. Sa raison d'être? Servir le sport, entreprise d'allégresse et aussi de douleur où l'athlète accepte de moins en moins ses limites mais doit se résigner quand la houle du renoncement l'atteint. D'où l'ivresse et le pathétique de ces vies fré- missantes. «Vais-je donc passer sans fournir la note que Dieu avait mise en moi?» s'interro- geait Maurice Barrès. La question hante ceux pour qui l'existence est un acte de foi. Leur force d'âme n'est pas là pour mas- quer leurs échecs mais au contraire pour les pousser à satisfaire le plus difficile, autrement dit soi-même. Jacques Goddet peut être rassuré. Cette note que « Dieu avait mise» en lui, il l'a jouée. Et plus d'une fois. Comme journaliste, il s'est émer- veillé, avec des tremblements d'adoles- cent, de ce qu'il a vu et souvent suscité car le blasement n'a pas prise sur sa personne. -

Henri DESGRANGE
Créateur du Tour de France en 1903 et de la randonnée cyclotouriste Audax, cet humaniste précurseur dédie sa vie au sport tant par la pratique qu’en étant dirigeant et journaliste. Henri DESGRANGE Né le 31 janvier 1865 à cinq heures du matin à Paris 10 e selon acte n°478 source : Archives de Paris en ligne Décédé le 16 août 1940 à Beauvallon Drôme 26 Le goût du sport le détourne de la carrière d’avocat Cet homme organisateur-né, au caractère bien trempé est ainsi qualifié en son temps par le journaliste Jacques Goddet : « Rude dans son comportement, rude dans ses expressions, rude envers lui-même plus encore qu'envers ses collaborateurs, Henri Desgrange a considéré la vie comme un combat permanent. » Quand il débute sa vie professionnelle à Paris, comme clerc de notaire, il se destine à devenir avocat. Mais bientôt, il délaisse ce projet pour se consacrer au sport tant pour la pratique que pour l’organiser et le diriger. C’est ainsi que le 11 mai 1893, il est le premier à battre un record de l’heure cycliste, sans entraîneur avec 35,325 km. Il détient également plusieurs records à tricycle sur piste, sur 50 et 100 km. En tant que journaliste sportif, il collabore à plusieurs revues : La Bicyclette, Paris-Vélo et Le Journal de sports . Directeur d’un quotidien sportif… et de vélodromes à Paris S’il aime le sport de déplacement, il a aussi le talent pour organiser en grand. C’est ainsi qu’en 1897, il devient directeur du vélodrome du Parc des Princes à Paris puis, en 1903 du vélodrome d’Hiver. -

Les Premières Retransmissions Sportives Télévisées En France (1952– 1958) : Des Enjeux Esthétiques Et Économiques À L'avènement D'une Pratique Culturelle
Université Rennes 2 – Haute Bretagne UFR Arts, Lettres, Communication département des Arts du Spectacle Mémoire de master en études cinématographiques parcours histoire et esthétique du cinéma Les premières retransmissions sportives télévisées en France (1952– 1958) : des enjeux esthétiques et économiques à l'avènement d'une pratique culturelle Gwen Péron sous la direction de Roxane Hamery ANNEXES Année universitaire 2017-2018 TABLE DES MATIÈRES I – Biographies p. 2 II – Rapports d'écoutes du contrôle artistique des émissions p. 4 III -Extrait d'une décision de la FFBB p. 10 IV - Chiffres clés des rencontres du Tournoi des Cinq Nations organisées en France entre 1954 et 1962 p. 11 V – Retransmissions des rencontres du Tournoi des Cinq Nations en France entre 1955 et 1959 p. 12 VI – Matches des Coupes du monde de Football 1954 et 1958 retransmis par la RTF p. 13 VII – Publicités de fabricants de téléviseurs et de la RTF publiées dans L'Équipe entre 1954 et 1958 p. 14 VIII – Lettre de Léo Wallenborn aux membres de l'UER, 16 décembre 1955 p. 18 IX – Synthèse du courrier des téléspectateurs p. 19 1 I - Biographies Jacques Goddet (21 juin 1905 – 15 décembre 2000) Fils de Victor Goddet, ami et collaborateur d'Henri Desgranges, fondateur du journal L'Auto. Jacques Goddet se spécialise dans le journalisme sportif et entre lui aussi à L'Auto. Il prend la relève d'Henri Desgranges et devient directeur du journal en 1931. Il devient, en 1936, directeur du Tour de France. Après l'occupation, Jacques Goddet parvient, à force de batailles juridiques et administratives à relancer un quotidien sportif, sans pouvoir reprendre le nom de L'Auto. -

Préface De Luc Leblanc
Préface de Luc Leblanc Comme moi à la lecture de cet ouvrage, la première question qui vous viendra probablement à l’esprit est : mais quel est mon premier souvenir de Tour de France ? Car que l’on aime ou pas le sport et le cyclisme, nous avons tous un souvenir de Tour de France en nous, comme nous avons tous un souvenir de jeux Olympiques ou de Coupe du monde de football. C’est ainsi. Pour moi, le premier souve- nir de Tour de France que j’ai, c’est Raymond Poulidor, ses duels avec Bernard Thévenet et Eddy Merckx. Véritable icône de France et de ma région, dans le Limousin il était notre image. En plus, son histoire personnelle fait qu’il n’a jamais remporté le Tour malgré une abnégation de tous les instants. C’est aussi un homme de la terre, un terreux et surtout un terrien, comme l’était Jean Robic et bien avant lui encore les pionniers, Maurice Garin, les frères Pélissier ou encore Antonin Magne dont vous allez découvrir les histoires de Tour mais surtout les histoires de vie. Et le premier, c’est évidemment Henri Desgrange, le père du Tour de France. Personne ne doit oublier ceux qui ont créé d’abord, puis fait vivre le Tour de France depuis 1903. Henri Desgrange fut le premier metteur en scène de ces « forçats de la route », de ces premiers acteurs 5 qui se firent connaître à grands coups d’exploits parfois aussi surhumains que leurs fins furent tragiques. Le Tour de France est légendaire dès son premier départ, au café Au Réveil Matin à Montgeron et cela dure depuis plus d’un siècle.