Madagascar) Et Modèle De Distribution De Cette Communauté Selon Différents Types Physionomiques
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Madagascar: the Red Island
Andrea L. Baden & Rachel L. Jacobs Stony Brook University Taxonomic group Total species Endemic species % Endemism Plants 13,000 11,600 89.2 Mammals 155 144 92.9 Birds 310 181 58.4 Reptiles 384 367 95.6 Amphibians 230 229 99.6 Freshwater fish 164 97 59.1 *Recently extinct species: 45 (including birds, reptiles, and mammals) “The ecological state of being unique to a particular geographic location, such as a specific island…[Endemic species are] only found in that part of the world and nowhere else.” Taxonomic group Total species Endemic species % Endemism Plants 13,000 11,600 89.2 Mammals 155 144 92.9 Birds 310 181 58.4 Reptiles 384 367 95.6 Amphibians 230 229 99.6 Freshwater fish 164 97 59.1 *Recently extinct species: 45 (including birds, reptiles, and mammals) North & Central America . Phillippenes . California floristic province . Polynesia-Micronesia . Caribbean Islands . Southwest Australia . Madrean Pine Oak Woodlands . Sundaland . Mesoamerica . Wallaceae South America . Western Ghats & Sri Lanka . Atlantic Forest Europe & Central Asia . Cerrado . Caucasus . Chilean winter-Rainfall-Valdivian . Irano-Antalian forests . Mediterranean Basin . Tumbes-Choco-Magdalena . Mtns of Central Asia . Tropical Andes Africa Asia-Pacific . Cape Floristic region . E. Melanesian Islands . E. African coastal forests . Himalaya . Eastern afromontane . Indo-Burma . W. African Guinean forests . Japan . Horn of Africa . Mtns of SW China . Madagascar . New Caledonia . Maputaland-Pondoland-Albany . New Zealand . Succulent Karoo > 44% of the world’s plant species > 35% of the world’s terrestrial vertebrates Cover ~ 1.4% of the earth’s surface . was once 11%, but 88% of that has since been lost Madagascar contains 1 of 6 major radiations of primates . -

FAUNE DE MADAGASCAR Publiée Sous Les Auspices Du Gouvernement De La République Malgache
FAUNE DE MADAGASCAR Publiée sous les auspices du Gouvernement de la République Malgache 47 REPTILES SAURIENS CHAMAELEONIDAE Genre Brookesia et complément pour le genre Chamae/eo par E.-R. BRYGûû (Mu.séUTn national dHistoire naturelle) Volume honoré d'une subvention de l'Agence de Coopération culturelle et technIque ÜR5TûM CNRS Paris 1978 FAUNE DE MADAGASCAR Collection fondée en 1956 par M. le Recteur Renaud PA LIAN Corre pondant de l'Institut Recteur de l'Académie de Bordeaux (alors Dirocteur adjoint de 1'1 RSM) Collection honorée d'une subvention de l'Académie des Scienoes (fonds Loutreuil) Comité de patronage M.le Dr RAIWTO RATSIMA~fANGA, membre correspondant de l'Institut, Paris. M.le Ministre de l1tducation nati nale, Tananarive. - M. le Président de l'Académie Malgache, Tananarive. - M. le Recteur de 1Université de Tananarive. - M. le Professeur de Zoologie de 1 niversité de Tananariv .- f. le DU'ecteur général du CNRS, Paris. - M. le Directeur général ct l üRSTüM, Pari. M. le Professeur Dr J. MILLOT, membre de l'ln titut, fondateur et ancien directeur de l'IRSM, Parjs. - M. Je Profe ur R. HEIM, fi mbre de lIn titut, Paris. MM. les Professeur J. DOR. T, membre de l'Institut, diJ'ecteul' du Muséum national, Paris; J.-M. PÉRÈS, membre de l'ln titut, Marseille; A. CILU3AUD, Paris; C. DELAMARE DEBouTTEVlLLE, Pari; P. LEHM ,Paris; M. RAKOTOMARIA, Tananarive. Comité de rédaction: M. R. PAlJLIA 1 Président; MM. C. DELAMARE DEBouTTEvILLE, P. DRACH, P. GRIVEA D, A. GRJEBINE, J.-J. PETTER, G. RAMANANTSOAVINA, P. ROEDERER, P. Vn:TTE ( ecrétaire). Les volumes de la «Faune de Madagascar », honorés d'une subvention de la République Malgache, sont publiés avec le concours financier du Centre National de la Recherche Scientifique et de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer. -

Redalyc.Comparative Studies of Supraocular Lepidosis in Squamata
Multequina ISSN: 0327-9375 [email protected] Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas Argentina Cei, José M. Comparative studies of supraocular lepidosis in squamata (reptilia) and its relationships with an evolutionary taxonomy Multequina, núm. 16, 2007, pp. 1-52 Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas Mendoza, Argentina Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42801601 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto ISSN 0327-9375 COMPARATIVE STUDIES OF SUPRAOCULAR LEPIDOSIS IN SQUAMATA (REPTILIA) AND ITS RELATIONSHIPS WITH AN EVOLUTIONARY TAXONOMY ESTUDIOS COMPARATIVOS DE LA LEPIDOSIS SUPRA-OCULAR EN SQUAMATA (REPTILIA) Y SU RELACIÓN CON LA TAXONOMÍA EVOLUCIONARIA JOSÉ M. CEI † las subfamilias Leiosaurinae y RESUMEN Enyaliinae. Siempre en Iguania Observaciones morfológicas Pleurodonta se evidencian ejemplos previas sobre un gran número de como los inconfundibles patrones de especies permiten establecer una escamas supraoculares de correspondencia entre la Opluridae, Leucocephalidae, peculiaridad de los patrones Polychrotidae, Tropiduridae. A nivel sistemáticos de las escamas específico la interdependencia en supraoculares de Squamata y la Iguanidae de los géneros Iguana, posición evolutiva de cada taxón Cercosaura, Brachylophus, -

AC27 Doc. 12.5
Original language: English AC27 Doc. 12.5 CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA ____________ Twenty-seventh meeting of the Animals Committee Veracruz (Mexico), 28 April – 3 May 2014 Interpretation and implementation of the Convention Review of Significant Trade in specimens of Appendix-II species [Resolution Conf. 12.8 (Rev. CoP13)] SELECTION OF SPECIES FOR TRADE REVIEWS FOLLOWING COP16 1. This document has been prepared by the Secretariat. 2. In Resolution Conf. 12.8 (Rev. CoP13) on Review of Significant Trade in specimens of Appendix-II species, the Conference of the Parties: DIRECTS the Animals and Plants Committees, in cooperation with the Secretariat and experts, and in consultation with range States, to review the biological, trade and other relevant information on Appendix-II species subject to significant levels of trade, to identify problems and solutions concerning the implementation of Article IV, paragraphs 2 (a), 3 and 6 (a)... 3. In accordance with paragraph a) of that Resolution under the section Regarding conduct of the Review of Significant Trade, the Secretariat requested UNEP-WCMC to produce a summary from the CITES Trade Database of annual report statistics showing the recorded net level of exports for Appendix-II species over the five most recent years. Its report is attached as Annex 1 (English only) to the present document. The raw data used to prepare this summary are available in document AC27 Inf. 2. 4. Paragraph b) of the same section directs the Animals Committee, on the basis of recorded trade levels and information available to it, the Secretariat, Parties or other relevant experts, to select species of priority concern for review (whether or not such species have been the subject of a previous review). -

AC29 Doc13.3 A2
AC29 Doc. 13.3 Annex 2 Selection of species for inclusion in the Review of Significant Trade following CoP17 To comply with Stage 1 a) of Resolution Conf. 12.8 (Rev. CoP17) and the Guidance regarding the selection of species/country combinations outlined in Annex 2 of the Resolution, the UN Environment World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) has produced an extended analysis to assist the Animals Committee with their work in selecting species for inclusion in the Review of Significant Trade following CoP17. A summary output, providing trade in wild, ranched, source unknown and trade without a source specified over the five most recent years (2011-2015), to accompany this analysis is provided in AC29 Doc. 13.3, Annex 1. The methodology for the extended analysis was discussed by the 2nd meeting of the Advisory Working Group (AWG) of the Evaluation of the Review of Significant Trade (Shepherdstown, 2015). The AWG concluded that three criteria should be retained within the methodology (“high volume trade/high volume trade for globally threatened species”, “sharp increase in trade” and “endangered species in trade”), but that two previously used criteria added little value to the prioritisation exercise (“high variability in trade” and “overall increase/overall decrease in trade”). In addition, it was agreed to refine the methodology for “High Volume” trade to ensure that thresholds are set at a fine taxonomic resolution (order level) to ensure representation for all taxonomic orders. It was also agreed to include analysis of “Sharp Increase” in trade at the country level, as well as at the global level. -

The Population Status of Chameleons Within Ranomafana National Park, Madagascar, and Recommendations for Future Monitoring
The population status of chameleons within Ranomafana National Park, Madagascar, and recommendations for future monitoring Richard K. B. Jenkins, Lee D. Brady, Kieron Huston, Juliet L. D. Kauffmann, Jeanneney Rabearivony, Georges Raveloson and J. Marcus Rowcliffe Abstract Malagasy chameleons are threatened by the on distance sampling within an area of relatively relentless pace of habitat destruction. Their great popu- undisturbed rain forest at Ranomafana National larity amongst herpetoculturalists has also resulted in Park. In total 394 individuals from six species were collection for international animal markets. Most previ- recorded and population densities (+ SE) of 27.2 + ous fieldwork has focused on the compilation 5.4/ha Brookesia spp. and 21.4±4.0/ha Calumma of much needed species inventories, but little attention spp. were estimated using the computer program has been given to estimating chameleon popu- DISTANCE. The authors propose that monitoring of lation densities. This lack of information prevents a chameleons in areas subject to different threats should reliable assessment of the effects of habitat loss and begin immediately using the methods outlined in this direct exploitation on wild populations. A simple and paper. repeatable methodology for the monitoring of chameleon populations is therefore urgently required. Keywords Chameleon, Madagascar, population den- The present study developed survey techniques based sity, rain forest, trade. Introduction increased significantly and for some chameleon species increases of up to 400 per cent have been reported Although the degradation and destruction of forests are (World Conservation Monitoring Centre & IUCN/SSC undoubtedly the primary threat to Madagascar's fauna Trade Specialist Group, 1991; IUCN/SSC Trade Special- (Raxworthy, 1988), the additional pressure of exploi- ist Group et al, 1993). -

Ambatovy Case Study
Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP) BBOP Pilot Project Case Study The Ambatovy Project Forest Trends, Conservation International and the Wildlife Conservation Society provided the Secretariat for BBOP during the first phase of the programme's work (2004 – 2008). Publication Data The Ambatovy Project Business and Biodiversity Offsets Programme Pilot Project Case Study, 2009: The Ambatovy Project is a Joint Venture project between Sherritt Incorporated, Sumitomo Incorporated, Kores and SNC Lavalin. The Ambatovy Project is comprised of the following two Madagascan operating companies, Ambatovy Minerals SA (AMSA) and Dynatec Madagascar S.A. (DMSA). The Project Administrative offices are located at Trano Fitaratra, 7ème étage, Ankorondrano, Antananarivo, Madagascar (PO Box 12085, Poste Zoom, Ankorondrano), T: +261 20 22 230 88 / 22 397 35 – 37 F: +261 20 22 540 30, http://www.sherritt.mg/ Available from www.forest-trends.org/biodiversityoffsetprogram/guidelines/ambatovy-case-study.pdf. © The Ambatovy Project (Ambatovy Minerals SA/Dynatec Madagascar SA) 2009. Reproduction of this publication for educational or other non-commercial purposes is authorised without prior written permission from the copyright holder provided the source is fully acknowledged. Reproduction of this publication for resale or other commercial purposes is prohibited without prior written permission of the copyright holder. The findings, interpretations and conclusions expressed here are those of the authors and do not necessarily reflect the views of The -

O ---Douzième Réunion De L
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA ----------- o ---------- Douzième réunion de la Conférence des Parties Santiago (Chili), du 3 au 5 novembre 2002 --------------- o -------------- Proposition d’amendement des annexes suivant la Résolution de CITES Conf. 9. 24 A. Proposition Classement de l’espèce Brookesia spp (GRAY 1865) en Annexe II de la CITES. Compte tenu des synonymies entre certaines espèces (Raxworthy & Nussbaum, 1995) et des validités des noms d’espèces par Raxworthy (in litt.), 25 espèces de Brookesia sont reconnues pour cette proposition. Beaucoup d’espèces de Brookesia sont nettement affectées par le commerce international pendant les deux dernières années. Les données d’exportations de ces espèces au cours des deux dernières années le confirment (MEF, 2000, 2001) . A part B. perarmata, qui est déjà proposé en Annexe I, les 25 espèces sont considérées comme menacées d’extinction suivant l’Article II, paragraphe 1 remplissant les critères biologiques B (i) dans l’Annexe II de la Résolution de CITES Conf. 9. 24. Les autres espèces de ce genre devraient être inscrites en Annexe II conformément à l’Article II, paragraphe 2b) remplissant le critère B. Ainsi, elles sont considérées comme étant l’objet d’un amendement des Annexes de la CITES. B. Auteur de la proposition Madagascar C. Justificatif Brookesia ou caméléons nains sont classés parmi les faux caméléons, endémiques de Madagascar (Glaw & Vences, 1994 ; in Carpenter, 2002). Les espèces de Brookesia sont généralement de petite taille variant entre 30 et 110mm, terrestres, vivant sous la litière dans la forêt et offre un caractère mimétique relativement limité en couleur brune ou terne. -
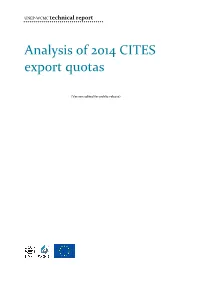
Analysis of 2014 CITES Export Quotas
UNEP-WCMC technical report Analysis of 2014 CITES export quotas (Version edited for public release) 2 Analysis of 2014 CITES export quotas Prepared for The European Commission, Directorate General Environment, Directorate E - Global & Regional Challenges, LIFE ENV.E.2. – Global Sustainability, Trad e & Multilateral Agreements , Brussels, Belgium Published April 2014 Copyright European Commission 2014 Citation UNEP-WCMC. 2014. Analysis of 2014 CITES export quotas. UNEP-WCMC, Cambridge. The UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) is the specialist biodiversity assessment centre of the United Nations Environment Programme, the world’s foremost intergovernmental environmental organization. The Centre has been in operation for over 30 years, combining scientific research with policy advi ce and the development of decision tools. We are able to provide objective, scientifically rigorous products and services to help decision - makers recognize the value of biodiversity and apply this knowledge to all that they do. To do this, we collate and verify data on biodiversity and ecosystem s ervices that we analyze and interpret in comprehensive assessments, making the results available in appropriate forms for national and international level decision -makers and businesses. To ensure that our work is both sustainable and equitable we seek to build the capacity of partners where needed, so that they can provide the same services at national and regional scales. The contents of this report do not necessarily reflect the views or policies of UNEP, contributory organisations or editors. The desig nations employed and the presentations do not imply the expressions of any opinion whatsoever on the part of UNEP, the European Commission or contributory organisations, editors or publishers concerning the legal status of any country, territory, city area or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. -

Systematic Biology
Volume 58 Number 6, pp. 547–661 58 Number Volume Systematic Biology Volume 58, Number 6 December 2009 CONTENTS Systematic Biology REGULAR ARTICLES Species Tree Discordance Traces to Phylogeographic Clade Boundaries in North American Fence A JOURNAL OF THE Lizards ( Sceloporus ) Adam D. Leaché ........................................................................................................................................................................ 547 Society of Systematic Biologists The Use and Validity of Composite Taxa in Phylogenetic Analysis Véronique Campbell and François-Joseph Lapointe .................................................................................................................. 560 Radiation of Extant Cetaceans Driven by Restructuring of the Oceans Mette E. Steeman, Martin B. Hebsgaard, R. Ewan Fordyce, Simon Y. W. Ho, Daniel L. Rabosky, Rasmus Nielsen, Carsten Rahbek, Henrik Glenner, Martin V. Sørensen, and Eske Willerslev ........................................................................... 573 Taxon Selection under Split Diversity Bui Quang Minh, Steffen Klaere, and Arndt von Haeseler ...................................................................................................... 586 Estimating Trait-Dependent Speciation and Extinction Rates from Incompletely Resolved Phylogenies Richard G. FitzJohn, Wayne P. Maddison, and Sarah P. Otto ................................................................................................. 595 Reticulation, Data Combination, and Inferring -

Vertebrate Time-Tree Elucidates the Biogeographic Pattern of a Major Biotic Change Around the K–T Boundary in Madagascar
Vertebrate time-tree elucidates the biogeographic pattern of a major biotic change around the K–T boundary in Madagascar Angelica Crottinia,b,1, Ole Madsenc, Celine Pouxd,e,f, Axel Straußa, David R. Vieitesg, and Miguel Vencesa,2 aDivision of Evolutionary Biology, Zoological Institute, Technical University of Braunschweig, 38106 Braunschweig, Germany; bSezione di Zoologia e Citologia, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Milano, 20133 Milan, Italy; cAnimal Breeding and Genomics Centre, Wageningen University, 6700 AH Wageningen, The Netherlands; dUniversité Lille Nord de France, Campus Lille 1-Université des Sciences et Technologies de Lille, Laboratoire de Génétique et Évolution des Populations Végétales, F-59650 Villeneuve d’Ascq, France; eCentre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Unité Mixte de Recherche (UMR) 8198, F-59650 Villeneuve d’Ascq, France; fVertebrate Department, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, 1000 Brussels, Belgium; and gMuseo Nacional de Ciencias Naturales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 28006 Madrid, Spain Edited by David B. Wake, University of California, Berkeley, CA, and approved January 18, 2012 (received for review August 25, 2011) The geographic and temporal origins of Madagascar’s biota have reconstruction of molecular time-trees have started to resolve long been in the center of debate. We reconstructed a time-tree the biogeography of Madagascar, previously characterized as one including nearly all native nonflying and nonmarine vertebrate of the greatest mysteries of natural history (10, 11). For numerous clades present on the island, from DNA sequences of two single-copy Malagasy clades of amphibians, squamates, and mammals, sister- BDNF RAG1 protein-coding nuclear genes ( and ) and a set of congru- group relationships to African taxa and a Cenozoic age are now ent time constraints. -

Species Specific Provisions for Amphibians Background
Restricted Strasbourg, 27 August 2004 GT 123 (2004) 14 WORKING PARTY FOR THE PREPARATION OF THE FOURTH MULTILATERAL CONSULTATION OF PARTIES TO THE EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF VERTEBRATE ANIMALS USED FOR EXPERIMENTAL AND OTHER SCIENTIFIC PURPOSES (ETS 123) 8th Meeting of the Working Party Strasbourg, 22-24 September 2004 ___________ Species specific provisions for Amphibians Background information for the proposals presented by the Group of Experts on Amphibians and Reptiles PART B _____ This document will not be distributed at the meeting. Please bring this copy. Ce document ne sera plus distribué en réunion. Prière de vous munir de cet exemplaire. 2 Background information On the species-specific proposals for amphibians Presented by the Expert Group on Amphibians and Reptiles Jörg-Peter Ewert 1 (Coordinator), John E. Cooper 2, Tom Langton 3, Gilbert Matz 4, Kathryn Reilly 5, Helen Schwantje 6 ___________________ 1Department of Neurobiology, Faculty of Natural Sciences, University of Kassel, Heinrich-Plett-Str. 40, D-34109 Kassel, Germany, Email: [email protected], [email protected] 2Wildlife Health Services, PO Box 153, Wellingborough NN8 2ZA, UK, Email: [email protected] [Present address: Prof. John E. Cooper, DTVM, FRCPath, FIBiol, FRCVS ; School of Medical Sciences, The University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad and Tobago; Email: [email protected] ] 3Triton House, Bramfield, Halesworth, Suffolk 1P19 9AE, UK, Email: [email protected] 4Laboratoire de Biologie Animale, Université d'Angers, 2 Bd Lavoisier, F-49045 Angers Cedex 01, France 5Merck Sharp & Dohme Ltd, Terling Park, Eastwick Road, Harlow, Essex CM20 2QR, UK, Email: [email protected] 6Canadian Council on Animal Care Constitution Square, Tower II, 315-350 Albert Street, Ottawa, ON K1R 1B1, Canada, Email: [email protected] 3 C o n t e n t s Preamble Amphibians 1.