La Série Des Danois : [I : Victor Bendix
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A CN 34 Orkester Tekst 01 1 03/12/04, 15:27 C ARL NIELSEN
C ARL NIELSEN V ÆRKER W ORKS Carl Nielsen Udgaven CN 00034 i A CN 34 orkester tekst 01 1 03/12/04, 15:27 C ARL NIELSEN 1 865-1931 V ÆRKER W ORKS Udgivet af Carl Nielsen Udgaven Det Kongelige Bibliotek Hovedredaktør Niels Krabbe Serie II. Instrumentalmusik. Bind 8 Published by The Carl Nielsen Edition The Royal Library Editor in chief Niels Krabbe Series II. Instrumental Music. Volume 8 Edition Wilhelm Hansen Copenhagen 2004 Carl Nielsen Udgaven CN 00034 ii A CN 34 orkester tekst 01 2 03/12/04, 15:27 C ARL NIELSEN ORKESTERVÆRKER 2 ORCHESTRAL WORKS 2 Udgivet af Edited by Niels Bo Foltmann Peter Hauge Edition Wilhelm Hansen Copenhagen 2004 Carl Nielsen Udgaven CN 00034 iii A CN 34 orkester tekst 01 3 03/12/04, 15:27 Orchestral parts are available Graphic design Kontrapunkt A/S, Copenhagen Music set in SCORE by New Notations, London Text set in Swift Printed by Quickly Tryk A/S, Copenhagen CN 00034 ISBN 87-598-1127-7 ISMN M-66134-113-0 Sponsored by Vera og Carl Johan Michaelsens Legat Distribution Edition Wilhelm Hansen A/S, Bornholmsgade 1, DK-1266 Copenhagen K Translation James Manley © 2004 Carl Nielsen Udgaven, Det Kongelige Bibliotek, København All rights reserved 2004 Carl Nielsen Udgaven CN 00034 iv A CN 34 orkester tekst 01 4 03/12/04, 15:27 INDHOLD C ONTENTS General Preface vii Generelt forord Preface xi Forord Facsimiles xxxiii Faksimiler SAGA DREAM, OPUS 39 1 SAGA-DRØM, OPUS 39 AT THE BIER OF A YOUNG ARTIST 23 VED EN UNG KUNSTNERS BAARE FOR STRING ORCHESTRA FOR STRYGEORKESTER ANDANTE LAMENTOSO ANDANTE LAMENTOSO NEARER MY GOD TO -
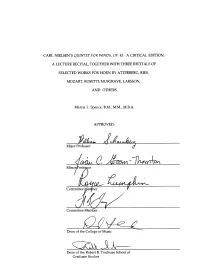
Carl Nielsen's Quintet for Winds, Op. 43: a Critical Edition
CARL NIELSEN'S QUINTET FOR WINDS, OP. 43: A CRITICAL EDITION, A LECTURE RECITAL, TOGETHER WITH THREE RECITALS OF SELECTED WORKS FOR HORN BY ATTERBERG, RIES, MOZART, ROSETTI, MUSGRAVE, LARSSON, AND OTHERS Marcia L. Spence, B.M., M.M., M.B.A. APPROVED: Major Professor Minor rofessor Committee eiber Committee Member Dean of the College of Music Dean of the Robert B. Toulouse School of Graduate Studies ONA1If CARL NIELSEN'S QUINTET FOR WINDS, OP. 43: A CRITICAL EDITION, A LECTURE RECITAL, TOGETHER WITH THREE RECITALS OF SELECTED WORKS FOR HORN BY ATTERBERG, RIES, MOZART, ROSETTI, MUSGRAVE, LARSSON, AND OTHERS DISSERTATION Presented to the Graduate Council of the University of North Texas in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS By Marcia L. Spence, B.M., M.M., M.B.A. Denton, Texas December, 1995 Spence, Marcia Louise, Carl Nielsen's Quintet for Winds, Op. 43: A Critical Edition, A Lecture Recital, Together with Three Recitals of Selected Works for Horn by Atterberg, Ries, Mozart, Rosetti, Musgrave, Larsson, and Others. Doctor of Musical Arts (Performance), December, 1995, 143 pp., 14 examples, 3 appendices, bibliography, 29 titles. The purpose of this dissertation is to prepare and present a critical edition of Carl Nielsen's Quintet fbr Winds, Op. 43, a major work in the woodwind quintet repertoire. Written for the Copenhagen Wind Quintet in 1922, it is also considered a pivotal composition in Nielsen's artistic output. The only published edition of this piece, by Edition Wilhelm Hansen, is rife with errors, a consistent problem with many of Nielsen's compositions. -

Yhtenäistetty Carl Nielsen
Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 166 Yhtenäistetty Carl Nielsen Teosten yhtenäistettyjen nimekkeiden ohjeluettelo Heikki Poroila Suomen musiikkikirjastoyhdistys Helsinki 2013 Julkaisija Suomen musiikkikirjastoyhdistys Toimitustyö ja ulkoasu Heikki Poroila Verkkoversio 1.0 © Heikki Poroila 2013 01.4 POROILA , HEIKKI Yhtenäistetty Carl Nielsen : Teosten yhtenäistettyjen nimekkeiden oh- jeluettelo / Heikki Poroila. – Verkkoversio 1.0. – Helsinki : Suomen musiikkikirjastoyhdistys, 2013. – 39 s. - (Suomen musiikkikirjastoyh- distyksen julkaisusarja, ISSN 0784-0322 ; 166). – ISBN 978-952- 5363-65-4 (PDF) ISBN 978-952-5363-65-4 Lukijalle CARL NIELSEN (9.6.1865 – 3.10.1931) on tanskalaisille suunnilleen samassa asemassa kuin Jean Si- belius suomalaisille. Meillä Nielsenin tuotannosta tunnetaan kuitenkin vain kuusi sinfoniaa, muu- tama orkesteriteos ( Helios -alkusoitto, Pan og Syrinx sekä huilu- ja klarinettikonsertot) ja ehkä oop- perat Saul og David ja Maskarade . Nielsenin laaja vokaalituotanto, kantaatit ja lukuisat näyttämö- musiikkiteokset ovat Tanskan ulkopuolella huonosti tunnettuja. Kirjaston luetteloijille tarkoitetun ohjeluettelon tarve ei ole ollut erityisen suuri, mutta koska Niel- senin tuotantoon liittyy erinäisiä kielellisiä erityiskysymyksiä ja eräiden sinfonioiden erisnimisyys on synnyttänyt epätietoisuutta, lienee tällekin luettelolle jonkinlainen tarve. Olen pitänyt teosauktoriteettina suhteellisen vanhaa Dan Fogin teosluetteloa*, jonka FS-numerointi on vakiintunut yleiseen käyttöön satunnaisten opusnumeroiden -

Carl Nielsen the Masterworks Volume 1 – Orchestral Music
carl NielseN The masTerworks Volume 1 – orchestral music DaNish NatioNal symphoNy orchestra Michael Schønwandt / thoMaS dauSgaard CD 1 carl NielseN Symphony no. 3, op. 27 “Sinfonia espansiva” (1910-11) 37:11 1 I Allegro espansivo �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11:41 The masTerworks 2 II Andante pastorale** 9:33 Volume 1 – orchestral music 3 III Allegretto un poco ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6:21 4 IV Finale: Allegro �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9:28 ** Inger Dam-Jensen, soprano; Poul Elming , tenor DaNish NatioNal symphoNy orchestra Michael Schønwandt / thoMaS dauSgaard * Symphony no. 2, op. 16 “The Four Temperaments” (1901-02) �����������������������������33:44 5 I Allegro collerico ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10:07 6 II Allegro comodo e flemmatico 4:39 7 III Andante malincolico �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11:20 -

C a R L N I E L S E N S T U D I
CARL NIELSEN STUDIES V O L U M E V I • 2 0 2 0 CARL NIELSEN STUDIES V O L U M E V I • 2 0 2 0 Edited by Michelle Assay, David Fanning (editor-in-chief), Daniel Grimley, Niels Krabbe (consultant), and Christopher Tarrant Copenhagen 2020 The Royal Library Honorary board John Bergsagel, prof.emer., Copenhagen Jean Christensen, prof., University of Louisville, Kentucky Ludwig Finscher, prof.emer., Wolfenbüttel Jim Samson, prof., Royal Holloway, London Arnold Whittall, prof.emer., King’s College, London Editorial board Michelle Assay David Fanning (editor-in-chief) Daniel Grimley Niels Krabbe (consultant) Christopher Tarrant Translation or linguistic amendment of texts by Eskildsen, Røllum-Larsen, and Caron has been carried out by David Fanning, Marie-Louise Zervides, and Michelle Assay. Graphic design Kontrapunkt A/S, Copenhagen Layout and formatting Hans Mathiasen Text set in Swift ISSN 1603-3663 Sponsored by The Carl Nielsen and Anne Marie Carl-Nielsen Foundation © 2020 The authors and Carl Nielsen Studies, The Royal Library All rights reserved 2020 Permission for the use of quotations from the Carl Nielsen Edition has been kindly given by The Royal Library. NIELSEN AND GADE Landmarks of Musical Denmarks By Karsten Eskildsen Where did it all come from? This is a fair question not only in relation to Nielsen but also to most artists. So where did Nielsen collect all his skills, ideas and ambitions? For decades, Danish musical tradition has had it that young Nielsen was a country lad who through his own will, professional musicianship at the military band in Odense, and three years at Copenhagen Conservatoire was able in his maturity to transform the folk music experience of his childhood into mastery and universal art. -

Flute: Late Style in Carl Nielsen’S Works for Flute
THE “ARCADIAN” FLUTE: LATE STYLE IN CARL NIELSEN’S WORKS FOR FLUTE A thesis submitted to the Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS in the Performance Studies Division of the College-Conservatory of Music 2004 by Beth E. Chandler B.M., Baylor University, 1993 M.M., New England Conservatory, 1996 Committee Chair: bruce d. mcclung, Ph.D. ABSTRACT Revered as Denmark’s most celebrated musical figure and regarded as one of the finest, albeit under recognized composers, Carl Nielsen (1865–1931) holds a place as one of the most individual and creative artists of his time. Straddling the nineteenth and twentieth centuries and with consideration to the dramatically changing musical climate of that time, Nielsen’s vast output is stylistically complex. His music spans an array of styles, with elements of Romanticism in his early works, to an outright rejection of these same principles and an adoption of extensive progressivism in later works, all the while maintaining features of neoclassicism. There are six known works by Carl Nielsen that include flute in a solo or chamber role. These works date from his late, mature compositional period and include a short piece for solo flute from the incidental music to Aladdin, Op. 34 (1918–19); three pieces from the incidental music to Moderen (The mother), Op. 41 (1920): “Taagen letter” (The fog is lifting) for flute and piano or harp, “Børnene spiller” (The children are playing) for solo flute, and “Tro og håb spiller” (Faith and hope are playing) for flute and viola; the Wind Quintet, Op. -

C a R L N I E L S E N S T U D I
CARL NIELSEN STUDIES V O L U M E V I • 2 0 2 0 CARL NIELSEN STUDIES V O L U M E V I • 2 0 2 0 Edited by Michelle Assay, David Fanning (editor-in-chief), Daniel Grimley, Niels Krabbe (consultant), and Christopher Tarrant Copenhagen 2020 The Royal Library Honorary board John Bergsagel, prof.emer., Copenhagen Jean Christensen, prof., University of Louisville, Kentucky Ludwig Finscher, prof.emer., Wolfenbüttel Jim Samson, prof., Royal Holloway, London Arnold Whittall, prof.emer., King’s College, London Editorial board Michelle Assay David Fanning (editor-in-chief) Daniel Grimley Niels Krabbe (consultant) Christopher Tarrant Translation or linguistic amendment of texts by Eskildsen, Røllum-Larsen, and Caron has been carried out by David Fanning, Marie-Louise Zervides, and Michelle Assay. Graphic design Kontrapunkt A/S, Copenhagen Layout and formatting Hans Mathiasen Text set in Swift ISSN 1603-3663 Sponsored by The Carl Nielsen and Anne Marie Carl-Nielsen Foundation © 2020 The authors and Carl Nielsen Studies, The Royal Library All rights reserved 2020 Permission for the use of quotations from the Carl Nielsen Edition has been kindly given by The Royal Library. N I E L S E N , SAUL AND DAVID A N D THE SYMBOLIST MOVEMENT Cultural-Historical Perspectives By Marie-Louise Zervides In his 1991 biography, Carl Nielsen – Danskeren (Carl Nielsen – The Dane), the Danish theo- logian and literary critic Jørgen I. Jensen argued the importance of symbolism in Carl Nielsen’s artistic development. He stated: ‘Carl Nielsen’s art originates in short from a symbolist culture; it is musical symbolism.’1 Nielsen never publicly associated himself with the term, however. -
Jensen Discography 2015-1
RECORDINGS OF THOMAS JENSEN, CONDUCTOR (2015 EDITION by Anthony Cane) Born Copenhagen 25 Oct 1898, died Frederiksberg (Copenhagen) 13 Nov 1963 Principal Conductor of the Aarhus By-Orkester (Civic or Municipal Orchestra), later Aarhus Symphony Orchestra, 1935-57 Conductor of Danish State Radio Symphony Orchestra (now Danish National Symphony Orchestra) 1957-63 Conductor of Tivoli Concert Hall (Symphony) Orchestra, also Copenhagen Philharmonic Orchestra, 1936-49 Jensen’s first recordings were made in Copenhagen, headquarters of the major record companies HMV and Tono. Not until 1948 did Tono establish recording facilities enabling Jensen to record with his own orchestra in Aarhus. ABBREVIATIONS ACO Aarhus Civic (Municipal) Orchestra bc broadcast (later Symphony Orchestra) pp public performance (so-called “live”) CPO Copenhagen Philharmonic Orchestra p piano (a pickup ensemble for recording purposes) vn violin DR Danish Radio fl flute DRSO Danish (State) Radio (Broadcasting) Symphony Orchestra tpt trumpet HMV His Master’s Voice s soprano RO Royal Orchestra (Royal/Copenhagen Opera Orchestra) ms mezzo-soprano (also sometimes Royal Chapel Orchestra, misleadingly t tenor in that “kapel” in music is “orchestra,” not “chapel”) br baritone TCO Telmányi (or Emil Telmányi’s) Chamber Orchestra bs bass (augmented) Tivoli Tivoli Concert Hall/Symphony Orchestra WRC World Record Club All 78 or 33 records are 30cm (12in) unless otherwise stated; EP (45rpm) records are 17cm (7in) DATE/ARTISTS MATRIX TITLE CATALOGUE THE EARLY COPENHAGEN RECORDINGS 8/9/37 -

CARL NIELSEN and the GOTHENBURG ORCHESTRAL SOCIETY 1914-31 Contact, Programming, and Repertoire
CARL NIELSEN AND THE GOTHENBURG ORCHESTRAL SOCIETY 1914-31 Contact, programming, and repertoire By Peter Hauge Carl Nielsen’s time in Gothenburg may be regarded as one of his most successful peri- ods as conductor. Mutual respect prevailed between Nielsen the conductor, the Or- chestral Society’s management and the musicians. Among ‘Europe’s finest orchestras’ which Carl Nielsen had conducted up until 1918 – such as the orchestras in Stuttgart, Berlin, Amsterdam, Stockholm, Helsinki and Kristiania (Oslo) – he included the Gothen- burg Symphony Orchestra, and said that it was ‘better than the Royal Chapel in Copen- hagen when taken in its entirety’.1 This claim should also be seen in the light of the considerable disagreement between the composer and the Royal Theatre leading to his resignation in 1914. When one reads contemporary reviews of the concerts which Nielsen conducted in Gothenburg, it is apparent that he was extremely popular among the musicians and especially among the audience. It was also in Gothenburg that Nielsen composed some of his greatest works, including the Fifth Symphony at the start of the 1920s and not least the Wind Quintet, which he completed and had played through while he was in Gothenburg in Spring 1922.2 Nevertheless, this pe- riod is only superficially discussed in the recent literature on the composer, which most often relies on the first Carl Nielsen biography by Meyer and Schandorf Petersen (1947-48).3 Their material is often based on anecdotes and the relatively few pub- 1 bedre end det Kgl. Kapel i Kjøbenhavn hvad Helheden angaar. DK-Kk, CNA I.A.c., Carl Nielsen to Johannes Nielsen, 12.12.1918; in 1930 Nielsen wrote a short article for the orchestra’s 25th anniversary, reproduced in John Fellow (ed.), Carl Nielsen til sin samtid, Copenhagen 1999, 552-53. -

Booklet DACOCD351-353 . Kopi
CARL NIELSEN ON RECORD VINTAGE AND HISTORIC RECORDINGS DACOCD 801-830 30 CD Thomas Jensen Launy Grøndahl Erik Tuxen Carl Nielsen (1865-1931) is the central figure in Wagner’s operas. Danish music after the Romantic period. Through Similarly, his approach to thematic development his music, his writings and his strong personality and to structure seems to have been strongly he exerted a decisive influence on 20th-century influenced by his admiration for Beethoven’s and Danish music and musical aesthetics, and he was, Franck’s chamber music and symphonies. Fairly moreover, a source of inspiration for composers early on, however, he discovered his own in the other Scandinavian countries. He absorbed personal and unmistakable style, which he later and reformulated the best features of the musical developed relatively undisturbed within its own heritage, and he composed in nearly all genres. premises. His six symphonies are milestones in his Nielsen started out from the Classical harmony of compositorial output. the 18th and early 19th centuries, with its In the 20th-century Nielsen’s music has often preference for triads in the tonic and related keys been described as a reaction against the high and and for a relatively fast harmonic rhythm, and late Romantic style; but this description is these elements clearly marked his entire output. incorrect, since it throws less light on the music But during the 1890s he developed his harmony, than on the fact that later generations adopted the apparently independently, to what might be called stylistic ideals of Nielsen, and since Nielsen “extended tonality”, where all 12 semitones could himself denied the possibility of revolution in art. -

Carl Nielsen and the Radio
CARL NIELSEN AND THE RADIO By Knud Ketting Only a few places in Europe took up the newly developed radio as quickly and as widely as Denmark. In 1930, when the public Danish radio organisation had five years behind it, Denmark was statistically leading in European terms and had been there for some time. At this point in Denmark there were 119.5 registered radio listeners per 1000 inhabitants, and a long way behind lay Sweden with 79, and the UK, Austria and Ger- many with 77.5, 63.4, and 56.2 respectively.1 There were certainly also some ‘pirate listeners’, or ‘plankeværkslyttere’ as they were known in Denmark, which is to say, lis- teners who did not pay the statutory fee. But the Danish weekly radio magazine, which published the figures, maintained that the highest number could be found at the bot- tom of the European table, in Romania, where the official figure was 2.8. Radio broadcasting was of crucial importance for the development of musical life in Denmark, and therefore also for Carl Nielsen, without doubt the leading com- poser in Denmark at the time. As in a series of other European nations, the develop- ment of radio broadcasting began with a private war of the air waves, in which politi- cians then intervened. Relatively swift legislation led to the creation of a national licence- paid broadcasting authority on 1 April 1925, at first as a trial and then, within a year, on a permanent basis. It was hardly a coincidence that the first manager of the Danish broadcasting authority to be chosen was a man already involved with music, namely the bass singer Emil Holm (1867-1950), who, after a career in German opera houses2 returned to Denmark at the outbreak of the First World War. -

Carl Nielsen Studies 2 (2005)
REPORTS REPORTS The Carl Nielsen Edition in The Carl Nielsen Edition despite the fact Since the publication of Carl Nielsen Studies that it is not orchestrated by Nielsen, 1 the following volumes have appeared: which is in full conformity to the editorial principles behind the edition. Vol. II/8, Orchestral Works 2, edited by Niels Bo Foltmann and Peter Hauge Vol. II/10, Chamber Music 1, edited by Lisbeth Contents: Saga Dream Op. 39, At the Bier Ahlgren Jensen, Elly Bruunshuus Petersen of a Young Artist (Andante Lamentoso), Nearer and Kirsten Flensborg Petersen. my God to Thee (Paraphrase), Pan and Syrinx Contents: String Quartets, Op. 5, Op. Op. 49, Rhapsody Overture (An imaginary 13, Op. 14 and Op. 44, String Quintet, and journey to the Faroe Islands), and Bohemian- the two works for solo violin, Op. 48 and Danish Folksong Paraphrase. Op. 52. One of these works are printed here for the first time, namely the paraphrase Vol. II/11, Chamber Music 2, edited by Lisbeth of Nearer my God to Thee, which is pre- Ahlgren Jensen, Elly Bruunshuus Petersen sented in the edition in the original in- and Kirsten F. Petersen. strumentation for large wind orchestra, Contents: Violin Sonatas Op. 9 and Op. drawn up by Julius Reesen with Carl Niel- 35, Fantasy Pieces for Oboe and Piano, Op. sen’s full knowledge and against the back- 2, Canto Serioso, Serenata in vano, Wind ground of Nielsen’s manuscript short Quintet Op. 43, Three Pieces for Langeleik, score, which is preserved in The Royal Li- and Allegretto for Two Recorders.