Brgm/Rr-37322-Fr
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Le Mag' Touristique
LE MAG’ TOURISTIQUE - Soyez aux rendez vous 2020 2021 Interviews Patrimoine Nature & tradition Gastronomie e Les gens Les bastides 20 Route de L’automne d’ici & les châteaux la transhumance gourmand Office de Tourisme Les engagements ’ qualité des Landes d Armagnac Tél. 05 58 03 40 31 - [email protected] Qualité de l’hébergement Nos bureaux Gabarret Labastide d’Armagnac, Maison du Gabardan www.clevacances.com 53, Place Royale 111, Rue Armagnac www.gites-de-france-landes.com Saint-Justin Villeneuve de Marsan 23, Place des Tilleuls 181, Grand’Rue Label Gîte Bacchus : labellisés Gîtes de France ou Clévacances, ils vous assurent une immersion totale dans l’ambiance du vignoble armagnacais. www.fleursdesoleil.fr : Label qui concerne uniquement les chambres Adresses utiles Lieux d’accès Internet Accueil vélo : cette marque signale les prestataires engagés pour offrir le meilleur • Villeneuve de Marsan - Médiathèque - 625 Av. des Pyrénées - 05 58 45 80 52 accueil et les services aux touristes à vélo. • Gabarret A.M.I. Tél. 05 58 44 38 64 - (0,50€ la 1/2 h) lundi et mardi • Roquefort A.M.I. Tél. 05 58 45 52 65 - 31, Chemin de Bas de Haut (0,50€ la 1/2h) jeudi et vendredi - Mairie, Place du Soleil d’Or (Gratuit) www.tourisme-handicaps.org • Les 4 points d’accueil de l’Office de Tourisme : accès wifi gratuit Médiathèques, bibliothèques www.logishotels.com • Villeneuve de Marsan Tél. 05 58 45 80 52 - [email protected] • Le Frêche Tél. 05 58 45 24 14 Qualité des produits et de l’accueil • St Cricq Villeneuve Tél. -

40990 Angoumé 40150 Angresse 40320 Arboucave 40110
40990 Angoumé 40150 Angresse 40320 Arboucave 40110 Arengosse 40700 Argelos 40430 Argelouse 40110 Arjuzanx 40330 Arsague 40190 Arthez-d'Armagnac 40120 Arue 40700 Aubagnan 40500 Audignon 40400 Audon 40320 Bahus-Soubiran 40380 Baigts 40700 Bassercles 40360 Bastennes 40320 Bats 40400 Bégaar 40410 Belhade 40120 Bélis 40300 Bélus 40180 Bénesse-lès-Dax 40230 Bénesse-Maremne 40250 Bergouey 40240 Betbezer-d'Armagnac 40370 Beylongue 40700 Beyries 40390 Biarrotte 40170 Bias 40390 Biaudos 40600 Biscarrosse 40330 Bonnegarde 40370 Boos 40270 Bordères-et-Lamensans 40190 Bourdalat 40330 Brassempouy 40320 Buanes 40120 Cachen 40300 Cagnotte 40430 Callen 40090 Campagne 40090 Canenx-et-Réaut 40400 Carcarès-Sainte-Croix 40400 Carcen-Ponson 40380 Cassen 40330 Castel-Sarrazin 40360 Castelnau-Chalosse 40320 Castelnau-Tursan 40700 Castelner 40500 Cauna 40300 Cauneille 40250 Caupenne 40700 Cazalis 40090 Cère 40320 Classun 40320 Clèdes 40180 Clermont 40210 Commensacq 40240 Créon-d'Armagnac 40360 Donzacq 40500 Dumes 40210 Escource 40290 Estibeaux 40240 Estigarde 40320 Eugénie-les-Bains 40500 Eyres-Moncube 40500 Fargues 40190 Frêche 40350 Gaas 40090 Gaillères 40380 Gamarde-les-Bains 40420 Garein 40180 Garrey 40110 Garrosse 40160 Gastes 40330 Gaujacq 40320 Geaune 40090 Geloux 40380 Gibret 40180 Goos 40990 Gourbera 40465 Gousse 40400 Gouts 40290 Habas 40700 Hagetmau 40300 Hastingues 40250 Hauriet 40180 Heugas 40190 Hontanx 40700 Horsarrieu 40230 Josse 40700 Labastide-Chalosse 40300 Labatut 40530 Labenne 40210 Labouheyre 40320 Lacajunte 40700 Lacrabe 40090 Laglorieuse -

16 Fsd N2000 Fr7200722
Date d'édition : 01/03/2019 Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne. http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200722 NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC) FR7200722 - Réseau hydrographique des affluents de la Midouze 1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1 2. LOCALISATION DU SITE .............................................................................................................. 2 3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4 4. DESCRIPTION DU SITE ............................................................................................................... 7 5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ........................................................................................... 8 6. GESTION DU SITE ........................................................................................................................ 8 1. IDENTIFICATION DU SITE 1.1 Type 1.2 Code du site 1.3 Appellation du site B (pSIC/SIC/ZSC) FR7200722 Réseau hydrographique des affluents de la Midouze 1.4 Date de compilation 1.5 Date d’actualisation 30/11/1995 31/05/1998 1.6 Responsables Responsable technique Responsable national et européen Responsable -

Corrigé THÈME 1 LES Transformations Du Paysage
livret du jeune visiteur élèves du cycle 3 corrigé THÈME 1 LES transformations du paysage 1 COMMENSACQ La Mouleyre. Bergers près d’un parc Sans date, réf M.A. : 66.27.2186. Juillet 2005. 1 - Complète le tableau ci-dessous en faisant la liste des éléments vus sur les photographies 2 - Réponds aux questions suivantes : - A quoi servait la construction de la photographie prise par Félix Arnaudin ? Photographie en noir et blanc Photographie en couleur A parquer les moutons. La bergerie La maison Les moutons La moto - A quoi servait la construction de la photographie prise par Jean-Joël Le Fur ? A se loger. Les bergers sur échasses L’homme assis à l’ombre - A ton avis, quel était l’intérêt au XIXe siècle de se déplacer dans la lande avec les échasses comme les bergers ? La forêt au lointain Les chênes autour de la maison A faire de grands pas, voir au loin, enjamber les cours d’eau et les fossés. La forêt de pins au lointain 3 - Entoure sur les deux photos les moyens que les hommes utilisent pour se déplacer. Les échasses, la moto. THÈME 1 2 MORCENX Pêche au Lagouat à Cornalis 1 – Entoure sur les trois photographies la construction qui a servi de point de repère à Jean-Joël Le Fur. La bergerie. 2 – Réponds à la question suivante : Quel élément nouveau observe-t-on sur la photographie couleur (B) ? La forêt. A 13 février 1898, réf M.A. : 66.27.2163. 3 – Coche les bonnes réponses. Photographie Photographie en noir et blanc (A) en couleur (B) Lande rase ✓ Espace vide ✓ Espace plein ✓ Noir et blanc ✓ Couleur ✓ Forêt ✓ Eau ✓ 4 – Réponds aux questions suivantes : Quel événement est survenu avant la prise de la photographie appelée reconduite (C) ? La tempête KLAUS. -

Diagnostic Du Contrat De Dynamisation Et Cohésion Haute Lande Armagnac
CONTRAT TERRITORIAL DE DYNAMISATION ET DE COHESION HAUTE LANDE ARMAGNAC | Page 1 Diagnostic territorial 3 Présentation du territoire Haute Lande Armagnac 3 Contexte général …................... 3 Historique …................... 3 Instances …................... 3 Repères géographiques …................... 4 Fiche d'identité …................... 5 Démarches et procédures …................... 5 Synthèse des principales caractéristiques territoriales 6 ① Cadre de vie 6 Des caractéristiques spatiales singulières …................... 6 Un patrimoine remarquable …................... 7 Une organisation urbaine à consolider …................... 7 ② Dynamiques démographiques 9 Démographie et typologie des populations …................... 9 Fragilités sociales …................... 11 ③ Économie 13 Un territoire productif et industrialisé …................... 13 Des relais de croissance et d'emplois à investir …................... 15 Une vocation touristique typée, avec un potentiel de croissance …................... 16 Un vivier de TPE à dynamiser, dans l'artisanat et le commerce …................... 17 ④ Emploi-Formation 19 Formation …................... 19 Chômage et emploi …................... 21 Typologies des contrats et mobilités …................... 23 ⑤ Accès aux services 25 A l'intérieur, une armature solide …................... 25 A l'extérieur, des proximités motrices …................... 27 Matrice AFOM/SWOT 28 Stratégie territoriale 29 ① Diversifier les sources de revenus du territoire et soutenir les filières émergentes 29 CONTRAT -

Landes Randonnée® (Itinéraires Pédestres, VTT Et Équestres)
Les types de balisage ® Landes Randonnée (itinéraires pédestres, VTT et équestres) Les circuits de randonnée sont tous balisés sur le Offices de Tourisme terrain avec un code différent selon les pratiques Promenades de randonnée : à pied, à vélo ou à cheval. Aire-sur-l’Adour - 40800 et randonnées Tél : 05 58 71 64 70 - tourisme-aire-eugenie.fr Type de sentier Amou - 40330 dans les Landes Tél : 05 58 89 02 25 - amoutourisme.com Site Nature 40 Bonne Biscarrosse - 40600 direction Tél : 05 58 78 20 96 - biscarrosse.com À PIED, À CHEVAL OU À VÉLO : ou rappel À CHACUN SA RANDO ! Capbreton - 40130 Tél : 05 58 72 12 11 - capbreton-tourisme.com Tournez à Edition gauche Castets - 40260 2019 Tél : 05 58 89 44 79 - cotelandesnaturetourisme.com Tournez à Dax - 40100 droite Tél : 05 58 56 86 86 - dax-tourisme.com Eugénie-les-Bains - 40320 Mauvaise Tél : 05 58 51 13 16 - tourisme-aire-eugenie.fr direction Gabarret - 40310 Tél : 05 58 44 34 95 - tourisme-landesdarmagnac.fr Geaune - 40320 Tél : 05 58 44 42 00 - landes-chalosse.com Grenade-sur-l’Adour - 40270 Tél : 05 58 45 45 98 - cc-paysgrenadois.fr/tourisme Hagetmau - 40700 Tél : 05 58 79 38 26 - tourisme-hagetmau.com Hossegor - 40150 Tél : 05 58 41 79 00 - hossegor.fr Département Labastide-d’Armagnac - 40240 des Landes Tél : 05 58 44 67 56 - tourisme-landesdarmagnac.fr Les Actions Environnementales Labenne - 40530 Tél : 05 59 45 40 99 - landesatlantiquesud.com Département des Landes Comité départemental du tourisme Léon - 40550 Direction de l’Environnement équestre Tél : 05 58 48 76 03 - cotelandesnaturetourisme.com 23 rue Victor Hugo 40025 Mont-de-Marsan cedex 40090 BOUGUE Lit-et-Mixe - 40170 Tél : 05 58 06 09 70 Tél : 05 58 42 72 47 - cotelandesnaturetourisme.com Tél. -

Session on Post-Accident
Your logo here Main results from the French panel of Blayais Post-accident (D9.71) session Mélanie MAÎTRE, Pascal CROÜAIL, Eymeric LAFRANQUE, Thierry SCHNEIDER (CEPN) Sylvie CHARRON, Véronique LEROYER (IRSN) TERRITORIES Final Workshop 12-14 November 2019, Aix-en-Provence This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 662287. Quick reminders about WP3 Your logo here ▌ FIRST STEPS Ref. Ares(2018)542785 - 30/01/2018 This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant ► agreement No 662287. Feedback analysis (post-Chernobyl, post-Fukushima) allowing to: EJP-CONCERT • European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Identify uncertainties and local concerns at stake in contaminated Research H2020 – 662287 D 9.65 – Decision processes/pathways TERRITORIES: Synthesis report of CONCERT sub-subtask 9.3.3.1 territories ; Lead Authors: Jérôme Guillevic (IRSN, France), Pascal Croüail, Mélanie Maître, Thierry Schneider (CEPN, France) • Develop a typology of uncertainties (deliverable D.9.65): With contributions from: Stéphane Baudé, Gilles Hériard Dubreuil (Mutadis, France), Tanja Perko, Bieke Abelshausen, Catrinel Turcanu (SCK•CEN, Belgium), Jelena Mrdakovic Popic, Lavrans Skuterud (NRPA, Norway), Danyl Perez, Roser Sala (CIEMAT, Spain), Andrei Goronovski, Rein Koch, Alan Tkaczyk (UT, Estonia) radiological characterization and impact assessment, zoning of affected Reviewer(s): CONCERT coordination team areas, feasibility and effectiveness of the remediation options, health consequences, socio-economic and financial aspects, quality of life in www.concert- the territories, social distrust. h2020.eu/en/Publications ▌ INTERACTIONS WITH STAKEHOLDERS ► Organization of panels, case studies, serious games: collect stakeholders' expectations and concerns to better consider the uncertainties in the management of contaminated territories. -

Actu Travaux
BORDEAUX SAUGNAC- ET-MURET 18 Pour votre confort, sur l’A63 landes MOUSTEY YCHOUX 17 LIPOSTHEY PISSOS LUË 16 LABOUHEYRE COMMENSACQ BAYONNE A63 landes ACTU TRAVAUX n°9 Semaine du 10 au 12 mai 2021 Liposthey dans le sens Bordeaux > Bayonne A63 Salles / St-Geours-de-Maremne Par ailleurs, les bretelles d’entrée et de sortie du diffuseur n°17 « LIPOSTHEY » seront fermées dans le sens Bordeaux > Bayonne. Les usagers souhaitant sortir au diffuseur Liposthey n°17 devront sortir au diffuseur n°16 « LABOUHEYRE », faire ½ tour et reprendre Du lundi 10 mai, 20h00 l’A63 direction Bordeaux. Les usagers souhaitant se rendre vers au mardi 11 mai, 6h00 Bayonne par l’A63 devront aller au diffuseur n°16 « LABOUHEYRE » en empruntant la RD43, la RD10E jusqu’à Labouheyre, puis la RD626 (itinéraire S3). Les trois voies de circulation seront neutralisées dans le sens Bordeaux > Bayonne, et la circulation sera basculée sur les voies opposées comme indiqué sur le schéma ci-dessous. BORDEAUX La voie de gauche et la voie médiane seront neutralisées dans le sens Bayonne > Bordeaux. • 10 au 12 mai 2021 17 RD43 BORDEAUX BAYONNE S3 BAYONNE ACTU TRAVAUX n°9 ACTU TRAVAUX BORDEAUX Zone de RD10E travaux Fermeture 16 Déviations La vitesse maximale autorisée RD626 de l’ensemble des véhicules A63 sur les zones de travaux, est fixée à80 km/h dans les 2 sens de circulation. BAYONNE Par ailleurs, les bretelles d’entrée et de sortie du diffuseur n°17 « LIPOSTHEY » seront fermées dans le sens Bordeaux > Bayonne. Les usagers souhaitant sortir au diffuseur Liposthey n°17 devront sortir au diffuseur n°16 « LABOUHEYRE », faire ½ tour et reprendre Du mardi 11 mai, 20h00 l’A63 direction Bordeaux. -
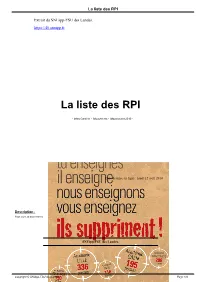
La Liste Des RPI
La liste des RPI Extrait du SNUipp-FSU des Landes. https://40.snuipp.fr La liste des RPI - Infos Carrière - Mouvement - Mouvement 2010 - Date de mise en ligne : lundi 12 avril 2010 Description : Pour aider au mouvement. SNUipp-FSU des Landes. Copyright © SNUipp-FSU des Landes. Page 1/4 La liste des RPI DAX CENTRE LANDES AZUR, MESSANGES, MOLIETS LEVIGNACQ, UZA BEYLONGUE, CARCEN PONSON LESGOR, LALUQUE, TALLER ARENGOSSE,OUSSE SUZAN, ST YAGUEN,VILLENAVE RPC CARCARES, AUDON, GOUTS DAX SUD ADOUR ESTIBEAUX,MOUSCARDES,OSSAGES,TILH MIMBASTE, MISSON ORTHEVIELLE, PORT DE LANNE ORIST, PEY BELUS, ST ETIENNE D'ORTHE ST CRICQ DU GAVE, SORDE L'ABBAYE HASTINGUES, SAMES (64) CANDRESSE, NARROSSE ST VINCENT DE PAUL, TETHIEU HEUGAS, ST PANDELON MONT DE MARSAN HAUTE LANDE BOSTENS,POUYDESSEAUX, STE FOY,GAILLERES BELIS,BROCAS,CANENX,CERE, MAILLERES LUCBARDEZ, SAINT AVIT ARUE, CACHEN, LENCOUACQ BOURRIOT,LOSSE,RETJONS,VIELLE, SOUBIRAN,ST GOR GAREIN,LABRIT,LE SEN,VERT CREON, LABASTIDE LE FRECHE, ST JUSTIN LUXEY, SORE MONT DE MARSAN SUD ARMAGNAC ARTASSENX, BASCONS, BRETAGNE Copyright © SNUipp-FSU des Landes. Page 2/4 La liste des RPI BORDERES, CASTANDET, MAURRIN FARGUES, MONTGAILLARD BOURDALAT,HONTANX,ST GEIN PUJO, SAINT CRICQ VILLENEUVE BOUGUE, LAGLORIEUSE, MAZEROLLES MONT DE MARSAN SUD CHALOSSE AUBAGNAN, BATS, VIELLE TURSAN BRASSEMPOUY, SAINT CRICQ CHALOSSE HORSARRIEU, Ste COLOMBE, SERRES GASTON LACRABE,MANT,MORGANX,PEYRE,MONSEGUR, POUDENX ARSAGUE, BONNEGARDE, CASTEL SARRAZIN CASTAIGNOS, MOMUY, NASSIET BASTENNES,CASTELNAU,DONZACQ,GAUJACQ GAMARDE,GOOS,PRECHACQ GARREY, SORT EN CHALOSSE CASSEN,GOUSSE,LOUER,ONARD,ST GEOURS D'AURIBAT, ST JEAN DE LIER,VICQ D'AURIBAT LAUREDE, POYANNE CAUPENNE,LARBEY,MAYLIS,ST AUBIN HAURIET,MONTAUT,TOULOUZETTE AURICE, CAUNA, LAMOTHE, LE LEUY COUDURES,MONTSOUE,SARRAZIET AUDIGNON,BANOS,DUMES,EYRES MONCUBE MONT DE MARSAN TURSAN ASH PHILONDENX, URGONS PIMBO, SORBETS, MIRAMONT CAZERES, LE VIGNAU LARRIVIERE, RENUNG MIMIZAN PAYS DE BORN BIAS, MEZOS Copyright © SNUipp-FSU des Landes. -

Carte Touristique Des Landes 2019 2019 Landes Des Touristique Carte D | | | Biscarrosse E Tonneins Y Biscarrosse
le naturel LES LANDES Ouvert tous les jours jusqu’au 03/11/19 (Calendrier sur rhune.com) A B C D E F G H I J K L M N Léognan Aire-sur-l'Adour.................... J9 Maillères.............................H-i7 BASSIN LégendeSauveterre Amou..................................G10 Mano .................................... G3 1 -de-Guyenne Angoumé...............................D9 Mant ................................... H10 1 D’ARCACHON AngresseDuras ............................ C10 Marpaps .............................G10 Office de Tourisme Arboucave............................i10 Mauries ................................i10 Arengosse .............................F7 Maurrin...................................i8 Argelos...............................G10 Mauvezin-d'Armagnac...... J-K7 Musée de france Argelouse............................. G4 Maylis ................................... G9 Biganos Arjuzanx ................................F7 Mazerolles..............................i8 www.rhune.com Classé Patrimoine mondial de l'UNESCO Arsague.............................. F10 Mées......................................D9 La Teste- Artassenx...............................i8 Meilhan................................. G8 de-Buch Arthez-d'Armagnac .............. J8 Messanges ............................C8 Musée Arue........................................i6 Mézos ....................................D6 Cap Ferret Arx......................................... L6 Mimbaste............................ E10 CarteLe Barp touristique Miramon Aubagnan...................... -

Projet Educati Territorial Communauté De Communes Cœur Haute Lande
Projet Educati Territorial Communauté de Communes Cœur Haute Lande 1 Préambule La Communauté de Communes Cœur Haute Lande est née le 1 janvier 2017 de la fusion des trois Communautés de Communes : du Pays d’Albret, du Canton de Pissos et de la Haute Lande. Composée de 26 communes pour une populaton de 15 055 habitants et une superfcie de 1 786,5 km², elle est située au cœur du massif forester landais. Elle bénéfcie d’une démographie positve encadrée par une stratégie d’accueil « raisonnable et raisonnée » préconisée par le SCOT Haute Lande et confortée par un modèle d’accueil atractf, renouvelé au regard des contraintes spatales, économiques, sociales et environnementales de ce vaste territoire. Le Projet Educatf de Territoire (PEDT), mentonné à l’artcle D 521-12 du Code de l’Educaton, formalise la volonté des collectvités territoriales de proposer à chaque enfant, chaque jeune, un parcours éducatf cohérent et de qualité. Ce projet relève avant tout d’une démarche volontariste et partenariale contractualisée pour une durée de 3 ans entre la Communauté de Communes Cœur Haute Lande et les services de l’Etat compétents (CAF, DDCSPP, DSDEN…). L’enjeu premier de ce nouveau PEDT est de proposer à chacun un parcours accompagné dès son inscripton dans les structures de la Communauté de Communes (RAM, accueils périscolaires et extrascolaires, collèges et lycée). Il s’agit de bâtr une politque d’éducaton et de co-éducaton cohérente pour l’enfant et sa famille. L’objectf est donc de mobiliser, grâce à une démarche partcipatve, les ressources actves locales de proximité impliquées sur le territoire (collectvités, associatons, enseignants, parents, équipe pédagogique pluridisciplinaire) pour donner la possibilité à chaque enfant d’avoir un parcours riche et accessible à tous. -

Armagnac 2019 De Septembre À Décembre
Fêtez l’esprit de l’Armagnac 2019 De septembre à décembre Rdv au village Armagnac en Fête Rdv au chai Autour de l’alambic Rdv gastronomique L’automne gourmand En savoir plus… www.armagnac.fr L’Armagnac www.qualitelandes.com Rencontre avec tourisme-aquitaine.fr Savoir apprécier “Je rends l’homme joyeux Prenez le temps. Lentement vieilli au au-dessus de tout” ... fil des années, je suis unique, on ne me consomme pas mais on me Selon Vital Dufour, prieur déguste, tous les sens en éveil. d’Eauze en 1310, j’ai 40 vertus L’œil… observez ma teinte pour peu qu’un homme “timide et ma brillance, faites-moi [me] boit de temps en temps”. tourner dans votre verre. Je suis l’Armagnac, j’ai 700 ans Le nez… chauffez votre verre au creux de la main et laissez et beaucoup de choses monter dans vos narines à vous dire… De l’enfance mes premières effluves. Les papilles… humectez votre à la maturité langue de quelques gouttes et L’art de ma fabrication réside dans le bouche close appréciez. Lorsque je respect des traditions. Trois étapes sont suis bien vieilli, je donne, après le cruciales pour mon épanouissement : premier feu de l’alcool, une impression de suavité. La longueur en bouche La vinification : les raisins sont est plus liée à l’âge qu’à la qualité. pressés puis vinifiés de façon Le fond de verre… chauffez à traditionnelle et naturelle (le soufrage nouveau au creux des mains le “fond du vin et la chaptalisation sont interdits) de verre” vous sentirez tout mon bouquet : pruneau, vanille, noisette..