Entrelacs, 10 | 2013 L’Image-Coupable : Haptique Du Regard Dans Le Cinéma De Larry Clark 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

HARMONY KORINE: Shooters
G A G O S I A N G A L L E R Y July 24, 2014 EXTENDED! UPDATED PRESS RELEASE GAGOSIAN GALLERY 821 PARK AVENUE T. 212.796.1228 NEW YORK NY 10021 E. [email protected] HOURS: Tue–Sat 10:00am–6:00pm SUMMER HOURS (Through August 29): Mon–Fri 10:00am–6:00pm HARMONY KORINE: Shooters Through Tuesday, July 29, 2014 Gagosian New York is pleased to present “Shooters,” an exhibition of recent paintings by Harmony Korine. From Kids (1995), a meditation on New York City youth, to Spring Breakers (2012), a contemporary film noir in which four college freshwomen are drawn into a murderous labyrinth of events, Korine’s films of the past twenty years merge reality with fiction and shaky “footage” with precise editing, holding viewers’ attention to the split second and thereby suspending disbelief. His heady mix of the unplanned, the seductive, and the outlandish crystallizes in his lesser-known paintings. Bypassing brush and art paint in favor of squeegees, leftover household paint, and masking tape, he creates loosely sequential images that echo the sonic and visual leitmotifs of his films. In Starburst paintings, he sticks overlapping segments of masking tape to the center of an unprimed canvas, then uses a broom to spread primary red, yellow, and blue dyes over the surface. The tape is removed to reveal bright, irregular stars shining through colorful mists; the final compositions are characterized by a spontaneous, explosive radiance. Loop Paintings are the result of a process somewhat related to filmmaking: Korine cast young men and women, made them up as elderly people, and photographed them in alleyways. -

Aaron J. Petten
Aaron J. Petten The Ohio State University Telephone: 614.292.7481 Department of History of Art E-mail: [email protected] 305 Pomerene Hall 1760 Neil Avenue Columbus, OH 43210 Education 2012 Ph.D. Film Studies Title: The Grotesque and / in / through Film Supervisors: Dr. Paul Dave, Professor Mike O’Pray, Dr. Andrew Stephenson Examiners: Professor Julian Petley, Professor Martin Barker, Dr. Valentina Vitali University of East London School of Arts & Digital Industries 4-6 University Way London E16 2RD United Kingdom 2000 M.A. Film & Television Studies Universiteit van Amsterdam International School for Humanities and Social Sciences Prins Hendrikkade 189-B 1011 TD Amsterdam The Netherlands 1999 B.A. Interdisciplinary Studies (Cinema Studies & Popular Culture) Temple University The College of Liberal Arts 1114 West Berks Street Philadelphia, PA 19122 U.S.A. Employment History 2014 Lecturer The Ohio State University Department of History of Art 217 Pomerene Hall 1760 Neil Ave. Columbus, OH 43210 U.S.A. Aaron J. Petten Curriculum Vitae Page 1 of 6 2005-2010 Permanent Lecturer University of East London School of Architecture & Visual Arts (Now School of Arts & Digital Industries) 4-6 University Way London E16 2RD United Kingdom 2004 Sessional Lecturer University of East London School of Humanities & Social Sciences (Now School of Arts & Digital Industries) 4-6 University Way London E16 2RD United Kingdom 2001-2005 Sessional Lecturer University of East London School of Architecture & Visual Arts 4-6 University Way London E16 2RD United Kingdom Publications • “The Narrative Structuring and Interactive Narrative Logic of Televised Professional Wrestling.” New Review of Film and Television Studies 8.4 (2010). -

What Killed Australian Cinema & Why Is the Bloody Corpse Still Moving?
What Killed Australian Cinema & Why is the Bloody Corpse Still Moving? A Thesis Submitted By Jacob Zvi for the Degree of Doctor of Philosophy at the Faculty of Health, Arts & Design, Swinburne University of Technology, Melbourne © Jacob Zvi 2019 Swinburne University of Technology All rights reserved. This thesis may not be reproduced in whole or in part, by photocopy or other means, without the permission of the author. II Abstract In 2004, annual Australian viewership of Australian cinema, regularly averaging below 5%, reached an all-time low of 1.3%. Considering Australia ranks among the top nations in both screens and cinema attendance per capita, and that Australians’ biggest cultural consumption is screen products and multi-media equipment, suggests that Australians love cinema, but refrain from watching their own. Why? During its golden period, 1970-1988, Australian cinema was operating under combined private and government investment, and responsible for critical and commercial successes. However, over the past thirty years, 1988-2018, due to the detrimental role of government film agencies played in binding Australian cinema to government funding, Australian films are perceived as under-developed, low budget, and depressing. Out of hundreds of films produced, and investment of billions of dollars, only a dozen managed to recoup their budget. The thesis demonstrates how ‘Australian national cinema’ discourse helped funding bodies consolidate their power. Australian filmmaking is defined by three ongoing and unresolved frictions: one external and two internal. Friction I debates Australian cinema vs. Australian audience, rejecting Australian cinema’s output, resulting in Frictions II and III, which respectively debate two industry questions: what content is produced? arthouse vs. -

“Highlights of a Trip to Hell” Contextualizing the Initial
“Highlights Of A Trip To Hell” Contextualizing the Initial Reception of Larry Clark’s Tulsa by William T. Green A thesis project presented to Ryerson University and George Eastman House, Intentional Museum of Photography in Film In partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the program of Photographic Preservation and Collections Management Rochester, New York, United States and Toronto, Ontario, Canada, 2013 © William T. Green 2013 Author’s Declaration I hereby declare that I am the sole author of this thesis. This is a true copy of the thesis, including any required final revisions, as accepted by my examiners. I authorize Ryerson University to lend this thesis to other institutions or individuals for the purpose of scholarly research. William T. Green I further authorize Ryerson University to reproduce this thesis by photocopying or by other means, in total or in part, at the request of other institutions or individuals for the purpose of scholarly research. I understand that my thesis may be made electronically available to the public. William T. Green ii Abstract Released in 1971, Tulsa, American artist Larry Clark’s career-launching first photobook, is today remembered as marking a watershed moment in American photography. This paper travels back to the era that Tulsa was first published to examine the book’s initial critical reception and significance within that specific cultural and artistic climate. It presents an abbreviated overview of Tulsa’s gradual creation; illustrates the ways in which the book was both similar to and different from other commonly cited contemporaneous works; and surveys its evolving status and reputation throughout the 1970s and into the early 1980s, when its second edition was published. -

Larry Clark, Invité D'honneur
Communiqué de presse n°2 – Journées cinématographiques dionysiennes LARRY CLARK, INVITÉ D’HONNEUR DES 18es JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DIONYSIENNES Larry Clark © Javier Ortega 18 ans, et toujours REBEL REBEL ! Les Journées cInématographiques dionysIennes revIennent du 7 au 13 févrIer 2018 au cinéma L’Écran de Saint-Denis (93). Pour cette 18e édition intitulée REBEL REBEL, elles dresseront un grand panorama de la rébellion à l'écran, avec plus de soixante-dix films (inédits, avant-premières, classiques) et de nombreuses rencontres en présence de cinéastes, critiques ou membres de la société civile. Le photographe et réalIsateur amérIcaIn LARRY CLARK sera l’InvIté d’honneur. Il accompagnera une rétrospectIve de ses fIlms (Kids, Bully, Ken Park, Wassup Rockers...), ainsi que ses deux derniers fIlms Inédits tournés en toute indépendance, Marfa Girls 1 & 2, et un long métrage surprIse. Pour clore en musique cette édItIon de la majorIté, les Journées cinématographiques dionysIennes REBEL REBEL accueilleront les musIcIens de Wassup Rockers pour un concert final. www.dIonysIennes.org RelatIon Presse : Géraldine Cance - 06 60 13 11 00 - [email protected] LARRY CLARK, INVITÉ D’HONNEUR « De ses clichés noir et blanc du début des années 1960 aux longs métrages qu’il réalise depuis 1995 tels que Kids (1995), Bully (2001) ou Ken Park (2002), Larry Clark, internationalement reconnu pour son travail, traduit sans concession la perte de repères et les dérives de l’adolescence. » Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, lors de la première rétrospective de ses photographies en France, en 2010. Le photographe et réalisateur Larry Clark est né en 1943 à Tulsa aux États-Unis. -

FOR IMMEDIATE RELEASE Larry Clark Los Angeles 2003-2006 February 6Th – March 14Th 2008
FOR IMMEDIATE RELEASE Larry Clark Los Angeles 2003-2006 February 6th – March 14th 2008 Simon Lee Gallery is pleased to announce its forthcoming exhibition of new photographs by the renowned American photographer and filmmaker Larry Clark. Los Angeles 2003-2006 reflects the artist's life-long interest in the subject of today's youth within a marginalized urban environment. In this particular body of work, we witness the physical transformation of Jonathan Velasquez throughout the period of his adolescent years. Jonathan, a teenager living in South Central Los Angeles whom the artist encountered by chance, inspired Clark to write and direct the film Wassup Rockers . In this obsessive four year photographic chronicle of Jonathan's life, we experience not so much the unfolding of a series of portraits but rather the weaving of the subject's personal life within the context of a particular social milieu common to so many of today's urban youth subcultures. Building upon Larry's previous photographic accomplishments beginning with Tulsa , Teenage Lust , 1992 , the Perfect Childhood , punk Picasso , and in film with Kids , Bully , Ken Park and Wassup Rockers this series of photographs further probes with equal intensity and unabashed honesty the often subtle, often glaring changes that all youth, and in particular Jonathan, go through in their teenage years. The close-up shots, the fulllength frontal views, the groupings of Jonathan with his friends all combine to portray the vulnerability as well as the subjects’ expressions of newfound individuality, vitality and independence of life style. The large scale pigment prints reflect a departure for Clark from the more spare and documentary sensibility that characterize his earlier work, and in so doing allow for a more tender and evocative exploration of his subject. -

UNIVERSITY of CENTRAL OKLAHOMA Edmond, Oklahoma Dr
UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA Edmond, Oklahoma Dr. Joe C. Jackson College of Graduate Studies Keyholes A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTERS OF FINE ARTS IN CREATIVE WRITING By Henry Alexander Shafer 2013 ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank the following professors, classmates, and fellow writers for their influence, encouragement, and expertise in craft and editing during the creation of this collection: Allison Hedge Coke, James Daro, MFA, Dr. Matt Hollrah, Dr. Christopher Givan, Dr. Tim Petete, Dr. Steve Garrison, Corey Mingura, Adam Michael Wright, Kathy Judge, Ryan Burkholder, Jordan Gilbert, and Jennifer Maib. To Jasmine Elizabeth Smith, my muse, best critic, contemporary, confidant, and source of endless encouragement and love, this collection would absolutely not have happened without you. To my mother, Jackie Arnold-Shafer, my father, Randy Shafer, and my step-mother, Cheryl Shafer for supporting me through all of my endeavors (especially when I step far out on a limb). Also, I would like to thank my friends, who are more like brothers for their loyalty and reading when I ask: Zach Moore, Skyler Smith, Justin Davis, Nate Terrill, and Chance Pickett. A special thanks to J.L. Morrissey for reminding me of Larry Clark. And finally, I would like to thank Billy Childish, Charles Bukowski, and Larry Clark for creating fearless and bold art, which will never cease to inspire me. TABLE OF CONTENTS ABSTRACT OF THESIS vi INTRODUCTION 1 BIBLIOGRAPHY OF READINGS 14 KEYHOLES 18 UNTITLED, 2013: –BASED ON THE PHOTOGRAPHY OF LARRY CLARK 20 1. -
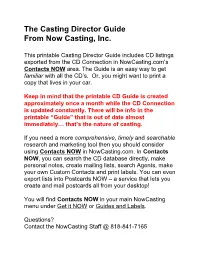
The Casting Director Guide from Now Casting, Inc
The Casting Director Guide From Now Casting, Inc. This printable Casting Director Guide includes CD listings exported from the CD Connection in NowCasting.com’s Contacts NOW area. The Guide is an easy way to get familiar with all the CD’s. Or, you might want to print a copy that lives in your car. Keep in mind that the printable CD Guide is created approximately once a month while the CD Connection is updated constantly. There will be info in the printable “Guide” that is out of date almost immediately… that’s the nature of casting. If you need a more comprehensive, timely and searchable research and marketing tool then you should consider using Contacts NOW in NowCasting.com. In Contacts NOW, you can search the CD database directly, make personal notes, create mailing lists, search Agents, make your own Custom Contacts and print labels. You can even export lists into Postcards NOW – a service that lets you create and mail postcards all from your desktop! You will find Contacts NOW in your main NowCasting menu under Get it NOW or Guides and Labels. Questions? Contact the NowCasting Staff @ 818-841-7165 Now Casting.com We’re Back! Many post hiatus updates! October ‘09 $13.00 Casting Director Guide Run BY Actors FOR Actors More UP- TO-THE-MINUTE information than ANY OTHER GUIDE Compare to the others with over 100 pages of information Got Casting Notices? We do! www.nowcasting.com WHY BUY THIS BOOK? Okay, there are other books on the market, so why should you buy this one? Simple. -

329 Sterbak F
art press 333 interview Larry Clark l’œil du cyclone Interview par Raphaël Cuir Il y a presque un an, était présenté au Festival de Cannes, Destricted, programme de sept courts métrages signés par Marina Abramovic, Matthew Barney, Gaspar Noé, Richard Prince, Marco Brambilla, Sam Taylor- Wood et Larry Clark. Il s’agissait de répondre à l’incitation des producteurs, Mel Agace et Neville Wakefield : aborder la sexualité «de facon explicite», autrement dit, brouiller la frontière entre art et pornographie. Ce programme sort maintenant en salles en France (le 25 avril) et bientôt en DVD (en octobre). Bonne occasion pour réaliser notre vieux rêve de rencontrer Larry Clark, il faut dire, le plus explicite de tous (1). Les images de la série Tulsa (1963-1971) ne sont peut-être plus aussi subversives qu’il y a une quarantaine d’années. Pour autant, elles n’ont rien perdu de leur intensité. Cette violence, Larry Clark dit qu’il faut en payer le prix, c’est-à-dire le prix émotionnel. C’était autrefois le retour du refoulé, l’autre face du rêve américain dont certains, certaines, ne sont pas revenus. C’est encore, aujourd’hui, ouvrir «en entier la nature humaine à la conscience de soi !» (G. Bataille). «On ne peut pas savoir ce que peut le corps» (B. Spinoza), il faut chercher, et nous n’avons pas fini d’être étonnés (F. Nietzsche : «L’étonnant c’est le corps.»). L’adolescence est un des moments privilégiés de cette quête avec la découverte des nouvelles possibilités qu’offre la maturité corporelle. -

Id Title Year Format Cert 20802 Tenet 2020 DVD 12 20796 Bit 2019 DVD
Id Title Year Format Cert 20802 Tenet 2020 DVD 12 20796 Bit 2019 DVD 15 20795 Those Who Wish Me Dead 2021 DVD 15 20794 The Father 2020 DVD 12 20793 A Quiet Place Part 2 2020 DVD 15 20792 Cruella 2021 DVD 12 20791 Luca 2021 DVD U 20790 Five Feet Apart 2019 DVD 12 20789 Sound of Metal 2019 BR 15 20788 Promising Young Woman 2020 DVD 15 20787 The Mountain Between Us 2017 DVD 12 20786 The Bleeder 2016 DVD 15 20785 The United States Vs Billie Holiday 2021 DVD 15 20784 Nomadland 2020 DVD 12 20783 Minari 2020 DVD 12 20782 Judas and the Black Messiah 2021 DVD 15 20781 Ammonite 2020 DVD 15 20780 Godzilla Vs Kong 2021 DVD 12 20779 Imperium 2016 DVD 15 20778 To Olivia 2021 DVD 12 20777 Zack Snyder's Justice League 2021 DVD 15 20776 Raya and the Last Dragon 2021 DVD PG 20775 Barb and Star Go to Vista Del Mar 2021 DVD 15 20774 Chaos Walking 2021 DVD 12 20773 Treacle Jr 2010 DVD 15 20772 The Swordsman 2020 DVD 15 20771 The New Mutants 2020 DVD 15 20770 Come Away 2020 DVD PG 20769 Willy's Wonderland 2021 DVD 15 20768 Stray 2020 DVD 18 20767 County Lines 2019 BR 15 20767 County Lines 2019 DVD 15 20766 Wonder Woman 1984 2020 DVD 12 20765 Blackwood 2014 DVD 15 20764 Synchronic 2019 DVD 15 20763 Soul 2020 DVD PG 20762 Pixie 2020 DVD 15 20761 Zeroville 2019 DVD 15 20760 Bill and Ted Face the Music 2020 DVD PG 20759 Possessor 2020 DVD 18 20758 The Wolf of Snow Hollow 2020 DVD 15 20757 Relic 2020 DVD 15 20756 Collective 2019 DVD 15 20755 Saint Maud 2019 DVD 15 20754 Hitman Redemption 2018 DVD 15 20753 The Aftermath 2019 DVD 15 20752 Rolling Thunder Revue 2019 -

CMP Press Release
3834 Main Street California Museum of Photography Riverside, CA 92501 Sweeney Art Gallery 951.827.3755 Culver Center of the Arts culvercenter.ucr.edu sweeney.ucr.edu University of California, Riverside cmp.ucr.edu artsblock.ucr.edu PRESS RELEASE For Immediate Release California Museum of Photography at UCR ARTSblock presents Unruly Bodies: Dismantling Larry Clark’s Tulsa Selections from the Permanent Collection of the California Museum of Photography June 10, 2016-January 28, 2017 Reception: Thursday, June 9, 6-9pm Reception is FREE and open to the public The California Museum of Photography presents Unruly Bodies: Dismantling Larry Clark’s Tulsa, on view at the museum from June 10, 2016 through January 28, 2017, featuring works from the museum’s permanent collection. The exhibition is guest curated by graduate students from the Department of the History of Art and the Public History Program as advised by Susan Laxton, Assistant Professor of the History of Art at UCR. Unruly Bodies will be celebrated during a public reception on Thursday, June 9, 6-9pm, and will be accompanied by public programming and a publication of student writing. This exhibition is a historically informed reassessment of the artist Larry Clark’s controversial first book, Tulsa (1971), a set of 50 images depicting a tight circle of friends and drug addicts in Tulsa, Oklahoma, photographed over a span of nine years (1963-71) by one of their number, Clark himself. On first appearing, the exposé was hailed as “a devastating portrait of an American tragedy” and embraced as an artistic watershed of participant-observer oriented personal documentary. -

Only the Lonely
34 MISTER LONELY Screen International February 2, 2007 SET REPORT Samantha Morton and Denis Levant ONLY THE in Mr Lonely LONELY It’s been a long road back for indie wunderkind Harmony Korine, but his new project finds him brimming with enthusiasm and working with a starry cast. He tells FIONNUALA HALLIGAN how the dark years helped create his “best work” t has been a decade since Gummo and a good sional Madonna impersonator) and Abraham Early highs eight years since Julien Donkey-Boy, and Lincoln (Richard Strange). Mister Lonely is being readied for Cannes Harmony Korine is finally back behind the Running through this story, somehow and after a lengthy spell in the film wilderness, Icamera with Mister Lonely. He co-scripted — Korine will not be drawn — is the Panama Korine is definitely back — he has two more the story about celebrity impersonators — the thread which features magician David Blaine projects ready to roll, with which Agnes B wants key characters being “Michael Jackson” and and Werner Herzog. to be involved. Agnes, a grandmother, helped “Marilyn Monroe” — with his younger brother At $8.2m, Mister Lonely is a considerable the troubled 34-year-old get his life back on Avi, the first time the writer of Kids has collabo- step up for a Harmony Korine project, although track after they first met at Venice at the premiere rated on a screenplay. That, however, is possi- admittedly it is only his third as director. It is of Julien Donkey-Boy. bly the least unusual part of Mister Lonely. being produced by the French fashion designer “She let me lean on her.