Mémorial De L'aurès
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
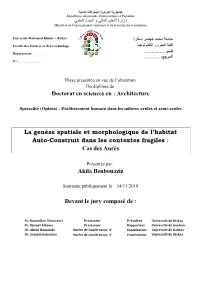
Doctorat En Sciences En : Architecture
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire وزارة التعليم العالي و البحث العلمي Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique جامعة محمد خيضر بسكرة Université Mohamed Khider – Biskra كلية العلوم و التكنولوجيا Faculté des Sciences et de la technologie قسم:.………… ……………: Département المرجع:..……… Ref :……………… Thèse présentée en vue de l’obtention Du diplôme de Doctorat en sciences en : Architecture Spécialité (Option) : Etablissement humain dans les milieux arides et semi-arides La genèse spatiale et morphologique de l’habitat Auto-Construit dans les contextes fragiles : Cas des Aurès Présentée par : Akila Benbouaziz Soutenue publiquement le 14/11/2019 Devant le jury composé de : Pr. Nouredine Zemmouri Professeur Président Université de Biskra Pr. Djamel Alkama Professeur Rapporteur Université de Guelma Dr. Abida Hamouda Maitre de Conférences ‘A’ Examinateur Université de Batna1 Dr. Soumia Bouzaher Maitre de Conférences ‘A’ Examinateur Université de Biskra بسم هللا الرحمن الرحيم و الصﻻة والسﻻم على الحبيب المصطفى، الحمد هلل على هذه الن عمة، و إن هلتوفيق من هللا ان اكتملت هذه اﻻطروحة التي نعتبرها قطرة في محيط، وإنا لنتمنى أن تكون غيثا صائبا للن ـاهيلين. I Je dédie cette thèse à toute ma famille et spécialement ma maman. A tous les jeunes algériens qui aspirent à la liberté et à la justice II REMERCIMENTS Louange à Dieu le tout-puissant de sa miséricorde de m’avoir donné la force pour venir à bout de cette recherche. Ma première rencontre avec la recherche scientifique s’est déroulée voici maintenant treize années, et je la dois à Monsieur le Professeur Djamel Alkama, auprès de qui j'ai tant appris, certes le temps qu’a pris cette thèse s'est quelque peu éloigné de la durée prévue, mais j'espère qu'il ne m'en tiendra pas rigueur, sinon, rien de ce qui suit n'aurait été possible sans sa direction. -
![Dictionnaire Des Communes De L'algérie, Villes, Villages, Hameaux, Douars, Postes Militaires, Bordjs, Oasis, [...]](https://docslib.b-cdn.net/cover/8524/dictionnaire-des-communes-de-lalg%C3%A9rie-villes-villages-hameaux-douars-postes-militaires-bordjs-oasis-428524.webp)
Dictionnaire Des Communes De L'algérie, Villes, Villages, Hameaux, Douars, Postes Militaires, Bordjs, Oasis, [...]
Dictionnaire des communes de l'Algérie, villes, villages, hameaux, douars, postes militaires, bordjs, oasis, [...] Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Dictionnaire des communes de l'Algérie, villes, villages, hameaux, douars, postes militaires, bordjs, oasis, caravansérails, mines, carrières, sources thermales et minérales, comprenant en outre les villes, villages, oasis du Touat, du Gourara, du Tidikelt et de la vallée de l'Oued-Saoura. 1903. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. -

Analyse Des Contraintes Physiques Et Potentialité D'aménagement Dans La
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Université colonel El Hadj Lakhder Batna Faculté des sciences Département des sciences de la terre et de l’univers Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Magister en Aménagement du territoire. Option : Dynamique des milieux physiques et risques naturels. Analyse des contraintes physiques et potentialité d’aménagement dans la vallée d’Oued Abdi Approche systémique Présenté par : BAALA FATIMA Membres du jury : Titre Nom et prénom Grade Université d’origine présidente Dridi Hadda Professeur Univ .Batna Examinateur Hadjab Makhloufi Maitre de conférences Univ - M’sila Examinateur Gettouche Med Said Professeur USTHB Examinateur Yahiaoui Abdelouaheb Maitre de conference Univ .Batna Rapporteur Kalla Mahdi Professeur Univ .Batna Année universitaire 2011/2012 Remerciement Je remercie le bon Dieu qui m’a donné la patience et la force pour atteindre mes buts. Je tiens à présenter mes humbles et sincères remerciements, ainsi que ma profonde gratitude à mon promoteur, le professeur kalla Mahdi, Le directeur du Laboratoire de recherche « Risques Naturels et Aménagement du Territoire » LRNAT pour tous ses conseils judicieux et son soutien tout au long de la préparation de ce travail, ainsi que pour sa patience et son aide précieux. Je tiens à exprimer ma gratitude à Mme Dridi Hadda pour ses conseils judicieux et fructueux. Je souhaite également remercier Monsieur Yahiaoui Abdelouahab d'avoir accepté de juger mon travail. Mes sincères remerciements a mon mari Yahyaoui Habibi qui a été toujours à mes cotés, ainsi pour ses conseils et ses explications très précieuses. Il est également de mon devoir de remercier ma reconnaissance aux cadres de la circonscription des forets de commune Thniet El Abed. -

Plan Développement Réseau Transport Gaz Du GR TG 2017 -2027 En Date
Plan de développement du Réseau de Transportdu Gaz 2014-2024 N°901- PDG/2017 N°480- DOSG/2017 CA N°03/2017 - N°021/CA/2017 Mai 2017 Plan de développement du Réseau de Transport du Gaz 2017-2027 Sommaire INTRODUCTION I. SYNTHESE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT I.1. Synthèse physique des ouvrages I.2. Synthèse de la valorisation de l’ensemble des ouvrages II. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES RESEAUX GAZ II.1. Ouvrages mis en gaz en 201 6 II.2. Ouvrages alimentant la Wilaya de Tamanrasset et Djanet II.3. Ouvrages Infrastructurels liés à l’approvisionnement en gaz nature l II.4. Ouvrages liés au Gazoduc Rocade Est -Ouest (GREO) II.5. Ouvrages liés à la Production d’Electricité II.6. Ouvrages liés aux Raccordement de la C lientèle Industrielle Nouvelle II.7. Ouvrages liés aux Distributions Publiques du gaz II .8. Ouvrages gaz à réhabiliter II. 9. Ouvrages à inspecter II. 10 . Plan Infrastructure II.1 1. Dotation par équipement du Centre National de surveillance II.12 . Prévisions d’acquisition d'équipements pour les besoins d'exploitation II.13 .Travaux de déviation des gazoducs Haute Pression II.1 4. Ouvrages en idée de projet non décidés III. BILAN 2005 – 201 6 ET PERSPECTIVES 201 7 -202 7 III.1. Evolution du transit sur la période 2005 -2026 III.2. Historique et perspectives de développement du ré seau sur la période 2005 – 202 7 ANNEXES Annexe 1 : Ouvrages mis en gaz en 201 6 Annexe 2 : Distributions Publiques gaz en cours de réalisation Annexe 3 : Distributions Publiques gaz non entamées Annexe 4 : Renforcements de la capacité des postes DP gaz Annexe 5 : Point de situation sur le RAR au 30/04/2017 Annexe 6 : Fibre optique sur gazoducs REFERENCE Page 2 Plan de développement du Réseau de Transport du Gaz 2017-2027 INTRODUCTION : Ce document a pour objet de donner le programme de développement du réseau du transport de gaz naturel par canalisations de la Société Algérienne de Gestion du Réseau de Transport du Gaz (GRTG) sur la période 2017-2027. -

Among the Hill-Folk of Algeria
r r L HT E , S T l l F0RNIA SAN DIEGO Il7l ll| || | n |Tll?im9^, i l / 3 1822 02605 9378 {f^.E.LAURlM-co. iMPOKreKSS^KSEtiERS 385 Wash'n St. Boston AMONG THE HILL- FOLK OF ALGERIA ON THE M VKC1I IN TIIK AUUK.S. Frontispiece. AMONG THE HILL- FOLK OF ALGERIA JOURNEYS AMONG THE SHAWIA OF THE AURES MOUNTAINS By M. W. HILTON-SIMPSON B.Sc, F.R.G.S., F.Z.S., F.R.A.L, MEMBRE DE LA SOCIETE DE GFloGRAPHIE D*ALGER. Author of "ALGIERS AND BEYOND," "LAND AND PEOPLES OF THE KASAI" WITH 40 ILLUSTRATIONS AND A MAP NEW YORK DODD, MEAD AND COMPANY 1921 (All rights reserved) PRINTED IN GREAT BRITAIN CONTENTS PAGE INTRODUCTION 9 CHATTER I. AT THE "MOUTH OP THE DESERT" . 13 II. AMONG THE HILL-FOLK . .35 III. FROM AFRICA TO EUROPE ... 55 IV. AT THE "CAPITAL" OF THE AURES . 74 V. FROM MENAA TO THE HOME OF A SAINT 96 VI. TO THE CENTRAL VALLEYS OF THE MASSIF 116 VII. LIFE IN A CLIFF VILLAGE . .136 VIII. IN THE HEART OF THE AURES . .159 IX. THE HEALING ART IN THE HILLS . 179 X. THE VALLEYS OF THE DJEBEL CHERCHAR 199 APPENDIX I. HINTS TO TRAVELLERS IN THE AURES . .233 II. SPORT . .237 INDEX 243 ILLUSTRATIONS ON THE MARCH IN THE AURES . Frontispiece PACING PAGE "THE MOUTH OF THE DESERT" 26 A FEAST AT THE TOMB OF A SAINT . 26 A PIPER OF THE DESERT 34 ON THE ROOF . 34 A SHAWIA POTTER, BENI FERAH 42 FIRING POTTERY AT BENI FERAH . -

Site Archéologique De Chemora
Ministère de la Culture Direction de la Conservation et la Restauration du Patrimoine Culturel Sous Direction de l’Inventaire des Biens Culturels Base de Données des Biens Culturels Immobiliers Liste Générale des Biens Culturels Protégés (05) Batna Date de publication N° Identification du bien Datation du bien Commune Mesures et date de protection au J O Classé 1 Arc de triomphe de Markouna Antique Tazoult Classé parmi les sites et monuments historiques en (L.1900), Conformément à N° 07 du 23/01/1968 l’article 62 de l’ordonnance N° 67-281 du 20/12/1967 2 Grenier de Balloul Antique Tigherghar Classé parmi les sites et monuments historiques par arrêté du 27/06/1993, après N° 48 du 21/07/1993 avis favorable de la commission nationale des monuments et sites historiques tenu le 30/12/1992. 3 Grenier Iguelfene Antique Tigherghar Classé parmi les sites et monuments historiques par arrêté du 27/06/1993, après N° 48 du 21/07/1993 avis favorable de la commission nationale des monuments et sites historiques tenu le 30/12/1992. 4 Maison de la famille Baâziz Moderne Arris Inscrit sur l’inventaire général des biens culturels immobiliers par arrêté du N° 60 du 26/09/2007 14/07/2007, après avis favorable de la commission nationale des biens culturels tenu le 12/10/2006. 5 Maison Meddour Azoui Moderne Arris Inscrit sur l’inventaire général des biens culturels immobiliers par arrêté du N° 60 du 26/09/2007 14/07/2007, après avis favorable de la commission nationale des biens culturels tenu le 12/10/2006. -

Ordonnance N° 67-281 Du 20 Décembre 1967 Relative Aux Fouilles Et À La Protection Des Sites Et Monuments Historiques Et Naturels
Ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels. Evolution Loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. (page 03) Texte(s) d'application Loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. (page 03) Texte(s) d'application Art. 107.- Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de l'ordonnance n° 67-281du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels. Décret n° 81-135 du 27 juin 1981 portant modification de l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels. (Page 646) Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'éduction nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale ; Vu la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque, ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée ; Vu l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zone et aux site touristiques ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, notamment son article 160 ; Vu l'ordonnance n° 6-24 du 18 janvier -

La Sécurité De L'algérie Est Directement Liée À Celle De
DÉCÈS DU PRINCE PHILIP Le chef de l’Etat présente ses condoléances à la reine Elizabeth II e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de L condoléances à sa Majesté Elizabeth II, reine du Royaume Uni de Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord et chef du Commonwealth, suite au décès, hier, de son époux, le prince Philip. «C’est avec une grande affliction que j’ai reçu la nouvelle du décès de son Altesse royale, le prince Philip, Duc d’Edimbourg. En cette douloureuse cir- constance, je présente, au nom du gouvernement algérien et en mon nom personnel, Horizons mes condoléances les plus attristées à la Reine Elizabeth II, à la famille royale et au peuple britannique», a écrit le président Tebboune dans son message. QUOTIDIEN NATIONAL VENDREDI 9 - SAMEDI 10 AVRIL 2021 - 26 - 27 CHAÂBANE 1442 - N° 7308 - PRIX 10 DA SOCIÉTÉ CIVILE Le président Tebboune reçoit les représentants de six associations .PAGE 3 ww VICTIMES DU TERRORISME SAÏD CHANEGRIHA AU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES FRANÇAISES 99,63% des dossiers traités, LA SÉCURITÉ DE L’ALGÉRIE selon Beldjoud EST DIRECTEMENT LIÉE Le ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, a fait savoir qu’un travail colossal a été effectué À CELLE DE SES VOISINS par les pouvoirs publics pour traiter les dossiers des victimes du terroris- me, à travers notamment le versement d’indemnités consquentes, et que les moyens nécessaires ont été mis en œuvre pour identifier les cas les délicats et leur venir en aide. .PAGE 7 ww REVENDICATIONS DU PERSONNEL DE SANTÉ Le ministre va engager le dialogue avec les syndicats .PAGES 9 CORONAVIRUS l Bilan 135 nouveaux cas, 103 ’Algérie considère que la stabilité et la sécurité de son voisinage sont directement liées à sa sécurité, a affirmé, jeudi derniere, le géné- guérisons et 4 décès ces L ral de corps d’armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire au général d’armée François Lecointre, chef d’état-major des armées françaises. -

Archi-M-2012.Pdf
ار اا ااط ا République Algérienne Démocratique et Populaire وزارة ا ا و ا ا Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ة Université Mohamed Khider – Biskra ام و ا Faculté des Sciences et de la technologie : ا ار Département d’Architecture ا:…………… Ref :……………… Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme de Magister Option : Etablissements humains dans les milieux arides et semi-arides La ville de Batna, à la recherche d’un schéma de cohérence urbaine Présenté par : Bouha Imen Soutenu publiquement le : 03/07/2012. Devant le jury composé de : Pr. Maazouz Said. Président Université de Biskra Pr. Farhi Abdallah. Directeur de mémoire Université de Biskra Dr. Alkama Djamel. Examinateur Université de Biskra Dr. Bellakhal Azeddine. Examinateur Université de Biskra Remerciement Avant tout, je remercie ALLAH le tout puissant de m’avoir donné la volonté, la force et le courage pour réaliser ce travail dans les meilleures conditions. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance au directeur du mémoire, Pr. Farhi Abdallah, pour sa disponibilité, ses précieux conseils et ses critiques constructives pour l’élaboration de ce travail. Mes chaleureux remerciements et toute ma gratitude vont aux membres de jury d’avoir accepté d’honorer le jury par leurs présence, ainsi qu’à tous mes enseignants de post- graduation. Mes remerciements vont également à toute ma famille pour son soutien et encouragement et particulièrement ma mère et mon père. Enfin, je remercie tous ceux qui ont contribué à enrichir cette recherche en mettant à ma disposition l'information nécessaire. Je ne peux les citer tous mais qu'ils soient surs que leur aide m'a été très précieuse. -

Décret Exécutif N° 12-428 Du 16 Décembre 2012 Portant Déclaration
9 Safar 1434 7 23 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 DECRETS Décret exécutif n° 12-428 du 2 Safar 1434 Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 16 décembre 2012 portant correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; déclaration d’utilité publique les opérations de réalisation des projets entrant dans le cadre de la Vu le décret présidentiel n°12-325 du 16 Chaoual 1433 production, du transport et de la distribution de correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du l’électricité et du gaz. Premier ministre ; ———— Vu le décret présidentiel n°12-326 du 17 Chaoual 1433 Le Premier ministre, correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Sur le rapport conjoint du ministre des finances et le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret exécutif n°93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 n°91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles (alinéa 2) ; relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Après approbation du Président de la République ; complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n°91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant Décrète : les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Article 1er. – En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n°91-11du 27 avril 1991, et conformément Vu la loi n°98-04 du 20 Safar 1419 correspondant -

Algérie Liste Des Sites Et Monuments Classes 2003
ALGERIE : LISTE DES SITES ET MONUMENTS CLASSES *Source : Ministère de la communication et de la culture. In le site web de l’Année de l’Algérie, décembre 2003 (01) Wilaya d’Adrar Place des martyres : Site Naturel (Adrar) Place de l’Indépendance : Site Naturel (Timimoune) Ksar de Tamentit : Centre-UrbainVivant. (Timimoune) Casbah de Melouka : Monument de Culte Islam (Timimoune) L’Ancien Hôpital d’Adrar : Adrar (02) Wilaya de Chlef Mosaïque de l’Eglise : Œuvre d’art/Antique. (Chlef) Ruines romaines de la Kalâa des Ouled Abdallah : Ruines/Antique. (Ténès) Mosquée du vieux Ténès : Monument de Culte/Islam. (Ténès) (03) Wilaya de Laghouat Dessins rupestres : Œuvres d’art/Préhistoire. (El Guicha) Rocher Fromentin : Site Naturel (Laghouat) Gravures rupestres : Oued Remailia Œuvres d’art / Préhistoire. (Sidi-Makhlouf) El Hasbaia : Site / Préhistoire. (Laghouat) Zaouia Tidjania : Monument. de culte/Islam (Ain Madhi) Centrale électrique diesel de Laghouat : Ouvrage/Industriel-Moderne(Laghouat) (04) Wilaya d’oum El- Bouaghi Dolmens et Cromlechs : Monument. Funéraire /Pré-.Hist. (Sigus) (05) Wilaya de Batna Gorges de Tilatou : Site naturel (Tilatou) Village de Bouzina : Site naturel (Bouzina) Village de Tagoust : Site naturel (Tagoust) Village d’Amentane : Site naturel (Menaa) Village de Tighanimine : Site naturel (Tighanimine) Canon de Rhouffi : Site naturel (T’Kout) Ruines de la ville antiqueique de Tobna : Ruines/Antique. (Bitam Barika) Mausolée des Rois numides dit le Médiévallracen : Monument Funéraire/Antique (El- Madher) Arc de triomphe de Markouna : Monument Hon/Antique. (Tazoult) Territoires et monuments de l’antique lambaesis : Sites et monuments/Antique. (Tazoult) Territoires et monuments de l’antique Thamugadi : Sites et monuments/Antique. Timgad) Gorges de Foum Ksentina : Site naturel (Timgad) Territoires et monuments de l’Antique Diana Veteranorum : (Zana) Sites et monuments/Antique. -

Étude Des Cas De Menaa, Teniet El Abed Et Arris Dans Les Aurès (Algérie)
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire وزارة التعليم العالي و البحث العلمي Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique جامعة محمد خيضر بسكرة Université Mohamed Khider – Biskra كلية العلوم و التكنولوجيا Faculté des Sciences et de la technologie قسم: .....الهندسة المعمارية.… ……Département :…Architecture المرجع:..……… Ref :……………… Thèse présentée en vue de l’obtention Du diplôme de Doctorat en sciences Spécialité (Option) : Architecture Intitulé Les établissements humains anciens face à la micro urbanisation : étude des cas de Menaa, Teniet El Abed et Arris dans les Aurès (Algérie) Présentée par : Djemâa BARROU Soutenue publiquement le …26/09/2019………… Devant le jury composé de : Pr. Noureddine Zemmouri Professeur Président Université de Biskra Pr. Djamel ALKAMA Professeur Rapporteur Université de Guelma Pr. Belkacem DIB Professeur Examinateur Université de Batna 1 Dr. Soumia BOUZAHER Maitre de Conférences ‘A’ Examinateur Université de Biskra Dedicace A la mémoire de mes parents A mon époux et ma fille A mon frère et mes sœurs A mon beau frère et ma belle sœur A mes neveux et mes nièces i Remerciment Je tiens à exprimer tous mes remerciements et ma gratitude à mon Directeur de thèse Monsieur le Professeur Djamel ALKAMA pour son suivi, sa disponibilité, son soutien, sa patience et ses orientations durant l’élaboration de cette recherche. Je tiens à remercier aussi Monsieur le Professeur Marc CÔTE de m’avoir accueilli au sein de l’Unité de Formation et de Recherche des Sciences géographiques et de l’Aménagement, de m’avoir aidé à accéder à la bibliothèque de l’Institut de Géographie,Université de Provence (Aix- Marseille I) ainsi que celle de l’IRMAM et de m’avoir accordér de son temps pour m’orienter et me permettre d’avancer dans le travail.