Télécharger Le Cahier En Format
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Te Matatini and More Harry Evison Keri Hulme Marine Vision
ABOUT NGĀI TAHU—ABOUT NEW ZEALAND—ABOUT YOU KAHURU/AUTUMN 2014 $7.95 61 HAKA! TE MATATINI AND MORE HARRY EVISON KERI HULME MARINE VISION ii TE KARAKA KAHURU 2014 www.tahufm.com - - - - Murihiku 99.6 // Otautahi 90.5 // Timaru 89.1 // Kaikoura 90.7 // Otakou 95 // SKY 423 KAHURU/AUTUMN 2014 61 8 POUNAMU MANA 8 NGĀ HAU E WHĀ FROM THE EDITOR One Sunday in early March I drove to Kaikōura in a rain storm. I was on my way to the launch of the Kaikōura Marine Management Bill and it seemed to be rain- ing marine reserves. That week the government announced five new marine reserves on the West Coast and the formation of a 14-strong commu- nity forum to consider marine protection for the Otago coastline. The West Coast marine reserves were recommended by the West Coast Marine Protection Forum. Ngāi Tahu is represented on the West Coast Marine Protection Forum and will be represented on the Otago group. In Kaikōura, Ngāti Kurī were pivotal in getting establishing Te Korowai o Te Tai ō 12 HAKA! Marokura, the Kaikōura Coastal Marine Why is kapa haka so popular? Kaituhi Mark Revington reports. Guardians, and all meetings were held at Takahanga Marae to emphasise the impor- 12 tance of the coastline and marine resources to Ngāti Kurī and Te Rūnanga o Kaikōura. As Gina Solomon and Nigel Scott point out in our story (p 18,19), the key to Te Korowai strategy was customary tools (the strategy includes two taipure and three mātaitai). It is fantastic news and a huge step forward after nine years of kōrero. -

Political Reviews
Political Reviews michael lujan bevacqua, elizabeth (isa) ua ceallaigh bowman, zaldy dandan, monica c labriola, nic maclellan, tiara r na'puti, gonzaga puas peter clegg, lorenz gonschor, margaret mutu, salote talagi, forrest wade young 187 number of representatives of the ter- Islands, Hawai‘i, Norfolk Island, ritory in the Paris National Assembly and Senate and to create term limits Wallis and Futuna are not included in for the president of French Polynesia this issue. and the mayors of municipalities. French Polynesia These proposals met with protests across the local political spectrum The period under review was one of (otr, 26 June, 7 July 2018). mixed messages. On one hand, French Even more controversial was Polynesia’s reconnection with the rest the clause recognizing the effects of of Oceania is accelerating, symbolized nuclear testing that was to be inserted by an important business proposal into the updated organic law of with shareholders from other Polyne- French Polynesia. After first recogniz- sian countries. On the other hand, the ing the territory’s “contributions to French state’s repressive colonial poli- nuclear deterrence and defense of the cies continue unabatedly: Just as an nation,” the clause then states that old act of arbitrary colonial injustice compensation by the French state for from the 1950s was finally revised, irradiation victims will be defined new acts were committed, with the by law and that the French state will French judiciary removing the pro- provide adjustments for structural and independence opposition leader from economic imbalances caused in conse- the political scene and prosecuting him quence of the tests (Légifrance 2019). -

Ngā Ohaoha a Te Matatini Measuring the Kapa Haka Economy
Ngā Ohaoha a Te Matatini Measuring the Kapa Haka Economy Mere Takoko A thesis submitted in fulfilment of the degree of Master of Arts Victoria University Wellington Wellington, New Zealand 2019 1 . He karakia nā Kahukura Ka tatara, koia. Ka tatara i ō urunga, koia, Ka tatara i ō tukemata, koia, Ko he toka whakataratara, koia, Ki roto ki te kopinga, koia, Ki roto ki te kopinga, koia, Koi huna mai, koia, Koi whakina mai, koia, Ko rua mahunuku koe tonga ē. Wetea iho i runga i te popoki ō Kahukura, He kura mawete-ka mawete he kura, ī! Matara, ka matara ki taku rangi ē Tō te maro o Kahukura kia hurua mai, ka tatau, tau ē! Ka tatau te maro ō Aitu, te eke mai he aitu, Ki tēnei matorohanga, torohanga. Whāngāi atu i te ata, kia kai mai ō mata horea, Kia whiu, kia tā i a koe ō mata horea, Ko mata te aongā nuku, Ko mata te aongā rangi. Tiora tamaka kōrua paipai nunui ki te ihongā ē! Tautai, e hine, te pari-ā-nuku, te pari-ā-rangi, Hioi-nuku, hioi-rangi, whakataretare te pō ē! Tautai ere, tautai ere, tī. 2 . Ko Hikurangi te maungā Ko Waiapu te awa Ko Ngāti Porou te iwi Ko Ngāti Hinerupe raua ko Ngāti Hinepare ngā hapū Ko Māui te tipuna! Tihei tohi ora te whakapapa, te whakapono, o taku manu kōrero kia tuku atu te aho ki te tai whakarunga ki te tai whakararo ki a Ngāti Ruawaipu, kia pera anō koutou ki te ahikāroa o te Arapangāteatinuku, o te Arapangateatirangi e! Mē timata te tīramarama nuku i ā Kōpuarēhua kia kawe ai te ahi hiraurau hopanga o Rūarikitua ō Waikapakapa ki te tiramarama rangi o te Mimi-o-Rērēwā o Tūpapakūrau, e! Ka haere tonu te tīramarama nuku ō te whakamahi ō Maraehara kia tautoko ai te tīramarama rangi ō Waitaiko, ō Otihi, e! Ka heke tonu te tīramarama nuku ō Mangātekawa ō Awatere kia kawe ai te papori mē te mahi tahi ō te whakahaere whaioro ki te tīramarama rangi ō Pikoko, ō Maruhou, ō Wharariki, ē! Mai i te tīramarama ō Ōruatua, ō Horoera mē haere tahi ai te tīramarama rangi o te ahi hangāngā ki Whakateao, ki Pouretua, ki Ahikāroa. -

Breaking the Stage: from Te Matatini to Footprints/Tapuwae
7. Breaking the Stage: From Te Matatini to Footprints/Tapuwae TE RITA PAPESCH, SHARON MAZER The post-imperial writers of the Third World therefore bear their past within them – as scars of humiliating wounds, as instigation for different practices, as potentially revised visions of the past tending towards a post-colonial future, as urgently reinterpretable and redeployable experiences, in which the formerly silent native speaks and acts on territory reclaimed as part of a general movement of resistance, from the colonist.1 You can take my marae to the stage but don’t bring the stage to my marae.2 Mihi Kei te mingenga e pae nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ahakoa i tukuna ngā mihi i nākuanei kua riro māku anō te mihi nā māua ki a koutou i tēneki wā, nā reira, nau mai, haere mai ki ‘Ka Haka – Empowering Performance’. Ko te tūmanako ka areare ngō koutou taringa ki ngā māua kōrero. Ki te kore waiho ngā kōrero ki ngā pā tū o te whare neki ki reira 1 Edward Said, Culture and Imperialism (1993. London: Vintage, 1994) 256. 2 John Te Ruruhe Rangihau, personal communication with Te Rita Papesch, 2007. 108 Breaking the Stage: From Te Matatini to Footprints/Tapuwae iri atu ai hei kohinga kōrero mā ngā uri whakaheke. Kāti. Ka huri ki a Sharon māna tā māua kauwhau e whakatūwhera.3 Kaupapa There’s too much talk of decolonising the stage, as if the theatre were not itself a colonial artefact, a hangover from the settlers’ desire to appear civilised in what they saw as a savage land. -
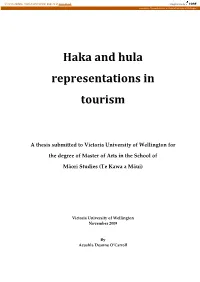
Haka and Hula Representations in Tourism
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by ResearchArchive at Victoria University of Wellington Haka and hula representations in tourism A thesis submitted to Victoria University of Wellington for the degree of Master of Arts in the School of Māori Studies (Te Kawa a Māui) Victoria University of Wellington November 2009 By Acushla Deanne O’Carroll I Abstract Haka and hula performances tell stories that represent histories, traditions, protocols and customs of the Māori and Hawai’ian people and give insight into their lives and the way that they see the world. The way that haka and hula performances are represented is being tested, as the dynamics of the tourism industry impact upon and influence the art forms. If allowed, these impacts and influences can affect the performances and thus manipulate or change the way that haka and hula are represented. Through an understanding of the impacts and influences of tourism on haka and hula performances, as well as an exploration of the cultures’ values, cultural representations effective existence within the tourism industry can be investigated. This thesis will incorporate the perspectives of haka and hula practitioners and discuss the impacts and influences on haka and hula performances in tourism. The research will also explore and discuss the ways in which cultural values and representations can effectively co-exist within tourism. II Mihimihi I te riu o te whenua Te Rua o te Moko I raro i te maru o Taranaki I ruia i ngā kākano o te ora Kia ora ai te hapū, ko Puawhato te Rangatira! Ko Taranaki te maunga Ko Aotea te waka Ko Waingōngōrō te awa Ko Ngāruahine Rangi, Ngāti Ruanui me Te Ātiawa ngā iwi Ko Otaraua me Kanihi-Umutahi ngā hapū Ko Otaraua me Kanihi-Māwhitiwhiti ngā marae Ko Acushla Deanne O’Carroll tōku ingoa Tēnā tātou katoa III Dedication This thesis is dedicated to all of the participants involved in this research. -

Business Plan
TE MAHERE RAUTAKI BUSINESS PLAN -Courtesy of Rotorua Daily Post Te Matatini National Festival 2013 - Rotorua (Pōwhiri) T E MATATINI - THE MANY FACES Te Matatini (‘Mata’ meaning face or faces, and ‘tini’ meaning many) is a term stalwart, and a Companion of the New Zealand Order of Merit for services to postulated by Professor Wharehuia Milroy, a respected Māori language ‘Māorithe traditional Māori Language. performing He arts describes bring together the underpinning people of allphilosophy: ages, all beliefs, all backgrounds, participants and observers, Māori and non-Māori alike. When I look I see many faces, young and old’. Our name – Te Matatini - partners, government funders acknowledges the many faces of the and sponsors whose support not people who contribute to the vitality only assists the work and vision of Te Matatini, but strengthens the foundation upon which Kapa andIt stands vibrancy as an of enduring Kapa Haka. testament to the multitudes that are a part of, or have been a part of Te Matatini and continuesHaka can flourish. to be showcased Through and their contributions, Kapa Haka excellence itsThese kaupapa. include the thousands of experienced by audiences throughout Finally, encompassed within the composers, young and old, who bring New Zealand and overseas. Kapa Haka performers, tutors and philosophy of Te Matatini is the role and on the marae, in schools and Kapa Haka to life every day, at home communities and through regional, of Kapa Haka in sustaining Māori makeculture. connections Kapa Haka and provides embark a vehicle on also includes the many individuals in which whānau, hapū and iwi can national and international events. -

Creating a Modern Māori Identity Through Kapa Haka Te Rita
Creating a Modern Māori Identity Through Kapa Haka Te Rita Bernadette Papesch Doctor of Philosophy Department of Theatre and Film Studies University of Canterbury 2015 ii He Rārangi Tuhinga - Table of Contents Nama Whārangi Momo Tuhinga Explanation (Page Number) i Whārangi Ingoa Tuhinga Title Page ii Rārangi Tuhinga Table of Contents 1 He Mihi Acknowledgements 4 Ariā Abstract 5 Kupu Whakamārama By way of explanation 8 Rārangi Kupu Glossary 21 Whakaeke Introduction 55 Waiata Koroua Chapter 1 96 Poi Chapter 2 127 Haka Chapter 3 154 Waiata-ā-ringa Chapter 4 185 Whakawātea Conclusion 198 Āpitihanga 1 Appendix 1 199 Āpitihanga 2 Appendix 2 205 Āpitihanga 3 Appendix 3 210 Pukapuka Tautoko Works Cited 218 Ā Te Ipurangi Web Sources 1 He Mihi: Acknowledgements I te tuatahi e tuku whakaaro ana ki a rātou i whomai te Kapa Haka ki a tātou. Rātou ko ngō tātou tūpuna, mātua, ko Tā Apirana Ngata, ko Paraire Tomoana, ko Te Puea Herangi, ko Tuini Ngawai. Heke iho ki tana irāmutu, ki a Ngoi Pewhairangi, ki a Wiremu Kerekere, ki a Tā Kīngi Ihaka, ki Te Kēnana Wi Te Tau Huata. Moe mai rā koutou ki roto i te tauawhi a te wāhi ngaro. Kei te waiatatia tonutia ngā koutou waiata hei kōrero ki te iwi, hei whakangahau i te iwi. Ka tuku whakaaro hoki ki a Te Rangihau. Nōku te waimarie i whakaako ia i ahau ki ngā tātou tikanga a te karanga me te mau patu. Moe mai rā i tō moengaroa. E kore rawa koe e wareware i ahau. Ki a koe hoki Tīmoti, taku whakaruruhau, taku kaipoipoi, taku kaiarahi i roto i ngā tau, ngāku mihi nui. -

Ejournal Foreword
Research in New Zealand Performing Arts: Nga Mahi a Rehia no Aotearoa E-journal Foreword Tena koutou katoa! Over the past several years there have been a great many exciting developments in Aotearoa / New Zealand performing arts. One example is the recent prominence of New Zealand and success of New Zealanders in the realm of mainstream Hollywood blockbuster films, as evidenced by The Lord of the Rings trilogy, The Last Samurai, The Lion, the Witch and the Wardrobe, and others. Such films, have seen this relatively small nation enjoy a profile in a global industry, which is disproportionate to the size of its populace. Of particular note in the case of the film industry are the successes of films based on local stories and culture. With the exception of the biographical, The World’s Fastest Indian (about NZ racer Burt Munro), most of the other NZ films that have done well in the last four years have been primarily based upon the stories, cultures, and experiences of Māori and Pacific Islanders,1 including Whale Rider, No. 2, River Queen, Sione’s Wedding, and the Oscar-nominated short film Two Cars, One Night. All of these have received much critical acclaim at home and abroad, and give some credence to the statement found on the New Zealand Film Commission’s website asserting that “it’s never been so hip to be brown.”2 Keeping in this same vein, if “brown” film, TV, music, dance, etc. have in the past been poorly supported and appreciated by New Zealand and the rest of the world, now, more than ever, it seems the tide has turned and their time has come. -

A Review of Te Matatini 2017
A Review of Te Matatini 2017 Report prepared for Te Matatini Society Incorporated By Angus & Associates May 2017 Contents Introduction .................................................................................................. 3 Background ............................................................................................................................... 3 Objectives ................................................................................................................................. 3 Methodology ............................................................................................................................ 4 Executive Summary and Conclusions ............................................................ 5 Summary of Findings ................................................................................................................ 5 Conclusions ............................................................................................................................... 6 Findings ........................................................................................................ 7 Audience Profile ....................................................................................................................... 7 Communications ..................................................................................................................... 15 Audience Behaviour ............................................................................................................... 17 Audience -

Auckland Tourism, Events and Economic Development
Auckland Tourism, Events and Economic Development Quarter 3 Performance Report For the period ending 31 March 2019 This report outlines the key performance of Auckland Tourism, Events & Economic Development, which includes economic development and visitor economy‐related activities and investments Page 1 ATEED Q3 summary Highlights, issues & risks for the quarter Financials ($m) YTD actual YTD budget Actual vs Budget During Q3, ATEED continued to deliver a more focussed portfolio of activity to drive its vision of quality jobs for all Capital delivery 3.1 3.4 ‐0.4 Aucklanders. Highlights for the quarter: Direct revenue 13.3 14.7 ‐1.4 1. The America’s Cup 36 (AC36) Host Venue Agreement was signed – a significant project milestone. Direct expenditure 43.7 49.8 6.2 2. The Auckland. We’re Hiring campaign launched in January to attract high‐skilled migrants to Auckland. 3. ATEED’s Net Promoter Score for the Regional Business Partner Network (RBP) programme with NZTE and Net direct expenditure 30.4 35..2 4.8 Callaghan Innovation was +81, above the national average of +73. 4. The 20th Auckland Lantern Festival was successfully delivered together with the signing of the NZ Year of Financial Commentary Tourism 2019 MoU with UnionPay International and Immigration NZ, and the launch of the official Auckland Capital delivery: Costs relate to the move of ATEED to 167b WeChat account. Victoria Street. 5. The Go with Tourism skills campaign attracted more than 100 ‘quality employer’ business registrations. Direct revenue: Reduced revenue from Kumeu Film Studios, 6. A short break campaign went live in Australia targeting independent professionals (25‐54 years). -

The Festivalisation of Pacific Cultures in New Zealand: Diasporic Flow and Identity Within ‘A Sea of Islands’
The Festivalisation of Pacific Cultures in New Zealand: Diasporic Flow and Identity within ‘a Sea of Islands’ A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy The University of Otago Dunedin New Zealand Jared Mackley-Crump 2012 Abstract In the second half of the twentieth century, New Zealand witnessed a period of significant change, a period that resulted in dramatic demographic shifts. As a result of economic diversification, the New Zealand government looked to the Pacific (and to the at the time predominantly rural Māori population) to fill increasing labour shortages. Pacific Peoples began to migrate to New Zealand in large numbers from the mid-1960s and continued to do so until the mid-1970s, by which time changing economic conditions had impacted the country’s migration needs. At around this time, in 1976, the first major moment of the festivalisation of Pacific cultures occured. As the communities continued to grow and become entrenched, more festivals were initiated across the country. By 2010, with Pacific peoples making up approximately 7% of the population, there were twenty-five annual festivals held from the northernmost towns to the bottom of the South Island. By comparing the history of Pacific festivals and peoples in New Zealand, I argue that festivals reflect how Pacific communities have been transformed from small communities of migrants to large communities of largely New Zealand-born Pacific peoples. Uncovering the meanings of festivals and the musical performances presented within festival spaces, I show how notions of place, culture and identity have been changed in the process. Conceiving of the Pacific as a vast interconnected ‘Sea of Islands’ kinship network (Hau’ofa 1994), where people, trade, arts and customs have circulated across millennia, I propose that Pacific festivals represent the most highly visible public manifestations of this network operating within New Zealand, and of New Zealand’s place within it. -

Native Decolonization in the Pacific Rim: from the Northwest to New Zealand
NATIVE DECOLONIZATION IN THE PACIFIC RIM: FROM THE NORTHWEST TO NEW ZEALAND KRISTINA ACKLEY AND ZOLTÁN GROSSMAN, FACULTY CLASS TRIP AND STUDENT PROJECTS, THE EVERGREEN STATE COLLEGE, OLYMPIA, WASHINGTON, USA, WINTER 2011 KAUPAPA MAORI PRACTICES 1. Aroha ki tangata (a respect for people). 2. Kanohi kitea (the seen face). 3. Titiro, whakarongo…korero (look, listen…speak). 4. Manaaki ki te tangata (share, host people, be generous). 5. Kia tupato (be cautious). 6. Kaua e takahia te mana o te tangata (do not trample over the mana of people). 7. Kaua e mahaki (don’t flaunt your knowledge). Linda Tuhiwai Smith, Decolonizing Methodologies (p. 120) Booklet available as a PDF color file: http://academic.evergreen.edu/g/grossmaz/NZ.pdf CONTENTS 3. PROGRAM DESCRIPTION MAPS: 4. New Zealand, 5. Maori population Maori Iwi (tribes) The powhiri (welcoming 2011 CLASS TOUR: ceremony) of 6. Itinerary the kapa haka 7. Auckland, Jan. 27-29 festival Te 8. Wellington, Jan. 30-31 Matatini o Te 9. Rotorua, Feb. 1-2 Ra (The Many 10. Waipoua Forest, Feb. 3-4 Faces of the Sun) 11. Waitangi / Paihia, Feb. 5-6 in Gisborne, 12. Russell, Feb. 7 February 16, 2011. STUDENT PROJECT PRESENTATIONS: Wednesday, March 2 (Longhouse 1007B) 14. Andrew Kuich, “Non-Native Institutions Providing Mental Health Service in Native American Communities” 15. Shannon DeLong, “Pacific Rim Indigenous Connections through Indigenous Art” 16. Tess Ames, “Just Keep Weaving…Movements Across Mediums” Friday, March 4 (SEM II E1105) 17. Jennifer Nguyen, “Maori Hip Hop: Creating a Political Space Through Public Performances” 18. Elizabeth Lehuta, “The Face of the Māori: Tā Moko and Kirituhi's Body Language in Pop Culture” 19.