Architecture Option
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Journal Officiel Algérie
N° 64 Dimanche 19 Safar 1440 57ème ANNEE Correspondant au 28 octobre 2018 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale.................................. 1090,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction...... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d'expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 19 Safar 1440 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 octobre 2018 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 18-262 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant ratification du protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali sur l'échange de connaissances et d'expériences dans le domaine juridique et judiciaire, signé à Alger, le 15 mai 2017............... -

BENI SLIMANE « Non Au 19 Mars »
INFO 588 BENI SLIMANE « Non au 19 mars » BENI SLIMANE Dans le centre algérien et culminant à 584 mètres d’altitude le village de BENI SLIMANE est situé à 21 km au Sud- ouest de TABLAT ; à 40 km à l’Ouest de BIR RABALOU sur la RN 18 et à 70 Km de MEDEA. Nous donnerons à l'ensemble des montagnes au Nord et au Sud de la vallée de BERROUAGHIA, le nom de monts du TITTERI du nom de l'ancien beylick, dont MEDEA était le chef-lieu. Ce nom que l'historien arabe Ibn-KHALDOUN donne au KEF LAKHDAR, situé à moitié distance de BOGHAR et d'AUMALE, n'est plus guère usité; mais il nous a paru d'autant préférable au point de vue synthétique, qu'entre les termes locaux le choix est singulièrement embarrassant. Au-delà des montagnes abruptes et ravinées qui dominent au Sud la plaine de la MITIDJA, le plateau argileux et nu, de MEDEA, au relief tourmenté, découpé par les profonds sillons des rivières qui s’éloignent vers l’Ouest, le Nord et l’Est, a de nombreuses sources et qui n’est pas dépourvu de terres propices aux céréales. Il forme un passage, d’ailleurs assez difficile, entre la vallée du CHELIFF et les trois plaines des BENI SLIMANE, des ARIB et de BOUIRA, qui se suivent de l’Ouest à l’Est, représentant une ancienne vallée, à une altitude de 600-500 mètres. La première, qui nous concerne BENI SLIMANE, souffre de la sécheresse. On traverse ensuite la plaine des ARIB, très bonnes terres, mais peu cultivées; la route passe par les Frênes, BIR RABALOU, LES TREMBLES, petits villages de colonisation, pour pénétrer dans la cuvette dont AUMALE occupe le centre. -

Journal Officiel N°2020-59
N° 59 Dimanche 16 Safar 1442 59ème ANNEE Correspondant au 4 octobre 2020 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: 1 An 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Edition originale................................... 1090,00 D.A 2675,00 D.A Tél : 021.54.35..06 à 09 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction.... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 ALGER (Frais d'expédition en sus) BADR : Rib 00 300 060000201930048 ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 16 Safar 1442 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 4 octobre 2020 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 20-274 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux -

Rapport Sur Les Priorités Et La Planification Année 2021
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère des Ressources en Eau Rapport sur les priorités et la planification Année 2021 Volume 2 Octobre/ 2020 Table des matières Contenu Section 1. Message du ministre .......................................................................................4 1.1 Message du ministre ...................................................................................................4 1.2 Déclaration du Secrétaire Général ..............................................................................5 Section 2. Au sujet du portefeuille...................................................................................6 2.1 La mission ...................................................................................................................6 - Production de l’eau domestique, industrielle et agricole, y compris la production et l’utilisation de l’eau de mer dessalée, de l’eau saumâtre et des eaux usées Épurées ;6 2.2 Le ministère ................................................................................................................7 2.3 Fiche Portefeuille ........................................................................................................9 Gestionnaire responsable : Ministre des Ressources en Eau ...............................................9 2.4 Planification des activités pour l’année 2021 ...........................................................11 Section 3. Planification détaillée du programme 01 ......................................................12 -
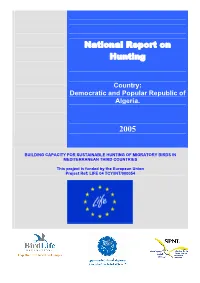
National Report on Hunting 2005
National Report on Hunting Country: Democratic and Popular Republic of Algeria. 2005 BUILDING CAPACITY FOR SUSTAINABLE HUNTING OF MIGRATORY BIRDS IN MEDITERRANEAN THIRD COUNTRIES This project is funded by the European Union Project Ref: LIFE 04 TCY/INT/000054 National Report on Hunting Country: Democratic and Popular Republic of Algeria Prepared by: Dr Mohammed BELHAMRA 2005 SOMMAIRE A/ La chasse et les activités de chasse 1. Noms et coordonnées gèo-rèfèrentielles des principales zones de chasse 2. Liste des espèces d’oiseaux migrateurs chassées 3. Nombre d’oiseaux chassés par espèce et par localité 4. Détails relatifs aux méthodes de chasse utilisées 5. Estimation de la charge en plomb introduite dans l’environnement à travers l’exercice de la chasse. 6. Types de chasseurs et nombres de chasseurs part type 7. Nombre de chasseurs enregistrés en 2004/2005 et estimation du nombre de braconniers 8. Noms et adresses des associations de chasseurs nationales et locales et détails relatifs à leurs membres 9. Appréciation des activités de chasse touristique 10. Détails relatifs aux bagues d’oiseaux retrouvées sur des oiseaux tués dans le cadre de la chasse 11. Appréciations des donnés manquantes et du besoin de recherche en matière de chasse des oiseaux migrateurs. B/ La législation en matière de chasse des oiseaux migrateurs et application de la réglementation en vigueur 1. organisation de la gestion de la chasse (responsabilités des institution gouvernementales, des association de chasseurs et autres organisations de chasseurs et autre organisation, formes de collaboration par exemple en matière de formation et livraison de chasse, etc.). 2. principale législation pertinente en matière de chasse des oiseaux migrateurs et les limitations fixées en ce qui concerne les périodes de chasse, le nombre d’oiseaux par espèce et par période de chasse autorisée, les espèces gibier, les espèces protégées, 2 restriction en ce qui concerne les horaires, les zones, la fréquence et les méthodes de chasse, etc. -

Journal Officiel = De La Republique Algerienne Democratique Et Populaire Conventions Et Accords Internationaux - Lois Et Decrets
No 22 ~ Mercredi 14 Moharram 1421 ~ . 39 ANNEE correspondant au 19 avril 2000 Pee nls 43 Ub! sess Sbykelig bte é yr celyly S\,\n JOURNAL OFFICIEL = DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS. ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANCAISE) Algérie ; ER DIRECTION ET REDACTION: Tunisie ETRANGER SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libyeye que le Maghreb) ” , Mauritanie Abonnement et publicité: : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An- 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 a 17 - C.C.P. 3200-50 | Edition originale.....ccccsesseeees 856,00 D.A| 2140,00 D.A _ ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ . BADR: 060.300.0007 68/KG Edition originale et sa traduction}1712,00 D.A|. .4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d'expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de joindre la derniére bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22.14 Moharram 1421 19 avril 2000 SOMMAIRE | | ; ARRETES, DECISIONS ET AVIS | MINISTERE DES FINANCES Arrété du 13 Ramadhan 1420 correspondant au 21 décembre 1999 modifiant et complétant l'arrété du 26 Rajab 1416 -correspondant au 19 décembre 1995 portant création des inspections des impéts dans les wilayas relevant de la _,direction régionale des imp6ts de Chlef... -

Brèves Du Centre
L’Algérie profonde / Actualités L’Algérie profonde Brèves du centre M’SILA TROIS MORTS ET UN BLESSÉ GRAVE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION Trois personnes ont été tuées et une autre grièvement blessée dans un accident de la circulation survenu hier à 6h10 à 17 km de la ville de M’Sila. Selon la Protection civile de M’Sila, cet accident s’est produit lorsqu’un camion Renault 340 a heurté de plein fouet une voiture Peugeot 305 sur le RN60, reliant Hammam Dalaâ à M’Sila, au lieu dit Loukmane dans la commune d’Ouled Mansor. Cet accident a fait 3 morts sur le coup et un blessé grave. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances et les causes exactes du drame. Chabane BOUARISSA Médéa création de nouveaux pôles urbains Une opération de création de nouveaux pôles urbains, lancée il y a quelques mois, a été accréditée par les autorités de la wilaya en vue d'asseoir une nouvelle vision qui tienne compte des contraintes particulières liées à la gestion du foncier. C’est dans cette optique que s’inscrit la mise en œuvre, l’année écoulée, d’une dizaine de pôles urbains, expérience qui sera encore consolidée au cours de cet exercice par l’aménagement de huit nouveaux pôles qui concerneront toutes les agglomérations à grande concentration de populations. Cette démarche, est-il indiqué, est dictée par le souci d’harmoniser la croissance des villes touchées et partant d’arriver à une utilisation parcimonieuse des espaces dans l’objectif de mettre en valeur les équipements publics en adéquation avec l’environnement et les besoins d’extension urbaine. -

ALGÉRIE =Æ Incendies Médéa Image D'analyse: 19 Juillet 2017 | Publiée 24 Juillet 2017 | Version 1.0 FR20170712DZA
ALGÉRIE =Æ Incendies Médéa Image d'analyse: 19 juillet 2017 | Publiée 24 juillet 2017 | Version 1.0 FR20170712DZA 2°32'0"E 2°36'0"E 2°40'0"E 2°44'0"E 2°48'0"E 2°52'0"E 2°56'0"E ¥¦¬Alger Surface incendiée Tipaza Blida Localisation de la carte Wilaya / Commune (ha) sur l'étendue de la carte Aïn Defla Bouira Médéa Médéa 5414.1 Ouled Bouachra 1637.6 Ouled Antar 1271.1 Tissemsilt ALGERIA Ouled Hellal 1134.4 M'Sila Bouaichoune 537.6 36°6'0"N Djelfa 36°6'0"N Tiaret Zoubiria 428.6 Boughar 328.8 Feux de Forêts au nord de l'Algérie Medjebar 76.0 - Impact dans la wilaya de Médéa Si El Mahdjoub 0.1 Ain Defla 49.0 Cettecarte illustrezonesles d’incendies observées à Oued Chorfa 45.9 partird’images satellitaires couvrant wilaya la de Barbouche 3.1 Médéautilisanten unedifférence de ratios de brûlure Total 5463.1 normalisédérivée(NBR) des images Sentinel-2du 29 J uin 2017 et du 19 Juillet 2017 ainsietJ du Juillet uin2017 2017 que 19 foyersles 36°3'0"N 36°3'0"N d'incendiesdétectés Juillet 19 Juilletetentre le 01 le 2017 àpartir 2017 des données MODIS.Sur l’emprise de cettecarte, haenviron semblent 5.400 avoir brulé Aperçu de zone essentiellement dans les communes de Ouled parcourue par le feu Bouachra (1.637 ha), Ouled Antar (1.271 ha), etOuled ha), OuledBouachra Antarha), (1.271 (1.637 Hellal (1.134 ha). La surfaceLa ha). (1.134 totale incendiée Hellal pourrait êtresous-estimée étant donné que certaines zones semblentavoir déjà subi des incendies. -

Pdf Transaction D Algérie Du 2021-05-15
16 Dimanche 16 mai 2021 ACTUALITE TRANSACTION D’ALGERIE N°3924 Réunion du conseil des ministres Selon le ConsumerLab d’Ericsson LA POSSIBILITÉ DE RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES LA 5G MODIFIE DÉJÀ NOTRE TERRESTRES ET AÉRIENNES AU MENU UTILISATION DES SMARTPHONES P. 2 Finances •La plus grande étude de consommation réalisée à ce jour sur la 5G a recueilli l’opi- NÉCESSITÉ D’ACCÉLÉRER nion représentative de plus 1,3 milliard de consomma- teurs et 220 millions d’utilisa- LA CADENCE teurs de la 5G. •Les utilisateurs de la 5G DE NUMÉRISATION passent plus de temps sur la Dimanche 16 mai 2021 www.Transactiondalgerie.com Quotidien national réalité augmentée et le cloud Transactionwww.Transactiondalgerie.DZ DU SECTEUR N° 3924 Prix : 10 DA d’information économique D’ALGERIE P. 3 gaming, tandis que 20 % d’entre eux ont réduit l’utili- sation du Wi-Fi sur leur télé- phone, que ce soit à la maison ou dans d’autres lieux. •Sept utilisateurs de la 5G Signé par le Premier ministre Abdelaziz Djerad sur dix s’attendent à des servi- ces et des applications plus innovants, la couverture inté- rieure étant jugée deux fois plus importante que la vitesse ou l’autonomie de la batterie pour les primo-adoptants. Le nouveau rapport du LES NOUVELLES CONDITIONS D’EXERCICE ConsumerLab d’Ericsson sou- ligne l’impact que la 5G a déjà sur les utilisateurs de smart- phones du monde entier et ce qu’ils attendent de cette tech- nologie à l’avenir. La couver- clés derrière l’adoption, l’uti- augmentée (RA) par rapport satisfaisantes. -

Etat Des Chirurgiens Dentistes Generalistes Et Specialistes Du Secteur Prive Dans La Wilaya De Medea
ETAT DES CHIRURGIENS DENTISTES GENERALISTES ET SPECIALISTES DU SECTEUR PRIVE DANS LA WILAYA DE MEDEA N° Nom et Prénom du praticien Adresse commune Spécialité N TELEPHONE 01 ZEMERLINE SAAD EDDINE BEZIOUCHE KEF SLITANE COMMUNE DE MEDEA CH/ DENT 02 BEN BAHA MOHAMED QUARTIER M'SALLA BT 18 COMMUNE DE MEDEA CH/ DENT 025-58-00-08 03 BENKAID ALI BRAHIM CITE SARRI AHMED BLOC 08 N° 32 COMMUNE DE MEDEA CH/ DENT - 04 BENROUISSI ABD EL AZIZ CITE SEGUON N°01 COMMUNE DE MEDEA CH/ DENT 025-58-03-84 05 BENROUISSI HALIMA CITE SEGUON N°01 COMMUNE DE MEDEA CH/ DENT Cabinet de groupe 06 BERKANI ZINEB CITE SEMMANA BT 04 COMMUNE DE MEDEA CH/ DENT 025-59-13-00 07 BOUCHENAFA OMAR QUARTIER 24 FEVRIER BT 303 / 07 COMMUNE DE MEDEA CH/ DENT - 08 BOUHADDA MOHAND AMEZIAN QUARTIER THENIET EL H'DJAR COMMUNE DE MEDEA CH/ DENT 025-58-28-64 09 BOUHRAOUA BENISSA QUARTIER TAKHABIT COMMUNE DE MEDEA CH/ DENT - 10 BOUKHALKHAL MOHAMED BOULVARD 17 OCTOBRE BT OUACHANNE COMMUNE DE MEDEA CH/ DENT - 11 BOUKHATEM KHALED QUARTIER MARDJACHEKIR BT 31/06 COMMUNE DE MEDEA CH/ DENT 025-58-37-17 12 DALI BRAHAM MALIK CITE SEMMANA N° D 34 COMMUNE DE MEDEA CH/ DENT - 13 DOUGDAG SADDIK BOULVARD A L N TAKBOU COMMUNE DE MEDEA CH/ DENT - 14 HADJ HAMDI SLIMANE CITE TAHTOUH BT 02/21 COMMUNE DE MEDEA CH/ DENT 025-59-13-00 15 HAMOUDI YOUSSEF QUARTIER MARDJACHKIR BT 01/04 COMMUNE DE MEDEA CH/ DENT 025-58-50-13 16 HARKABI YOUCEF QUARTIER SEMMANA BT 3 N° 27 COMMUNE DE MEDEA CH/ DENT 07-77-17-71-33 17 LEKHALI DJAMEL RUE FERRAH AHMED BT SARIE AHMED N°07/24 N°24 COMMUNE DE MEDEA CH/ DENT 025-58-95-46 18 MAMI -

Mémoire De Fin De Cycle En Vue De L’Obtention Du Diplôme De Master En Science Economiques Spécialité : Management Territorial Et Ingénierie De Projets
UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES, COMMERCIALES ET DES SCIENCES DE GESTION DEPARTEMENT DES SCIENCES ECONOMIQUES Mémoire de fin de cycle En vue de l’obtention du diplôme de Master en Science Economiques Spécialité : management territorial et ingénierie de projets Option : management des services publics territoriaux Thème Typologie des études du CETIC de Boumerdes de 2000 à 2016, étude de cas des PATW Présenté par : Encadré par : MANSOUR Lydia Pr. Malika AHMED ZAID ZOUAOUI Lamia Co-encadré par : Mr. Aziz LALEG Devant le jury composé de : Président: Mr. OUNASSI Hassen, MAA à l'UMMTO; me Encadreur : M . AHMED ZAID Malika, Professeure à l'UMMTO; Co-encadreur : Mr. LALEG Aziz, Doctorant à l'UOEB; me Examinatrice : M . RAMDINI Samira, MAA à l'UMMTO. Année universitaire 2016/2017 Remerciements On remercie ALLAH le tout puissant de nous avoir donné la force, le courage et la patience d’arriver à terme de ce travail. En tiens à exprimer nous vifs remercîments à : A nous chers parent de nous avoir soutenue tout le long de notre parcourt ; Notre encadreurs Professeur Malika AHMED ZAID-, professeur d’économie, directrice de laboratoire de recherches REDYL « Réformes Economiques et Dynamiques Locales » au département des Sciences Economiques, pour ces énormes sacrifices pour la réussite de notre master ; A notre Co-encadreur Aziz LALEG d’avoir été pation avec nous ; A monsieur Kamel AMEZIAN et madame BANSOUT et tout les membres de CETIC qui nous ont aidé dans notre stage pratique. Je dédie ce travail… A ma très chère mère Rabea Affable, honorable, aimable : Tu représentes pour moi le symbole de la bonté par excellence, la source de tendresse et l’exemple du dévouement qui n’a pas cessé de m’encourager et de prier pour moi. -

Page 8 Regions 23 Avril
Le Soir d’Algérie Régions Mercredi 23 avril 2008 - PAGE 8 SIDI-BEL-ABBéS TLEMCEN AlgŽrie TŽlŽcom, Sidi-Ali Benyoub crie Expo grand public La direction territoriale des télécommunications à Tlemcen a organisé une exposition grand public sur les ˆ la catastrophe Žcologique différents secteurs des télécoms. C’était l’occasion pour le public de découvrir des stands sur l’internet et ses Les habitants de la daïra de Sidi-Ali Benyoub de leurs enfants se sont des murs et plafonds qu’il est réseaux, la téléphonie ainsi que le stand commercial. (Sidi-Bel-Abbès) crient à la catastrophe écolo- organisés à travers des impossible de réparer à Des explications étaient fournies aux visiteurs par des associations et comités de cause de la répétitions des gique qui les menace chaque jour. professionnels par le biais d’une projection. A la fin de quartier, pour tirer la sonnet- explosions. cette journée, il y a eu une conférence où deux communi- «Il y va de notre santé rique, dégâts sur leurs te d’alarme et crier à l’insup- D’ailleurs, le wali avait cations ont été faites, l’une sur «histoire de l’internet et son physique et morale et celle demeures, maladies de leurs portable, pointant du doigt demandé à son exécutif l’en- évolution en Algérie» et l’autre «internet, la solution des de nos enfants», s’insurgent enfants, telles sont les les exploitants des carrières voi d’une commission d’en- entreprises économiques». les habitants des localités de conséquences engendrées qui «continuent à nuire indi- quête pour vérifier les décla- Sidi-Ali Benyoub, Bordj par l’exploitation de ces car- rectement à notre vie quoti- rations des habitants.