Province Du Woleu-Ntem
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
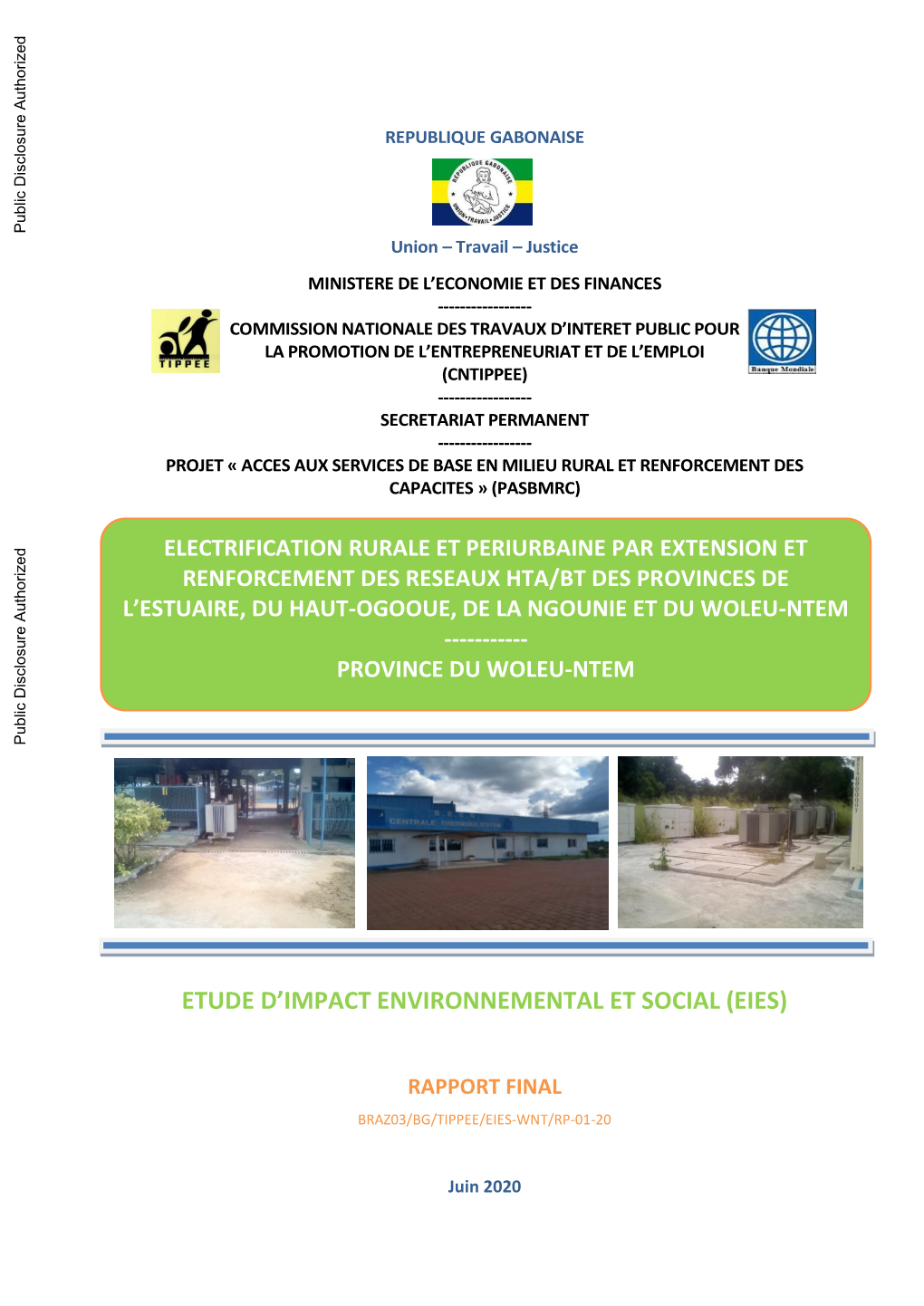
Load more
Recommended publications
-
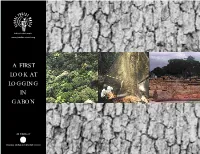
A First Look at Logging in Gabon
Linking forests & people www.globalforestwatch.org A FIRST LOOK AT LOGGING IN GABON An Initiative of WORLD RESOURCES INSTITUTE A Global Forest Watch-Gabon Report What Is Global Forest Watch? GFW’s principal role is to provide access to better What is GFW-Gabon? information about development activities in forests Approximately half of the forests that initially cov- and their environmental impact. By reporting on The Global Forest Watch-Gabon chapter con- ered our planet have been cleared, and another 30 development activities and their impact, GFW fills sists of local environmental nongovernmental orga- percent have been fragmented, or degraded, or a vital information gap. By making this information nizations, including: the Amis de la Nature-Culture replaced by secondary forest. Urgent steps must be accessible to everyone (including governments, et Environnement [Friends of Nature-Culture and taken to safeguard the remaining fifth, located industry, nongovernmental organizations (NGOs), Environment] (ANCE), the Amis Du Pangolin mostly in the Amazon Basin, Central Africa, forest consumers, and wood consumers), GFW [Friends of the Pangolin] (ADP), Aventures Sans Canada, Southeast Asia, and Russia. As part of promotes both transparency and accountability. We Frontières [Adventures without Borders] (ASF), this effort, the World Resources Institute in 1997 are convinced that better information about forests the Centre d’Activité pour le Développement started Global Forest Watch (GFW). will lead to better decisionmaking about forest Durable et l’Environnement [Activity Center for management and use, which ultimately will result Sustainable Development and the Environment] Global Forest Watch is identifying the threats in forest management regimes that provide a full range (CADDE), the Comité Inter-Associations Jeunesse weighing on the last frontier forests—the world’s of benefits for both present and future generations. -

A Masterwork That Sheds Tears … and Light a Complementary Study of a Fang Ancestral Head
A Masterwork that Sheds Tears … and Light A Complementary Study of a Fang Ancestral Head Roland Kaehr and Louis Perrois Downloaded from http://direct.mit.edu/afar/article-pdf/40/4/44/1734965/afar.2007.40.4.44.pdf by guest on 24 September 2021 with Marc Ghysels translated by Rachel Pearlman ince the beginning of the twentieth century, Fang ancestral sculpture of Equatorial Africa figured among the most emblematic and esteemed genres of African art. These anthropomorphic effigies, with an often haphazardly oozing black patina, of upright posture and subtle craftsmanship, were mounted on sewn-bark relic boxes containing the remains, including the Sskulls, of lineal ancestors. Every family had one or more. Hon- ored and often “consulted” during rites of propitiation or of divi- nation, these sculptures and the skulls they magically protected constituted the basic wealth of the Fang peoples of the past, a source of welfare, strength, and social power. Who among Afri- can art lovers today does not know the Fang reliquary head at the Neuchâtel Musée d’ethnographie1 (MEN), Head III.C.7400 (Fig. 1), the famous byeri that “cries”, so often exhibited and written about? Paradoxically, for a long time the object’s very familiar- ity led to neglect of the carefully preserved archives that accom- panied it over a century ago. In 2005, on the occasion of the MEN’s centennial, the staff took action to complete the study of this exceptional object by means of state-of-the art technology, particularly physiochemical analyses. The results, which pro- vided surprising revelations, make possible both an improved approach to the piece itself and a more nuanced stylistic classifi- cation of Fang sculptural art. -

UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE 1 Faculté Des Sciences Economiques Et Sociales Institut De Sociologie
N° d’ordre : 4311 UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE 1 Faculté des Sciences Economiques et Sociales Institut de Sociologie Doctorat Changement social – option Ethnologie Mélanie SOIRON LA LONGEVITÉ POLITIQUE. Ou les fondements symboliques du pouvoir politique au Gabon. Sous la direction de Rémy BAZENGUISSA-GANGA Professeur de Sociologie, Université de Lille 1 Membres du Jury : Joseph TONDA (rapporteur et Président du Jury), Professeur de Sociologie et d’Anthropologie, Université de Libreville, Gabon. André MARY (rapporteur), Professeur d’Anthropologie. Directeur de recherches au CNRS. Alban BENSA, Professeur d’Anthropologie. Directeur d’études à l’EHESS. Bruno MARTINELLI, Professeur d’Anthropologie, Université de Provence. Thèse soutenue publiquement le 28 janvier 2009 Tome 1 sur 2 Résumé A partir d’une question initiale portant sur les raisons de la longévité politique du président de la République gabonaise, nous avons mis en lumière les fondements symboliques du pouvoir politique au Gabon. Ceux-ci sont perceptibles au sein des quatre principales institutions étatiques. Ainsi, une étude détaillée des conditions de création, et d’évolution de ces institutions, nous a permis de découvrir la logique de l’autochtonie au cœur de l’Assemblée nationale, celle de l’ancestralité au sein du Sénat, tandis qu’au gouvernement se déploie celle de la filiation (fictive et réelle), et que le symbolisme du corps présidentiel est porté par diverses représentations. A ce sujet, nous pouvons distinguer d’une part, une analogie entre les deux corps présidentiels qui se sont succédés et d’autre part, le fait que le chef de l’Etat actuel incarne des dynamiques qui lui sont antérieures et qui le dépassent. -

Ancestral Art of Gabon from the Collections of the Barbier-Mueller
ancestral art ofgabon previously published Masques d'Afrique Art ofthe Salomon Islands future publications Art ofNew Guinea Art ofthe Ivory Coast Black Gold louis perrois ancestral art ofgabon from the collections ofthe barbier-mueiler museum photographs pierre-alain ferrazzini translation francine farr dallas museum ofart january 26 - june 15, 1986 los angeles county museum ofart august 28, 1986 - march 22, 1987 ISBN 2-88104-012-8 (ISBN 2-88104-011-X French Edition) contents Directors' Foreword ........................................................ 5 Preface. ................................................................. 7 Maps ,.. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. 14 Introduction. ............................................................. 19 Chapter I: Eastern Gabon 35 Plates. ........................................................ 59 Chapter II: Southern and Central Gabon ....................................... 85 Plates 105 Chapter III: Northern Gabon, Equatorial Guinea, and Southem Cameroon ......... 133 Plates 155 Iliustrated Catalogue ofthe Collection 185 Index ofGeographical Names 227 Index ofPeoplcs 229 Index ofVernacular Names 231 Appendix 235 Bibliography 237 Directors' Foreword The extraordinarily diverse sculptural arts ofthe Dallas, under the auspices of the Smithsonian West African nation ofGabon vary in style from Institution). two-dimcnsional, highly stylized works to three dimensional, relatively naturalistic ones. AU, We are pleased to be able to present this exhibi however, reveal an intense connection with -

Twenty-Sixth Session Libreville, Gabon, 4
RAF/AFCAS/19 – INFO E November 2019 AFRICAN COMMISSION ON AGRICULTURAL STATISTICS Twenty-sixth Session Libreville, Gabon, 4 – 8 November 2019 INFORMATION NOTE 1. Introduction The objective of this General Information is to provide participants at the 26th Session of AFCAS with all the necessary information so as to guide them for their travel and during their stay in Libreville, Gabon. 2. Venue and date The 26th Session of the African Commission on Agricultural Statistics (AFCAS) will be held at the Conference Room No 2 of Hôtel Boulevard – Libreville, Gabon, from 4 to 8 novembre 2019. 3. Registration Registration of participants will take place at the Front Desk of Conference Room No 2 of Hôtel Boulevard – Libreville, Gabon: AFCAS: 4 November 2019, between 08h00 and 09h00 The opening ceremony begins at 09h00. 4. Technical documents for the meetings The technical documents related to the 26th Session will be available from 30 September 2019 onwards at the following Website: http://www.fao.org/economic/ess/ess-events/afcas/afcas26/en/ 5. Organization of the meetings The Government of the Republic of Gabon is committed to provide the required equipment for the holding of this session. You will find the list of hotels where bookings can be made for participants at the Annex 1. Transportation will be provided from the hotel to the venue for the Conference. 6. Delegations All participants are kindly requested to complete the form in Annex 2 and return it to the organizers latest by 11 October 2019. The form contains all the details required for appropriate arrangements to be made to welcome and lodge delegates (Flight numbers and schedule). -

Gouvernement De La République Gabonaise
Nouveau partenariat pour le Organisation des Nations Unies développement de l’Afrique (NEPAD) pour l’alimentation et l’agriculture Programme détaillé pour le Division du Centre d’investissement développement de l’agriculture africaine (PDDAA) GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DU NEPAD–PDDAA TCP/GAB/2907 (I) (NEPAD Ref. 05/09 F) Volume V de V PROFIL DE PROJET D’INVESTISSEMENT BANCABLE Fonds d’appui à la diversification des productions en milieu rural Octobre 2005 GABON: Appui à la mise en œuvre du NEPAD–PDDAA Volume I: Programme national d’investissement à moyen terme (PNIMT) Profils de projets d’investissement bancables (PPIB) Volume II: Relance des services d’appui techniques au développement agricole Volume III: Appui à l’intensification de la filière de la banane et du plantain Volume IV: Appui au développement de la filière manioc Volume V: Fonds d’appui à la diversification des productions en milieu rural PROFIL DE PROJET D’INVESTISSEMENT BANCABLE DU PDDAA–NEPAD Pays: Gabon Secteur d’activité: Financement rural Titre du projet proposé: Fonds d’appui à la diversification des productions en milieu rural Zone du projet: Haut Ogooué, Ngounié, Woleu–Ntem Durée du projet: 4 ans Coût estimé: Coût en devises:..................... 2,4 millions de dollars EU Coût en monnaie locale: ........ 1,0 millions de dollars EU Total.................................... 3,4 millions de dollars EU Financement envisagé: Source Millions de FCFA1 Millions de $EU % du total Gouvernement 187 0,3 10 Institution(s) de 1 309 2,4 70 financement Bénéficiaires 374 0,7 20 Total 1 870 3,4 100 1 Equivalence monétaire: Unité monétaire = franc CFA (FCFA) 1 $EU = 550 FCFA 100 FCFA = 0,18 $EU GABON Profil de projet d’investissement bancable du PDDAA–NEPAD « Fonds d’appui à la diversification des productions en milieu rural » Table des matières Abréviations......................................................................................................................................... -

Knowledge Institutions in Africa and Their Development 1960-2020: Gabon
Knowledge institutions in Africa and their development 1960-2020: Gabon Knowledge Institutions in Africa and their development 1960-2020 Gabon Introduction This report about the development of the knowledge institutions in Gabon was made as part of the preparations for the AfricaKnows! Conference (2 December 2020 – 28 February 2021) in Leiden, and elsewhere, see www.africaknows.eu. Reports like these can never be complete, and there might also be mistakes. Additions and corrections are welcome! Please send those to [email protected] Highlights 1 Gabon’s population increased from 501,000 in 1960, via 950,000 in 1990, to 2.2 million in 2020. 2 Gabon’s literacy rate is 85% (15 years and older, 2018). 3 The so-called education index (used as part of the human development index) improved between 1990 (earlier data not available) and 2018: from 0.473to 0.636 (it can vary between 0 and 1). 4 Regional inequality is consistent and low. Performing best overall is Libreville-Port Gentil. The region with the fastest development is Estuaire (the province where Libreville is located). Performing worst overall is Ogooue Lolo. The slowest developing province is Moyen Ogooue. 5 The Mean Years of Schooling for adults improved between 1990 and 2018, from 4.3 years to 8.3 years. There is high regional inequality until 2010. 6 The Expected Years of Schooling for children improved somewhat: from 11.1 to 12.1 years. There is low regional inequality throughout the period. 7 Gabon has had higher education institutions since the late 1950s. Currently there are about 32 tertiary knowledge institutions in Gabon, 15 public and 17 private ones. -

Rapport Du Groupe De Travail De La Commission Africaine Sur Les Populations / Communautés Autochtones
REPORT OF THE AFRICAN for Indigenous Affairs Indigenous for International Work Group Group Work International COMMISSION’S WORKING GROUP ON INDIGENOUS POPULATIONS/COMMUNITIES N O RESEARCH AND INFORMATION VISIT TO et des Peuples des et des Droits de l’Homme l’Homme de Droits des THE REPUBLIC OF GABON Commission Africaine Africaine Commission 15-30 September 2007 REPUBLIC OF GAB REPUBLIQUE DU GAB 15-30 Septembre 2007 Septembre 15-30 EN REPUBLIQUE DU GABON DU REPUBLIQUE EN African Commission on Human and Peoples’ Rights VISITE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION D’INFORMATION ET RECHERCHE DE VISITE O N COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES COMMUNAUTÉS SUR LES POPULATIONS / / POPULATIONS LES SUR International Work Group for Indigenous Affairs DE LA COMMISSION AFRICAINE AFRICAINE COMMISSION LA DE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE GROUPE DU RAPPORT RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION AFRICAINE SUR LES POPULATIONS / COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES VISITE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN REPUBLIQUE DU GABON 15-30 Septembre 2007 La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a pris note de ce rapport lors de sa 45ème session ordinaire, 13-27 mai 2009 Commission Africaine des Droits International Work Group de l’Homme et des Peuples for Indigenous Affairs (CADHP) 2010 RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION AFRICAINE SUR LES POPULATIONS / COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES VISITE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN REPUBLIQUE DU GABON 15– 30 Septembre 2007 © Copyright: CADHP et IWGIA Mise en page: Jorge Monrás Imprimerie: Eks-Skolens Trykkeri, Copenhague, Danemark ISBN: 978-87-91563-74-4 Distribution en Amerique du Nord: Transaction Publishers 300 McGaw Drive Raritan Center - Edison, NJ 08857 www.transactionpub.com COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HoMME ET DES PEUPLES (CADHP) No 31 Bijilo Annex Layout Kombo North District, Western Region B.P. -

Pdf | 699.42 Kb
Emergency Plan of Action Final Report Gabon: Elections Preparedness DREF operation No. MDRGA007 Date of disaster: 15 July – 28 August 2016 Date of Issue: 28 February 2017 Operation start date: 15 July 2016 Operation end date: 21 November 2016 Operation manager (responsible for this EPoA): Josuane Point of contact: Léonce-Omer Mbouma, National Flore Tene, Disaster and Crisis Prevention, Response and Director for Organisational Development and Disaster Recovery Coordinator and Risk Management Overall operation budget: CHF 257,240 Initial budget: CHF 41,854 Additional budget: CHF 215,386 Number of people assisted: 5,000 people Host National Society: Gabonese Red Cross Society with 2,700 volunteers, 15 local committees, 54 branches and 14 employees. Red Cross Red Crescent Movement partners currently actively involved in the operation: International Committee of Red Cross, and International Federation of Red Cross and Crescent Societies Other partner organizations involved in the operation: Ministry of Interior, Gabon’s Civil Protection/medical emergency services (SAMU, SMUR - which joined the Red Cross teams in a coordinated manner a few days after the beginning of the hostilities) and United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (collecting and relaying information), African Union (in a mediation role) Summary: On 15 July 2016, with a DREF allocation of CHF 41,854, the Gabonese Red Cross started to train and equip its emergency teams as part of its contingency plan for election preparedness. The initial DREF was set to end on 21 September 2016. Expenses were at 90 percent and the remaining activities were as follows: (1) A lessons learnt exercise; and (2) Finance control and closure exercise by Central Africa Country Cluster office in Yaoundé. -

Situation Socio-Économique - Ngounié 2012
1 SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE - NGOUNIÉ 2012 NGOUNIÉ 2013.indd 1 25/06/14 12:41 2 SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE - NGOUNIÉ 2012 NGOUNIÉ 2013.indd 2 25/06/14 12:41 AVANT-PROPOS 9 INTRODUCTION 11 SOMMAIRE Partie I : CONNAITRE LA PROVINCE 13 I.1. LA TERRE ET LES HOMMES 15 I.1.1. La situation géographique 15 I.1.2. La géographie physique 15 I.1.3. Le découpage administratif 17 I.1.4. La géographie humaine 18 I.2. L’HISTOIRE ET LA CULTURE 19 I.2.1. Bref rappel historique 19 I.2.2. Les religions et les rites traditionnels 20 I.2.3. Les groupes linguistiques 21 I.2.4. Les légendes et mythes de la province 21 Partie II : INFORMATIONS SOCIALES 25 II.1. LA SANTE 27 II.1.1. Les infrastructures 27 II.1.2. Le personnel 28 II.1.3. Les activités de santé maternelle et infantile 29 II.2. L’EDUCATION 31 II.2.1. L’enseignement pré-primaire 31 II.2.2. L’enseignement primaire 32 II.2.3. L’enseignement secondaire général 32 II.2.4. L’enseignement secondaire technique et professionnel 33 II.3. L’EMPLOI 35 II.3.1. L’emploi dans le secteur privé 35 II.3.2. L’emploi dans le secteur public 35 III-INFORMATIONS ECONOMIQUES 39 3 SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE - NGOUNIÉ 2012 NGOUNIÉ 2013.indd 3 25/06/14 12:41 III.1. LA FORET ET LES INDUSTRIES DU BOIS 41 III.2. LES INDUSTRIES AGRO ALIMENTAIRES 42 III.3. L’AGRICULTURE, L’ELEVAGE LA PECHE ET LA CHASSE SOMMAIRE 43 III.3.1. -

Les Ethnies Du Gabon Et Leur Localisation
Centre d’études stratégiques du bassin du Congo LES PRINCIPALES ETHNIES DU GABON ET LEUR LOCALISATION NOM PROVINCE LOCALISATION Andesa Haut-Ogooué Sud de Franceville Apindji Ngounié Nord de Mouila Bekwil Ogooué Ivindo Rive Invindo defrontière Gabon-Congo à Makokou Duma Plusieurs provinces Majoritairement à Lastourville Majoritairement dans Du nord de la forêt des Abeilles à Bakoumba. l’Ogooué Lolo De Lébamba à Mounana Evea Ngounié Environ de Fougamou Fang Ntumu Woleu Ntem Majoritairement d’Oyem à Bitam Sous-groupes 1. Mekaa, 1. Mekaa : Mitzic 2. Mveny 2. Mveny :Minvoul 3. Okok 3. Okok : Medouneu Ethnie apparentée Nzaman Ogooué Ivindo Environs de l'Ogooué, à Makokou et à Booué Galwa Moyen Ogooué Lacs Onangué, Avanga, Ezanga et Lambaréné Ethnies apparentées : 1. Adjumba 1. Lac Azingo , 2. Enanga 2. Lac Zilè Kande Moyen Ogooué Entre le confluent Ogooué/Okano et Booué Kaningi Haut-Ogooué Franceville Kele Moyen Ogooué Entre Lambaréné et Ndjolé Ngounié Fougamou Kota Haut-Ogooué Okondja Ogooué Ivindo Mékambo Lumbu Nyanga Tchibanga Entre Setté-Cama et Mayumba Mahongwe Ogooué Ivindo Mékambo Makaa Ogooué Ivindo Environ de Port Boué Mbaama Haut-Ogooué Rive de la Sembé, Akiéni, Okondja et Franceville Mbangwe Haut-Ogooué Nord de Franceville Myene Estuaire et Ogooué Maritime Sous-groupes : 1. Mpongwe 1. Libreville et Ponte Denis 2. Orungu 2. Cap Lopez et Port-Gentil 3. Nkomi 3. Fernan-Vaz 4. Ajumba 4. Lac Azingo 5. Enenga 5. Lac Zilé Ndambomo Ogooué Ivindo Sud de l’Ogooué Ivindo Nduumo Haut-Ogooué Franceville, Moanda Ngom 1. Ogooué Ivindo 1. Mékambo 2. Ogooué Lolo 2. Koulamoutou Nzébi 1. Ngounié 1. -

Situation Socio-Économique - Woleu - Ntem 2012 2 Situation Socio-Économique - Woleu - Ntem 2012 AVANT-PROPOS 8
1 SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE - WOLEU - NTEM 2012 2 SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE - WOLEU - NTEM 2012 AVANT-PROPOS 8 INTRODUCTION 10 SOMMAIRE Partie I. - CONNAITRE LA PROVINCE 12 I.1. LA TERRE ET LES HOMMES 14 I.1.1. Situation géographique 14 I.1.2. Géographie physique 14 I.1.3. Géographie humaine 16 I.1.4. Découpage administratif 18 I.2. L’HISTOIRE ET LA CULTURE 18 I.2.1. L’histoire 18 I.2.2. La culture et les rites traditionnels 20 I.2.3. Les grands groupes ethno-linguistiques 21 Partie II – INFORMATIONS SOCIALES 23 II.1. LA SANTE 25 II.1.1. Les structures sanitaires 25 II.1.2. Le personnel de santé 27 II.1.3. Les activités préventives et les consultations infantiles 30 II.2. L’EDUCATION 31 II.2.1. Les structures éducatives 32 II.2.2. L’effectif des élèves et des enseignants 33 II.2.3. Les résultats scolaires 33 II.2.4. L’enseignement professionnel 34 II.3. L’EMPLOI 37 II.3.1. L’emploi dans le secteur privé 37 II.3.2. L’emploi dans les administrations publiques 38 II.3.3. L’emploi dans les administrations décentralisées 39 II.4. LA CONDITION DE LA FEMME 41 II.4.1. Le volet famille 41 II.4.2. Le volet promotion de la femme 42 3 SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE - WOLEU - NTEM 2012 II.5. LES AFFAIRES SOCIALES 42 II.6. L’HABITAT 43 SOMMAIRE Partie III – INFORMATIONS ECONOMIQUES 45 III.1. L’AGRICULTURE, L’ÉLEVAGE ET LA PECHE 47 III.1.1.