Tour De France 2021 Et Anecdotes Historiques
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Preserving Power After Empire: the Credibility Trap and France's
Preserving Power after Empire: The Credibility Trap and France’s Intervention in Chad, 1968-72 Marc R. DeVore Open Access Copy—Please Do Not Cite Forthcoming in War in History 1 Abstract France’s 1968-72 intervention in Chad constitutes a forgotten turning point in the Fifth Republic’s foreign relations. Inter-connected institutions and treaties gave France a disproportionate influence over its African ex-colonies. French security guarantees underscored this system, however, whereby francophone African leaders continued to accept French economic and political leadership. French leaders discovered in Chad, however, that they had fewer choices and needed to dedicate more resources to fulfilling these commitments than President Charles de Gaulle had intended. Prosperous ex-colonies’ leaders judged French commitments’ value according to how France responded to crises in its least valued ex- colonies. Thus, although French analysts viewed intervening in Chad as irrational from a cost/benefit perspective, they found themselves pressured into doing so by other African governments who let it be known that they would interpret failing to support Chadian President François Tombalbye as a sign that they too could not count on France. Entrapped by prior commitments, French policymakers developed a new approach to using force, which I term strategic satisficing, far different from traditional French counterinsurgency practices. The tightly-coupled application of force and diplomacy in pursuit of limited objectives enables France to intervene with the frequency needed to uphold its post-colonial order in Africa. Introduction France’s role in Africa sets it apart from other states of its size. France is arguably the most politically potent foreign actor in Sub-Saharan Africa even though it is today a medium- sized European state with an economy that only occasionally ranks amongst the world’s top half dozen. -

Guerrilleros
b « Résister est un verbe qui se conjugue au présent » (Lucie Aubrac) N° CPPAP 0919 A 07130 3 € 31 Mars 201 7 – 1er trimestre n° 145 Samedi 3 juin 2017 - 11h Paris a décidé d’honorer le chef des guérilleros deParis, la Zone boulevard Nord, St-Germain cérémonie à PRAYOLS José BARÓN , là où il est tombé le 19 août 1944 : au cœur de la ville (Ariège, à 6 km au sud de Foix) Apéritif à midi et quart, place de la Mairie Repas fraternel (24 €) à 13 h 30 salle de la mairie de Montgailhard Réservations par chèque avant le 20 mai : 06 34 46 50 17 - 05 61 69 85 81 ou : [email protected] Bus ou covoiturage, se renseigner selon les départements : La Ville de Paris a fixé :ICI EST TOMBÉ Aude : [email protected] la date d’inauguration JOSÉ BARÓN CARREÑO Gard : [email protected] de la stèle qui honorera le RÉPUBLICAIN ESPAGNOL Haute-Garonne : [email protected] chef guérillero tué le 1er jour CHEF EN ZONE NORD DE LA FRANCE Gironde : [email protected] de l’insurrection parisienne . POUR L’AGRUPACIÓN Lot : [email protected] Merci Paris ! DE GUERRILLEROS ESPAÑOLE S Pyrénées-Atlantiques : [email protected] Soyons nombreux pour (UNE -FFI ) Hautes-Pyrénées : [email protected] partager cet acte de MORT POUR LA FRANCE Pyrénées-Orientales : [email protected] reconnaissance historique ! LE 19 AOÛT 1944 Tarn-et-Garonne : [email protected] Voir note page 6 SOMMAIRE P. 2 Les frères Canovas : ensemble, deux volets de la Résistance P. -

Marcel Bigeard Est Fait Prisonnier Le 7 Mai 1954 Lors De La Chute Du Camp
1950, Bigeard embarque à Saigon sur le paquebot La Marseillaise et quitte une nouvelle fois l'Indochine. Au printemps 1951, Bigeard est affecté à Vannes à la demi-brigade coloniale du colonel Gilles et se voit confier le bataillon de passage. En septembre 1951, il obtient le commandement du 6e bataillon de parachutistes coloniaux à Saint-Brieuc. Il a le grade de chef de bataillon en janvier 1952. Le 28 juillet 1952, Bigeard, à la tête du 6e BPC, débarque à Haiphong pour un troisième séjour en Indochine et prend ses quartiers à Hanoï. Le 16 octobre 1952, le bataillon est parachuté sur Tu Lê 16 et affronte durant huit jours les régiments des divisions Viet Minh 308 et 312. L'unité se distingue à nouveau lors de la bataille de Na San (parachutage dans la cuvette de Ban Som le 27 décembre 1952), lors de l'opération Hirondelle sur Lang Son le 17 juillet 1953 et lors de l'opération Castor sur Dien Bien Phu le 20 novembre 1953. Le 31 décembre 1953, il prend le commandement du GAP n° 417, constitué du II/1er RCP et du 6e BPC, et intervient au moyen Laos entre Thakhek et Savannakhet vers lesquelles deux divisions Viet Minh se dirigent. Parachuté, le 16 mars 1954, alors que le sort de la bataille de Dien Bien Phu est scellé, le commandant Bigeard est nommé lieutenant-colonel lors des combats et devient l'un des héros de la cuvette en combattant avec son bataillon sur les points d'appuis Éliane 1 et 2, mais surtout en codirigeant les troupes d'intervention du camp retranché avec le colonel Langlais. -

Algerian War of Independence - France
Joint Crisis: Algerian War of Independence - France JHUMUNC 2017 1 Joint Crisis: Algerian War of Independence - France Topic A: The Grand Ensemble and the Algerian War Topic B: Domestic Challenges and the Challenge to French Identity Overview committee and its legislative board, the The French-Algerian War occurred Algerian cabinet. between 1954-1962, spanning the Fourth and Fifth Republics of France. The war was Parliamentary Procedure not limited to conflict between French For this committee, we will follow colonial authorities and Algerian standard parliamentary procedure. We will nationalists, but also involved civil divide on remain in moderated caucus, unless a the Algerian front between populations of motion for an unmoderated caucus is different cultural backgrounds, religions, motioned and approved. Standard voting and ideologies toward the future of the state. procedure will be observed, and any This committee opens in 1955 and serves as differences regarding procedures will be the managerial body of the French subject to the decision of the chair and dais government, the French Cabinet, with Rene staff. Gustav Coty as the director, who will be represented by the chair. Delegates are responsible for evaluating domestic and Delegate Biographies foreign challenges simultaneously. Part of Maurice Bougrès-Maunoury the committee will revolve around growing Maunoury played an important role resistance in the French colony of Algeria, as the leader in the French Resistance, a while another segment will address the movement to interfere with the Nazi internal challenges faced by the French occupation of France. Following the end of government, which affect the future World War II, Borges served as minister for structure of the government and all of several different seats including defense, France. -

French Combatants' Memoirs of the Algerian War, 1954-1988
LE SILENCE DE LA GUERRE? FRENCH COMBATANTS' MEMOIRS OF THE ALGERIAN WAR, 1954-1988. Anndal G. Narayanan A thesis submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Department of History. Chapel Hill 2012 Approved by: Donald Reid Lloyd Kramer Christopher Lee ©2012 Anndal G. Narayanan ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT ANNDAL NARAYANAN: Le silence de la guerre? French combatants' memoirs of the Algerian War, 1954-1988 (Under the direction of Donald Reid) Fifty years after the cessation of hostilities, the memory of the Algerian War of Independence (1954-1962) remains an open wound in French society. From the time of the war itself, French veterans of Algeria sought to find their voice in a society largely indifferent to them and their experiences. This thesis examines the evolving memory of the Algerian War among French veterans who wrote wartime memoirs, and seeks the relationship of these narratives with the wider French collective memory of the Algerian War, by closely following the constructed figure of the combatant. This study finds that French veterans' narratives of Algeria, while all expressing various kinds of victimhood, evolved in time from the political to the personal, encouraged by governmental amnesties that depoliticized the memory of the war and contributed to the impossibility of a general collective memory of the Algerian War in France. iii To the memory of Mr. Donald Hall, who taught me the importance of reading, writing, and teaching history. iv ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank my adviser, Dr. -

Découvrez Le Dossier Commandos Marine Réalisé Par L'asaf
AVANT-PROPOS « Ce que je demande, je le fais » 1 Pour son septième numéro hors-série depuis 2012, l’ASAF a choisi de mieux faire connaître les 100 années d’existence du parachutisme militaire français. Elle le fait d’autant plus que 2018 est l’année du choix par les élèves-officiers des Écoles de Saint- Cyr Coëtquidan des généraux Fourcade et Le Boudec comme parrains de promotions. C’est aussi le 70 e anniversaire de la décision de prendre saint Michel comme saint patron des paras. Elle fait enfin ce choix car les parachutistes sont présents aujourd’hui dans les trois armées (Terre, Marine et Air), dans les organismes interarmées (COS, DRM, SSA,…), ainsi que dans la Gendarme - rie et dans d’autres organismes tels que la DGSE. Ce numéro explique comment on est passé du parachute comme moyen de secours pour les aé - rostiers et pilotes de la Grande Guerre, au parachute manœuvrable dans les régiments et à l’aile destinée aux unités de commandos engagées discrètement loin derrière les lignes ennemies pour y mener des opérations spéciales. Mais quelles que soient les modalités de mise en place, - aérolargage, posé d’assaut ou hélipor - tage -, ce sont les conditions d’engagement au sol de ces soldats du ciel, souvent isolés, équipés de moyens légers, qui vont conduire ces unités à développer des qualités de cohésion, de rusti - cité, d’endurance, d’adaptation et d’innovation. Si la condition physique est vitale, l’audace et la recherche de la surprise sont essentielles pour compenser leur infériorité numérique. Dans ce type d’engagement, la place et le rayonnement du chef sont déterminants. -

On the Spaces of Guerre Moderne: the French Army in Northern Algeria (1954–1962) Samia Henni
37 On the Spaces of Guerre Moderne: The French Army in Northern Algeria (1954–1962) Samia Henni Introduction French National Assembly formally recognised On the night of Friday, 13 November 2015, as the the term war by law and authorised the use of the Paris attacks were still unfolding, François Hollande, appellation La Guerre d’Algérie in French schools President of the Fifth Republic stood before national and in official terminology.2 television and declared the closing of the country’s borders and a nationwide état d’urgence (state of In 2015, sixty years after the institution of the emergency). The French media compared these state of emergency, the same extraordinary law attacks with the calamities of World War II, thus is enforced, but it took the French president a few disregarding and undermining the Paris Massacre hours to call the Paris attacks ‘an act of war’, and of 17 October 1961, during La Guerre d’Algérie (the a few days after that to proclaim that ‘France is at Algerian War, 1954–1962), which killed hundreds war’. Hollande and his government, however, had of peaceful Algerian pro-independence protesters no intention of recalling the peculiar character of who had gathered in Paris. The Paris police forces warfare that France waged (and is still waging), a were then under the authority of Maurice Papon, a war that Colonel Roger Trinquier, a French army French civil servant who had served twice in Algeria officer and theorist who served in Algeria, termedla under French colonial rule, and who was convicted guerre moderne (modern warfare). -

Memory, Empire, and Postcolonialism: Legacies of French Colonialism' and Singer and Langdon, 'Cultured Force: Makers and Defenders of the French Colonial Empire'
H-French-Colonial Barrows on Hargreaves, 'Memory, Empire, and Postcolonialism: Legacies of French Colonialism' and Singer and Langdon, 'Cultured Force: Makers and Defenders of the French Colonial Empire' Review published on Friday, January 15, 2010 Alec G. Hargreaves, ed. Memory, Empire, and Postcolonialism: Legacies of French Colonialism. Lanham: Lexington Books, 2005. 272 pp. $32.95 (paper), ISBN 978-0-7391-0821-5.Barnett Singer, John W. Langdon. Cultured Force: Makers and Defenders of the French Colonial Empire. Madison: University of Wisconsin Press, 2004. xi + 483 pp. $45.00 (cloth), ISBN 978-0-299-19900-5; $29.95 (paper), ISBN 978-0-299-19904-3. Reviewed by Leland Barrows (Voorhees College) Published on H-French-Colonial (January, 2010) Commissioned by Jyoti Mohan Myths and Realities: Conflicting Perceptions of French Colonial History and Postcolonialism Postcolonial studies came later to the Francophone than to the Anglophone world probably because of the trauma associated with much of French decolonization. There was also a felt need in France to come to terms with the Vichy era before turning to the almost as traumatic end of French rule in Algeria. But by the 1990s, French colonial studies were rapidly coming into vogue. The two books under review, Cultured Force, a revisionist history of the French empire that stresses a biographical approach to historical narrative, andMemory, Empire, and Postcolonialism, which publishes the proceedings of an interdisciplinary conference on cultural memory, are good examples of the varied types of writing that the rekindled interest in the French empire is spawning. “Biographical study,” the authors ofCultured Force inform their readers, “provides a relatively painless way to introduce people to an era’s subtleties,”enabling them to develop an awareness of the relativity and the contradictions of received truths, particularly those reflecting the history of modern imperialism and colonialism (p. -

Architecture of Counterrevolution the French Army
Research Collection Doctoral Thesis Architecture of Counterrevolution: The French Army in Algeria, 1954–1962 Author(s): Henni, Samia Publication Date: 2016 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-010794984 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library DISS. ETH NO. 23583 Architecture of Counterrevolution Th e French Army in Algeria, 1954–1962 Samia Henni Institute for the History and Th eory of Architecture, gta D-ARCH, ETH Zurich 2016 DISS. ETH NO. 23583 Architecture of Counterrevolution Th e French Army in Algeria, 1954–1962 A thesis submitted to attain the degree of Doctor of Sciences of ETH Zurich (Dr. sc. ETH Zurich) Presented by Samia Henni Master in Architecture, Academy of Architecture, USI, Mendrisio, 2004 Advanced Master in Architecture and Urban Planning, Berlage Institute, Rotterdam, 2010 PhD Guest Researcher in Visual Culture, Goldsmiths, University of London, 2014 Born on 09.09.1980 in Algiers, Algeria Citizen of Algeria, France and Switzerland Accepted on the recommendation of Prof. Dr. Philip Ursprung, ETH Zurich, Switzerland and Prof. Dr. Tom Avermaete, TU Delft, Th e Netherlands Prof. Dr. Jean-Louis Cohen, Institute of Fine Arts, New York University, USA 2016 4 Architecture of Counterrevolution Zusammenfassung Die vorliegende Dissertation untersucht das Zusammenwirken von französischer Kolonialpolitik und militärischen Massnahmen zur Bekämpfung der Aufstände im Hinblick auf die Architektur während der Algerischen Revolution (1954–62). Im Zuge des blutigen und langwierigen bewaff neten Konfl ikts in Algerien, teilten die französischen Zivil- und Militärbehörden, das ländliche und städtische Territorium neu ein, veränderten die gebaute Umwelt von Grund auf, errichteten in kürzester Zeit neue Infrastruktur und verfolgten eine Baupolitik, mit deren Hilfe die französische Kolonialherrschaft in Algerien erhalten werden sollte. -
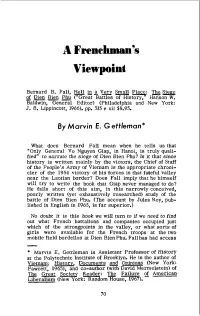
Left and Right 3 3 10.Pdf
A Frenchman's Viewpoint Bernard B. Fall, 2 Verv Small Place: The Siege ----of Dien Bien Phu ("Great Battles of ~istory," Hanson W. Baldwin. General Editor) (Philadel~hia and New York: J. B. ~ib~incott,1966). pp. 515 t xii $695. By Marvin E. G ettleman* What does Bernard Fall mean when he tells us that "Only General Vo Nguyen Giap, in Hanoi, is truly quali- fied" to narrate the siege of Dien Bien Phu? Is it that since history is written mainly by the victors, the Chief of Staff of the People's Army of Vietnam is the appropriate chroni- cler of the 1954 victory of his forces in that fateful valley near the Laotian border? Does Fall imply that he himself will try to write the book that Giap never managed to do? He falls short of this aim, in this narrowly conceived, poorly written (yet exhaustively researched) study of the battle of Dien Bien Phu. (The account by Jules Roy, pub- lished in English in 1965, is far superior.) No doubt it is this book we will turn to if we need to find out what French battalions and companies occupied just which of the strongpoints in the valley, or what sorts of girls were available for the French troops at the two mobile field bordellos at Dien Bien Phu. Fall has had access * Marvin E. Gettleman is Assistant Professor of History at the Polytechnic Institute of Brooklyn. He is the author of Vietnam: History, Documents 4Opinions (New York: Fawcete. 1965). and co-author (with David Mermelstein) of T& Great Society Reader: The Failure of American Liberalism (New York: Random ~ousm). -

Des Fusils Aux Idée: Technological Skepticism and Maculinity in the French Army, 1954–1962
Chapter 14 Des Fusils Aux Idée: Technological Skepticism and Maculinity in the French Army, 1954–1962 William Waddell The opposite of manliness isn’t cowardice; it’s technology. nassim nicholas taleb1 Président de la République Charles de Gaulle announced a debatably overdue triumph in his New Years’ address to the army in 1962. Henceforth, French arms would be dedicated to “modernization,” to a return of its units from the winding-down Algerian War, and to a reduction in effectives. Specifically, he had in view the creation of a smaller, more technologically sophisticated force, built to defend the métropole against Soviet aggression and backed by the de- terrent power of France’s relatively new force de frappe. It was unwelcome news to many who had spent their careers fighting in the “dirty wars” for France’s shrinking overseas empire, particularly the paratroops and the members of the Foreign Legion. Given the failure of the April 1961 putsch against de Gaulle, further resistance on the part of the professional troops d’outre-mer (overseas) was out of the question, though, as Le Monde journalist Jean Planchais noted at the time, their tempers remained “heated.”2 Most of this animus came, for these men, from de Gaulle’s perceived aban- donment of the empire; but, it was also rooted quite strongly in his turn to technology and to Europe. In many ways, and especially in the minds of many of the long-serving colonial professionals, these were closely related phenom- ena. De Gaulle had quite nearly said as much several years earlier at an ad- dress to l’École Militaire. -

Lire La Suite De L'article En
CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE LE 3ème REGIMENT PARACHUTISTE D’INFANTERIE DE MARINE Héritier du 3ème Bataillon colonial de commandos parachutistes créé à Saint-Brieuc en 1947, le 3ème Régiment parachutiste d’infanterie de marine s’illustre en Indochine avant d’être anéanti lors de la bataille de la Route co- loniale 4 en octobre 1950. Il renait fin 1951 et, en 1952, devient le 3ème Bataillon de parachutistes coloniaux. V Dissous en 1953, il est recréé en juin 1955 sous le nom de 3ème Régiment de parachutistes coloniaux placé sous les ordres du lieutenant-colonel Bigeard. Décoré des croix de Guerre des théâtres d’opérations extérieurs (TOE, 3 I palmes et 1 étoile de bronze) et de la Valeur militaire (2 palmes), il porte la fourragère de la croix de Guerre TOE. L L Le 1er décembre 1958, il reçoit l’ap- dans les sables du Sahel ou dans les 3ème RPIMa a tenu à honorer un de pellation de 3ème Régiment parachu- froidures des montagnes balkaniques, ses chefs les plus éminents en édifiant E tiste d’infanterie de marine (RPIMa). nos anciens nous ont montré la voie : et en dévoilant, à proximité du quar- S A l’issue de son séjour dans les dje- nous cultiverons l’esprit d’excellence, tier Laperrine, une stèle de marbre bels et les sables du Sahel, il quitte un moral de vainqueur et la vertu de rose de douze tonnes dédiée au géné- E Sidi-Ferruch (Algérie) en juillet 1962 générosité ». ral Bigeard. T pour s’installer au quartier Laperrine à Le drapeau du 3ème RPIMa porte à ce Carcassonne.