Programme Des Nations Unies Pour L'environnement Plan D'action Pour
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Technical Guidance Notes for Implementation of Regulation (EC)
1.3.2011 EN Official Journal of the European Union C 65/1 IV (Notices) NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES EUROPEAN COMMISSION COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TECHNICAL GUIDANCE NOTES FOR IMPLEMENTATION OF REGULATION (EC) No 689/2008 Publication made in accordance with Article 23 of Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 concerning the export and import of dangerous chemicals (2011/C 65/01) TABLE OF CONTENTS Page 1. INTRODUCTION . 3 2. THE ROTTERDAM CONVENTION . 5 3. REGULATION (EC) No 689/2008 . 6 3.1. Article 1: OBJECTIVES . 7 3.2. Article 2: SCOPE . 7 3.3. Article 3: DEFINITIONS . 7 3.4. Article 4: DESIGNATION OF NATIONAL AUTHORITIES . 8 3.5. Article 5: PARTICIPATION OF THE EUROPEAN UNION IN THE CONVENTION . 8 3.6. Article 6: CHEMICALS SUBJECT TO EXPORT NOTIFICATION, CHEMICALS QUALIFYING FOR PIC NOTIFICATION, AND CHEMICALS SUBJECT TO THE PIC PROCEDURE . 8 3.7. Article 7: EXPORT NOTIFICATIONS FORWARDED TO THIRD COUNTRIES . 9 3.8. Article 8: EXPORT NOTIFICATIONS FROM THIRD COUNTRIES . 11 3.9. Article 9: INFORMATION ON EXPORT AND IMPORT OF CHEMICALS . 11 3.10. Article 10: PARTICIPATION IN THE PIC NOTIFICATION PROCEDURE . 12 3.11. Article 11: INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE PIC SECRETARIAT ON CHEMICALS NOT QUALIFYING FOR PIC NOTIFICATION . 12 3.12. Article 12: OBLIGATIONS IN RELATION TO IMPORTS OF CHEMICALS . 12 3.13. Article 13: OBLIGATIONS IN RELATION TO EXPORTS OF CHEMICALS OTHER THAN EXPORT NOTIFICATION . 13 C 65/2 EN Official Journal of the European Union 1.3.2011 Page 3.14. -

Rodenticides - Kramer R.E
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND HUMAN HEALTH – Vol. I - Rodenticides - Kramer R.E. and Baker R.C. RODENTICIDES Kramer R.E. and Baker R.C. Department of Pharmacology and Toxicology, University of Mississippi Medical Center, U.S.A. Keywords: Fluoroacetate, sodium monofluoroacetate, compound 1080, fluorocitrate, fluoroacetamide, compound 1081, 1,3-difluoro-2-propanol, DFP, thiourea, α- naphthylthiourea, ANTU, pyriminil, PNU, Vacor, bromethalin, vitamin D, cholecalciferol, ergocalciferol, norbormide, scillirosides, scillirosidin, glycosides, α- chlorohydrin, thallium, phosphorus, zinc phosphide, aluminum phosphide, phosphine, strychnine, anticoagulants, brodifacoum, bromadiolone, chlorophacinone, coumachlor, difenacoum, diphencoumarin, difethialone, diphacinone, flocoumafen, pindone, warfarin, vitamin K, mechanisms of action, toxicity, treatment; antidotes Contents 1. Introduction 2. Fluoroacetate derivatives 2.1. Sodium Monofluoroacetate 2.2. Fluoroacetamide 2.3. 1,3-Difluoro-2-propanol 3. Thiourea Rodenticides 3.1. α-Naphthylthiourea (ANTU) 3.2. Pyriminil 4. Bromethalin 5. Vitamin D-based rodenticides 6. Norbormide 7. Scilliroside 8. Alpha (α)-chlorohydrin 9. Thallium 10. Yellow phosphorus 11. Zinc phosphide 12. Strychnine 13. Anticoagulant rodenticides Glossary BibliographyUNESCO – EOLSS Biographical Sketches SAMPLE CHAPTERS Summary A rodenticide is defined as any compound used to kill rodents or other small animals. They are widely used, and as a class encompass a disparate group of compounds with differing structures and mechanisms of action. -

Partial Agreement in the Social and Public Health Field
COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS (PARTIAL AGREEMENT IN THE SOCIAL AND PUBLIC HEALTH FIELD) RESOLUTION AP (85) 4 ON GUIDELINES TO REDUCE THE RISKS OF CONTAMINATION OF ANIMAL PRODUCTS FOR HUMAN CONSUMPTION BY RESIDUES WHICH MAY RESULT FROM THE USE OF PESTICIDES ON LIVESTOCK AND IN LIVESTOCK PREMISES (Adopted by the Committee of Ministers on 20 June 1985 at the 387th meeting of the Ministers' Deputies) (superseding Resolution AP (81) 2) The Representatives on the Committee of Ministers of Belgium, France, the Federal Republic of Germany, Italy, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, these states being parties to the Partial Agreement in the social and public health field, and the Representatives of Austria, Denmark, Ireland and Switzerland, states which have participated in the public health activities pursued within the above-mentioned Partial Agreement since 1 October 1974, 2 April 1968, 23 September 1969 and 5 May 1964, respectively, Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members and that this aim may be pursued by common action in the social and public health field; Having regard to the provisions of the Brussels Treaty, signed on 17 March 1948, by virtue of which Belgium, France, Luxembourg, the Netherlands and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland declared themselves resolved to strengthen the social ties by which they were already united; Having regard to the Protocol modifying and completing the Brussels -

ANALGESIC EFFECTS of SCILLIROSIDE, PROSCILLARIDIN-A and TAXIFOLIN from SQUILL BULB (Urginea Maritima) on PAINS
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 5, No 2, May 2010, p. 457 – 465 ANALGESIC EFFECTS of SCILLIROSIDE, PROSCILLARIDIN-A and TAXIFOLIN FROM SQUILL BULB (Urginea maritima) on PAINS VAHDETTİN BAYAZİT*, VAHİT KONARa Muş Alparslan University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, 49100, Muş, Turkey aFırat University, Faculty of Sciences and Arts, Department of Biology, Elazığ,Turkey The aim of the present study was to assess the clinical efficacy of proscillaridin-A (C30H42O8), taxifolin (C15H12O7) and scilliroside ( C32H44O12 ) and safety of squill bulb (Urginea maritima) (L.) Baker extract on various pains of spontaneous volunteer patients. In this study, 250 patients were monitored in coats. The average age of these patients were between 40 and 74 years old. Of these 100 were male and 150 female patients. Also, 60 % of proscillaridin-A (C30H42O8), taxifolin (C15H12O7) and scilliroside ( C32H44O12 ) solution in pure glycerin was applied as external on the pain area.ASO, CRP and RF higher values of patiens were significantly decreased ( p < 0.05 and p < 0.01). Knee, joint, calf, hip, shoulder, upper back, low back (lumbago), tailbone and fibromyalgia paints of patients were significantly reduced (p < 0.05 and p < 0.01).Squill bulb constituents can reduce the musculoskeletal pains. (Received May 7, 2010; accepted May 14, 2010) Keywords: Squill bulb (Urginea maritima) (L.) Baker, scilliroside, taxifolin, proscillaridin-A, lumbago, fibromyalgia, pain 1. Introductıon Urginea maritima (Liliaceae) is cultivated in the Mediterranean area. It is used as a cardiotonic diuretic in Europe for the treatment of cardiac marasmus and edema. Squill (white sea onion) is a cardiotonic similar to digitalis. -
(12) Patent Application Publication (10) Pub. No.: US 2017/0208806 A1 Barton Et Al
US 20170208806A1 (19) United States (12) Patent Application Publication (10) Pub. No.: US 2017/0208806 A1 Barton et al. (43) Pub. Date: Jul. 27, 2017 (54) MOLECULES HAVING PESTICIDAL Publication Classification UTILITY, AND INTERMEDIATES, (51) Int. Cl. COMPOSITIONS, AND PROCESSES, AOIN 4I/O (2006.01) RELATED THERETO AOIN 37/34 (2006.01) AOIN 37/20 (2006.01) (71) Applicant: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, C07C 31 7/28 (2006.01) IN (US) C07C32L/4 (2006.01) (52) U.S. Cl. (72) Inventors: Thomas Barton, Indianapolis, IN (US); CPC ............ A0IN 41/10 (2013.01); C07C317/28 Xin Gao, Carmel, IN (US); Jim (2013.01); C07C321/14 (2013.01); A0IN Hunter, Indianapolis, IN (US); Paul R. 37/20 (2013.01); A0IN 37/34 (2013.01) LePlae, Brownsburg, IN (US); William (57) ABSTRACT C. Lo, Fishers, IN (US); Joshodeep This disclosure relates to the field of molecules having Boruwa, Noida, IN (US); Raghuram pesticidal utility against pests in Phyla Arthropoda, Mol Tangirala, Bengaluru, IN (US); Gerald lusca, and Nematoda, processes to produce Such molecules, B. Watson, Zionsville, IN (US); John intermediates used in Such processes, compositions contain Herbert, Fishers, IN (US) ing Such molecules, and processes of using Such molecules and compositions against Such pests. These molecules and compositions may be used, for example, as acaricides, (73) Assignee: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, insecticides, miticides, molluscicides, and nematicides. This IN (US) document discloses molecules having the following formula (“Formula One”). (21) Appl. No.: 15/408,693 (22) Filed: Jan. 18, 2017 Related U.S. Application Data (60) Provisional application No. 62/286.684, filed on Jan. -
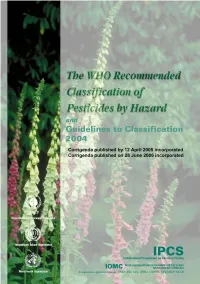
The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification : 2004
WHO Library Cataloguing-in-Publication Data World Health Organization. The WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification : 2004. 1.Pesticides - toxicity 2.Pesticides - classification 3.Hazardous substances - classification 4.Guidelines I.International Programme on Chemical Safety..II.Title. ISBN 92 4 154663 8 (NLM classification: WA 240) ISSN 1684-1042 © World Health Organization 2005 All rights reserved. Publications of the World Health Organization can be obtained from Marketing and Dissemination, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland (tel: +41 22 791 2476; fax: +41 22 791 4857; email: [email protected]). Requests for permission to reproduce or translate WHO publications – whether for sale or for noncommercial distribution – should be addressed to Marketing and Dissemination, at the above address (fax: +41 22 791 4806; email: [email protected]). The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. The mention of specific companies or of certain manufacturers’ products does not imply that they are endorsed or recommended by the World Health Organization in preference to others of a similar nature that are not mentioned. Errors and omissions excepted, the names of proprietary products are distinguished by initial capital letters. All reasonable precautions have been taken by WHO to verify the information contained in this publication. -
![W©IR<[L[Q) [F{][E~Lll~ (Q)OO~[M~~U~Cawj](https://docslib.b-cdn.net/cover/0275/w%C2%A9ir-l-q-f-e-lll-q-oo-m-u-cawj-6830275.webp)
W©IR<[L[Q) [F{][E~Lll~ (Q)OO~[M~~U~Cawj
WHO!VBC/87.949 W©IR<[L[Q) [F{][E~lLl~ (Q)OO~[M~~u~cawJ ~®©it(Q)1F ~O(Q)~~ ~!T1lcdl CCootl:rnij [Q)n~o~n(Q)!1i), , ., 1987 FOREWORD Since 1970 the Vector Biology and Control Division of WHO has. prepared, with the assistance of collaborators outside the Organization, a number of papers on vector control. The Expert Committee on Insecticides held in October 1974 (Technical Report Series No. 561) recommended that these documents - general reviews of the ecology and control of individual vector groups - should be continued and reviewed from time to time to provide workers with up-to-date practical information on the particular subject. In 1985, with the greater demand for this material for use as training and information guides by different categories of personnel. particularly in the deVeloping countries, it was decided to develo(J two separate series of these documents; an advanced series for M. Sc. students in medical entomology and professional staff, and a middle-level series for less specialized workers in the community. The advanced series will cover the relevant subject in more detail and at a higher technical level. It is believed that this type of information will assist vector control specialists to acquire the knowledge required for their daily work. In order to improve the value and usefulness of this guide, evaluation forms are attaChed, and users are requested to send the completed forms to the WHO Division of Vector Biology and Control in Geneva so that their comments may be taken into consideration when the guide is revised. -

US 2018 / 0325105 A1 Nov
US 20180325105A1 ( 19) United States (12 ) Patent Application Publication (10 ) Pub. No. : US 2018 /0325105 A1 VADAKEKUTTU et al. ( 43 ) Pub . Date : Nov. 15 , 2018 ( 54 ) AGRICULTURAL COMPPOSITIONS (52 ) U .S . CI. CPC .. .. .. .. AOIN 25 / 12 ( 2013 .01 ) ; C05D 9 / 00 ( 71 ) Applicants : Thankapan VADAKEKUTTU , (2013 . 01 ) ; C05G 3 / 02 ( 2013 .01 ) ; C05G Mumbai ( IN ) ; Arun Vitthal SAWANT, 370058 ( 2013 . 01 ) Mumbai ( IN ) ( 57 ) ABSTRACT The invention relates to an agricultural water disintegrable (72 ) Inventors : Thankapan VADAKEKUTTU , granular composition . More particularly , the invention Mumbai ( IN ) ; Arun Vitthal SAWANT, relates to a water disintegrable granular composition , where Mumbai ( IN ) the granules include at least one water insoluble crop nutrient or or algae or pesticidal active ingredient , and one ( 21 ) Appl . No . : 15 / 976 , 304 or more agrochemically acceptable excipient, whereby the granules have a bulk density of less than 1 . 5 gm /ml and hardness of at least 1 Newton . The invention further relates ( 22 ) Filed : May 10 , 2018 to a water disintegrable granular composition which includes at least one algae and at least one agrochemically ( 30 ) Foreign Application Priority Data acceptable excipient wherein granules have particles in the size range of 0 . 1 micron - 50 microns , granule size is in the May 10 , 2017 ( IN ) .. .. .. .. .. .. .. 201721016449 range of 0 . 1 mm to 6 mm and attrition resistance of the Jun . 21 , 2017 ( IN ) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 201721021720 granules are at least 50 % . Jul. 11 , 2017 ( IN ) .. .. .. .. .. 201721024425 Furthermore , the invention relates to a process of preparing Sep . 18 , 2017 ( IN ) . .. .. .. .. .. .. .. PCT / IN2017 /050408 the water disintegrable granular composition including one or more water insoluble crop nutrients or algae or the pesticidal active ingredients . -

Substance Number Common Name Chemical Name CAS DOT SHHC
2010 Right to Know Hazardous Substance List CAS Substance Common Name CAS Number Order DOT SHHC Sources Number Chemical Name 50-00-0 0946 # FORMALDEHYDE 1198 CA CO MU F4 1 2 3 4 5 6 7 8 15 17 18 19 20 FORMALDEHYDE 21 22 50-07-7 1307 # MITOMYCIN C 3077 CA 3 6 7 17 19 20 21 AZIRINO[2',3':3,4]PYRROLO[1,2-a]INDOLE-4,7-DIONE, 6-AMINO-8-[[(AMINOCARBONYL)OXY]METHYL]-1,1a,2,8,8a,8b- HEXAHYDRO-8a-METHOXY-5-METHYL-,(1aS,8S,8aR,8bS)- 50-14-6 2391 ERGOCALCIFEROL 2811 3 6 17 19 9,10-SECOERGOSTA-5,7,10(19),22-TETRAEN-3-OL, (3.beta.,5Z,7E,22E)- 50-29-3 0596 # DDT 2761 CA TE 1 2 3 4 5 6 7 8 17 20 21 BENZENE, 1,1'-(2,2,2-TRICHLOROETHYLIDENE)BIS[4-CHLORO- 50-31-7 1776 2,3,6-TBA 2769 3 14 17 BENZOIC ACID, 2,3,6-TRICHLORO- 50-32-8 0207 # BENZO(a)PYRENE 3077 CA MU 1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 20 21 BENZO[a]PYRENE 51-03-6 3732 PIPERONYL BUTOXIDE 6 18 1,3-BENZODIOXOLE, 5-[[2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHOXY]METHYL]-6-PROPYL- 51-21-8 1966 # 5-FLUOROURACIL TE 6 7 18 19 2,4(1H,3H)-PYRIMIDINEDIONE, 5-FLUORO- 51-28-5 2950 # 2,4-DINITROPHENOL 1320 R4 3 6 8 17 18 20 21 PHENOL, 2,4-DINITRO- Page 1 of 268 2010 Right to Know Hazardous Substance List CAS Substance Common Name CAS Number Order DOT SHHC Sources Number Chemical Name 51-75-2 1377 # NITROGEN MUSTARD 2810 CA MU TE 3 6 7 17 18 19 ETHANAMINE, 2-CHLORO-N-(2-CHLOROETHYL)-N-METHYL- 51-79-6 1986 # URETHANE 3077 CA MU TE 3 5 6 7 8 17 18 20 21 22 CARBAMIC ACID, ETHYL ESTER 51-83-2 2209 CARBACHOL CHLORIDE 6 19 ETHANAMINIUM, 2-[(AMINOCARBONYL)OXY]-N,N,N-TRIMETHYL-, CHLORIDE 52-24-4 1515 # TRIS(1-AZIRIDINYL)PHOSPHINE SULFIDE CA 5 7 AZIRIDINE, -

The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard Was Approved by the 28Th World Health Assembly in 1975 and Has Since Gained Wide Acceptance
WRO/PCS/96..3 ENGLISH ONLY I)istr.: LIMITED IPCS Internationat Programme on Chemical Safety THE WHO RECOMMENDED CLASSIFICATION OF PESTICIDES BY HAZARD and GUIDELINES TO CLASSIFICATION 1996-1997 United NatioasEiyizirnment Programme International Labour Organization World Health Organization Programme des Nations Unies pour Bureau international dii Trarnil Organisation Mondiale de In Sante I'Fnvironnemen( WHO/PCS/96. 3 ENGLISH ONLY Distr,: ENGLISH THE)~ HQ RECOMMENDED CLASSIFICATION OF PESTICIDES BY HAZARD and GUIDELINES TO CLASSIFICATION 1996-97 LI01iIIIW1(•i The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard was approved by the 28th World Health Assembly in 1975 and has since gained wide acceptance. When it was published in the WHO Chronicle, 22 , 397-401 (1975), an annex, which was not part of the Classification, illustrated its use by listing examples of classification of some pesticidal active ingredients and their formulations. Later suggestions were made by Member States and pesticide registration authorities that further guidance should be given on the classification of individual pesticides. Guidelines were first issued in 1978, and have since been revised and reissued at 2-yearly intervals. The document is arranged as follows: Part I: The Classification as recommended by the World Health Assembly. This part is not subject to periodic review and the classification table and text can only be changed by resolution of the World Health Assembly. Part II: Guidelines to Classification. Individual products are classified in a series of tables, according to the oral or dermal toxicity of the technical product, and its physical state. The tables are subject to review periodically. The toxicity values are intended to be a guide only. -

A Novel Mutation in VKORC1 and Its Effect on Enzymatic Activity in Japanese Warfarin-Resistant Rats
Advance Publication The Journal of Veterinary Medical Science Accepted Date: 8 Sep 2012 J-STAGE Advance Published Date: 26 Sep 2012 Field of paper: toxicology Type of paper: full paper A novel mutation in VKORC1 and its effect on enzymatic activity in Japanese warfarin-resistant rats Kazuyuki D. Tanaka1), Yusuke K. Kawai1), Yoshinori Ikenaka1), Tsunehito Harunari2), Tsutomu Tanikawa2), Shoichi Fujita1), and Mayumi Ishizuka1), 1)Laboratory of Toxicology, Department of Environmental Veterinary Sciences, Graduate School of Veterinary Medicine, Hokkaido University, Kita-18 Nishi-9, Kita-ku, Sapporo 060-0818, Japan 2)Technical Research laboratory, Ikari Corporation, Chiba, 260-0844, Japan Corresponding author: Dr. Mayumi Ishizuka, Laboratory of Toxicology, Department of Environmental Veterinary Sciences, Graduate School of Veterinary Medicine, Hokkaido University, Kita-18 Nishi-9, Kita-ku, Sapporo 060-0818, Japan, Tel:81-11-706-6949 / Fax:81-11-706-5105 e-mail: [email protected] Running head: VKOR OF WARFARIN RESISTANT RATS IN JAPAN 1 ABSTRACT Warfarin is a rodenticide commonly used worldwide. It inhibits coagulation of blood by inhibiting vitamin K 2,3-epoxide reductase (VKOR) activity. An inadequate supply of vitamin K blocks the production of prothrombin and causes hemorrhage. Recently, warfarin-resistant brown rats (Rattus norvegicus) were found around the Aomori area of Japan. There is no significant difference in the metabolic activity of warfarin in sensitive and resistant brown rats. To clarify the mechanism underlying warfarin resistance, we cloned the VKORC1 gene from rats and identified a novel substitution of arginine to proline at position 33 of the VKORC1 amino acid sequence. Then, we determined the differences in kinetics of VKOR activity between warfarin-resistant and sensitive rats. -

Practice No. 5 Rodenticides
Practice No. 5 Rodenticides Rodenticides: • Rodenticides are a group of pesticides which is primarily established for rodent control • There are strict rules how, when and where to use them. In spite of this they are common source of both wild and domestic animals´ poisoning and are also used for malicious intentions to harm • Poisoning is quite easy when baits with rodenticides are placed inconveniently at locations easily accessible for domestic animals esp. dogs and cats • In these animals is also possible to poison themselves by eating a dead rodent which died of rodenticide poisoning – so called secondary poisoning Division of rodenticides: • according to chemical character: - inorganic – zinc phosphide (and other phosphides), formerly arsenic or thallium - organic – natural (strychnine, scilliroside, vitamin D), synthetic (anticoagulants) • according to the route of administration: for eating, for drinking, for dusting, for fumigation • according to the type of action: one dose, cumulative/repetitive intake Zinc phosphide + aluminium phosphide • Phosphides are the only inorganic and single-shot used agents nowadays. Their use is in agriculture, they are not allowed in households. • They are very potent and absolutely non-selective and cause many accidental poisonings • Zinc phosphide is used as feed bait and aluminium phosphide is fumigated in closed spaces (stocks, stores). • Feed baits are made of grains impregnated by zinc phosphide or they are granules with active substance. Usually are not colourful! • Often cause poisonings