Ascomycota Lichénisés, P
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

BLS Bulletin 111 Winter 2012.Pdf
1 BRITISH LICHEN SOCIETY OFFICERS AND CONTACTS 2012 PRESIDENT B.P. Hilton, Beauregard, 5 Alscott Gardens, Alverdiscott, Barnstaple, Devon EX31 3QJ; e-mail [email protected] VICE-PRESIDENT J. Simkin, 41 North Road, Ponteland, Newcastle upon Tyne NE20 9UN, email [email protected] SECRETARY C. Ellis, Royal Botanic Garden, 20A Inverleith Row, Edinburgh EH3 5LR; email [email protected] TREASURER J.F. Skinner, 28 Parkanaur Avenue, Southend-on-Sea, Essex SS1 3HY, email [email protected] ASSISTANT TREASURER AND MEMBERSHIP SECRETARY H. Döring, Mycology Section, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB, email [email protected] REGIONAL TREASURER (Americas) J.W. Hinds, 254 Forest Avenue, Orono, Maine 04473-3202, USA; email [email protected]. CHAIR OF THE DATA COMMITTEE D.J. Hill, Yew Tree Cottage, Yew Tree Lane, Compton Martin, Bristol BS40 6JS, email [email protected] MAPPING RECORDER AND ARCHIVIST M.R.D. Seaward, Department of Archaeological, Geographical & Environmental Sciences, University of Bradford, West Yorkshire BD7 1DP, email [email protected] DATA MANAGER J. Simkin, 41 North Road, Ponteland, Newcastle upon Tyne NE20 9UN, email [email protected] SENIOR EDITOR (LICHENOLOGIST) P.D. Crittenden, School of Life Science, The University, Nottingham NG7 2RD, email [email protected] BULLETIN EDITOR P.F. Cannon, CABI and Royal Botanic Gardens Kew; postal address Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB, email [email protected] CHAIR OF CONSERVATION COMMITTEE & CONSERVATION OFFICER B.W. Edwards, DERC, Library Headquarters, Colliton Park, Dorchester, Dorset DT1 1XJ, email [email protected] CHAIR OF THE EDUCATION AND PROMOTION COMMITTEE: S. -
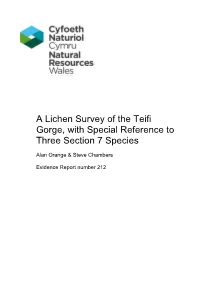
A Lichen Survey of the Teifi Gorge, with Special Reference to Three Section 7 Species
A Lichen Survey of the Teifi Gorge, with Special Reference to Three Section 7 Species Alan Orange & Steve Chambers Evidence Report number 212 Report series: Evidence Reports Report number: 212 Publication date: May 2017 Contract number: P21018-0023 Contractor: A Orange Contract Manager: SDS Bosanquet Title: A Lichen Survey of the Teifi Gorge, with Special Reference to Three Section 7 Species Author(s): A. Orange, S.P. Chambers Technical Editor: Peer Reviewer(s) SDS Bosanquet Approved By: Restrictions: None Distribution List (core) NRW Library, Bangor 2 National Library of Wales 1 British Library 1 Welsh Government Library 1 Scottish Natural Heritage Library 1 Natural England Library (Electronic Only) 1 Recommended citation for this volume: Orange, A., Chambers, S.P. 2017 A Lichen Survey of the Teifi Gorge, with Special Reference to Three Section 7 Species. NRW Evidence Reports 212. www.naturalresourceswales.gov.uk 1 Contents 1. Crynodeb Gweithredol ......................................................................................... 3 2. Executive Summary ............................................................................................. 4 3. Introduction .......................................................................................................... 5 4. Methods ................................................................................................................ 5 5. Results .................................................................................................................. 6 5.1. General -

Piedmont Lichen Inventory
PIEDMONT LICHEN INVENTORY: BUILDING A LICHEN BIODIVERSITY BASELINE FOR THE PIEDMONT ECOREGION OF NORTH CAROLINA, USA By Gary B. Perlmutter B.S. Zoology, Humboldt State University, Arcata, CA 1991 A Thesis Submitted to the Staff of The North Carolina Botanical Garden University of North Carolina at Chapel Hill Advisor: Dr. Johnny Randall As Partial Fulfilment of the Requirements For the Certificate in Native Plant Studies 15 May 2009 Perlmutter – Piedmont Lichen Inventory Page 2 This Final Project, whose results are reported herein with sections also published in the scientific literature, is dedicated to Daniel G. Perlmutter, who urged that I return to academia. And to Theresa, Nichole and Dakota, for putting up with my passion in lichenology, which brought them from southern California to the Traingle of North Carolina. TABLE OF CONTENTS Introduction……………………………………………………………………………………….4 Chapter I: The North Carolina Lichen Checklist…………………………………………………7 Chapter II: Herbarium Surveys and Initiation of a New Lichen Collection in the University of North Carolina Herbarium (NCU)………………………………………………………..9 Chapter III: Preparatory Field Surveys I: Battle Park and Rock Cliff Farm……………………13 Chapter IV: Preparatory Field Surveys II: State Park Forays…………………………………..17 Chapter V: Lichen Biota of Mason Farm Biological Reserve………………………………….19 Chapter VI: Additional Piedmont Lichen Surveys: Uwharrie Mountains…………………...…22 Chapter VII: A Revised Lichen Inventory of North Carolina Piedmont …..…………………...23 Acknowledgements……………………………………………………………………………..72 Appendices………………………………………………………………………………….…..73 Perlmutter – Piedmont Lichen Inventory Page 4 INTRODUCTION Lichens are composite organisms, consisting of a fungus (the mycobiont) and a photosynthesising alga and/or cyanobacterium (the photobiont), which together make a life form that is distinct from either partner in isolation (Brodo et al. -
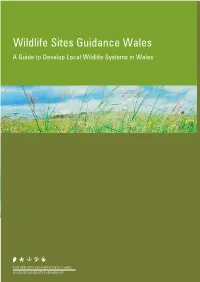
Sites of Importance for Nature Conservation Wales Guidance (Pdf)
Wildlife Sites Guidance Wales A Guide to Develop Local Wildlife Systems in Wales Wildlife Sites Guidance Wales A Guide to Develop Local Wildlife Systems in Wales Foreword The Welsh Assembly Government’s Environment Strategy for Wales, published in May 2006, pays tribute to the intrinsic value of biodiversity – ‘the variety of life on earth’. The Strategy acknowledges the role biodiversity plays, not only in many natural processes, but also in the direct and indirect economic, social, aesthetic, cultural and spiritual benefits that we derive from it. The Strategy also acknowledges that pressures brought about by our own actions and by other factors, such as climate change, have resulted in damage to the biodiversity of Wales and calls for a halt to this loss and for the implementation of measures to bring about a recovery. Local Wildlife Sites provide essential support between and around our internationally and nationally designated nature sites and thus aid our efforts to build a more resilient network for nature in Wales. The Wildlife Sites Guidance derives from the shared knowledge and experience of people and organisations throughout Wales and beyond and provides a common point of reference for the most effective selection of Local Wildlife Sites. I am grateful to the Wales Biodiversity Partnership for developing the Wildlife Sites Guidance. The contribution and co-operation of organisations and individuals across Wales are vital to achieving our biodiversity targets. I hope that you will find the Wildlife Sites Guidance a useful tool in the battle against biodiversity loss and that you will ensure that it is used to its full potential in order to derive maximum benefit for the vitally important and valuable nature in Wales. -

Lichens of Atlantic Woodlands
23163_Parmelion_1_12:Layout 1 3/12/08 09:42 Page 1 Key features for identification of lichens in this guide Cilia on Parmotrema perlatum The use of a hand lens (preferably x10 magnification) is recommended to examine and appreciate 3 OTHER SHRUBBY SPECIES 3.2 Hair lichens (Bryoria species) 4 CRUSTOSE SPECIES some of the key features of the lichens in this guide. A (x10) in the text indicates when a hand lens 3.1 Beard lichens (Usnea species) is necessary. Colour The colour of upper (and if visible the lower) surface can be variable between wet and dry states. Usnea filipendula Fishbone beard lichen Bryoria fuscescens Horsehair lichen Ochrolechia androgyna A cudbear lichen Orchrolehia tartarea A cudbear lichen Growth form of the thallus (the main body of the lichen) Leafy (foliose): thallus consists of leafy lobes. Shrubby (fruticose): thallus often tufted; composed of narrow cylindrical, or flattened strap-shaped Fruits on Ochrolechia tartarea branches. Crustose: thallus is a crust that may be thin, thick, smooth, wrinkled, powdery, granular or cracked like dried mud. Crustose species are adpressed (closely pressed) to the substrate. Some species have concentric growth rings at the margin. LICHENS OF ATLANTIC Features that may be present on the upper surface Cilia: wiry black hairs on the upper surface or lobe margins. WOODLANDS Fruits: sexual reproductive structures that produce spores. They can be round discs, pimple-like or globular. They can be brownish, pinkish, orange-brown or black, and may have a margin that is the Guide 2: Lichens on birch, alder and oak same colour as the thallus (a thalline margin). -

Implications of Climate Change for UK Bryophytes and Lichens
Ellis Bryophytes & Lichens Biodiversity Report Card Paper 8 2015 Biodiversity Climate change impacts repord card technical paper 8. Implications of climate change for UK bryophytes and lichens Christopher Ellis Royal Botanic Garden Edinburgh, 20A Inverleith Row, Edinburgh, EH3 5LR Email: [email protected] 1 Ellis Bryophytes & Lichens Biodiversity Report Card Paper 8 2015 EXECUTIVE SUMMARY This Technical Report: 1. Introduces the biology and conservation status of bryophytes and lichens, and our state of knowledge in their distribution (Section 1). 2. Matches species distributions in the British bryophyte and lichen flora to bioclimatic models applied to vascular plants, validating this comparison via cross-referencing against bioclimatic models specifically applied to case-study bryophytes and lichens (Section 2.1). 3. Compares the outcomes of predictive modelling to direct evidence for species range shifts (Section 2.2). 4. Examines climate impacts at a habitat scale, focussing on ecosystems in which bryophytes and lichens are important components of the vegetation (Section 3). The key findings are as follows: 1. Bryophytes and lichens are poikilohydric organisms and are particularly sensitive to microclimatic variation, with local microhabitats providing a buffer which may weaken direct sensitivity to macroclimatic change. 2. Nevertheless, a number of species have range edges in their British distribution, which is predicted by their global biogeography and is strongly suggestive of macroclimatic sensitivity. In addition, certain bryophyte and lichen species are important to the ecosystem function of habitats which are climate dependent, e.g. blanket bogs. 3. There is emerging evidence for a direct bryophyte and lichen response to human-induced climate change with a number of species shifting their range northwards (Medium Agreement, Limited Evidence); however, these shifts must be cautiously interpreted against changes in the pollution regime and land management. -

Systematique Et Ecologie Des Lichens De La Region D'oran
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE FACULTE des SCIENCES de la NATURE et de la VIE Département de Biologie THESE Présentée par Mme BENDAIKHA Yasmina En vue de l’obtention Du Diplôme de Doctorat en Sciences Spécialité : Biologie Option : Ecologie Végétale SYSTEMATIQUE ET ECOLOGIE DES LICHENS DE LA REGION D’ORAN Soutenue le 27 / 06 / 2018, devant le jury composé de : Mr BELKHODJA Moulay Professeur Président Université d’Oran 1 Mr HADJADJ - AOUL Seghir Professeur Rapporteur Université d'Oran 1 Mme FORTAS Zohra Professeur Examinatrice Université d’Oran 1 Mr BELAHCENE Miloud Professeur Examinateur C. U. d’Ain Témouchent Mr SLIMANI Miloud Professeur Examinateur Université de Saida Mr AIT HAMMOU Mohamed MCA Invité Université de Tiaret A la Mémoire De nos Chers Ainés Qui Nous ont Ouvert la Voie de la Lichénologie Mr Ammar SEMADI, Professeur à la Faculté des Sciences Et Directeur du Laboratoire de Biologie Végétale et de l’Environnement À l’Université d’Annaba Mr Mohamed RAHALI, Docteur d’État en Sciences Agronomiques Et Directeur du Laboratoire de Biologie Végétale et de l’Environnement À l’École Normale Supérieure du Vieux Kouba – Alger REMERCIEMENTS Au terme de cette thèse, je tiens à remercier : Mr HADJADJ - AOUL Seghir Professeur à l’Université d’Oran 1 qui m’a encadré tout au long de ce travail en me faisant bénéficier de ses connaissances scientifiques et de ses conseils. Je tiens à lui exprimer ma reconnaissance sans bornes, Mr BELKHODJA Moulay Professeur à l’Université d’Oran 1 et lui exprimer ma gratitude -

Corrections and Additions to the North Carolina, USA Lichen Checklist
126 EVANSIA EVANSIA Corrections and Additions to the North Carolina, USA Lichen Checklist Gary B. Perlmutter1 and Douglas N. Greene2 In response to the recently published North Carolina lichen checklist (Perlmutter 2005), a few errors were noticed and many citings of literature reports documenting additional taxa have been brought to our attention. Therefore, corrections to these errors and a supplemental checklist are here presented to clarify the checklist and make it more complete. An additional 128 lichen taxa are here reported for the state (Table 1) with two removed as not occurring in North America, bringing the total to 731. Corrections -- Corrections to the checklist are listed below: 1. The Global Biodiversity Information Facility (GBIF) references were not fully cited. These are for three taxa: Collema callibotrys, Pertusaria propinqua and P. rubefacta. Their full citations are: Collema callibotrys: GBIF Data Portal, www.gbif.net. 2005-08-03. Collema callibotrys Tuck.; United States. GBIF-Sweden Provider, Lichens (S), 1 record from North Carolina. Pertusaria propinqua: GBIF Data Portal, www.gbif.net. 2005-08-03. Pertusaria propinqua Müll. Arg.; United States. International Institute for Sustainability (ASU) DiGIR Provider, Arizona State University Lichen Herbarium, 2 records from North Carolina. Pertusaria rubefacta: GBIF Data Portal, www.gbif.net. 2005-08-03. Pertusaria rubefacta Erichsen; United States. International Institute for Sustainability (ASU) DiGIR Provider, Arizona State University Lichen Herbarium, 1 record from North Carolina. 1 North Carolina Botanical Garden, The University of North Carolina at Chapel Hill, CB 3375, Totten Center, Chapel Hill NC 27599-3375; e-mail: [email protected] 2 31 Cape Cod Avenue, Reading, MA 01867; e-mail: [email protected] 127 Volume 22 (4) 2. -

The Lichens of the Alps – an Annotated Checklist
A peer-reviewed open-access journal MycoKeys 31: 1–634 (2018) The lichens of the Alps - an annotated checklist 1 doi: 10.3897/mycokeys.31.23658 MONOGRAPH MycoKeys http://mycokeys.pensoft.net Launched to accelerate biodiversity research The lichens of the Alps – an annotated checklist Pier Luigi Nimis1, Josef Hafellner2, Claude Roux3, Philippe Clerc4, Helmut Mayrhofer2, Stefano Martellos1, Peter O. Bilovitz2 1 Department of Life Sciences, University of Trieste, Via L. Giorgieri 10, 34127 Trieste, Italy 2 Institute of Plant Sciences, NAWI Graz, University of Graz, Holteigasse 6, 8010 Graz, Austria 3 Chemin des Vignes- Vieilles, 84120 Mirabeau, France 4 Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, 1 chemin de l’Impératrice, 1292 Chambésy/GE, Switzerland Corresponding author: Helmut Mayrhofer ([email protected]) Academic editor: H.T. Lumbsch | Received 11 January 2018 | Accepted 6 February 2018 | Published 12 March 2018 Citation: Nimis PL, Hafellner J, Roux C, Clerc P, Mayrhofer H, Martellos S, Bilovitz PO (2018) The lichens of the Alps – an annotated checklist. MycoKeys 31: 1–634. https://doi.org/10.3897/mycokeys.31.23568 Abstract This is the first attempt to provide an overview of the lichen diversity of the Alps, one of the biogegraphi- cally most important and emblematic mountain systems worldwide. The checklist includes all lichenised species, plus a set of non- or doubtfully lichenised taxa frequently treated by lichenologists, excluding non- lichenised lichenicolous fungi. Largely based on recent national or regional checklists, it provides a list of all infrageneric taxa (with synonyms) hitherto reported from the Alps, with data on their distribution in eight countries (Austria, France, Germany, Liechtenstein, Monaco, Italy, Slovenia, Switzerland) and in 42 Operational Geographic Units, mostly corresponding to administrative subdivisions within the countries. -

Checklist of Georgia Lichens
Georgia Lichen Atlas Project Arthonia degelii Buellia caloosensis p Caloplaca granularis Arthonia interveniens Buellia curtisii Caloplaca holocarpa CHECKLIST Arthonia macrotheca Buellia elizae Caloplaca pollinii Arthonia montagnei Buellia imshaugiana Caloplaca saxicola of GEORGIA Arthonia quintaria Buellia lauricassiae Candelaria concolor Arthonia ruana Buellia maculata Candelaria fibrosa LICHENS Arthonia rubella Buellia mamillana Candelariella reflexa Arthopyrenia lyrata Buellia punctata Canoparmelia amazonica *non-lichenized, parasitic or lichenicolous fungus Arthrothelium spectabile Buellia spuria Canoparmelia caroliniana pprovisional status Aspicilia cinerea Buellia stillingiana Canoparmelia crozalsiana Date: Aspicilia contorta Buellia vernicoma Canoparmelia cryptochlorophaea Aspicilia verrucigera Buellia wheeleri Canoparmelia salacinifera Location: Aspicilia caesiocinerea Buelliella trypethelii* Canoparmelia texana Bacidia circumspecta Bulbothrix confoederata Carbonea latypizodes Lat/Long: Bacidia crenulata Bulbothrix goebelii Catillaria chalybeia Abrothallus cladoniae Bacidia diffracta Bulbothrix isidiza Cetradonia linearis Acarospora badiofusca Bacidia granosa Bulbothrix laevigatula Cetrelia chicitae Acarospora dispersa Bacidia heterochroa Byssoloma leucoblepharum Cetrelia olivetorum Acarospora fuscata Bacidia polychroa Byssoloma pubescens Chaenotheca brunneola Acarospora obpallens Bacidia rubella Calicium abietinum Chaenotheca furfuracea Agonimia opuntiella Bacidia schweinitzii Calicium glaucellum Chrysothrix flavovirens Ahtiana -

Bibliografía Botánica Del Caribe I
Consolidated bibliography Introduction To facilitate the search through the bibliographies prepared by T. Zanoni (Bibliographía botánica del Caribe, Bibliografía de la flora y de la vegetatíon de la isla Española, and the Bibliography of Carribean Botany series currently published in the Flora of Greater Antilles Newsletter), the html versions of these files have been put together in a single pdf file. The reader should note the coverage of each bibliography: Hispaniola is exhaustively covered by all three bibliographies (from the origin up to now) while other areas of the Carribean are specifically treated only since 1984. Please note that this pdf document is made from multiple documents, this means that search function is called by SHIFT+CTRL+F (rather than by CTRL+F). Please let me know of any problem. M. Dubé The Jardín Botánico Nacional "Dr. Rafael M. Moscoso," Santo Domingo, Dominican Republic, publishers of the journal Moscosoa, kindly gave permission for the inclusion of these bibliographies on this web site. Please note the present address of T. Zanoni : New York Botanical Garden 200th Street at Southern Blvd. Bronx, NY 10458-5126, USA email: [email protected] Moscosoa 4, 1986, pp. 49-53 BIBLIOGRAFÍA BOTÁNICA DEL CARIBE. 1. Thomas A. Zanoni Zanoni. Thomas A. (Jardín Botánico Nacional, Apartado 21-9, Santo Domingo, República Dominicana). Bibliografía botánica del Caribe. 1. Moscosoa 4: 49-53. 1986. Una bibliografía anotada sobre la literatura botánica publicada en los años de 1984 y 1985. Se incluyen los temas de botánica general y la ecología de las plantas de las islas del Caribe. An annotated bibliography of the botanical literature published in 1984 and 1985, covering all aspects of botany and plant ecology of the plants of the Caribbean Islands. -

Lichens of Atlantic Woodlands in the Lake District
5 IS THE LICHEN BEARD-LIKE, HAIR-LIKE OR STRAP-LIKE? 6 IS THE LICHEN CRUSTY, LUMPY OR PORRIDGE-LIKE? We are Plantlife Some key features to Cilia on Parmotrema perlatum For over 25 years, Plantlife has had a single look for when identifying lichens Usnea subfloridana Beard lichen Bryoria fuscescens Horsehair lichen Ochrolechia androgyna A cudbear lichen Ochrolechia tartarea A cudbear lichen ideal – to save and celebrate wild flowers, plants and fungi. They are the life support Use a hand lens (preferably x10 for all our wildlife and their colour and magnification) to examine them. character light up our landscapes. But without our help, this priceless natural Cilia Wiry black hairs on the upper heritage is in danger of being lost. surface or lobe margins. Fruits on Ochrolechia tartarea From the open spaces of our nature reserves Colour Of upper (and if visible, the lower) surface. The colour of a species to the corridors of government, we work can vary – eg, depending on whether it nationally and internationally to raise their is wet or dry. profile, celebrate their beauty and to protect their future. Cyphellae and pseudocyphellae Pores or cracks that expose the interior of the lichen, appearing as paler spots Where wild plants lead or lines on the surface. Dry Soredia and fruits Wildlife follows Fruits Reproductive structures that Isidia on Parmelia saxatilis produce spores. They can be round Form Shrubby tufts on trees, mainly found on twigs. Form Elongated tufts of very narrow, hair-like branches. Form A thick, warty crust, usually without fruits. Form A thick, warty crust with numerous ‘jam-tart’ fruits.