Charte Engagement LARGUE & LAYE-BD.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Élections Éliane Barreille Élue Présidente Du Conseil Départemental
Le magazine #185 - Août 2021 ÉLECTIONS ÉLIANE BARREILLE ÉLUE PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL PORTRAIT DE LA NOUVELLE ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE SOMMAIRE 3 4 6 8 Élections Entretien Portrait de Délégations avec Éliane Barreille, départementales nouvelle présidente du la nouvelle et commissions Conseil départemental assemblée 9 10 Routes__ Dossier__ Le centre Les grands chantiers d’astronomie de voirie 14 16 Culture__ Randonnée__ L’été dans les musées Découvrez… les Eaux Tortes du Laverq ©Centre d’astronomie ©Centre 15 19 22 23 Sport__ Histoires Sports À __lire d’archives__ Nature__ Championnat du monde La recette MTB masters UCI (VTT) Le Grou de Bane, L’Enfant Jésus un site de vol libre de l’UPC sous cloche exceptionnel Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence Réalisation : Autrement Dit Communication - G. Lecerf - 13 rue du Docteur Romieu - CS 70 216 Sisteron - 04 92 33 15 33 Certifié PEFC. Ce produit est issu 04995 DIGNE-LES-BAINS CEDEX 9 Impression : Imprimerie Zimmermann de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. Tél. 04 92 30 04 00 BP 45 - 06271 Villeneuve Loubet Cedex - 04 93 22 58 16 pefc-france.org Le magazine est consultable et téléchargeable sur : Distribution : Adrexo • Dépôt légal à parution www.mondepartement04.fr Crédits photos : P1 X. Delcroix, P2 Centre d’astronomie, P3-8 X. Retrouvez-nous sur : www.facebook.com/departement04 Delcroix, P9 Maison Technique de Barcelonnette, P10-13 Centre d’astronomie, Jianping G, Shutterstock, P14 N. Bineau, T. Vergoz, Directrice de la publication : Éliane Barreille X. Delcroix, P15 C. Joly, N. Eynaud, P16 S. Aubergier, F. Paret, P17 A. Chargé de la publication : Florian Paret Isoardi, P19 F. -

Nouveau Territoire D'itinérance
Alpes de Haute-Provence / Provincia di Cuneo nuovo territorio da scoprire - nouveau territoire d’itinérance Produits labellisés Huile d’olive Autoroutes Patrimoine naturel remarquable Olio d’oliva Routes touristiques / Strade turistiche Autostrade Patrimonio naturale notevole Torino Torino Fromage de Banon Carignano Routes principales Espaces protégés Formaggio di Banon Route des Grandes Alpes Asti Strada principale Strada delle Grandi Alpi Aree protette Vins régionaux / Caves / Musées Variante Routes secondaires Sommets de plus de 3 000 mètres Asti Enoteche regionali / Cantine / Musei Pinerolo Strada secondaria Routes de la lavande Montagne >3.000 metri Agneau de Sisteron Strade della lavanda Rocche del Roero Voies ferrées Via Alpina Agnello di Sisteron Ferrovie Itinéraire rouge - Point d’étape Casalgrasso Montà Govone Itinerario rosso – Punto tappa Canale Vergers de la Durance Route Napoléon Ceresole Polonghera S. Stefano Roero Priocca Train des Pignes Strada Napoléon Itinéraire bleu - Point d’étape Faule Caramagna d’Alba Frutteti della Durance Piemonte Monteu Roero Les Chemins de fer Itinerario blu – Punto tappa Castellinaldo de Provence Montaldo Vezza Sommariva Roero d’Alba Magliano Point étape des sentiers de randonnée trekking Racconigi d. Bosco Alfieri Maisons de produits de pays Murello Baldissero Digne-les-Bains > Cuneo Bagnolo Moretta d’Alba Castagnito Points de vente collectifs Piemonte Sanfrè Corneliano Punto tappa dei sentieri di trekking Cavallerieone Sommariva d’Alba Aziende di prodotti locali Perno Digne-les-Bains > Cuneo Rucaski Cardè Guarene Neive Raggruppamento di produttori con vendita diretta Villanova Piobesi M. Granero Torre Monticello Solaro d’Alba 3.171 m Abbazia S. Giorgio Pocapaglia d’Alba Barbaresco Barge Staffarda Castiglione Marchés paysans C. d. -

We Love It Here and So Will You !
Pays de Forcalquier Montagne de Lure We love it here and so will you ! OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 2 Editorial Summary Nature & Outdoors ............ p 4 à 9 Walks and hikes, riding, cycling or mountain-biking ........................... p 4 & 5 The montagne de Lure ............................. p 7 Astronomy ........................................... p 8 & 9 Hot air ballooning ....................................... p 9 Heritage & Culture ......... p 10 à 21 The villages ...................................... p 10 à 15 The county town of Forcalquier ...... p 16 & 17 The main monuments ..................... p 18 & 19 Land of books and writing ........................ p 21 “Cabanon pointu“ Fine Crafts .................... p 22 & 23 Words from a local Scents & Flavours .......... p 24 à 27 Our local produce ........................... p 24 & 25 I discovered this region 15 years ago and decided quite simply to stay here, and Places of discovery ................................. p 27 how lucky I have been in my choice! I had a variety of different reasons, as varied Factory shops .......................................... p 27 and diverse as the inhabitants of this little region, whose wealth is to be seen more in their day-to-day enthusiasm and the desire to share than in appearance. A land which is alive all year round First and foremost, food is good here because very good produce can be obtained from small producers at reasonable prices. I hope that there will be even more: ........................................... p 28 & 29 to my mind, the future lies in eating local! There are a large number of artists and fi ne craftsmen and all sorts of For kids .................................. p 30 associations liven up local life: exhibitions, theatre, concerts… something for everyone! Conferences and events around « living better differently » regularly How to get here ..................... -

Du Bassin Versant Du Programme D’Actions 2014-2016
Contrat du bassin versant du Programme d’actions 2014-2016 Communes incluses dans les limites géographiques du bassin versant du Largue et de la Laye : Aubenas-les-Alpes Banon Dauphin Forcalquier L’Hospitalet Lardiers Limans Mane Ongles Reillanne Revest-des-Brousses La Rochegiron St-Etienne-les-Orgues St-Maime St-Martin-les-Eaux St-Michel- l’Observatoire Saumane Vachères Villemus Villeneuve Volx 2014 Un projet animé par le BAT _ programme d'actions LARGUE & Laye.indd 1 03/04/2014 10:38:22 - 2 - Programme d’actions 2014-2016 - Contrat pour la gestion de l’eau du bassin versant du Largue & de la Laye BAT _ programme d'actions LARGUE & Laye.indd 2 03/04/2014 10:38:26 Sommaire Préambule ........................................................................................................................................................... 4 De l’élaboration concertée... à la mise en oeuvre du Contrat de gestion ............................ 4 Les enjeux du Contrat ..................................................................................................................... 4 1 Partie 1 : Le programme d’actions du Contrat 2014-2016 .............................................................. 5 Quelques chiffres clés ................................................................................................................... 5 Répartition des volumes financiers engagés dans le er1 programme ...................... 5 Répartition des engagements financiers des partenaires ......................................... 5 Des actions locales -

Conseil Scientifique Du Parc Naturel Régional Du Luberon – Géoparc Mondial Unesco Et De La Réserve De Biosphère Luberon-Lure
Conseil scientifique du Parc naturel régional du Luberon – Géoparc mondial Unesco et de la Réserve de Biosphère Luberon-Lure Avis sur le périmètre d’étude la charte « Objectif 2039 » du parc naturel régional du Luberon Le parc en conformité avec ses statuts a souhaité associer le Conseil scientifique à la révision de sa présente charte à toutes les étapes de son élaboration. Le CS a donc été consulté sur la question du périmètre d’étude du futur parc, avec la question de l’extension possible au périmètre de la réserve de Biosphère Luberon-Lure. Ces débats ont fait l’objet de deux réunions, le 6 juin et le 27 août 2019, auxquels étaient présents. Membres du Conseil – 6 juin 2019 Membres du Conseil – 27 août 2019 Tatoni Thierry Tatoni Thierry Domeizel Marianne Bellan Gérard Thiéry Alain Beuret Jean-Eudes Bachimon Philippe Bachimon Philippe Tardieu Claude Hatt Emeline Hatt Emeline Frapa Pierre Frapa Pierre Boyer Daniel Boyer Daniel Spill Jean-Michel Aspe Chantal Ollivier Vincent Spill Jean-Michel Gauquelin Thierry Ollivier Vincent Laban Dal Canto Isabelle Masotti Véronique Gauquelin Thierry Laban Dal Canto Isabelle Suite à la sollicitation de l’équipe du Parc, Le Conseil scientifique a exprimé un avis favorable à l’extension du périmètre d’étude aux communes suivantes (localisées sur le versant sud de la montagne de Lure : Revest du Bion, Redortiers, Montsalier, Simiane la Rotonde, Banon, La Rochegiron, L’Hospitalet, Saumane, Lardiers, Ongles, Saint Etienne les Orgues, Cruis, Montlaux, Revest Saint Martin, Fontienne. Cet avis est assorti de recommandations et de remarques, qui prennent la forme d’une analyse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces de cette extension, au regard des critères réglementaires de classement d’un parc naturel régional 1) Patrimoine naturel, paysages et patrimoine culturel Atouts D’un point de vue géologique, naturel et paysager, on constate un gradient de la Durance/vallée du Rhône vers le nord-Est : Petit Luberon, Grand Luberon, Luberon Oriental, Montagne de Lure. -
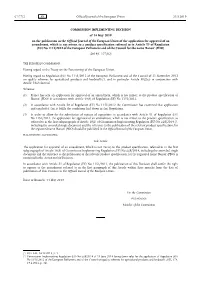
Commission Implementing Decision of 14 May 2019 On
C 177/2 EN Official Journal of the European Union 23.5.2019 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 14 May 2019 on the publication in the Official Journal of the European Union of the application for approval of an amendment, which is not minor, to a product specification referred to in Article 53 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council for the name ‘Banon’ (PDO) (2019/C 177/02) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (1), and in particular Article 50(2)(a) in conjunction with Article 53(2) thereof, Whereas: (1) France has sent an application for approval of an amendment, which is not minor, to the product specification of ‘Banon’ (PDO) in accordance with Article 49(4) of Regulation (EU) No 1151/2012. (2) In accordance with Article 50 of Regulation (EU) No 1151/2012 the Commission has examined that application and concluded that it fulfils the conditions laid down in that Regulation. (3) In order to allow for the submission of notices of opposition in accordance with Article 51 of Regulation (EU) No 1151 /2012, the application for approval of an amendment, which is not minor, to the product specification, as referred to in the first subparagraph of Article 10(1) of Commission Implementing Regulation (EU) No 668/2014 (2), including the amended single document and the reference to -

TRESORERIE GENERALE Comptes De Gestion Des Communes, Des Structures Intercommunales. 1995 1075 W 0001 Communes De Braux, Le Fuge
- Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence - TRESORERIE GENERALE Comptes de gestion des communes, des structures intercommunales. 1995 1075 W 0001 Communes de Braux, Le Fugeret, Méailles, Saint-Benoît, Ubraye, Vergons, SIVOM Canton d'Annot, SIVU Orée du Mercantour : budget, compte de gestion, pièces comptables. 1075 W 0002 Communes de Cruis, Fontienne, Lardiers, Mallefougasse, Montkaux, Montsalier, Ongles, Redortiers, Revest des Brousses, La Rochegiron, Saumane, SIVU Voierie de Saint- Etienne, SI Epuration des Eaux Saumane/L'Hospitalet : budget, compte de gestion, pièces comptables. 1075 W 0003 Commune de L'Hospitalet : budget, compte de gestion, pièces comptables, pièces justificatives (collectivité témoin). 1075 W 0004 Commune de Revest-Saint-Martin : budget, compte de gestion, pièces comptables, pièces justificatives (collectivité témoin). 1075 W 0005 Commune de Pontis : budget, compte de gestion, pièces comptables, pièces justificatives (collectivité témoin). 1075 W 0006 Commune de Faucon de Barcelonnette : budget, compte de gestion, pièces comptables, pièces justificatives (collectivité témoin). 1075 W 0007 Communes de Chaudon-Norante, Blieux, Majastres, Saint- Jacques, Saint-Lions, Senez, Tartonne, Demandolx, La Garde, Archail, Barras, Le Castellard-Mélan, Draix, Entrages, Marcoux, Mirabeau, La Robine sur Galabre, Communauté de Communes des Hautes-Duyes, SIVOM canton de La Javie, SIVOM de Senez, SIVU Voie Impériale, SIT Barrême, : budget, compte de gestion, pièces comptables. 1075 W 0008 Commune de Clumanc : budget, compte de gestion, pièces comptables, pièces justificatives (collectivité témoin). 1075 W 0009 Commune de Rougon : budget, compte de gestion, pièces comptables, pièces justificatives (collectivité témoin). 1075 W 0010 Commune de Rougon : budget, compte de gestion, pièces comptables + échantillon pièces justificatives. 1075 W 0011 Commune de Beaujeu : budget, compte de gestion, pièces comptables, pièces justificatives (collectivité témoin). -

Atlas Des Hébergements Touristiques
Atlas des hébergements touristiques 2015 Forcalquier - Campagne St St Lazare Campagne La La 1 www.alpes-haute-provence.com Sommaire 1. Les hébergements touristiques dans les Alpes de Haute-Provence 1.1. Taux de fonction touristique par commune ........................................................................................................................................................ page 4 1.2. Répartition de la capacité d’accueil des Alpes de Haute-Provence (hébergement marchand et résidences secondaires) .......................... page 5 2. Les hébergements marchands dans les Alpes de Haute-Provence 2.1. L’hôtellerie ............................................................................................................................................................................................................. page 7 2.2.L’hôtellerie de plein air ....................................................................................................................................................................................... page 14 2.3.Les résidences de tourisme et résidences hôtelières ......................................................................................................................................... page 23 2.4.Les hébergements collectifs ................................................................................................................................................................................ page 24 2.5.Les meublés labellisés ........................................................................................................................................................................................ -

Carte Banon.Indd
Château médiéval de Simiane Musée des Amis des Arts Châtaignes, Épeautre, Miel, Huile d’olive ... Perché au sommet du village classé, le château médiéval est l’un des Le musée présente une collection d’objets évoquant l’histoire de derniers témoins du passé des Agoult-Simiane. Le donjon de la fin Reillanne et de ses habitants au 19ème et au début du 20ème siècle. • Le Janorat : producteur de lavande, miel, châtaignes du XIIe siècle, appelé la Rotonde, abrite une superbe salle romane Les collections abordent tous les thèmes de la vie domestique : (crème et confiture), épeautre, lentilles... surmontée d’une coupole, chef-d’œuvre unique en Provence. costumes locaux, poterie, vannerie, cordonnerie. ALPES DE HAUTE PROVENCE 04 92 77 24 97 / 06 82 06 26 04 - Le Janorat (Redortiers) Adresse : Haut village - 04150 Simiane la Rotonde L’agriculture et l’élevage sont représentés par des outils anciens. • GAEC de la Boutonnelle : producteur de lavande fine, miel, Ouverture : Du 15 mars au 11 novembre - Mars - Avril - Septembre - Chaque été sont présentées des « Expositions Artistiques » d’artistes crème de marrons, petit épeautre 04 92 73 26 02 Octobre - Novembre : tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et locaux, dans la salle des expositions. 06 88 90 71 53 - Les Chênes Blancs (Redortiers) de 14h à 17h / De mai à fin août : tous les jours en continu de 10h à 19h Adresse : Rue du Planet, 04110 Reillanne • Les Aupillières : producteur de châtaignes fraîches et crème Contact : 04 92 73 11 34 / www.simiane-la-rotonde.fr Ouverture : du juin à septembre de châtaignes - vente à la ferme sur RDV - 04 92 73 27 10 Entrée payante / poss. -

Transport À La Demande Mis En Place Par La Communauté De Communes Du Pays De Banon Et Les Transports Sumian
Règlement La navette du marché est un transport à la demande mis en place par la Communauté de Communes du Pays de Banon et les transports Sumian. Ce service est accessible gratuitement à tout usager, aux conditions suivantes : TRANSPORT À LA Tous les arrêts indiqués sur le plan du réseau peuvent être utilisés à la DEMANDE montée comme à la descente. L'usager est seul responsable de son trajet ; ni la Communauté de Navette gratuite du marché Communes, ni les transports Sumian ne pourront être tenus responsables du fait que l'usager ne descende pas au bon endroit ou qu'il ne se présente à destination de Banon pas au bon arrêt à la bonne heure. Ni la Communauté de Communes, ni les transports Sumian ne peuvent être tenus pour responsables de quelque accident ou incident survenu en dehors du car. Arrêts : Banon, L'Hospitalet, La Rochegiron, Tout usager, dans le cadre du transport à la demande, qui veut monter Montsalier, Oppedette, Redortiers, à un arrêt indiqué, doit réserver sa place auprès des autocars Sumian Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion, en téléphonant au 06 70 13 63 92 au plus tard la veille de son départ à 17 h. Sainte-Croix-à-lauze, Saumane, Simiane-la-Rotonde, Vachères L'usager doit se présenter au plus tard, au moins 5 minutes avant l'heure normale de passage du bus ; les chauffeurs du bus n'attendront pas les usagers, quand bien même ceux-ci auraient réservé leur trajet. A partir du 05 juillet 2016 Attention !! en fonction des réservations, les circuits et les horaires peuvent être ajustés par le conducteur en accord avec la Communauté de Communes. -
Décrets, Arrêtés, Circulaires
27 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 149 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Décret no 2014-226 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Alpes-de-Haute-Provence NOR : INTA1402365D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3113-2 ; Vu le code électoral, notamment son article L. 191-1 ; Vu le décret no 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ensemble le I de l’article 71 du décret no 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; Vu la délibération du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence en date du 24 janvier 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Art. 1er.−Le département des Alpes-de-Haute-Provence comprend quinze cantons : – canton no 1 (Barcelonnette) ; – canton no 2 (Castellane) ; – canton no 3 (Château-Arnoux-Saint-Auban) ; – canton no 4 (Digne-les-Bains-1) ; – canton no 5 (Digne-les-Bains-2) ; – canton no 6 (Forcalquier) ; – canton no 7 (Manosque-1) ; – canton no 8 (Manosque-2) ; – canton no 9 (Manosque-3) ; – canton no 10 (Oraison) ; – canton no 11 (Reillanne) ; – canton no 12 (Riez) ; – canton no 13 (Seyne) ; – canton no 14 (Sisteron) ; – canton no 15 (Valensole). -
CC Haute-Provence-Pays De Banon (Siren : 200071025)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC Haute-Provence-Pays de Banon (Siren : 200071025) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Mane Arrondissement Forcalquier Département Alpes-de-Haute-Provence Interdépartemental non Date de création Date de création 30/11/2016 Date d'effet 01/01/2017 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Jacques DEPIEDS Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège Mairie de Mane Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 04300 MANE Téléphone 04 92 75 04 13 Fax 04 92 75 31 23 Courriel Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF oui Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population Population totale regroupée 9 999 1/4 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 20,74 Périmètre Nombre total de communes membres : 21 Dept Commune (N° SIREN) Population 04 Aubenas-les-Alpes (210400123) 96 04 Banon (210400180) 1 013 04 Dauphin (210400685) 848 04 La Rochegiron (210401691) 107 04 L'Hospitalet (210400958) 91 04 Mane (210401113) 1 382 04 Montjustin (210401295) 60 04 Montsalier (210401329) 143 04 Oppedette (210401428) 53 04 Redortiers (210401592) 91 04 Reillanne (210401600) 1 716 04 Revest-des-Brousses (210401626) 269 04 Revest-du-Bion (210401634) 556 04