TOME XIV-1§76. N° 3 (Juillet-Septembre)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Major-General Sir Christopher Charles Teesdale VC KCMG CB
| | HERO OF THE MONTH BY LORD ASHCROFT BY LORD ASHCROFT HERO OF THE MONTH LEFT 'The Defence of Kars', a lithograph showing Fenwick Williams and Lt Christopher Teesdale by William Simpson. (BROWN UNIVERSITY LIBRARY/HISTORIC MILITARY PRESS) BELOW 'Repulse of the Russians', an 1857 British engraving. (TOPFOTO) army, guarding against a Russian invasion Major-General Sir Christopher from Tiflis (now Tbilisi). The Russians had moved 35,000 troops into the area in early 1854, hoping to open up a second Charles Teesdale VC KCMG CB front against a weak and disorganised Turkish Army. On 3 and 6 August, the Russians twice routed the Turks on the battlefield. Smarting from two heavy defeats, the Turks fell back on the town of Kars, southwest of Tiflis. Realising the seriousness of the situation, the British decided in September 1854 to send a British Commissioner, accompanied hristopher Charles Teesdale will Christopher was just two years old when by a small staff, to join the Turkish force. forever be recorded in the history he returned to England with his family. For The man tasked with this key role was C books for two specific reasons: the rest of his childhood, he was raised in Colonel Sir Fenwick Williams of the Royal he received the only VC for the siege of England and Guernsey, where his mother’s Artillery, who was accompanied by an Kars – the last major action of the Crimean family lived. In 1848, Teesdale was accepted aide-de-camp, Lt Christopher Teesdale, War – and was the first South African-born as a gentleman cadet into the Royal Artillery and Dr Humphry Sandwith, who had been recipient of the VC. -

Ottoman Sea Power………
KADIR HAS UNIVERSITY SCHOOL OF GRADUATE STUDIES PROGRAM OF INTERNATIONAL RELATIONS CONTINENTAL POWERS AND QUEST FOR STATUS: A COMPARATIVE STUDY OF SULTAN ABDÜLAZİZ’S FLEET (1861-1876) MEHMET ALİOĞLU SUPERVISOR: PROF. DR. SERHAT GÜVENÇ PHD THESIS ISTANBUL, JUNE 2020 Mehmet Alioğlu Doktora Tezi 2020 Student’s Full Name Ph.D. (or M.S. or M.A.) Thesis 2011 CONTINENTAL POWERS AND QUEST FOR STATUS: A COMPARATIVE STUDY OF SULTAN ABDÜLAZİZ’S FLEET (1861-1876) MEHMET ALİOĞLU SUPERVISOR: PROF. DR. SERHAT GÜVENÇ PHD THESIS Submitted to the School of Graduate Studies of Kadir Has University in partial fulfillment of the requirements for the degree of PhD in the Discipline Area of International Relations under the Program of International Relations. ISTANBUL, JUNE, 2020 I, MEHMET ALİOĞLU; Hereby declare that this PhD Thesis is my own original work and that due references have been appropriately provided on all supporting literature and resources. MEHMET ALİOĞLU __________________________ JUNE 2020 ACCEPTANCE AND APPROVAL This work entitled CONTINENTAL POWERS AND QUEST FOR STATUS: A COMPARATIVE STUDY OF SULTAN ABDÜLAZIZ’S FLEET (1861-1876) prepared by MEHMET ALİOĞLU has been judged to be successful at the defense exam held on ... ... 2020 and accepted by our jury as PHD THESIS. Prof. Dr., Serhat Güvenç (Advisor) Kadir Has University Prof. Dr., Mitat Çelikpala Kadir Has University Doç. Dr., Gün Kut Boğaziçi University Prof. Dr., Gencer Özcan Bilgi University Doç. Dr., Ahmet Salih Bıçakçı Kadir Has University I certify that the above signatures belong to the faculty members named above. SIGNATURE Prof. Sinem Akgül Açıkmeşe Institute Director School of Graduate Studies DATE OF APPROVAL: …/…/…. -
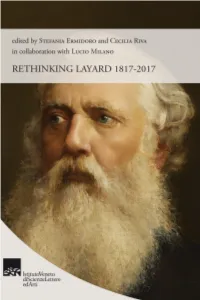
Rethinkinglayard18172017.Pdf
ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI RETHINKING LAYARD 1817-2017 edited by STEFANIA ERMIDORO and CECILIA RIVA in collaboration with LUCIO MILANO VENICE 2020 ISBN 978-88-92990-00-5 This volume contains the papers presented at the Conference Rethinking Layard 1817-2017 and is promoted by Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti and by Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici (Venice, 5-6 March 2018) This publication has been co-financed with the PRIN 2015 “Ebla e la Siria del Bronzo Antico: ricezione, circolazione e trasmissione di modelli culturali” project funds - Principal Investigator: Prof. Lucio Milano This volume is available in Open Access mode: https://www.istitutoveneto.org/pdf/rethinkinglayard18172017.pdf Project and editorial drafting: Ruggero Rugolo © Copyright Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 30124 Venice - Campo S. Stefano 2945 Tel. 0412407711 - Telefax 0415210598 [email protected] - www.istitutoveneto.it CONTENTS Preface . Pag. VII Andrew R. George, Layard of Nineveh and the Tablets of Nineveh . » 3 Silvia Alaura, Austen Henry Layard and Archibald Henry Sayce: an Anatolian Perspective . » 25 John Curtis, Layard’s Relationship with F.C. Cooper and His Other Artists . » 63 Georgina Herrmann, Austen Henry Layard, Nimrud and His Ivories . » 91 Stefania Ermidoro, A Family Treasure: the Layard Collection at Newcastle University . » 115 Henrike Rost, New Perspectives on a Supranational Elite in Venice: Lady Layard’s Musical Activities and Her Autograph Book (1881-1912) . » 137 Jonathan P. Parry, Henry Layard and the British Parliament: Outsider and Expert . » 155 Maria Stella Florio, Rawdon Brown and Henry Layard in Venice . » 171 Frederick Mario Fales, Layard, Saleh, and Miner Kellogg: Three Worlds in a Single Painting . -

Sa ) R INTRODUCTION and REVIEW of the SOURCES
xvi acknowledgements Among librarians, I am indebted most to Mehmet Manyas from Sabancı University for his eff orts to provide me with books and articles from other national and international libraries. Veronika Lapshina CHAPTER ONE and Yelena Strukova from the GPIB in Moscow have also been kindly helpful. Librarians of the Boğaziçi University were also very kind and INTRODUCTION AND REVIEW OF THE SOURCES helpful. Th e staff of the library of the Centre for Islamic Studies (ISAM) was also very helpful. Introduction Associazione Europiemonte in Turin fi nanced my participation in the congress on the 150th anniversary of the end of the Crimean War Th is book concerns the Ottoman involvement in the Crimean War of in Turin in November 2006. My friend Kemal Çetinelli has generously 1853–1856. While a huge literature in the European languages (includ- fi nanced all the costs of my research trip to Moscow in June 2006. My ing Russian) is available on this topic, there hardly exists any mod- friend Tarık Tayfun has also supported me in many ways during my ern, up-to-date, comparative, scholarly monograph based on original studies. research in Ottoman sources and focusing on the Ottoman state and While I thank all for their help, comments and criticism, I alone am society. Th e main concern of this study is to re-construct the narra- responsible for all possible mistakes and omissions. tive of the war as experienced by the Ottomans, setting the record straight by an up-to-date, comparative study of factual data from pri- mary sources. -

Department of History
University Museums and Special Collections Services Department of History Dissertations Subject Explorer PART B – EIGHTEENTH AND NINETEENTH CENTURIES This part concentrates mainly on conflicts and key political figures during the period. One subject (The British soldier) extends beyond the period. This part covers the following subject areas: The British soldier Edmund Burke and Parliament in the late 18th century The American Revolution The French Revolution Napoleon and the Napoleonic Wars Horatio Nelson The War of 1812 Italian Unification The Crystal Palace and the Great Exhibition (1851) The Crimean War The American Civil War (1861-1865) Please note that there are many other collections within the University relating to this period, particularly for rural and agricultural history, and industrialisation. The British soldier These sources pertain to the lives and experiences of several British soldiers ranging from the Crimean war in the 1850’s, through the Boer war at the beginning of the twentieth century to the Second World War, including a piece on the development of the soldier from Cromwellian times. Possible subject areas include: The British soldier in Italy and Tunisia during WW2 The development of the British soldier Conditions and experiences of the British soldier in the Boer War The British soldier in the Crimean War The failings of supply and difficult conditions during the Crimean war. The British soldier in operations during the Sino-Japanese war Details of items in Special Collections: MS1148-8- folders 22-27 These folders, making up part of the Stenton correspondence contain within them numerous letters from D.Fisher a soldier during the Second World War who relates at length to Frank and Doris Stenton his experiences in the war fighting in Tunisia and Italy. -

Karendergi F74cb.Pdf
Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü adına sahibi / Owned on behalf of Institute of Black Sea Studies by Prof. Dr. Mehmet OKUR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Trabzon/TÜRKİYE EDİTÖRLER / EDITORS Dr. Öğr. Üyesi Yüksel KÜÇÜKER Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü, Trabzon/TÜRKİYE Dr. Öğr. Üyesi Volkan AKSOY Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü, Trabzon/TÜRKİYE Doç. Dr. Bahadır GÜNEŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Trabzon/TÜRKİYE ALAN EDİTÖRLERİ / FIELD EDITORS Arkeoloji - Sanat Tarihi / Archaeology - Art History Dr. Öğr. Üyesi Hülya Çalışkan AKGÜL Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Trabzon/TÜRKİYE Deniz Bilimleri / Marine Sciences Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Trabzon/TÜRKİYE Dil ve Edebiyat / Languages and Literature Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Trabzon/TÜRKİYE İktisadî ve İdarî Bilimler / Economic and Administrative Sciences Prof. Dr. Rahmi YAMAK Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Trabzon/TÜRKİYE Mimarlık ve Çevre Bilimleri / Architecture and Environmental Sciences Prof. Dr. Cenap SANCAR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Trabzon/TÜRKİYE Sosyoloji / Sociology Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YADİGAROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Trabzon/TÜRKİYE Tarih / History Doç. Dr. Ahmet KÖKSAL Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Trabzon/TÜRKİYE Uluslararası İlişkiler -

British Liberalism and the Balkans, C. 1875-1925
ORBIT - Online Repository of Birkbeck Institutional Theses Enabling Open Access to Birkbecks Research Degree output British liberalism and the Balkans, c. 1875-1925 http://bbktheses.da.ulcc.ac.uk/82/ Version: Full Version Citation: Perkins, James Andrew (2014) British liberalism and the Balkans, c. 1875- 1925. PhD thesis, Birkbeck, University of London. c 2014 The Author(s) All material available through ORBIT is protected by intellectual property law, including copyright law. Any use made of the contents should comply with the relevant law. Deposit guide Contact: email British liberalism and the Balkans, c. 1875-1925 James Andrew Perkins Department of History, Classics and Archaeology Birkbeck, University of London Submitted for the degree of Doctor of Philosophy June 2014 1 I confirm that the work presented in this thesis is my own. James Perkins 2 Abstract This is a study of the place of the Balkans in British liberal politics from the late-Victorian era to the aftermath of the First World War. It argues that engagement with the region was part of a wider reformist dynamic in British politics and society in this period. The late-nineteenth and early-twentieth centuries saw the final collapse of the Ottoman Empire, and the emergence of independent successor states in the Balkans against a background of nationalist tension, political violence, and humanitarian suffering. This raised questions and concerns that resonated particularly strongly within British liberal political culture, as revealed through analysis of correspondence and memoir, -

Explaining Coexistence and Conflict
EXPLAINING COEXISTENCE AND CONFLICT IN EASTERN ANATOLIA, 1800-1878 by Brad Ronald Dennis A dissertation submitted to the faculty of The University of Utah in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of History The University of Utah December 2015 Copyright © Brad Ronald Dennis 2015 All Rights Reserved The University of Utah Graduate School STATEMENT OF DISSERTATION APPROVAL The dissertation of Brad Ronald Dennis has been approved by the following supervisory committee members: Peter John Sluglett , Chair 06/11/2015 Date Approved Peter Von Sivers , Member 05/20/2015 Date Approved M. Hakan Yavuz , Member 05/20/2015 Date Approved Leonard C. Chiarelli , Member 05/20/2015 Date Approved Edward Erickson , Member 05/20/2015 Date Approved Walter P. Reeve , Member 05/20/2015 Date Approved and by Isabel Moreira , Chair/Dean of the Department/College/School of History and by David B. Kieda, Dean of The Graduate School. ABSTRACT It is a common assumption in much of the scholarship on Eastern Anatolia that groups in the region, both today and throughout the past, primarily defined and distinguished themselves in terms of their ethnicity and religious affiliations and that such distinctions were the primary causes of tension and conflict throughout history. However, an in-depth investigation of government documents, firsthand accounts, memoirs, interviews, court records, official and private investigations, and travelogues written in Ottoman Turkish, Armenian, Russian, French, German, and English reveals that tensions in Eastern Anatolia between 1800 and 1878 ran along a number of different lines besides religion and ethnicity and that groups did not appear to even imagine a conflict along such lines until the Great Powers became more involved in Ottoman politics. -

The End of Yugoslavia, Contemporary European History, 2001; 10 (2):317-331
PUBLISHED VERSION Drapac, Vesna Maria. The end of Yugoslavia, Contemporary European History, 2001; 10 (2):317-331. Copyright © 2001 Cambridge University Press PERMISSIONS http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=4088&level=2#4408 The right to post the definitive version of the contribution as published at Cambridge Journals Online (in PDF or HTML form) in the Institutional Repository of the institution in which they worked at the time the paper was first submitted, or (for appropriate journals) in PubMed Central or UK PubMed Central, no sooner than one year after first publication of the paper in the journal, subject to file availability and provided the posting includes a prominent statement of the full bibliographical details, a copyright notice in the name of the copyright holder (Cambridge University Press or the sponsoring Society, as appropriate), and a link to the online edition of the journal at Cambridge Journals Online. Inclusion of this definitive version after one year in Institutional Repositories outside of the institution in which the contributor worked at the time the paper was first submitted will be subject to the additional permission of Cambridge University Press (not to be unreasonably withheld). 10th December 2010 http://hdl.handle.net/2440/15673 The End of Yugoslavia VESNA DRAPAC Francine Friedman, The Bosnian Muslims: Denial of a Nation (Colorado: Westview Press, 1996), 288 pp., $35.00, ISBN 0-8133-2096-8. Eric D. Gordy, The Culture of Power in Serbia: Nationalism and the Destruction of Alternatives (University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1999), 230 pp., $17.95, ISBN 0-271-01958-1. -

Ottoman War on the Danube: State, Subject, and Soldier (1853-1856)
OTTOMAN WAR ON THE DANUBE: STATE, SUBJECT, AND SOLDIER (1853-1856) A Ph.D. Dissertation by İBRAHİM KÖREMEZLİ Department of International Relations İhsan Doğramacı Bilkent University Ankara December 2013 To my family OTTOMAN WAR ON THE DANUBE: STATE, SUBJECT, AND SOLDIER (1853-1856) Graduate School of Economics and Social Sciences of İhsan Doğramacı Bilkent University by İBRAHİM KÖREMEZLİ In Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT UNIVERSITY ANKARA December 2013 I certify that I have read this thesis and have found that it is fully adequate, in scope and in quality, as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in International Relations. --------------------------------- Assoc. Prof. Hakan Kırımlı Supervisor I certify that I have read this thesis and have found that it is fully adequate, in scope and in quality, as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in International Relations. --------------------------------- Prof. Norman Stone Examining Committee Member I certify that I have read this thesis and have found that it is fully adequate, in scope and in quality, as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in International Relations. --------------------------------- Prof. Dr. Hasan Ünal Examining Committee Member I certify that I have read this thesis and have found that it is fully adequate, in scope and in quality, as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in International Relations. --------------------------------- Asst. Prof. Nur Bilge Criss Examining Committee Member I certify that I have read this thesis and have found that it is fully adequate, in scope and in quality, as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in International Relations. -

Survival Among the Kurds Also by John S
Survival Among the Kurds Also by john S. Guest The Euphrates Expedition Survival Among the Kurds A History of the Yezidis John S. Guest ~ ~~~~~~n~~~up LONDON AND NEW YORK First published in I993 by Kegan Paul International This edition first published in 2010 by Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OXI4 4RN Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge 711 Third Avenue, New York, NY 10017 Routledge is an imprint ofthe Taylor & Francis Group, an itiforma business ©JohnS. Guest I987, I993 All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers. British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library ISBN 10: 0-7103-0456-0 (hbk) ISBN 13:978-0-7103-0456-8 (hbk) Publisher's Note The publisher has gone to great lengths to ensure the quality of this reprint but points out that some imperfections in the original copies may be apparent. The publisher has made every effort to contact original copyright holders and would welcome correspondence from those they have been unable to trace. To Margaret Contents List of Illustrations IX Preface to the Revised Edition xiii Chapter 1 Antecedents Chapter 2 Sheikh Adi and His Order 15 Chapter 3 The Y ezidi Religion 29 Chapter 4 Early Encounters with the Outside -

British Liberalism and the Balkans, C. 1875-1925
ORBIT-OnlineRepository ofBirkbeckInstitutionalTheses Enabling Open Access to Birkbeck’s Research Degree output British liberalism and the Balkans, c. 1875-1925 https://eprints.bbk.ac.uk/id/eprint/40082/ Version: Full Version Citation: Perkins, James Andrew (2014) British liberalism and the Balkans, c. 1875-1925. [Thesis] (Unpublished) c 2020 The Author(s) All material available through ORBIT is protected by intellectual property law, including copy- right law. Any use made of the contents should comply with the relevant law. Deposit Guide Contact: email British liberalism and the Balkans, c. 1875-1925 James Andrew Perkins Department of History, Classics and Archaeology Birkbeck, University of London Submitted for the degree of Doctor of Philosophy June 2014 1 I confirm that the work presented in this thesis is my own. James Perkins 2 Abstract This is a study of the place of the Balkans in British liberal politics from the late-Victorian era to the aftermath of the First World War. It argues that engagement with the region was part of a wider reformist dynamic in British politics and society in this period. The late-nineteenth and early-twentieth centuries saw the final collapse of the Ottoman Empire, and the emergence of independent successor states in the Balkans against a background of nationalist tension, political violence, and humanitarian suffering. This raised questions and concerns that resonated particularly strongly within British liberal political culture, as revealed through analysis of correspondence and memoir, journalism,