Georges Clemenceau Et Les Chrétiens
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
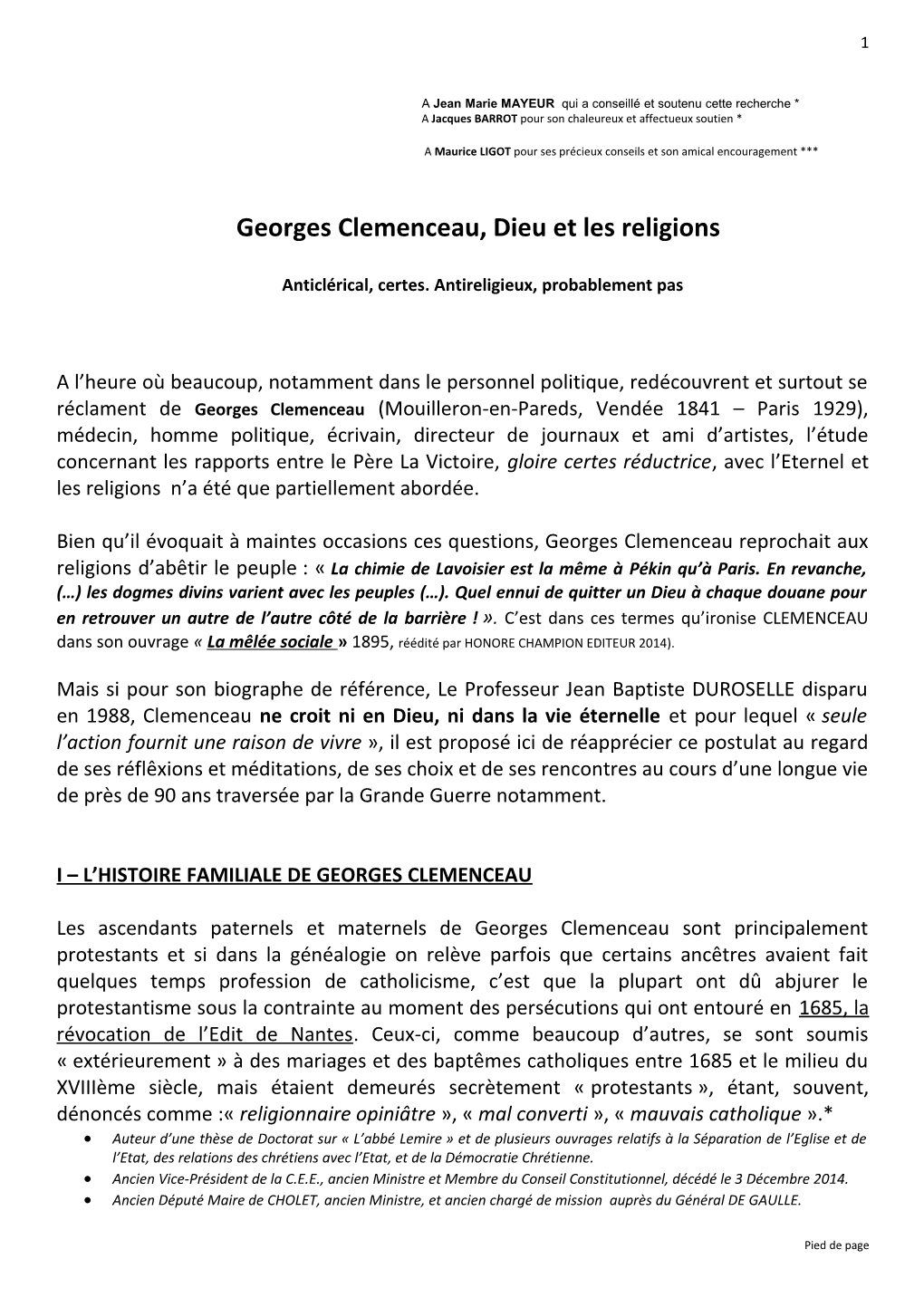
Load more
Recommended publications
-

Uva-DARE (Digital Academic Repository)
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Le roi et l’exil Les relations de Charles de Gaulle avec les Juifs jusqu’en 1940 Foucaud-Royer, E.A.J. Publication date 2019 Document Version Other version License Other Link to publication Citation for published version (APA): Foucaud-Royer, E. A. J. (2019). Le roi et l’exil: Les relations de Charles de Gaulle avec les Juifs jusqu’en 1940. General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:03 Oct 2021 Abréviations (œuvres de Charles de Gaulle utilisées pour ce travail) FE : Le Fil de l’épée et autres écrits, Paris : Plon, 1990 MG : Mémoires de guerre, Paris : Plon, 1999 LNC I : Lettres, notes et carnets : 1905-1941, Paris : Robert Laffont « Bouquins », 2010 LNC II : Lettres, notes et carnets. -

Charles De Gaulle - Wikipedia Charles De Gaulle from Wikipedia, the Free Encyclopedia
338 REKHITA [to scarify] [= TA-KI-RI] FILIP FALETOLU KAWATIRI ©All Rights Reserved Courtesy: De Gaulle during World War II, Wikipedia wearing the two stars of a général de brigade on his sleeve. President of France Co-Prince of Andorra 27/07/2017 Charles de Gaulle - Wikipedia Charles de Gaulle From Wikipedia, the free encyclopedia Charles André Joseph Marie de Gaulle (French: [ a l də ʃ ʁ Charles de Gaulle ɡol]; 22 November 1890 – 9 November 1970) was a French general and statesman. He was the leader of Free France (1940–44) and the head of the Provisional Government of the French Republic (1944–46). In 1958, he founded the Fifth Republic and was elected as the President of France, a position he held until his resignation in 1969. He was the dominant figure of France during the Cold War era and his memory continues to influence French politics. Born in Lille, he graduated from Saint-Cyr in 1912. He was a decorated officer of the First World War, wounded several times, and later taken prisoner at Verdun. During the interwar period, he advocated mobile armoured divisions. During the German invasion of May 1940, he led an armoured division which counterattacked the invaders; he was then appointed Under-Secretary for War. Refusing to accept his government's armistice with Nazi Germany, de Gaulle President of France exhorted the French population to resist occupation and to Co-Prince of Andorra continue the fight in his Appeal of 18 June. He led a In office government in exile and the Free French Forces against the 8 January 1959 – 28 April 1969 Axis. -

Charles De Gaulle Du Même Auteur
CHARLES DE GAULLE DU MÊME AUTEUR LA MAUVAISE FRÉQUENTATION. LES GARÇONS. TOURNEBELLE. GASTON BONHEUR CHARLES DE GAULLE BIOGRAPHIE GALLIMARD 5, rue Sébastien-Bottin, Paris VII Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays, y compris la Russie. © 1958, Librairie Gallimard. La plus grande partie de cette biographie fut écrite en 1944 et publiée en 1946. Il s'agit des chapitres qui vont de l'enfance au débarquement en Normandie. L'actualité ayant fourni l'occasion de rééditer cet ou- vrage, une dernière partie a été écrite en juin 1958, pour faire le pont par-dessus les quatorze ans qui avaient passé. Le poète suscite avec un glaive nu... STÉPHANE MALLARMÉ. PREMIÈRE PARTIE AVANT 14 L'ENFANT DU SIÈCLE En cette année 1900, les bérets des petits garçons s'appelaient volontiers Le Vengeur, en lettres d'or, ou L'Indomptable. Et pour- quoi pas La Revanche ? Coiffé d'un de ces noms exaltants qui le désignent à notre attention, le petit Charles de Gaulle s'avançait à travers les allées du Luxembourg, par une fin d'après-midi d'au- tomne. Culottes mi-longues, manches mi- courtes, il paraissait encombré de lui-même, et on eût dit que sa tête penchée pesait à son cou. Dans sa main, il tenait roulé le programme de L'Aiglon. Pour ses dix ans, son père l'avait mené au théâtre, et l'enfant était encore tout étourdi d'alexandrins, tout ébloui de gloire. Il voyait à peine, à travers les images qui collaient à ses yeux, le tableau de ce parc débonnaire où des messieurs à barbe calamistrée termi- naient gravement leur partie de croquet. -

Charles De Gaulle, L'homme Du « Nord »
Charles de Gaulle, l’homme du « Nord » Itinéraires en Hauts-de-France pour comprendre l’homme qui incarne « une certaine idée de la France » « Le Nord représentait non seulement un lieu de naissance mais aussi une éthique, un mode d’éducation, une manière de voir. Il ne convenait pas d’être expansif. On ne faisait pas d’histoires. » Le témoignage est de Philippe de Gaulle, le fils du Général. En 1944, dans sa ville natale libérée, Charles de Gaulle lance à la foule : « Nous autres, Lillois, ce sont les vérités que nous regardons en face, beaucoup plus que nous ne goûtons les formules. » En 1947, à l’Hippodrome des Flandres de Marcq-en-Barœul, il appuie : « Nous autres gens du Nord, sommes fiers que les hommes et les femmes de chez nous aient, en très grand nombre et comme toujours, bien servi la patrie dans le drame où s’est joué son destin. Et comme nous ne sommes point d’une race qui redoute la vérité, même quand elle grave et dure, c’est aussi pour la voir en face ensemble que nous nous sommes groupés aujourd’hui... » le pa BRUXELLES ’O d Malo e t Calais ô Antoing C Sangatte Wissant LILLE Wimereux Dinant Wimille Haillicourt Bruay-la-Buissière e d e ai e Arras B m m So Abbeville AMIENS Montcornet Huppy Beauvais Berry-au-Bac PARIS P1 Le graph de couverture est signé Mister P, le street artiste Thomas. « Je cherchais à exprimer ma fierté pour la région où je suis né. J’ai tout de suite pensé au Général, le seul à avoir une telle dimension universelle. -

Note to Users
NOTE TO USERS Page(s) not included in the original manuscript are unavailable from the author or university. The manuscript was microfilmed as received 14 and 65 This reproduction is the best copy available. UMI 1848 De Gaulle: son image du système international et des relations France—Canada-Québec par Jacques Filion Thèse présentée en vue de l'obtention d'un M.A. en science politique .©BLIO^ BIBL'OTHèQUES * Université d'Ottawa, . L.BRAWtS ^ Ottawa, Ontario. Janvier 1974« Cj Jacques Filion, Ottawa, 1974, UMI Number: EC55397 INFORMATION TO USERS The quality of this reproduction is dépendent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleed-through, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send a complète manuscript and there are missing pages, thèse will be noted. AIso, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. UMI UMI Microform EC55397 Copyright 2011 by ProQuest LLC Ail rights reserved. This microform édition is protected against unauthorized copying underTitle 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 AnnArbor, Ml 48106-1346 Nous tenons à remercier le plus sincèrement possible M. William Badour pour ses judicieux conseils, ses encouragements constants et à lui dire notre appréciation pour sa très grande disponibilité. Merci à Mme Carmen Long Houle pour sa diligence à trans crire le présent texte. Car le pouvoir, s'il est amour de la domination, je le juge ambition stupide. -

Charles De Gaulle. L'homme Et Son Destin
DU MÊME AUTEUR LA PROMESSE ACCOMPLIE, poèmes, Paris, 1921 (épuisé). L'AMITIÉ DE PROUST (Cahiers Marcel Proust, n° 8), Gallimard, Paris, 1935. PAROUSIE, poèmes, Corrêa, Paris, 1938. SYMBOLE DE LA FRANCE (avec un poème liminaire de P. Claudel), La Baconnière, Neuchâtel, 1943. CHARLES DE GAULLE, Portes de France, Porrentruy, 1944 et 1946 (47 mille). VICTOR HUGO, introduction et choix de textes. I prose, II poésie, en colla- boration avec P. Zumthor (Cri de la France), L. U. F. 1943-45. TROIS POÈTES, HOPKINS, YEATS, ELIOT, L. U. F., Fribourg et Paris, 1947. OUTRENUIT, poèmes, G. L. M., Paris, 1948. MOHAMED-ALY ET L'EUROPE (en collaboration avec René Cattaui bey), Geuthner, Paris, 1949. (Ouvrage couronné par l'Académie des Sciences morales et politiques.) MARCEL PROUST, préface de Daniel-Rops, Julliard, Paris, 1950 (Prix Femina-Vacaresco) (6e mille). LÉON BLOY, préface de Pierre Emmanuel (Coll. « Les Classiques du XX siè- cle »). Ed. Universitaires, Paris, 1954. MARCEL PROUST (Documents iconographiques), Ed. P. Cailler, Genève, 1956. CHARLES DE GAULLE (Coll. « Les Témoins du XX siècle »), Ed. Univer- sitaires, Paris, 1956. T. S. ELIOT (Coll. « Les Classiques du XX siècle »), Ed. Universitaires, Paris., 1957. MARCEL PROUST, avant-propos de P. de Boisdeffre (Coll. « Les Classiques du XX siècle »), Ed. Universitaires, Paris, 1958. SAINT BERNARD DE CLAIRVAUX OU L'ESPRIT DU CANTIQUE DES CANTIQUES, Gabalda, Paris, 1960. JULES HARDOUIN MANSART (en collaboration avec P. Bourget), Vincent Fréal, Paris, 1960. GEORGES CATTAUI CHARLES DE GAULLE L'HOMME ET SON DESTIN LIBRAIRIE ARTHÈME FAYARD 18 RUE DU SAINT-GOTHARD PARIS XIV Il a été tiré de cet ouvrage : 50 exemplaires sur papier de châtaignier numérotés de 1 à 50. -

Une Famille Du Nord
Une famille du Nord La famille de Gaulle et la famille Maillot Les MacCarthan Les grands-parents de Charles de Gaulle avaient tous deux des ascendances étrangères. Leurs aïeux se sont fixés en France à partir du milieu du 18ème siècle. Né à Lille, Jules-Emile Maillot a des origines allemandes par la famille Kolb, native du grand duché de Bade. Julia Delannoy-Maillot avait des origines irlandaises par les Mac Carthan. Les grands-parents de Charles de Gaulle Les grands-parents paternels du Général sont deux lettrés : Julien-Philippe De Gaulle, chartiste, est l'auteur de plusieurs ouvrages historiques tels "Histoire de Paris et de ses environs" (1841) et une "Vie de Saint Louis". Il est aussi collaborateur au " Journal des savants ". Quant à son épouse Joséphine, née Maillot, et donc cousine de Julia la future "veuve Maillot", c'est un écrivain très productif puisque les titres de son œuvre occupent 8 pages du catalogue de la Bibliothèque nationale. Il s'agit de romans, de biographies ou guides dont notamment l'"Itinéraire des chemins de fer du Nord". Les grands-parents paternels sont des intellectuels et leur vie matérielle n'en est pas facilitée pour autant. Leur fils Henri, admissible à Polytechnique, y renoncera pour subvenir aux besoins de la famille. Les grands-parents Maillot Avant son mariage, Jules-Emile Maillot étudia en Angleterre la fabrication du tulle, alors inconnu en France. Il créa à Lille la première usine de ce nouveau procédé avec succès et obtient en 1878, un prix lors de l'Exposition universelle. Jules-Emile Maillot épousa Julia Delannoy en 1858. -

Introduction
Notes INTRODUCTION 1 The figures for these and other plebiscites and referenda are taken from Quid (Paris: Laffont, 1985) p. 626. 2 See J.-R. Tournoux, La Tragedie du General (Paris: Pion, 1967) p. 470. The full quotation illustrates the permanence of de Gaulle's vision of the nation state and of nationalism as decisive forces in world politics: 'Napoleon, the greatest captain of modern times, was defeated from the moment when, instead of using a national army against royal armies, he found himself facing nations with the name of Spain, Prussia and Russia.' 3 See Albert Soboul, La Revolution Franf(aise (Paris: PUF, 1965) 'Que sais-je?', p. 116. It is very comforting, after reading the account in William Doyle (see note 12 to Chapter 1) of how Anglo-Saxon historians have cast doubt on all the received wisdom about the French Revolution, to turn back to a historian who considers that the Revolution did take place; that it did destroy the remnants of the feudal system; that the French nobility did enjoy fiscal privileges; that it was a closed caste; that the nationalisation of the Church lands did create a class of peasant small-holders; that the Revolution itself was (p. 114) an 'etape necessaire de Ia transition generale du feodalisme au capitalisme' (a necessary stage in the general transition from feudalism to capitalism); that it was therefore a Good Thing; especially since the rising middle class would shortly be giving way to the triumphant proletariat. For a more up-to-date and less traditional account of what really mattered in the French Revolution, see T. -

Pdf II S'agit Là D'un Personnage Politique Français Particulièrement Important Durant Les Quatre Premières Décennies De La Ve République
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC MÉMOIRE PRÉSENTÉ À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAÎTRISE EN ÉTUDES ET INTERVENTIONS RÉGIONALES PAR EDOUARD BARATON DE GAULLE OU L'HYPOTHÈQUE FRANÇAISE SUR LE CANADA HIVER 2012 A mes grands-parents... Résumé « Vive le Québec libre », derrière ces mots lancés à la foule par le général de Gaulle se trouve bien plus qu'il n'y parait. Il s'agit tout d'abord de l'aboutissement d'une longue ligne de pensée politique qui, en France comme dans l'espace canadien-français, n'a cessé de vivre depuis 1763 : le Peuple français est un, les francogènes de France, d'Amérique ou d'ailleurs formant un seul et même ensemble, nonobstant les séparations politiques nées de défaites du passé. Cette conception se décèle depuis l'Ancien Régime jusqu'à de Gaulle en passant par le Premier Empire, la Révolte des patriotes de 1837-1838, le Second Empire ou chez les nationalistes, Français ou Canadiens-français de la fin du XIXe siècle. Il ne s'agit pas uniquement d'un aboutissement, la révélation soudaine d'une idée restée platonique la majeure partie du temps durant deux siècles, mais aussi du début d'une vaste entreprise où le Canada et ses problématiques du XXe siècle se télescopent avec un grand dessein gaullien embrassant de vastes espaces à travers le monde et ayant pour objectif fondamental de briser les blocs de granit jetés à travers le monde par l'ancien Empire britannique pour lier les mains à la France. La France se lance dans une grande entreprise de lutte tous azimuts contre un ensemble de faits accomplis politiques dans le but de regagner sa liberté d'action, sa « Grandeur ». -

Pétain Et De Gaulle. Avec 29 Illustrations Hors-Texte
DU MÊME AUTEUR SECRETS D'ÉTAT « ... S'il est un livre d'histoire qui soit d'actualité, c'est bien celui- là ». JACQUES FAUVET ( Le Monde). « ... Tournoux passionne la France avec la politique ». ( Paris-Match). « ... De l'histoire en train de se faire... ». ROGER GIRON (Le Figaro). « ... Ce livre sensationnel révèle les dessous de la politique fran- çaise entre 1946 et 1959... ». J. GALTIER-BoiSSIÈRE (Le Crapouillot). sionnante...« ... Une page ». d'histoire impres- JEAN-PIERRE MOULIN (La Tribune de Lausanne). « ... Un travail d'historien... ». G. POTUT (Revue Politique et Parlementaire). « ... Une œuvre incontestable d'historien... ». YVES HUGONNET (Les Dernières Nouvelles d'Alsace). « ... Œuvre d'information pure qui touche aux ressorts les plus intimes du régime... ». J. BARSALOU (La Dépêche du Midi). « ... Un ouvrage historique... ». A. DELSART (« Le Progrès » de Lyon). « ... Livre passionnant, prodigieu- sement renseigné sur les dessous des événements que la France a vécus depuis quinze ans... » RÉMY ROURE. PÉTAIN ET DE GAULLE DU MÊME AUTEUR CHEZ LE MÊME ÉDITEUR : CARNETS SECRETS DE LA POLITIQUE. (Épuisé). L'HISTOIRE SECRÈTE, 60e mille. SECRETS D 'ÉTAT *, 165e mille. (Prix Thiers de l'Académie française). EN PRÉPARATION: SECRETS D'ÉTAT ***. J.-R. TOURNOUX SECRETS D'ÉTAT PÉTAIN ET DE GAULLE Avec 29 illustrations hors-texte. PLON 0 19G4 by Librairie Plon, 8, rue Garancière, Paris-6e, Imprimé en France. A ma femme Adresse Tantôt à MONTAIGNE, tantôt à TALLEYRAND, le propos est attribué : Tant qu'on n'a pas vu tout, et le contraire de tout, on n'a pas vécu. Hommage A tous les esprits libres qui nous ont permis d'écrire ce livre. -

De Gaulle Sans Nous Offre Lormier Documents Etdestémoignagesinédits, Dominique Dotes Demeurentméconnus
près des décennies de publications et de documentaires, on croit tout savoir de Charles de Gaulle. Or de nombreux faits et anec- A LORMIER dotes demeurent méconnus. S’appuyant sur des DOMINIQUE documents et des témoignages inédits, Dominique Lormier nous offre un Charles de Gaulle sans masque et nous dévoile le grand homme d’État – qui a marqué la France comme aucun autre pré- sident – dans son intimité et ses réalités ignorées : les passions multiples qu’il a cultivées tout au long de sa vie, son appétence pour la spiritualité mys- tique, la littérature et la philosophie, ses liens pro- DOMINIQUE LORMIER fonds avec Philippe Pétain durant de nombreuses années, ses cinq tentatives d’évasion entre 1916- INTIME ET MECONNU 1918 alors qu’il était prisonnier en Allemagne, son action militaire en Pologne et son mariage, ses com- bats au sein de la 4e division cuirassée en mai-juin 1940, la vérité sur la guerre d’Algérie, les origines cachées de l’arme nucléaire… DEINTIME GAULLE ET MÉCONNU Par-delà le récit officiel et l’historiographie consacrée, découvrez l’homme qui se cache derrière l’une des figures d’État les plus emblématiques de la France.. DE GAULLE Historien et écrivain, membre de l’Institut Jean Moulin et Chevalier de la Légion d’honneur, Dominique Lormier est consi- déré comme l’un des spécialistes les plus remarquables de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance. Il est l’auteur de plus d’une centaine d’ouvrages dont Nouvelles histoires extraor- dinaires de la Résistance et Les Grandes Affaires de la Libération aux éditions Alisio. -

A Man of the “North”
Charles De Gaulle a man of the “North” 7 itinéraires in Hauts-de-France to help you better understand the man who embodied “a certain vision of France” CAP GRIS NEZ Malo “The North wasn’t just a place of birth but CAP BLANC NEZ Rosendael represented a set of beliefs, an education and a Sangatte Wissant CITE DE LA DENTELLE way of seeing the world. ET DE LA MODE MAISON NATALE DE CH DE GAULLE Being effusive was deemed inappropriate. Wimereux NOTRE DAME People didn’t like to make a fuss. “ Testimony from Wimille DE LA TREILLE Bondues LA CITADELLE MUSEE Philippe de Gaulle, General de Gaulle’s son. DE LA RESISTANCE In 1944, in his liberated home town, Charles de Bruay-la-Buissière Haillicourt Gaulle launched into a speech to the crowd: CENTRE HISTORIQUE LA FOSSE MINIER “For us, the people of Lille, it is the truth that D’HAILLICOURT LA CITADELLE counts, not frills and fripperies .” Lewarde CARRIERE WELLINGTON In 1947, at Marcq-en-Barœul racecourse, Huppy in Flanders, he further elaborated: “We, the people LE CHÂTEAU of the North, are proud that the men and women of Peronne FAMILISTERE MUSEE DE LA Guise DE GUISE our communities, always, and in such vast number, GRANDE GUERRE served their country well in this struggle where our Montcornet fate hung in the balance. And because we are not a Tergnier MUSEE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION race that fears the truth, however grave or difficult, Compiègne Pontavert we have gathered here today so we can confront it Oulches-la-Vallée-Foulon together.