Un Film De Jacques Audiard
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
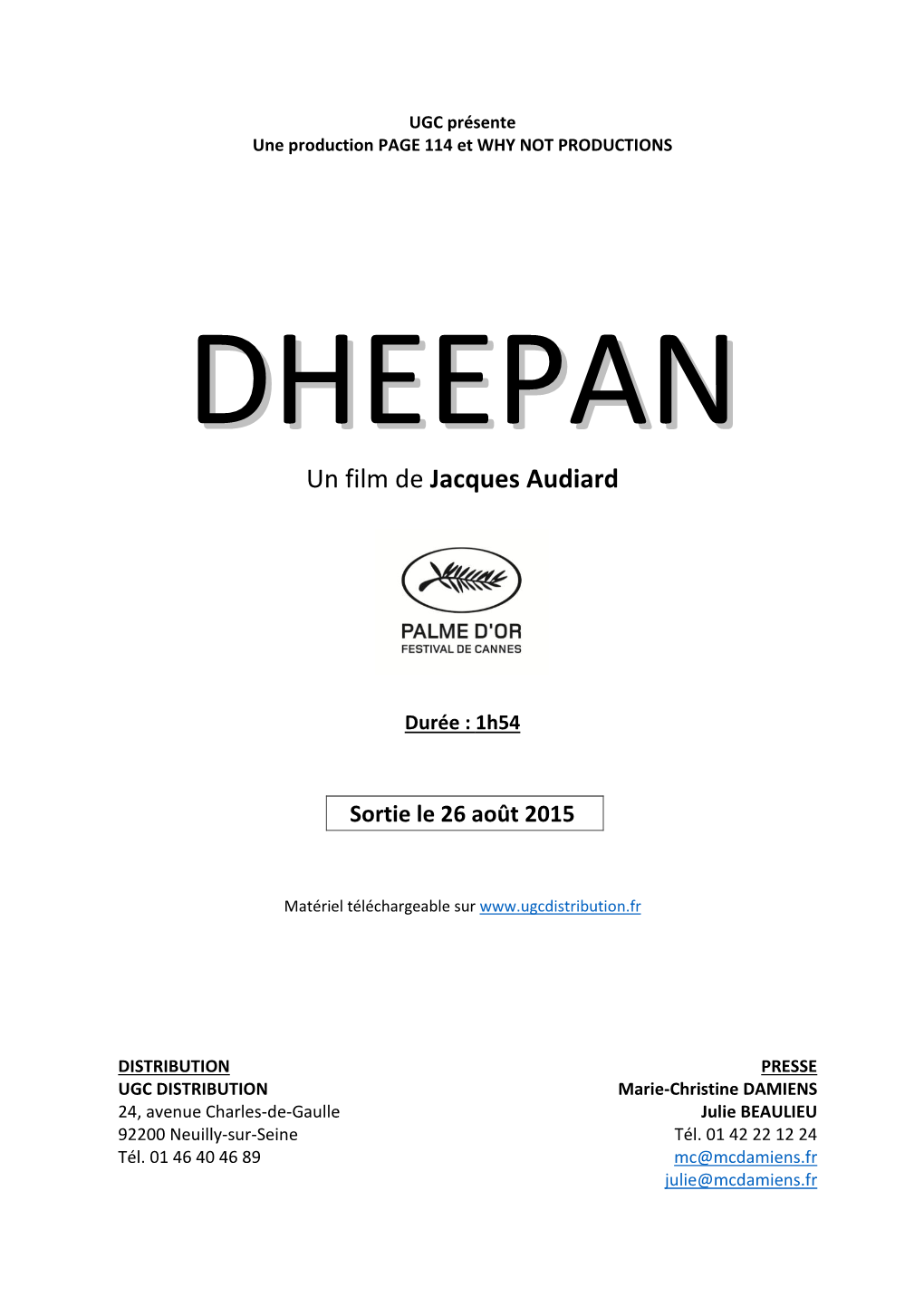
Load more
Recommended publications
-
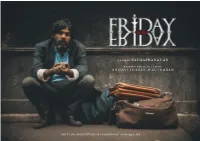
A Film by Sathapranavan Antonythasan Jesuthasan
A FILM BY SATHAPRANAVAN WRITTEN AND MAIN CAST BY ANTONYTHASAN JESUTHASAN IBC TAMIL PRODUCTION - DA XIONGMAO - LAIDAK FILMS TECH. SHEET MAIN CAST & CREW Title : Friday and Friday Antonythasan Jesuthasan Lawrence Valin Language : French, Tamil Johanna Bros Manmathan Basky Genre : Drama, society Runtime : 72’ Director : Sathapranavan (Sri Lanka / France) Tech. : 4K - 2:35 color - 5.1 audio Screenplay : Antonythasan Jesuthasan, Sathapranavan Date of conclusion : May 2018 Original music score : Antoine Duchêne Production : IBC Tamil - Da Xiongmao - Laïdak Films Director of photography : Thomas Migevant Countries : Sri Lanka – France – UK Sound mixer : Eric Gattat Chief editor : Julien Chardon Casting manager : Marie-Charlotte Crétey Written and main cast by Anthonythasan Jesuthasan Executive producers : Baskaran Kandiah, Johann Chapelan Best actor (ICS, INOCA, Césars) for Dheephan, Cannes Palme d’Or 2015 Associate producers : Antoine Liétout, Ivan Zuber STORYLINE La Chapelle, a vibrant melting-pot neighborhood in Paris, France. It is the Ganesh festival, elephant god of knowledge and obstruction. Tamil people are celebrating. With incense, drums and dancers, streets are submerged by the crowd. Wandering through the streets, a homeless Tamil drinks wine with illegal immigrants and gets some comfort with an old prostitute. During the day he is begging for money to his Tamil “brothers” and to French people. Bad tempered and bitter, he makes up any reasons to get some change. He then crosses the road of a young French-Tamil filmmaker, Sathis, seeking to win back Laure, the French woman he loves. Sathis tries to convince Laure to get back with him. She is pregnant and wants stability in her life. Despite many fails, Sathis continues to write screenplays. -

Attualità Cinema Musica Ritratti
20/10/2015 Da guerrigliero a scrittore fino alla Palma d'Oro, la storia di Antonythasan Jesuthasan: "A Parigi è molto forte l’'islamofobia'" Il Fatto Quotidiano Temi del Giorno IGNAZIO MARINO • IGNAZIO VISCO • LEGGE SEVERINO • MC DONALD'S • SONDAGGI ELETTORALI IlFattoQuotidiano.it / FQ Magazine / Cinema Attualità Cinema Musica Ritratti http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/17/daguerriglieroascrittorefinoallapalmadorolastoriadiantonythasanjesuthasanaparigiemoltofortelislamofobia/2136266/ 1/10 20/10/2015 Da guerrigliero a scrittore fino alla Palma d'Oro, la storia di Antonythasan Jesuthasan: "A Parigi è molto forte l’'Rislamiofotbiar'" aIl Fatto tQuiotidiano Cultura Stile •ULTIMA ORA• SEZIONI BLOG FATTO TV ABBONATI FQ SHOP PARTEC!PA Te×levi sioAcnceedi | Abbonamenti Cucina Da guerrigliero a scrittore Donne fino alla Palma d’Oro, la La Musica è storia di Antonythasan Lavoro Jesuthasan: “A Parigi è Segui FQ Magazine su: molto forte l’’islamofobia'” Mi piace 11mila Segui @FQMagazineit di Davide Turrini × FQmagazine.it 11.168 "Mi piace" "La vicenda raccontata in Dheepan è vera al 50%. Reale per tutto quello che ho passato tra la guerriglia, la fuga dallo Sri Lanka con un passMaip poiarcteo q ufeasltsao P,a giina Condividi lavori alla giornata nelle periferie francesi. Diversa da quella del film è invece Piace a 2 amici la visione che ho della vita”, spiega lo scrittore/attore a FQMagazine di Davide Turrini | 17 ottobre 2015 Annunci casa.it Condividi 7 Tweet 16 0 COMMENTI (3) 700mila immobili sul portale n 1 in Italia. -

Antonythasan Jesuthasan, Loin Des Tigres
Date : AVRIL 18 Page de l'article : p.17 Journaliste : Gladys Marivat Pays : FR Périodicité : Mensuel OJD : 52113 Page 1/1 L'INCONNU CÉLÈBRE Antonythasan Jesuthasan, loin des Tigres Réfugié en France pour fuir les guerres civiles de son pays, l'acteur tamoul couche sur le papier ses souvenirs et détaille la nouvelle vie qui s'est alors offerte à lui, à Paris. on nom ne vous dit peut-être rien maîs son visage, vous I avez son pere, la peur permanente d être certainement vu dans le magnifique Dheepan de Jacques retrouve par les Tigres, ses relations avec SAudiard Dans ce film, Palme d'or a Cannes en 2015, les prostituées, les déboires des militants Antonythasan Jesuthasan joue un ancien soldat des Tigres tamouls, et les astuces pour gagner un visa pour exile en France Un rôle semi-autobiographique pour l'acteur, ne l'Europe Dans chaque histoire, on sent au Sn Lanka, en 1967 Tres jeune, il a rejoint les rangs du mouve- le goût de l'écrivain pour l'ironie de la vie et un talent - une ment indépendantiste reclamant un Etat tamoul, dans le nord-est douceur même - pour dépeindre les vies méconnues des exiles de l'île Quand il décide de fuir l'organisation, desillusionne, il se tamouls Ainsi, Layla nous entraîne en Seine-Saint-Denis auprès réfugie en Asie du Sud-Est puis arrive en France en 1993 ou il d'une ancienne militante indépendantiste et Friday, dans le obtient l'asile politique À Sevran, il fait des petits boulots, puis quartier tamoul de la Chapelle, dans le nord de Paris Ravis, commence a écrire sous le nom de Shobasakhti Son oeuvre -

“Magnífica” Hermanos Coen “Una Obra Inmensa Y Poderosa” the Guardian “Absorbente Y Maestra” Screen International
Una producción WHY NOT PRODUCTIONS y PAGE 114 “MAGNÍFICA” HERMANOS COEN “UNA OBRA INMENSA Y PODEROSA” THE GUARDIAN “ABSORBENTE Y MAESTRA” SCREEN INTERNATIONAL PARIS MATCH TELERAMA L’EXPRESS THE GUARDIAN PALMA DE ORO FESTIVAL DE CANNES CON MARC ZINGA JOSÉPHINE DE MEAUX FRANCK FALISE BASS DHEM FAOUZI BENSAÏDI TASSADIT MANDI GUIÓN DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA EPONINE MOMENCEAU MONTAJE JULIETTE WELFLING © 2015 - WHY NOT PRODUCTIONS - PAGE 114 - FRANCE 2 CINEMA - FOTO : MARCEL HARTMANN 114 - FRANCE 2 CINEMA FOTO : WHY NOT PRODUCTIONS - PAGE © 2015 - NOÉ DEBRÉ THOMAS BIDEGAIN JACQUES AUDIARD MÚSICA ORIGINAL NICOLAS JAAR DIRECTOR DE ARTE MICHEL BARTHÉLÉMY (A.D.C.) COLABORACIÓN ARTÍSTICA HÉLÉNA KLOTZ VESTUARIO CHATTOUNE SONIDO DANIEL SOBRINO VALÉRIE DELOOF CYRIL HOLTZ CASTING PHILIPPE ELKOUBI MOHAMED BELHAMAR SCRIPT NATHALIE VIERNY 1ER AYUDANTE DE DIRECCIÓN JEAN-BAPTISTE POUILLOUX PRODUCTOR EJECUTIVO MARTINE CASSINELLI UNA CO-PRODUCCIÓN WHY NOT PRODUCTIONS PAGE 114 FRANCE 2 CINÉMA CON LA PARTICIPACIÓN DE CANAL + CINÉ + FRANCE TÉLÉVISIONS CON LA AYUDA DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE EN ASOCIACIÓN CON CINÉMAGE 9 A PLUS IMAGE 5 PALATINE ETOILE 12 INDÉFILMS 3 LA BANQUE POSTALE IMAGE 8 COFINOVA 11 SOFITVCINÉ 2 SOFICINÉMA 11 PRESSBOOK WWW.DHEEPAN.ES UGC presenta Una producción de PAGE 114 y WHY NOT PRODUCTIONS Duración : 1h54 ESTRENO 6 DE NOVIEMBRE 2015 DISTRIBUCIÓN VÉRTIGO FILMS PRENSA C/Carranza, 25. 7ª planta Borja Morais 28004 Madrid [email protected] T : 91 524 08 19 T : 91 524 08 19 SINOPSIS Huyendo de la guerra civil de Sri Lanka, un viejo soldado, una joven y una niña se hacen pasar por familia. Una vez refugiados en Francia, sin apenas conocerse, intentarán construir juntos un hogar. -

AMC River East 21 312-332-FILM
© Poster Design: Kuo-Crary Tsung-Hui 322 E. Illinois St. AMC River East 21 312-332-FILM Cinema/CHicago Presents 51st Chicago International Oct. 15-29, 2015 Fim Festival FESTIVAL AT A GLANCE chicagofilmfestival.com Clever - p. 17 The 33 - p. 12 Funny Girl - p. 20 Brooklyn - p. 15 A Perfect Day - p. 29 Carol - p. 16 Stinking Heaven - p. 31 Dheepan - p. 18 The Thin Yellow Line - p. 32 dAm I Am Michael - p. 23 Very Semi-Serious - p. 34 I Smile Back - p. 23 Walking Distance - p. 35 James White - p. 24 cMeY We Are Francesco - p. 35 Macbeth - p. 26 Bite - p. 15 All About Them - p. 13 Ludo - p. 26 Big Father, Small Father and Other Stories - p. 14 Other Madnesses - p. 29 Cuckold - p. 18 The Red Spider - p. 30 Neon Bull - p. 28 Tag - p. 32 tRiLe Orphans of Eldorado - p. 28 They Look Like People - p. 32 Tough Love - p. 33 Three Days in September - p. 32 XConfessions: A Conversation With Erika Lust - p. 36 sXy Why Me? - p. 35 CONTENTS 5 Welcome! 42 Travel Guide 7 Tickets & Passes 43 Hot Spots The Birth of Saké - p. 14 10 Opening Night 44 Education Program Breakfast at Ina’s - p. 15 11 Film Program Guide 45 Membership For Grace - p. 20 12-36 Film Guide: A to Z 45 Merchandise Open Tables - p. 28 Sweet Bean - p. 31 36 Closing Night 46-52 Daily Film Schedule 38 Industry Days 53 Film Index by Country fOd 39 Spotlight: Architecture 53 Film Index by Category 39 Panels & Tast of Cinema 54 Film Index by Theme 40 Short Films 55 Festival Partners BecaUse everYboDY loves movies! For over half a century, the Chicago International Film Festival has done our part to expand your cinematic horizons with entertaining, provocative, and illuminating selections from around the globe. -

Festival Catalogue 2015
Jio MAMI 17th MUMBAI FILM FESTIVAL with 29 OCTOBER–5 NOVEMBER 2015 1 2 3 4 5 12 October 2015 MESSAGE I am pleased to know that the 17th Jio MAMI Mumbai Film Festival is being organised by the Mumbai Academy of Moving Image (MAMI) in Mumbai from 29th October to 5th November 2015. Mumbai is the undisputed capital of Indian cinema. This festival celebrates Mumbai’s long and fruitful relationship with cinema. For the past sixteen years, the festival has continued promoting cultural and MRXIPPIGXYEP I\GLERKI FIX[IIR ½PQ MRHYWXV]QIHME TVSJIWWMSREPW ERH GMRIQE IRXLYWMEWXW%W E QYGL awaited annual culktural event, this festival directs international focus to Mumbai and its continued success highlights the prominence of the city as a global cultural capital. I am also happy to note that the 5th Mumbai Film Mart will also be held as part of the 17th Mumbai Film Festival, ensuring wider distribution for our cinema. I congratulate the Mumbai Academy of Moving Image for its continued good work and renewed vision and wish the 17th Jio MAMI Mumbai Film Festival and Mumbai Film Mart grand success. (CH Vidyasagar Rao) 6 MESSAGE Mumbai, with its legacy, vibrancy and cultural milieu, is globally recognised as a Financial, Commercial and Cultural hub. Driven by spirited Mumbaikars with an indomitable spirit and great affection for the city, it has always promoted inclusion and progress whilst maintaining its social fabric. ,SQIXSXLI,MRHMERH1EVEXLM½PQMRHYWXV]1YQFEMMWXLIYRHMWTYXIH*MPQ'ETMXEPSJXLIGSYRXV] +MZIRXLEX&SPP][SSHMWXLIQSWXTVSPM½GMRHYWXV]MRXLI[SVPHMXMWSRP]FI½XXMRKXLEXE*MPQ*IWXMZEP that celebrates world cinema in its various genres is hosted in Mumbai. -
Filmekimi 2015 Istanbul.Indd
3--11 Ekim 2015 filmekimi.iksv.org filmekimi_ilan_mobil_edit.pdf 1 10/09/15 16:20 Vodafone Red'in katkılarıyla yenilenen ücretsiz İKSV Mobil 3--11 Ekim 2015 uygulamasıyla Filmekimi’ni ve filmekimi.iksv.org tüm İKSV etkinliklerini daha yakından ve kolayca takip edebilir, kendi takviminizi oluşturabilir ve anlık kampanyalardan haberdar olabilirsiniz. C M Y CM MY CY CMY K Bu etkinlik 5224 sayılı yasa gereğince Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’ndan alınan izinle düzenlenmektedir. MANTIKSIZ ADAM İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 14. Filmekimi’nin IRRATIONAL MAN gerçekleştirilmesine büyük destek sağlayan Yönetmen Director: woody allen TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Oyuncular Cast: emma stone, joaquın Telif Hakları Genel Müdürlüğü, TC İstanbul Valiliği, phoenıx, parker posey, jamıe blackley ABD USA / 2015 / DCP / Renkli Colour / 95’ TC İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TC Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu Belediyesi’ne teşekkür eder. The Istanbul Foundation for Culture and Arts would like to thank the ▪ Mantıksız Adam, Woody Allen’ın benzersiz dünya görüşünün katıksız bir temsili: “Varoluşun Ministry of Culture and Tourism,General Directorate of Cinema, tamamen anlamsız bir sıradanlık olduğuna inancım sonsuz” diyor büyük yönetmen. “Zihni kaşıyan gerilim dolu bir film” sözleriyle övülen Mantıksız Adam’ın merkezinde yaşama arzusunu General Directorate of Copyright, Governorship of Istanbul, yeniden kazanmak isteyen felsefe profesörü Abe Lucas var. Hayatta ne zevk ne de bir anlam Istanbul Provincial Directorate of Culture and Tourism, bulamayan Abe, duygusal açıdan dibe vurmuştur. Ders vermeye başladığı küçük bir kasabadaki üniversitede iki kadınla yakınlaşır: Mutsuz evliliğinde debelenen öğretim üyesi Rita ile en iyi Metropolitan Municipality of Istanbul, Beyoğlu District Office, öğrencisi Jill. -

Antonythasan Jesuthasan, Loin Des Tigres
« Et quand l’histoire, en cours d’adaptation cinématographique, prend le tour d’une sublime réflexion sur le pouvoir de la littérature, on ressent la joie immense d’avoir découvert une voix rare et précieuse. » Gladys Marivat, Lire « Qu’il évoque la ville de Jaffna, au nord du Sri Lanka, ou le quartier tamoul de La Chapelle, à Paris, on est pris à chaque fois dans une histoire haletante et minutieusement ciselée… Ces nouvelles donnent envie de découvrir le reste de l’œuvre… » Florence Noiville, Le Monde des Livres « Antonythasan Jesuthasan, acteur principal de Dheepan, prouve qu’il est aussi un écrivain. » Sean J. Rose, Livres Hebdo « On en sort secoués mais assurés d’avoir lu la prose tout à la fois poétique et percutante d’un grand écrivain. » Laurence Péan, La Croix « Friday et Friday est l’œuvre d’un écrivain dont le courage d’outrepasser les tabous et de faire connaître la vérité n’a d’égal que le talent poétique et l’art de créer des personnages puissants par leur vulnérabilité, inoubliables par leur résilience (...) » Anne-Frédérique Hébert- Dolbec, Le Devoir « Auteur de fiction original et moderne (...) » Tirthankar Chanda, RFI « Ce recueil de six nouvelles, souvent métaphoriques […], n’en est que plus précieux et éclairant. Il est, en plus, porté par un style magnifique, révélant un grand écrivain traduit ici pour la première fois. » Frédéric L’Helgouach, La Revue des ressources L'OBS Pays : France Date : 03/09 MAI 18 Périodicité : Hebdomadaire Page de l'article : p.90 OJD : 359285 Journaliste : AMANDINE SCHMITT Page 1/1 s'y faire sardonique, comme dans « le Che- valier de Kandi », qui reprend une trame de Tolstoï pour suivre l'histoire d'un comité central de pieds nickelés n'ayant pas les moyens de faire exécuter son pri- sonnier. -

DHEEPAN Un Film De / a Film by Jacques Audiard
UGC PRÉSENTE / UGC PRESENTS UNE PRODUCTION PAGE 114 ET WHY NOT PRODUCTIONS / A WHY NOT PRODUCTIONS AND PAGE 114 PRODUCTION DHEEPAN Un film de / A film by Jacques Audiard Durée / Running time : 1h50 Sortie le 26 août 2015 / French release date: August 26th, 2015 - UGC Matériel téléchargeable sur www.ugcdistribution.fr / Press kit and images downloadable from www.wildbunch.biz DISTRIBUTION FRANCE INTERNATIONAL SALES PRESSE FRANCE UGC DISTRIBUTION CELLULOID DREAMS MARIE-CHRISTINE DAMIENS 24, avenue Charles-de-Gaulle HENGAMEH PANAHI 06 85 56 70 02 92200 Neuilly-sur-Seine [email protected] [email protected] Tél. : 01 46 40 46 89 WILD BUNCH JULIE BEAULIEU [email protected] Cannes Sales Office 06 77 29 26 46 st A Cannes : 4 La Croisette - 1 floor [email protected] Villa UGC (In front of the Palais) 67 La Croisette Phone: +33 4 93 68 62 33 Tél. : 04 92 18 44 90 VINCENT MARAVAL & NOEMIE DEVIDE [email protected] INTERNATIONAL PRESS CAROLE BARATON & OLIVIER BARBIER MAGALI MONTET [email protected] +33 6 71 63 36 16 EMILIE SERRES [email protected] [email protected] DELPHINE MAYELE SILVIA SIMONUTTI +33 6 60 89 85 41 [email protected] [email protected] Synopsis Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une petite fille se font passer pour une famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer. To escape the civil war in Sri Lanka, a former soldier, a young woman and a little girl pose as a family. -

CONTENTS Festival Map Marquee Events 101 Talks, Workshops
CONTENTS 2 4 6 Forewords SWF Commission SWF Stage 16 18 22 Exhibitions Programmes: Programmes: 4 November 5–6 November 64 84 126 Programmes: Programmes: Country Focus: 7–11 November 12–13 Novmber Japan 131 139 193 Malay Conference Authors and SWF Programmes and Literary Pioneers Presenters for the Deaf 198 200 203 Visitor information Festival Map Acknowledgments INFORMATION IS CORRECT AS OF 5 OCTOBER. REFER TO SINGAPOREWRITERSFESTIVAL.COM FOR LATEST UPDATES. LEGEND Marquee 101 Talks, Workshops Family-friendly events events & Masterclasses (spot the events in different colours for easy reference!) Transcending Fun & Surprising Language and Genre Pop-ups FOREWORD The ritual is familiar to Singaporeans. Standing at a school assembly or a public function, you’d sing the lyrics of community tunes. They include 'Xiao Ren Wu De Xin Sheng' (Voices From The Heart), 'Munnaeru Vaalibaa' (Forward O Youth) and yes, 'Rasa Sayang' (Loving Feeling). Memories of belting out that last song welled up while my team and I were planning this year’s Singapore Writers Festival. But do we really know what the song means? Are we paying lip service to multi-lingualism, of getting to know each other? That is why we chose Sayang as the theme for this year’s festival. Found in Malay, Tagalog, Sundanese and various languages of the Malay Archipelago, the word ‘sayang’ means love and tenderness. Significantly, it also refers to regret Yeow Kai Chai and pity, delivered with a wistful sigh. We savour the nuances, its shades of loves Festival Director and losses. The word provides the guiding principle for our programming: What do we love and what sacrifices have we made? We are heartened, for instance, that you have embraced our inter-disciplinary approach last year, and we continue to do so this year, with productions, collaborations and lectures. -
Umberto Eco: „Informa]Ia Trebuie Filtrat\“ Drago[ Cojocaru
PRIMUL MAGAZIN CULTURAL DIN ROMÂNIA » APARE SÂMB|TA » WWW.SUPLIMENTULDECULTURA.RO 1,5 LEI ANUL XI » NR. 485 » 30 mai – 5 iunie 2015 » S\pt\mânal realizat de Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“ » [email protected] Bookfest 2015. Politicienii, cei mai vizibili CANNES 2015: autori R\zvan Chiru]\ un palmares surprinz\tor Dintre cele circa 300 de eveni- mente anun]ate de organizatori `n cadrul Salonului Interna - ]ional de Carte, desf\[urat la Romexpo, doar opt au fost dedi- cate lans\rii unor volume scri - se de politicieni sau despre po - liticieni. Dar apari]ia pe pia]\ a acestora a monopolizat, aproa - pe, relat\rile din presa cotidi- an\ despre Bookfest. Cronic\ de Cotroceni, cartea scris\ de Adriana S\ftoiu [i ap\rut\ la Editura Polirom, a fost, f\r\ `n - do ial\, volumul momentului la Bookfest 2015. » pag. 2-3 Umberto Eco: „Informa]ia trebuie filtrat\“ Drago[ Cojocaru ~n noul s\u roman, Num\rul zero (ap\rut `n colec]ia „Biblioteca Polirom“, `n traducerea din limba italian\ [i notele {tefaniei Mincu), Umberto Eco atac\ cu vitriol mass media, construind un por tret foar - te pu]in flatant presei scrise. „Este un portret de un grotesc absolut al unui ziar prost care se ded\ la [an- taje, cu ziari[ti rata]i“, admite au- torul la lansarea edi]iei `n limba Anun]area Palme d’Or-ului a uimit pe toat\ lumea. ~n acest an nu a existat un film care s\ francez\ a c\r]ii. concentreze simpatia unanim\ a presei, a[a cum s-a `ntâmplat cu ~n clas\/ Entre les murs `n » pag. -

Foreign Rights List General Fiction + Non-Fiction Fall 2017 2 Seas Literary Agency Inc
Foreign Rights List General Fiction + Non-Fiction Fall 2017 2 SEAS LITERARY AGENCY INC. 1129 Maricopa Hwy, Suite 175 Ojai, California 93023, USA MARLEEN SEEGERS, OWNER [email protected] CHRYSOTHEMIS ARMEFTI, JUNIOR AGENT [email protected] (based in Portugal) facebook.com/2seasagency twitter.com/2seasagency www.2seasagency.com The information in this catalog is accurate as of September 12, 2017. www.allary-editions.fr Founded in 2014, Allary Éditions is an independent trade publisher. Following a strict editorial selection process, we publish no more than 20 titles per year. Our authors build an oeuvre, and include Diane Brasseur, Raphaël Glucksmann, Alexandre Lacroix, Charles Pépin, Bernard Pivot, Matthieu Ricard, and Riad Sattouf. Our books provide reading pleasure while enriching the reader at the same time. 3 MATTHIAS DEBUREAUX Matthias Debureaux is the editor-in-chief of Citizen K magazine. His most recent book is How to Bore People with Your Travel Stories (De l’art d’ennuyer en racontant ses voyages, Allary Éditions 2015); more information on this title below. Essay | Humor NEVER PUT OFF TIll TomoRROW WHAT YOU CAN DO THE DAY AFTER TomoRROW JUST AS WEll A book that has the power to make you totally Orig. Title: Pourquoi remettre au idle and carefree. lendemain ce qui peut être fait le surlendemain? MATTHIAS DE BUREAUX “Tomorrow is often the busiest day of the week,” so POURQUOI REMETTRE Orig. Language: French AU LENDEMAIN CE QUI says a Spanish proverb. To which Mark Twain replies: PEUT ÊTRE FAIT Orig. Publisher: Allary Editions LE SURLENDEMAIN ? “Never put off till tomorrow what you can do the day 100 pp.