Ii - Analyses Et Restitution Des Resultats Des Tests D ’Inventaire
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
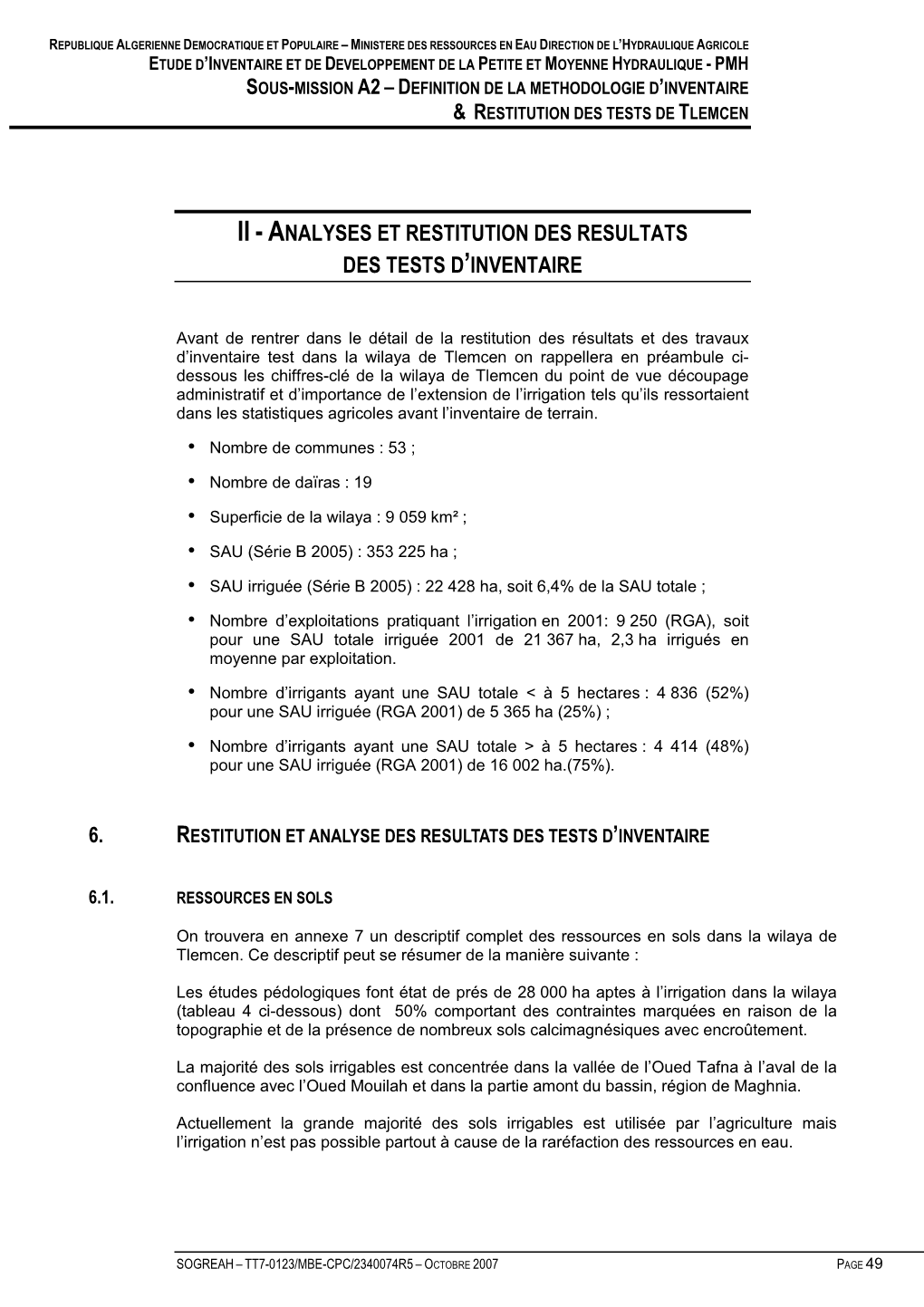
Load more
Recommended publications
-

Journal Officiel Algérie
N° 64 Dimanche 19 Safar 1440 57ème ANNEE Correspondant au 28 octobre 2018 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale.................................. 1090,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction...... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d'expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 19 Safar 1440 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 octobre 2018 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 18-262 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant ratification du protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali sur l'échange de connaissances et d'expériences dans le domaine juridique et judiciaire, signé à Alger, le 15 mai 2017............... -

Rapport Sur Les Priorités Et La Planification Année 2021
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère des Ressources en Eau Rapport sur les priorités et la planification Année 2021 Volume 2 Octobre/ 2020 Table des matières Contenu Section 1. Message du ministre .......................................................................................4 1.1 Message du ministre ...................................................................................................4 1.2 Déclaration du Secrétaire Général ..............................................................................5 Section 2. Au sujet du portefeuille...................................................................................6 2.1 La mission ...................................................................................................................6 - Production de l’eau domestique, industrielle et agricole, y compris la production et l’utilisation de l’eau de mer dessalée, de l’eau saumâtre et des eaux usées Épurées ;6 2.2 Le ministère ................................................................................................................7 2.3 Fiche Portefeuille ........................................................................................................9 Gestionnaire responsable : Ministre des Ressources en Eau ...............................................9 2.4 Planification des activités pour l’année 2021 ...........................................................11 Section 3. Planification détaillée du programme 01 ......................................................12 -
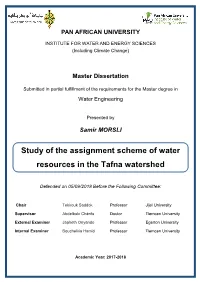
MT-Samir MORSLI.Pdf (4.618Mb)
PAN AFRICAN UNIVERSITY INSTITUTE FOR WATER AND ENERGY SCIENCES (Including Climate Change) Master Dissertation Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master degree in Water Engineering Presented by Samir MORSLI Study of the assignment scheme of water resources in the Tafna watershed Defended on 05/09/2018 Before the Following Committee: Chair Tekkouk Saddok Professor Jijel University Supervisor Abdelbaki Chérifa Doctor Tlemcen University External Examiner Japheth Onyando Professor Egerton University Internal Examiner Bouchelkia Hamid Professor Tlemcen University Academic Year: 2017-2018 Study of the assignment scheme of water resources in the Tafna watershed Declaration I SAMIR MORSLI, hereby declare that this thesis represents my personal work, realized to the best of my knowledge. I also declare that all information, material and results from other works presented here, have been fully cited and referenced in accordance with the academic rules andethics Signed Date 31/07/2018 SAMIR MORSLI This thesis has been submitted for examination with our approval as the University supervisor. Signature Date31/07/2018 Prof. ABDELBAKI CHERIFA Study of the assignment scheme of water resources in the Tafna watershed Dedication It is with the help of all powerful that I come to term of this modest work that I dedicate: To those who have cared for me since my birth to make me a person full of love for science and knowledge; my dear parents who have been able to give me happiness, Who knew how to guide my steps towards a safe future, who have never stopped encouraging me to undertake these studies and achieve this goal. -
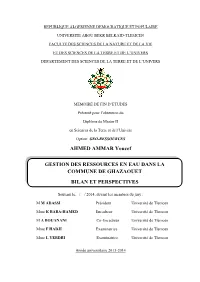
AHMED AMMAR Youcef GESTION DES RESSOURCES EN EAU
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE UNIVERSITE ABOU BEKR BELKAID-TLEMCEN FACULTE DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE ET DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS MEMOIRE DE FIN D’ETUDES Présenté pour l’obtention du Diplôme de Master II en Sciences de la Terre et de l’Univers Option: GEO-RESSOURCES AHMED AMMAR Youcef GESTION DES RESSOURCES EN EAU DANS LA COMMUNE DE GHAZAOUET BILAN ET PERSPECTIVES Soutenu le, / / 2014, devant les membres du jury : M M ADASSI Président Université de Tlemcen Mme K BABA-HAMED Encadreur Université de Tlemcen M A BOUANANI Co-Encadreur Université de Tlemcen Mme F HADJI Examinatrice Université de Tlemcen Mme L YEBDRI Examinatrice Université de Tlemcen Année universitaire 2013-2014 Je dédie ce modeste travail : A ceux qui ont tout sacrifié pour moi depuis mon enfance et qui ont tout fait pour ma formation, chers parents vous avez toute la gratitude. A mes frères et mes chères sœurs, A toute ma famille et mes amis. REMERCIEMENTS Tout d’abord, je remercie ALLAH tout puissant de m’avoir donnée la force et les moyens pour accomplir ce modeste travail. Je tiens à remercier vivement Mme K. BABA-HAMED et Mr A. BOUANANI mes encadreurs, qui ont donné un sens à mon travail grâce à leurs conseils et leurs orientations significatives. Je remercie aussi M M. ADASSI, pour m’avoir fait l’honneur de présider le jury et les membres du jury, Mesdames F.HADJI et L.YEBDRI qui ont accepté d’examiner ce travail et lui apporter un plus. -

Télécharger Article
مجلة هيرودوت للعلوم اﻹنسانية و اﻻجتماعية المجلد5/ العدد 1 )2021(....ص -22 111 Les concepts de l’occupation du sol en Algérie tude d’Anthropologie sociale dans la Trara oriental Land use concepts in Algeria: Study of social anthropology in the Eastern Trara Benslimane Abdennour * Faculté de droit et sciences politiques, Spécialité : Anthropologie- Université de Saida, Algérie. [email protected] تاريخ القبول: 32/23/0303 تاريخ اﻻستﻻم: 02/30/0302 تاريخ النشر: 0302/30/03 Résumé : Notre recherche a pour but d’analyser des concepts de l’occupation du sol qui en découlent dans la région de la Trara oriental. On a constaté qu’il y avait deux types de droits : Droit traditionnelle qui a vécu dans la période précoloniale et a été basé sur plusieurs sources comme (la décision du conseil et la présence de confrérie …),et le Droit coutumier qui a apparait bien dans la période coloniale et qui a été basé sur le système ancestrale et qui a pris le mode d’une légitimité auquel les individus ont recours pour revendiquer leurs droits d’appropriation du sol , cette dernière a causé des conflits entre les paysans au sujet de l’occupation des terroirs et qui demeure jusqu’à nos jours dans les régions montagnardes. Mots clés : concepts - occupation- sol- anthropologie-Algérie. Abstract: Our research aims to analyze concepts of land use resulting from this in the trara region. It was found that there were two types of rights: traditional law that lived in the pre- colonial period and was based on several sources such as (the council's decision and the presence of the confrerie ..), and customary law that It has appeared well in the colonial period and has been based on the ancestral system and has taken the mode of a legitimacy that individuals use to claim their rights of land appropriation. -

Chapitre I Généralité Sur Le Bassin Versant De La Tafna
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة اﻟﺘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻌــــــﻠﻴـــــــــﻢ اﻟﻌــــــــــــــــــــــــــــــﺎﱄ واﻟﺒــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺤﺚ اﻟﻌــــــــــــــــــــﻠــــــﻤــــــــــــﻲ Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ﺟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻣﻌﺔ أﰊ ﺑــﻜــــــــــــﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻳﺪ– ﺗـــــــﻠﻤﺴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎن – Université Aboubakr Belkaïd– Tlemcen – Faculté de TECHNOLOGIE MEMOIRE Présenté pour l’obtention du diplôme de MASTER En : Hydraulique Spécialité : Hydraulique urbaine Par : Chaib Draa Tani Meriem Acteurs de l’eau et leurs interactions dans la gestion de l’eau au niveau du bassin versant Tafna Soutenu publiquement, le / 06 / 2019, devant le jury composé de : M CHERIF Z. M A. (A) Univ. Tlemcen Président M MEGNOUNIF A. Professeur Univ. Tlemcen Encadreur Mme BOUKLI HACENE CH. M C. (A) Univ. Tlemcen Co-encadreur M BESSEDIK M. M C. (B) Univ. Tlemcen Examinateur Melle FANDI W. M A. (A) Univ. Tlemcen Examinatrice Année Universitaire 2018-2019 REMERCIMENTS Ce mémoire n’aurait pas été possibles sans l’intervention, conscientes, d’un grand nombre de personnes que je souhaite remercier dans cette modeste page. Je tiens d’abord à remercier très chaleureusement mes parents et toute ma famille. Je tiens aussi à remercier du fond de mon cœur Madame Boukli Hacene Cherifa et Monsieur Megnounif Abdeslam, qui m’ont permis de bénéficier de leur encadrement. Les conseils qu’ils m’ont prodigués, la patience, la confiance qu’ils ont témoignée ont été déterminants dans la réalisation de mon travail. Mes remerciements s’étendent également à Mr Cherif Zinedine président du jury, Mr Bessedik Madani et Melle Fandi Wassila examinateurs qui ont bien accepté de juger mon travail. Mes remerciements vont aussi à tous mes enseignants du Département d’Hydraulique. -

Plan Développement Réseau Transport Gaz Du GR TG 2017 -2027 En Date
Plan de développement du Réseau de Transportdu Gaz 2014-2024 N°901- PDG/2017 N°480- DOSG/2017 CA N°03/2017 - N°021/CA/2017 Mai 2017 Plan de développement du Réseau de Transport du Gaz 2017-2027 Sommaire INTRODUCTION I. SYNTHESE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT I.1. Synthèse physique des ouvrages I.2. Synthèse de la valorisation de l’ensemble des ouvrages II. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES RESEAUX GAZ II.1. Ouvrages mis en gaz en 201 6 II.2. Ouvrages alimentant la Wilaya de Tamanrasset et Djanet II.3. Ouvrages Infrastructurels liés à l’approvisionnement en gaz nature l II.4. Ouvrages liés au Gazoduc Rocade Est -Ouest (GREO) II.5. Ouvrages liés à la Production d’Electricité II.6. Ouvrages liés aux Raccordement de la C lientèle Industrielle Nouvelle II.7. Ouvrages liés aux Distributions Publiques du gaz II .8. Ouvrages gaz à réhabiliter II. 9. Ouvrages à inspecter II. 10 . Plan Infrastructure II.1 1. Dotation par équipement du Centre National de surveillance II.12 . Prévisions d’acquisition d'équipements pour les besoins d'exploitation II.13 .Travaux de déviation des gazoducs Haute Pression II.1 4. Ouvrages en idée de projet non décidés III. BILAN 2005 – 201 6 ET PERSPECTIVES 201 7 -202 7 III.1. Evolution du transit sur la période 2005 -2026 III.2. Historique et perspectives de développement du ré seau sur la période 2005 – 202 7 ANNEXES Annexe 1 : Ouvrages mis en gaz en 201 6 Annexe 2 : Distributions Publiques gaz en cours de réalisation Annexe 3 : Distributions Publiques gaz non entamées Annexe 4 : Renforcements de la capacité des postes DP gaz Annexe 5 : Point de situation sur le RAR au 30/04/2017 Annexe 6 : Fibre optique sur gazoducs REFERENCE Page 2 Plan de développement du Réseau de Transport du Gaz 2017-2027 INTRODUCTION : Ce document a pour objet de donner le programme de développement du réseau du transport de gaz naturel par canalisations de la Société Algérienne de Gestion du Réseau de Transport du Gaz (GRTG) sur la période 2017-2027. -

Complexe Touristique À Bider 2018
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Université Abou Bekr Belkaid Faculté de technologie Département D’Architecture MÉMOIRE DE MASTER EN ARCHITECTURE OPTION : Habitat et nouvelles technologies THEME : VERS UNE NOUVELLE FORME DE STRUCTURE HOTELIERE A BIDER Présenté par : - Melahi Ahmed Soutenance le 24/juin/2019 devant le jury composé de : Mr. D. Melih Architecte Univ. Tlemcen Président Mr. S. KHARBOUCHE MCB Univ. Tlemcen Examinateur Mr. M. BENAMMAR MAA Univ. Tlemcen Examinateur Mr. I. DIDI MAA Univ. Tlemcen Encadreur Année universitaire : 2018/2019 Tourisme COMPLEXE TOURISTIQUE A BIDER 2018 - 2019 Je remercie tout d’abord mon DIEU tout puissant et miséricordieux, de m’avoir guidé et mis sur le chemin du savoir, m’a inspiré les bon pas et les justes et reflexes et me donnant le courage, la force et la patience pour faire aboutir ce travail. Ce travail n’aurait jamais vu le jour sans l’aide précieuse de certaines personnes à qui je voudrais témoigner toute ma reconnaissance. Mes plus profonds remerciements vont à mes parents, ils m’ont toujours soutenu, encouragé et aidé. Ils ont su me donner toutes les chances pour réussir, qu’ils trouvent dans la réalisation de ce travail, l’aboutissement de leurs efforts ainsi que l’expression de ma plus affectueuse gratitude. Je tiens aussi à exprimer mes grands remerciements et ma profonde gratitude à mon encadreur Mr DIDI vos précieux conseils, vos explications, orientation, et votre aide durant toute la période de la réalisation de ce travail étaient d’un grand apport pour sa finalisation. -

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 Octobre 2018
N° 64 Dimanche 19 Safar 1440 57ème ANNEE Correspondant au 28 octobre 2018 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale.................................. 1090,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction...... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d'expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 19 Safar 1440 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 octobre 2018 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 18-262 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant ratification du protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali sur l'échange de connaissances et d'expériences dans le domaine juridique et judiciaire, signé à Alger, le 15 mai 2017............... -

Apport Du Modèle WEAP Dans L'étude Prospective De La Balance Offre/Demande En Eau Dans Le Bassin Versant De La Tafna
اجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــهـــــوريـــــــــــــــــــة اجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائـــريـــــة الدميـــــــــــــــــــــــــــــقـــراطــيـــــة الـــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــبـــيـــــة REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــليـــــــــم العــــــــــــــــــــــــــــــايل والبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحث العــــــــــــــــــــلــــــمــــــــــــي Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة أيب بــكــــــــــــر بــــلــــقـــــــايــد – تـــــــلمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان – Université Aboubakr Belkaïd – Tlemcen – Faculté de TECHNOLOGIE MEMOIRE Présenté pour l’obtention du diplôme de MASTER En : Hydraulique Spécialité : Hydraulique Urbaine Par : BADRAOUI Abderrahim TIAR Sidi Mohamed Sujet Apport du modèle WEAP dans l’étude prospective de la balance offre/demande en eau dans le bassin versant de la Tafna Soutenu publiquement, le 29 / 06 / 2019 devant le jury composé de : Mme. BENSAOULA FOUZIA Présidente Mr. BOUANANI ABDERRAZEK Examinateur Mr. BOUCHELKIA HAMID Examinateur Mr. BESSEDIK MADANI Encadreur Mme. BOUKLI HACENE CHERIFA Co-encadreur Promotion : 2018 - 2019 -

1-Les Monts De Tlemcen
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherch e scientifique UNIVERSITE ES- SENIA ORAN La république algérienne démocratique et populaire FACULTEMinistère DESde l’enseignement SCIENCES supérieur et de DEPARTEMENT la recherche scientifique DE BIOLOGIE LABORATOIRE D’ECOPHYSIOLOGIE VEGETALE THESE Présentée par : Melle BILEM Amel Pour obtenir le grade de : MAGISTERE en Biologie Ecole Doctorale Option : Biodiversité végétale méditerranéenne Contribution à l’étude histologique du Chamaerops humilis L. : Approche comparative des peuplements des Monts de Traras et des Monts de Tlemcen Soutenu devant la commission d’examen : Mr BELKHODJA Moulay Professeur Université Es Senia Oran Président Mr HASNAOUI Okkacha Maitre de Conférences Université de Saida Encadreur Mr HADJAJ Aouel Seghir Professeur Université Es Senia Oran Examinateur Mr BOUAZZA Mohamed Professeur Université A.B.B Tlemcen Examinateur 2011/2012 Dédicace Au terme de ce travail je remercie dieu le tout puissant pour m’avoir donné le courage, la volonté et la patience pour la réalisation de ce travail. Je le dédie à mes très chers parents qui m’ont encouragé durant toutes mes années d’études et je leur souhaite une vie pleine de joie et de bonheur. A mon frère IBRAHIM, AYOUB et l’’ adorable petite INES.A toute ma famille, à tous mes enseignants, aux étudiants de ma promotion ainsi à tous le pers onnel de département de Tlemcen, le département d’Oran et à tous mes amis (es). Amel BILEM Remerciements L'essentiel du travail de terrain qui a conduit à la réalisation de cette thèse a été dans les monts de Tlemcen et les monts de Traras. -

Ms.Hyd.Ayad+Bensaoula.Pdf
اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــهـــــوريـــــــــــــــــــة اجلــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــزائـــريـــــة الدميـــــــــــــــــــــــــــــقـــراطــيـــــة الــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــبـــيـــــة REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــليـــــــــم العــــــــــــــــــــــــــــــايل و البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحث العــــــــــــــــــــلــــــمــــــــــــي Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة أيب بــكــــــــــــر بــــلــــقـــــــايــد– تـــــــلمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان – Université Aboubakr Belkaïd– Tlemcen – Faculté de TECHNOLOGIE MEMOIRE Présenté pour l’obtention du diplôme de MASTER En : Hydraulique Spécialité : Hydraulique urbaine Par : AYAD Abdellatif Farouk & BENSAOULA Mohammed Said Etude des performances de fonctionnement d’une station de dessalement d’eau de mer : cas de la SDEM de Honaine Soutenu publiquement, le 04 / 06 / 2019, devant le jury composé de : M HABI M. Professeur Univ. Tlemcen Président M CHIBOUB A. Professeur Univ. Tlemcen Examinateur M BESSEDIK M. Maître-conférence B Univ. Tlemcen Examinateur M BOUMEDIENE M. Maître-conférence B Univ. Tlemcen Encadreur M BEDDIAF A. Ingénieur SDEM Honaine Co-encadreur Année Universitaire 2018-2019