Thesis Reference
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
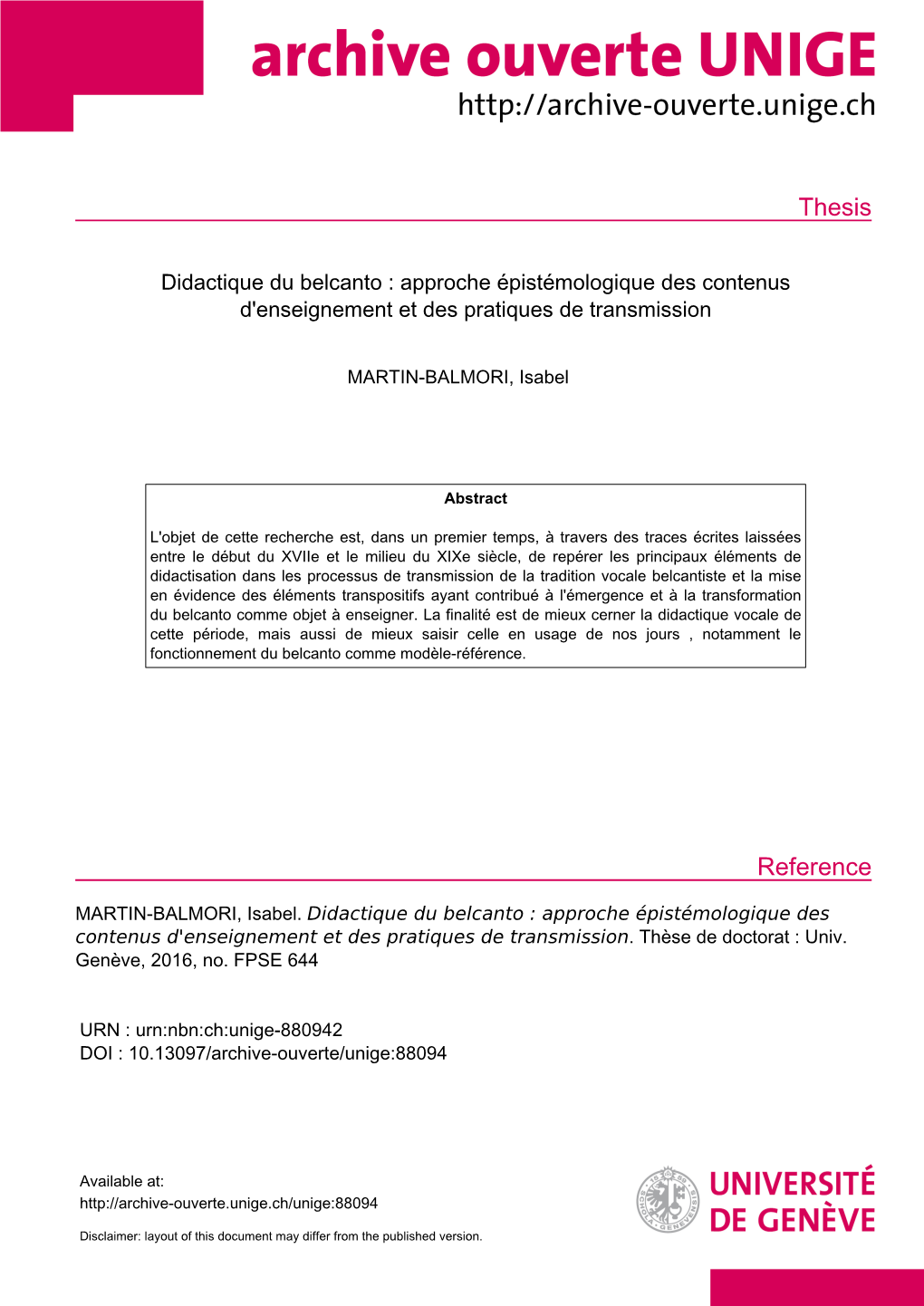
Load more
Recommended publications
-

Eugène Onéguine
Eugène Onéguine Véra deALbordeaux Vignette de couverture : Duel entre Onéguine et Letiski. Aquarelle de I. E. Repine. Opéra de Bordeaux Eugène Onéguine Scènes lyriques en trois actes et sept tableaux Livret de Piotr llyitch Tchaïkovski et de Constantin Chilovski d'après le poème d'Alexandre Pouchkine Musique de Piotr llyitch Tchaïkovski Editions Breitkopf et Hdrtel Production du Théâtre du Capitole de Toulouse Direction musicale : Louis Langrée Mise en scène : Nicolas Joël Réalisée par : Arnaud Bernard Décors et costumes : Hubert Monloup Lumières : Allain Vincent Chorégraphie réalisée par : Andrée Renard Madame Larina : Hanna Schaer Tatiana : Mireille Delunsch Olga : Wendy Hoffman (8, 10, 13 juin), Jolana Fogasova (16, 19, 22 juin) Filipievna : Irina Bogatcheva Eugène Onéguine : Jason Howard Lenski : Clifton Forbis Le prince Gremine : Michael Druiett Monsieur Triquet : Charles Buries Un capitaine : Bernard Auzimour Zarestski : Daniel Ottevaere Un paysan : Bruno Moga Chœur de l'Opéra de Bordeaux Direction : Gunter Wagner Ballet de l'Opéra de Bordeaux Orchestre National Bordeaux Aquitaine Première le 8 juin 1997 Grand-Théâtre Bordeaux ? Louis Langrée Direction musicale Élu «Révélation musicale de l'an née 1994», Louis Langrée compte Ballet de l'Opéra de Bordeaux parmi les valeurs les plus sûres de la nouvelle génération de chefs d'orchestre. Après plusieurs postes de chef de chant et d'assistant Acte I : (Opéra de Lyon, Festival d'Aix-en- Provence, Salvatore Gagliardi Théâtre du Châtelet, Festival de Bayreuth), il devient l'assistant de -

Staged Treasures
Italian opera. Staged treasures. Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini and Gioacchino Rossini © HNH International Ltd CATALOGUE # COMPOSER TITLE FEATURED ARTISTS FORMAT UPC Naxos Itxaro Mentxaka, Sondra Radvanovsky, Silvia Vázquez, Soprano / 2.110270 Arturo Chacon-Cruz, Plácido Domingo, Tenor / Roberto Accurso, DVD ALFANO, Franco Carmelo Corrado Caruso, Rodney Gilfry, Baritone / Juan Jose 7 47313 52705 2 Cyrano de Bergerac (1875–1954) Navarro Bass-baritone / Javier Franco, Nahuel di Pierro, Miguel Sola, Bass / Valencia Regional Government Choir / NBD0005 Valencian Community Orchestra / Patrick Fournillier Blu-ray 7 30099 00056 7 Silvia Dalla Benetta, Soprano / Maxim Mironov, Gheorghe Vlad, Tenor / Luca Dall’Amico, Zong Shi, Bass / Vittorio Prato, Baritone / 8.660417-18 Bianca e Gernando 2 Discs Marina Viotti, Mar Campo, Mezzo-soprano / Poznan Camerata Bach 7 30099 04177 5 Choir / Virtuosi Brunensis / Antonino Fogliani 8.550605 Favourite Soprano Arias Luba Orgonášová, Soprano / Slovak RSO / Will Humburg Disc 0 730099 560528 Maria Callas, Rina Cavallari, Gina Cigna, Rosa Ponselle, Soprano / Irene Minghini-Cattaneo, Ebe Stignani, Mezzo-soprano / Marion Telva, Contralto / Giovanni Breviario, Paolo Caroli, Mario Filippeschi, Francesco Merli, Tenor / Tancredi Pasero, 8.110325-27 Norma [3 Discs] 3 Discs Ezio Pinza, Nicola Rossi-Lemeni, Bass / Italian Broadcasting Authority Chorus and Orchestra, Turin / Milan La Scala Chorus and 0 636943 132524 Orchestra / New York Metropolitan Opera Chorus and Orchestra / BELLINI, Vincenzo Vittorio -

CATALOGUE OK.Indd
FERRI M. Bernard Lecomte Expert DROUOT-RICHELIEU Salle9- DROUOT-RICHELIEU MARDI 24 NOVEMBRE 2009 MARDI 24NOVEMBRE MARDI 24 NOVEMBRE 2009 DROUOT-RICHELIEU - Salle 9 Ventes aux Enchères et Expertises PREMIÈRE PARTIE : À 14 H JEAN-ÉMILE LABOUREUR (1877 – 1943) Bel ensemble de dessins, peintures, gravures et livres illustrés. ESTAMPES par : Expert : BONNARD, LAUTREC, RENOIR, VILLON M. Bernard LECOMTE Exposition privée chez l’expert, sur rendez-vous, 17, rue de Seine du mercredi 18 au jeudi 19 novembre de 14 h à 18 heures et le 75006 Paris vendredi 20 de 10 h à 12 heures. Tel. / Fax. 01 43 26 85 47 DEUXIÈME PARTIE : À 15 H 30 COLLECTION DE M. RAOUL OREILLE : CENT ANS D’OPÉRA EN 2000 PHOTOS (de 1880 à 1980) Les plus célèbres chanteurs photographiés à Paris, Milan, Vienne, Bayreuth, Munich et New York, par : NADAR - REUTLINGER - BOYER - BERT - BENQUE - ERLANGER DE ROSEN - HARCOURT - ERMINI - CRIMELLA - PICCAGLIANI - VERANI - HOUSTON ROGERS - DIETRICH - FAYER - LAUTERWASSER - BETZ - MELANSON - ETC... Célébrités de la Belle Époque et stars de cinéma des années 1920 à 1940. La plupart des photos dédicacées ou signées. Vente aux enchères publiques DROUOT - RICHELIEU - 9, rue Drouot - 75009 Paris Marc FERRI MARDI 24 NOVEMBRE 2009 A 14 H - Salle 9 Commissaire-Priseur judiciaire Expositions publiques à l’hôtel Drouot, salle 9 : Le lundi 23 novembre, de 11 à 18 h, le matin de la vente, de 11 à 12 h. Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 09 FERRI & Associés 53, rue Vivienne - 75002 Paris - Tél. 01 42 33 11 24 - Fax. 01 42 33 40 00 E-mail : [email protected] - www.ferri-drouot.com Œuvres de Jean-Émile LABOUREUR 1 Note : les dimensions sont exprimées en millimètres, la hauteur précédant la largeur. -

WERTHER Jules Massenet (1842-1912)
Brandon Jovanovich et Nora Gubisch en répétition 3 WERTHER Jules Massenet (1842-1912) Nouvelle production avec Brandon Jovanovich Werther Drame lyrique en 4 actes et 5 tableaux Nora Gubisch Charlotte Livret Edouard Blau, Paul Milliet et Georges Hartmann, René Schirrer Le Bailli d’après Goethe Hélène Guilmette Sophie Présenté pour la première fois à Vienne le 16 février 1892 Pierre Doyen Albert Jacques Calatayud Johann Direction musicale Alain Altinoglu Christophe Mortagne Schmidt Mise en scène Yves Beaunesne Yves Vandenbussche Brühlmann Décors Damien Caille-Perret Dorothée Pinto Käthchen Lumières Joël Hourbeight / Jean-Pascal Pracht Costumes Patrice Cauchetier Max Calimez, Maeva Descamps, Manon Dubois, Coline Collaboration artistique à la mise en scène Jean Gaudin Fertin, Florence Gourlet, Alexandre Lacomblez, William Assistante à la mise en scène Janick Moisan Ockenden Les enfants Deuxième assistant à la mise en scène Augustin Debiesse Chef de chant Nathalie Steinberg orchestre national de lille / région nord-pas de calais — Maîtrise Boréale Chef de choeur Eric Deltour — Production Opéra de Lille — Durée 2h40 avec entracte 4 orchestre national de lille / région nord-pas de calais direction jean-claude casadesus violon solo altos flûtes trombones fernand iaciu paul mayes chrystel delaval christian briez jean-marc lachkar pascal langlet alain vernay violons jean-paul blondeau raphaël patrix marc crenne anne le chevalier hautbois (trombone basse) françois cantault lionel part daniel pechereau alexandre diaconu chantal saradin philippe gérard -

Verdi's Don Carlo
Verdi’s Don Carlo: a partial survey of the discography by Ralph Moore Introduction The CLOR discography lists 165 recordings of Don Carlo (or should that be Don Carlos? - more of that anon). A couple of live recordings in German were made before the first one in Italian, live from the Met 1950, with a cast headed by Jussi Bjőrling, then there was a whole slew of live and radio recordings throughout the 50’s from the Met and various Italian opera houses, punctuated by the first studio account conducted by Santini in Rome in 1954, with a stellar (and Stella) cast including Gobbi and Christoff. This still stands up remarkably well despite its age and some casting weakness. Santini was again at the helm for the next studio recording in 1961 with an even finer cast, then Solti recorded the Five Act version for Decca in 1965. For so great and popular an opera, Don Carlo has received very few studio recordings; Giulini followed in 1971, Karajan in 1978, Abbado in 1983-84, Levine in 1992 and Haitink in 1996. Only Abbado’s was in French, and Richard Farnes recorded an English version for Chandos in 2009. Thus, so far, we have had a grand total of only nine studio versions: seven in Italian, one in English and only one of the original French version, yet the catalogue is teeming with live performances. No survey can encompass so many, nor have I considered DVDs. However, I assess below some twenty-seven audio accounts, having restricted my choice to the nine studio recordings plus a sampling of live performances, including the three live recordings of original Five Act versions in French; the rest are variously either of the Four or Five Act versions in Italian. -
![Known Also As Louis Victor Franz Saar [Lôô-Ee Veek-TAWR FRAHNZ SAHAHR]](https://docslib.b-cdn.net/cover/3525/known-also-as-louis-victor-franz-saar-l%C3%B4%C3%B4-ee-veek-tawr-frahnz-sahahr-4563525.webp)
Known Also As Louis Victor Franz Saar [Lôô-Ee Veek-TAWR FRAHNZ SAHAHR]
Saar C Louis Victor Saar C LOO-uss VICK-tur SAR C (known also as Louis Victor Franz Saar [lôô-ee veek-TAWR FRAHNZ SAHAHR]) Saar C Mart Saar C MART SAHAHR Saari C Tuula Saari C TÔÔÔÔ-lah SAHAH-rih Saariaho C Kaija Saariaho C KAHIH-yah SAHAH-rihah-haw C (known also as Kaija Anneli [AHN-neh-lih] Saariaho) Saavedra C Ángel Pérez de Saavedra C AHN-hell PAY-rehth day sah-VAY-drah Sabaneyev C Leonid Sabaneyev C lay-ah-NYITT sah-bah-NAY-eff C (known also as Leonid Leonidovich [lay-ah-NYEE-duh-vihch] Sabaneyev) Sabata C Victor de Sabata C VEEK-tohr day sah-BAH-tah C (known also as Vittorio de Sabata [veet-TOH-reeo day sah-BAH-tah]) Sabater C Juan María Thomas Sabater C hooAHN mah-REE-ah TOH-mahss sah-vah-TEHR C (known also as Juan María Thomas) Sabbatini C Galeazzo Sabbatini C gah-lay-AHT-tso sahb-bah-TEE-nee Sabbatini C Giuseppe Sabbatini C joo-ZAYP-pay sah-bah-TEE-nee Sabbatini C Luigi Antonio Sabbatini C looEE-jee ahn-TAW-neeo sahb-bah-TEE-nee Sabbato sancto C SAHB-bah-toh SAHNK-toh C (the Crucifixion before Easter Sunday) C (general title for individually numbered Responsoria by Carlo Gesualdo [KAR-lo jay-zooAHL- doh]) Sabin C Robert Sabin C RAH-burt SAY-binn Sabin C Wallace Arthur Sabin C WAHL-luss AR-thur SAY-binn Sabina C Karel Sabina C KAH-rell SAH-bih-nah Sabina C sah-BEE-nah C (character in the opera La fiamma [lah feeAHM-mah] — The Flame; music by Ottorino Respighi [oht-toh-REE-no ray-SPEE-ghee] and libretto by Claudio Guastalla [KLAHOO-deeo gooah-STAHL-lah]) Sabio C Alfonso el Sabio C ahl-FAWN-so ell SAH-veeo Sacchetti C Liberius Sacchetti C lyee-BAY-rihôôss sahk-KAY-tih Sacchi C Don Giovenale Sacchi C DOHN jo-vay-NAH-lay SAHK-kee Sacchini C Antonio Sacchini C ahn-TAW-neeo sahk-KEE-nee C (known also as Antonio Maria Gasparo Gioacchino [mah-REE-ah gah-SPAH-ro johahk-KEE-no] Sacchini) Sacco C P. -

Franco Corelli
FRANCO CORELLI THE PERFORMANCE ANNALS 1951-1981 EDITED BY Frank Hamilton © 2003 http://FrankHamilton.org [email protected] sources Gilberto Starone’s performance annals form the core of this work; they were published in the book by Marina Boagno, Fr anco Corelli : Un Uomo, Una Voce, Azzali Editori s.n.c., Parma, 1990, and in English translation Fr anco Corelli : A Man, A Voice, Baskerville Publishers, Inc., Dallas, 1996. They hav ebeen merged with information from the following sources: Richard Swift of New York and Michigan has provided dates and corrections from his direct correspodence with the theatres and other sources: Bologna (Letter from Teatro Comunale: 5/16/86); Bussetto (see Palermo); Catania (L: Teatro Massimo Bellini: 5/26/86); Enghien-les- Bains (see Napoli); Genoa (L: L’Opera de Genoa: 5/13/86); Hamburg (L: Hamburgische Staatsoper: 5/15/86); Lausanne (L: Theatre Municipal, Lausanne: 5/12/86); Lisbon (L: Teatro Nacional São Carlos: 1986); Livorno (L: Comune di Livorno: 5/31/87); Madrid (L: Teatro Nacional de La Zarzuela: 1/26/87); Modena (L: Comune di Modena: 10/16/87); Napoli (Il Mondo Lirico); Nice (L: Opera de Nice: 5/2/86, 8/5/88); Palermo (L: Teatro Massimo: 6/10/86, 10/13/88); Piacenza (L: Comune di Piacenza u. o. Teatro Municipale: 6/10/86); Rome (Opera Magazine); Rovigo (L: Accademia dei Concordi, Rovigo: 11/11/86, 2/12/87); San Remo (L: Comune di San Remo: 11/8/86); Seattle (Opera News 11/1967); Trieste (L: Teatro Comunale: 4/30/86). The following reference books are listed alphabetically by venue. -

01 07 2019 V 1 Crq Editions Latest Complete Catalogue
1 CRQ EDITIONS – CATALOGUE @ 01.07.2019 Please Note: All CDs listed are now out of print. CD issues 1-100 are available as downloads at: https://crqeditions.bandcamp.com/ DVD-ROMs are available as physical product via postal delivery from the address below Books are available either as physicl product via postal delivery from the address below or as free downloads at http://crqeditions.co.uk/crqeditions.php#Books CRQ Editions, 39. Banner Cross Road, Sheffield S11 9HQ, South Yorkshire, United Kingdom. Website: https://crqeditions.co.uk/ CD catalogue Verdi: Ernani (abridged) Iva Pacetti / Antonio Melandri / Gino Vanelli / Corrado Zambelli / Ida Mannarini / Aristide Baracchi / Giuseppe NessiChorus and Orchestra of La Scala, Milan / Lorenzo Molajoli Recorded in Milan in 1930 by the Columbia Graphophone Company. A superb example of operatic performance in Milan during the inter-war years - never before released on CD. Classic Record Quarterly Editions CRQ CD001 (1 CD) Tchaikovsky: Symphony No. 6 in B minor, ‘Pathétique’, Op. 74 London Philharmonic Orchestra / Sir Adrian Boult The 1959 Miller International recording, with correct stereo channels applied. Boult in masterly form in repertoire not recorded by him elsewhere. Classic Record Quarterly Editions CRQ CD002 (1 CD) Homage to Mogens Wöldike Danish State Radio Chamber Orchestra / Mogens Wöldike J. C. Bach: Sinfonia in B flat major Op. 18 No. 2; F. J. Haydn: Divertimento in G major; F. J. Haydn: Six German Dances; W. A. Mozart: Symphony No. 14 in A major, K. 114; K. D. von Dittersdorf: Symphony in C major Originally recorded by Decca and HMV. A representative programme demonstrating the genius of one of the early pioneers of period performance practice. -

Télécharger Un Extrait
Gerard Lecaillon Denise Scharley de l'Opéra de Paris Une vie de contralto © Gerard Lecaillon, 2020 ISBN numérique : 979-10-262-4081-5 Courriel : [email protected] Internet : www.librinova.com Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Merci à ma sœur Sylvie Noliac pour sa précieuse collaboration. « La voix de Denise Scharley, avait la séduction de ces fleurs vénéneuses et fascinantes. Séduction particulière au mezzo qui est souvent la voix de la fatalité. » – Martial Henri Claverie, Spécialiste de la musique et de l’opéra PRÉFACE de Jean-Jacques Hanine-Roussel, Docteur en Etudes Italiennes, Docteur d’État en Droit français, Dottore in Giurisprudenza Italiana, Historien de l’Opéra, Ancien Avoué près la Cour d’Appel de Paris Ma première rencontre avec Denise Scharley remonte à 1972. J’avais été invité par un ami à assister à la première des Dialogues des Carmélites au Palais Garnier. Il s’agissait de la reprise de l’ouvrage de Francis Poulenc, dont la mise en scène par Raymond Rouleau suscita tant de critiques. La distribution était moins brillante que celle de la création : outre Denise Scharley, il y avait parmi les principales interprètes Suzanne Sarroca, Michèle Vilma, Régine Crespin et Eliane Lublin dirigées par Georges Prêtre, que les critiques n’épargnèrent pas. -

Chant, Musique Et Spectacle Lettres Et Manuscrits Autographes
Expert Thierry BODIN, Les Autographes Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art 45, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris Tél. : + 33 (0)1 45 48 25 31 - Fax : + 33 (0)1 45 48 92 67 [email protected] JEUDI 28 févrIEr 2013 à 14 heures vente aux enchères publiques SALLE DES vENTES fAvArT 3, rue favart - 75002 Paris Chant, muSiquE Et SpECtaClE Abréviations : L.A.S. ou P.A.S. lettres et manuscrits autographes, iconographie, documents et souvenirs lettre ou pièce autographe signée L.S. ou P.S. os lettre ou pièce signée Collection Claude-pascal perna (n 1 à 218) (texte d’une autre main ou dactylographié) os L.A. ou P.A. et à divers amateurs (n 219 à 359) lettre ou pièce autographe non signée Expert Thierry BODIN, Les Autographes Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art 45, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris Tél. : + 33 (0)1 45 48 25 31 - Fax : + 33 (0)1 45 48 92 67 [email protected] Exposition privée sur rendez-vous chez l’expert Expositions publiques à la Salle des Ventes Favart Mercredi 27 février de 11 h à 18 h Jeudi 28 février de 10 h à 12 h Téléphone pendant l’exposition : 01 53 40 77 10 Catalogue visible sur www.ader-paris.fr Enchérissez en direct sur www.drouotlive.com ADER, Société de Ventes Volontaires - Agrément 2002-448 - Sarl au capital de 7 500 euros 3, rue Favart 75002 Paris - Tél. : 01 53 40 77 10 - Fax : 01 53 40 77 20 - [email protected] N° siret : 450 500 707 000 28 - TVA Intracom. -

The Operas of Charles Gounod by Nick Fuller
The Operas Of Charles Gounod by Nick Fuller I. Introduction Charles Gounod’s fame rests on one immortal opera, Faust . Roméo et Juliette and Mireille are regularly performed around the world, but many of his other operas were failures, did not hold the stage, or have been forgotten. Nevertheless, his music influenced and was admired by later generations of French composers. Debussy believed that Gounod represented an important stage in the evolution of French sensitivity, and that he modelled for an entire generation the principles of clarity, balance and suavity. Ravel held that the musical renaissance of his day began with Gounod. Saint-Saëns, Massenet and Bizet were his protégés and disciples, while Fauré admired him and César Franck considered Gounod his master. Reynaldo Hahn’s musical trinity was Mozart, Gounod and Saint-Saëns, and called Gounod the French Schubert and Schumann. Tellingly, most of these musicians were not primarily opera composers. It is, to be honest, more difficult to make the case for Gounod as an opera composer than it is for Meyerbeer or Massenet, who ruled the French lyric stage before and after him. Meyerbeer’s operas are rich and imaginative, while the quality and individuality of Massenet’s operas is astonishing. Although even his dramatically most feeble operas contain at least one delightful melody, Gounod’s operas are often less than the sum of their parts. What makes him a good composer of religious music or of mélodies makes him a weaker composer of opera. The problem, as Steven Huebner suggests, may be that Gounod was fundamentally not a dramatic composer; his tastes were too refined for the opera stage. -

Catalogue @ 01.08.2017
1 CRQ EDITIONS – CATALOGUE @ 01.08.2017 Verdi: Ernani (abridged) Iva Pacetti / Antonio Melandri / Gino Vanelli / Corrado Zambelli / Ida Mannarini / Aristide Baracchi / Giuseppe NessiChorus and Orchestra of La Scala, Milan / Lorenzo Molajoli Recorded in Milan in 1930 by the Columbia Graphophone Company. A superb example of operatic performance in Milan during the inter-war years - never before released on CD. Classic Record Quarterly Editions CRQ CD001 (1 CD) Tchaikovsky: Symphony No. 6 in B minor, ‘Pathétique’, Op. 74 London Philharmonic Orchestra / Sir Adrian Boult The 1959 Miller International recording, with correct stereo channels applied. Boult in masterly form in repertoire not recorded by him elsewhere. Classic Record Quarterly Editions CRQ CD002 (1 CD) Homage to Mogens Wöldike Danish State Radio Chamber Orchestra / Mogens Wöldike J. C. Bach: Sinfonia in B flat major Op. 18 No. 2; F. J. Haydn: Divertimento in G major; F. J. Haydn: Six German Dances; W. A. Mozart: Symphony No. 14 in A major, K. 114; K. D. von Dittersdorf: Symphony in C major Originally recorded by Decca and HMV. A representative programme demonstrating the genius of one of the early pioneers of period performance practice. Classic Record Quarterly Editions CRQ CD003 (1 CD) Verdi: Macbeth Margherita Grandi, Walter Midgley, Francesco Valentino, Italo Tajo Glyndebourne Festival Chorus, Scottish Orchestra / Berthold Goldschmidt, conductor Recording of the performance of 27th August 1947 given by Glyndebourne Festival Opera at the first Edinburgh Festival, First issued on ‘The Golden Age of Opera’ LPs by Ed Smith The ethos of the Weimar Republic’s Verdi revival, Glyndebourne’s exacting musical standards, and the occasion of the first Edinburgh Festival combine to create a memorable evening.