Quand Les Enfants De La Maison D'izieu Nous Parlent... (PDF)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
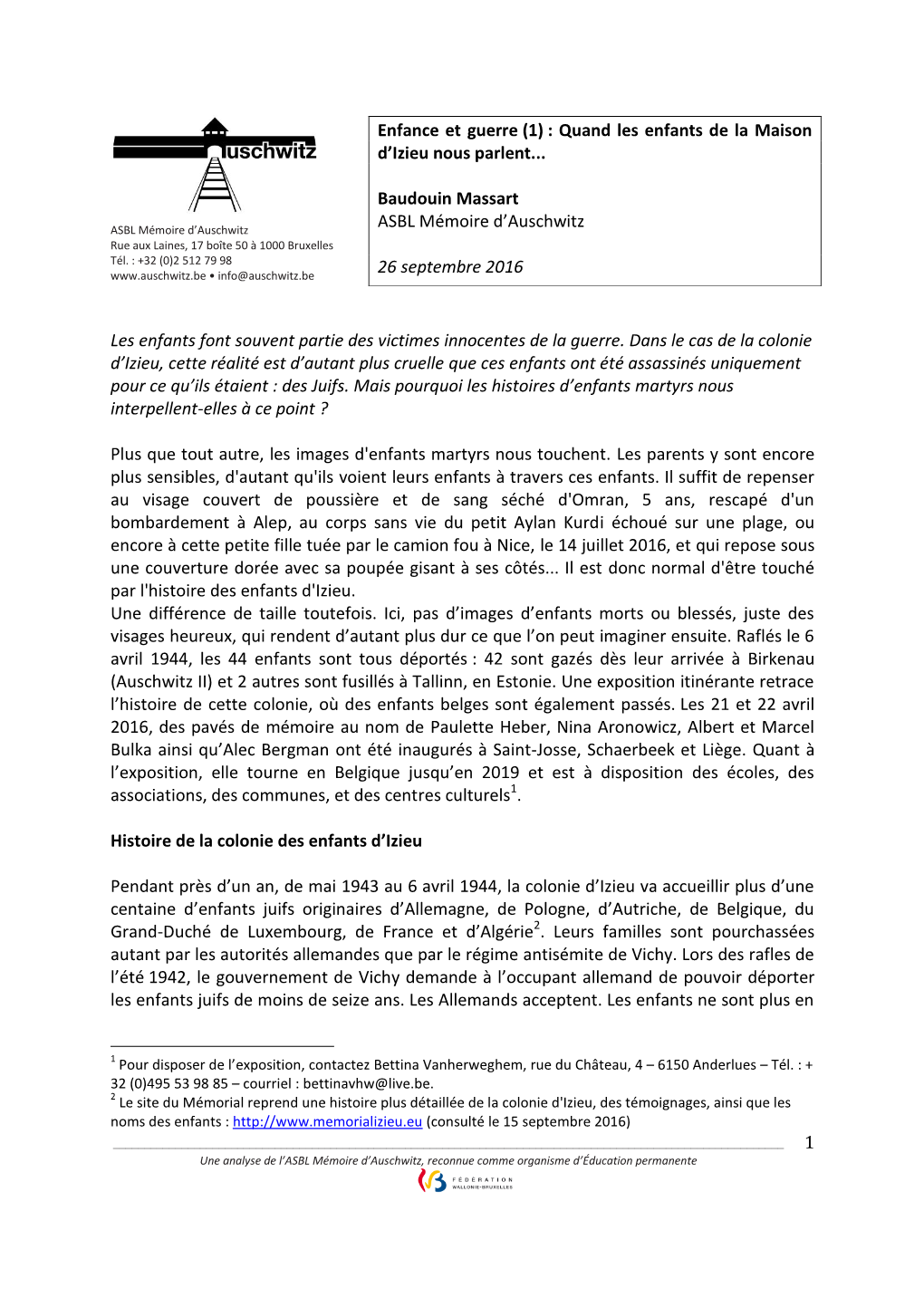
Load more
Recommended publications
-

Scheda Del Libro Realizzato Dall'istituto Storico E
NOVITÀ MARZO CHI VERREBBE A CERCARCI QUI, IN QUESTO POSTO ISOLATO? Izieu, una Colonia per bambini ebrei rifugiati - 1943-1944 192 pagine a colori, formato 22x23 cm oltre 120 illustrazioni, copertina cartonata PREZZO DI COPERTINA e 15,00 ISBN 978-88-96408-17-9 a cura di Stéphanie Boissard e Giulia Ricci Interventi di Cécile Kyenge, ministra per l’Integrazione e le Politiche Giovanili e di Jean-Christophe Bailly, filosofo Il libro narra le vicende della colonia per bambini ebrei di Izieu – un piccolo borgo francese a metà strada tra Chambéry e Lione – nel contesto sia della drammatica occupazione tedesca e italiana della Francia e delle deportazioni nei campi di sterminio, sia delle straordinarie azioni di solidarietà verso i perseguitati 32 CHI VERREBBE A CERCARCI QUI, IN QUESTO POSTO ISOLATO? LE VICENDE ITALO-FRANCESI DEL SECONDO CONFLITTO MONDIALE 1940-1944 33 messe in atto da tante persone e organizzazioni. 72 ze politiche e militari della Francia. La sua “rivoluzione tutta l’intenzione di rimettere in marcia il paese e dunque LES CAMPS D'INTERNEMENT ET DE DÉPORTATION all’apertura nel sud-ovest e alla frontiera con la Spagna nazionale” non tarda a rivelare in modo inequivocabile la si offrono a una collaborazione talvolta convergente su DES JUIFS (AOÛT 1942) di campi per rifugiati (Gurs, Septfonds, Saint-Cyprien, volontà esplicita di Vichy di inscriversi nella stessa rotta alcuni obiettivi, talaltra divergente e perciò costrittiva. Camps réservés aux internés juifs Argelès) e campi di internamento per “stranieri indeside- Una storia simile a quella italiana di Villa Emma di disegnata dal nazismo e dal fascismo, dai quali trae un Fino al 1942 Vichy pensa di disporre di un margine di CHI VERREBBE A CERCARCI QUI, IN QUESTO POSTO ISOLATO? Camps d’internement “mixtes” rabili” e residenti nemici (Rieucros, Les Milles, Le Vernet). -

Jerusalemhem Volume 80, June 2016
Yad VaJerusalemhem Volume 80, June 2016 Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Day 2016 (pp. 4-9) Yad VaJerusalemhem Contents Volume 80, Sivan 5776, June 2016 Inauguration of the Moshe Mirilashvili Center for Research on the Holocaust in the Soviet Union ■ 2-3 Published by: Highlights of Holocaust Remembrance Day 2016 ■ 4-5 Students Mark Holocaust Remembrance Day Through Song, Film and Creativity ■ 6-7 Leah Goldstein ■ Remembrance Day Programs for Israel’s Chairman of the Council: Rabbi Israel Meir Lau Security Forces ■ 7 Vice Chairmen of the Council: ■ On 9 May 2016, Yad Vashem inaugurated Dr. Yitzhak Arad Torchlighters 2016 ■ 8-9 Dr. Moshe Kantor the Moshe Mirilashvili Center for Research on ■ 9 Prof. Elie Wiesel “Whoever Saves One Life…” the Holocaust in the Soviet Union, under the Chairman of the Directorate: Avner Shalev Education ■ 10-13 auspices of its world-renowned International Director General: Dorit Novak Asper International Holocaust Institute for Holocaust Research. Head of the International Institute for Holocaust Studies Program Forges Ahead ■ 10-11 The Center was endowed by Michael and Research and Incumbent, John Najmann Chair Laura Mirilashvili in memory of Michael’s News from the Virtual School ■ 10 for Holocaust Studies: Prof. Dan Michman father Moshe z"l. Alongside Michael and Laura Chief Historian: Prof. Dina Porat Furthering Holocaust Education in Germany ■ 11 Miriliashvili and their family, honored guests Academic Advisor: Graduate Spotlight ■ 12 at the dedication ceremony included Yuli (Yoel) Prof. Yehuda Bauer Imogen Dalziel, UK Edelstein, Speaker of the Knesset; Zeev Elkin, Members of the Yad Vashem Directorate: Minister of Immigration and Absorption and Yossi Ahimeir, Daniel Atar, Michal Cohen, “Beyond the Seen” ■ 12 Matityahu Drobles, Abraham Duvdevani, New Multilingual Poster Kit Minister of Jerusalem Affairs and Heritage; Avner Prof. -

Mémoires De La "Dame D'izieu"
© Éditions Gallimard, 1992. AVANT-PROPOS Le livre de Sabine Zlatin est d'abord une leçon de vie. Née dans Varsovie occupée par les Russes, elle adhère en 1923 au Bund, l'union des ouvriers juifs de Pologne, de Litua- nie et de Russie, opposée à la fois aux mouvements bolcheviques et sionistes. A seize ans, elle sait déjà ce qu'est l'engagement et ce qu'est la prison. Elle est arrêtée lors d'une manifestation du 1er Mai des travailleurs pour la liberté. Sa décision est prise: vivre en France. C'est pour elle, comme pour tant d'humiliés au cœur de l'Europe, la patrie du Droit et de la Fraternité; celle qui, depuis 1789, a fait des juifs des citoyens libres et égaux. Au terme d'un long périple, seule, dépourvue de res- sources, elle parvient dans notre pays. Ce sont alors dix années de travail acharné pour bâtir, dans le Nord, avec son mari Miron Zlatin, une entreprise agricole. La guerre éclate. Elle choisit aussitôt d'être infirmière militaire de la Croix-Rouge. Son nouveau combat la conduit dans les sinistres camps d'Agde et de Rivesaltes où sont entas- sées, dans des conditions indignes, des familles de réfugiés. Elle y recueille des enfants juifs et crée la colonie d'Izieu dans l'Ain. Jour après jour, sans relâche, elle prodigue à ces enfants démunis de tout, séparés de leurs parents, hantés par le cauche- mar des camps, le réconfort et l'espérance. Le 6 avril 1944, les hommes de Barbie surgissent à Izieu. Quarante-quatre enfants sont déportés. -

Dossier De Presse
DOSSIER DE PRESSE 1987-2017 : il y a 30 ans, le procès Klaus BARBIE à LYON 1987-2017 : il y a 30 ans, le procès Klaus BARBIE à LYON Le 11 mai 1987, s’ouvrait à Lyon, devant la Cour d’Assises du Rhône, le procès de Klaus BARBIE Le 4 juillet 1987, au terme de 9 semaines de procès et plus de 6 heures de délibération, Klaus BARBIE, était reconnu coupable de 17 crimes contre l’humanité et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour arrestation et déportation de centaines de juifs de France et de résistants, notamment l’arrestation le 6 avril 1944 de 44 enfants juifs et 7 adultes à la maison d’Izieu et leur déportation au camp d’extermination d’Auschwitz. Ce chef d’accusation de crime contre l’humanité était retenu pour la première fois en France dans un procès. 30 ans après, plusieurs manifestations seront organisées tout au long de l’année 2017, pour entretenir la mémoire de ce procès hors norme, avec le soutien de l’Etat, de la Ville de Lyon, du département du Rhône, du CRIF Auvergne-Rhône- Alpes, du mémorial d’Izieu, du Mémorial national de la prison de Montluc, de l’association des Fils et Filles des déportés juifs de France, du Souvenir français, du Centre d’histoire de la résistance et de la déportation, des Archives départementales… • Edition d’une publication « Klaus BARBIE, un enfant du fanatisme » rédigée par Jean-Olivier VIOUT, Procureur général honoraire de Lyon Cet ouvrage, édité à plusieurs milliers d’exemplaires, sera mis à la disposition des collèges et lycées du département et des institutions et lieux de mémoire. -

Panneaux De L'exposition
Le département de l’Ain est le théâtre d’engagements continuels. Les forces de l’Intérieur bien commandées et organisées, dominent la situation. Elles le prouvent, le 11 novembre 1943 en occupant Oyonnax pendant toute cette journée de glorieux anniversaire. Là, le Colonel Romans-Petit les passe en revue devant le monument aux morts et les fait défiler à travers toute la ville au milieu de l’émotion populaire. « Pour réduire les maquis de l’Ain, les Allemands engagent, au début de 1944, d’importantes opérations qui leur coûtent plusieurs centaines de morts. En Avril, nouvel effort qu’ils doivent payer encore plus cher. En Juin, ce sont les nôtres qui prennent partout l’offensive, faisant 400 prisonniers… extrait des « Mémoires de Guerre » du général de Gaulle. Conseil général de l’Ain Conservation départementale des Musées de l’Ain Musée départemental d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de l’Ain et du Haut-Jura » 3 montée de l’abbaye 01130 Nantua tel : 04 74 75 07 50 www.musees.ain.fr temp_cartes 7/10/09 9:46 Page 1 LE DÉPARTEMENT DE L’AIN 1940-1943 Zone interdite le département de l'Ain en 1944 voie ferrée en 1944 Zone route nationale en 1944 libre ville importante ligne de démarcation zone d'occupation italienne à partir de novembre 1942 Altitude de 0 à 400 m de 400 à 600 m de 640 à 1000 m > 1000 m - Supprimer remerciements © IGN - BDCarto® - Ajouter « Cette exposition a été extraite à partir des éléments de © IGN - BDAlti® l’ouvrage « L’Ain 1939-1945 chemins de mémoire » qui à la manière Conseil général de l'Ain - Conservation départementale des musées DGAI - Service géomatique - 09/2009 d’un guide, vous invite dans un parcours mémoriel, à suivre les pas des résistants mais aussi à découvrir les traces sombres des victimes de la barbarie nazie et de la collaboration vichyste dans le département de l’Ain. -

Modélisation Du Fonctionnement Des Agrosystèmes Et Des Pathosystèmes Dans Un Contexte De Changement Climatique Marie Launay
Modélisation du fonctionnement des agrosystèmes et des pathosystèmes dans un contexte de changement climatique Marie Launay To cite this version: Marie Launay. Modélisation du fonctionnement des agrosystèmes et des pathosystèmes dans un con- texte de changement climatique. Sciences du Vivant [q-bio]. École doctorale 410 Sciences et Ingénierie des Ressources Naturelles (SIReNa), 2019. tel-02427243 HAL Id: tel-02427243 https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02427243 Submitted on 3 Jan 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Université de Lorraine AgroParisTech - Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement École doctorale 410 Sciences et Ingénierie des Ressources Naturelles (SIReNa) Modélisation du fonctionnement des agrosystèmes et des pathosystèmes dans un contexte de changement climatique Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme d’habilitation à Diriger des recherches par Marie Launay Ingénieur de Recherches à l’INRA Soutenu le 12 avril 2019 devant le jury composé de : Marie-Laure Desprez-Loustau, Directrice -

RAPPORT D'activites 2007 Assemblée Générale Du 18 Mai 2008
RAPPORT D’ACTIVITES 2007 Assemblée générale du 18 mai 2008 SOMMAIRE Rapport moral de la présidente 2 Disparition de Rénée Pallarés 5 Rapport d’activités de la directrice 7 Rapport d’activités du service pédagogique 12 La fréquentation en 2007 16 1 RAppORt MORAL DE LA pRéSIDENtE, HéLèNE WAYSBORD-LOINg Chaque année notre rencontre est l’occasion pour la Présidente de vous présenter le bilan et les perspec- tives de notre Maison de façon à vous donner en peu de temps une visibilité sur notre action. En raison du travail conduit par l’équipe, du soutien de la puissance publique et des besoins de l’actua- lité, l’année a été riche. Je la résumerai par deux mots, reconnaissance et développement. Comme vous pouvez le suivre d’après nos rapports, depuis plusieurs années, une conjonction bénéfique se réalise entre les orientations pédagogiques suivies dans cette Maison et les besoins de l’époque. En fidélité à notre vocation qui est de perpétuer la mémoire des 44 enfants juifs massacrés avec leurs éducateurs, le travail du Mémorial des Enfants d’Izieu est tourné vers la jeunesse, ouvert sur le monde et ses conflits. Il questionne le monde issu de la 2ème guerre mondiale. La découverte des horreurs de l’extermination a fait naître des institutions et des concepts destinés à en empêcher le retour : le crime contre l’humanité, les tribunaux internationaux, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme dont on va célébrer à l’automne le 60ème anniversaire. Le rapport d’activités qui vous a été fourni atteste du travail effectué par une équipe réduite, et du res- pect des missions qui résultent de l’histoire des Enfants juifs d’Izieu. -

Devoir De MÉMOIRE »1
132 CONTROVER ESS essais La MAISON D’IZIEU : la DÉROUTE du « devoir de MÉMOIRE »1 Muriel Darmon Psychiatre, membre de l’association La Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés. S i, jamais autant que ces dernières années, on n'a sacralisé, en France, le « devoir de mémoire » concernant la Shoah, paradoxalement, cette dernière décennie aura aussi vu naître une vague d’attaques sans précédent depuis la Seconde Guerre Mon- diale à l’encontre des Juifs, et à travers eux, de l’existence collective juive en France. Ce paradoxe qui se pose dans la société française existerait-il également au sein des grandes institutions consacrées à la mémoire de la Shoah ? Penchons- nous sur cette question à travers l’étude de la constitution d’un de ces lieux de mémoire nationale de la Shoah : la Maison d’Izieu. Nous étudierons en parti- culier, à partir d’ouvrages, de témoignages, de données recueillies lors de visites du site et des rapports d’activité de l’institution, la façon dont ce lieu de mémoire s’est constitué, les événements qui en ont marqué la création, ainsi que l’évo- lution de ses orientations2. Rappel historique : la Maison d’Izieu, un radeau dans la tourmente La Maison d’Izieu, créée en 1943 en zone d’occupation italienne, fut un des lieux où l’OSE (Oeuvre de Secours aux Enfants), association juive à caractère social et humanitaire, tenta d’organiser le sauvetage des enfants juifs fin 1942, lorsque ses « homes » établis en zone libre devinrent les cibles privilégiées de la Police Muriel Darmon CONTROVER ESS 133 française et de la Gestapo. -

Mémoires D'auschwitz
Mémoires d’Auschwitz d’hier et d’aujourd’hui Terminale Bac Pro Commerce Lycée Jean Jaurès, Grenoble 2009-2010 Nous sommes élèves en Terminale Bac Pro Commerce au lycée Jean Jaurès à Grenoble. Dans le cadre de notre cours d’histoire, nous avons étudié les totalitarismes, et particulièrement l’Allemagne nazie et le génocide juif. L’objectif de ce projet était de rendre compte d’un parcours de mémoires de la Shoah, des lieux et des personnes qui ont fait l’histoire, et de devenir à notre tour les relais de ces mémoires. Ce travail a commencé et s’est achevé par un témoignage, par la parole de ceux, Jules Fainzang et Yvette Lévy, dont la mémoire est à jamais inscrite dans les lieux que nous avons parcourus. Ces mémoires sont remplies de millions d’autres dont nous avons cherché à approcher la réalité et à percevoir l’écho. C’est la résonance de ces mémoires en nous que nous avons tenté de transmettre, de communiquer aux jeunes écoliers que nous avons accompagnés et qui nous ont accompagnés dans ce travail. Ce cheminement commun a enrichi petits et grands, et construit une part de la citoyenneté de chacun. La classe de Terminale Bac Pro Commerce 2009-2010 2 "Dans la haine nazie, il n’y a rien de rationnel […]. Nous ne pouvons pas la comprendre ; mais nous devons et nous pouvons comprendre d’où elle est issue et nous tenir sur nos gardes. Si la comprendre est impossible, la connaître est nécessaire parce que ce qui est arrivé peut recommencer, les consciences peuvent à nouveau être déviées et obscurcies : les nôtres aussi." Primo Levi, Si c’est un homme, 1947 (extrait de l’appendice de 1976). -
![[1° Facciata Depliant]](https://docslib.b-cdn.net/cover/5773/1%C2%B0-facciata-depliant-5355773.webp)
[1° Facciata Depliant]
Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère Association des Amis du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère I Musei della seconda guerra mondiale nelle Alpi occidentali tra passato e futuro 23, 24, 25, 26 NOVEMBRE 2005 TORINO/GRENOBLE Articolato in sei sedute consecutive, il convegno si è svolto in due tempi: • 23-24 novembre a Torino, presso il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà. • 25-26 a Grenoble, presso la Maison des Sciences de l’Homme, nel campus universitario. Sedi del Convegno TORINO 23-24 novembre Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà Palazzo dei Quartieri Militari Corso Valdocco, 4a (angolo via del Carmine) GRENOBLE 25-26 novembre Maison des Sciences de l’Homme-Alpes 1221 Avenue Centrale Domaine universitaire 38400 Saint-Martin-d’Hères 2 A sessant’anni dalla fine del secondo conflitto mondiale tre Paesi della regione alpina occidentale, l’Italia, la Francia, la Svizzera, mettono a confronto la rispettiva elaborazione della memoria di quegli eventi e le forme della sua rappresentazione. Dal confronto risultano realtà molto diverse: in Francia, dove si riscontra una fitta presenza di musei della Resistenza e della Deportazione, già da tempo è stato posto il problema del loro futuro e delle loro trasformazioni, dopo la fine dell’“era dei testimoni”. In Svizzera si supplisce in questi ultimi tempi, con frequenti e pregevoli mostre documentarie, a quella che può essere definita una “lacuna della memoria”. -

"Rue Sabine Et Miron Zlatin" À Lyon 7E
MF/MB SEANCE DU 2 AVRIL 2012 2012/4385 - PROJET DE DENOMINATION "RUE SABINE ET MIRON ZLATIN" A LYON 7E (DIRECTION DÉPLACEMENTS URBAINS) Le Conseil Municipal, Vu le rapport en date du 19 mars 2012 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : « La « Rue Sabine Zlatin », située à Lyon dans le 7e arrondissement (au Sud de l’avenue Berthelot, au niveau de la rue du Repos), a été dénommée suite au Conseil municipal du 14 septembre 2009. Sur proposition de Mme Haguenauer, Adjointe au Maire de Lyon déléguée à la Mémoire et aux anciens combattants, et en accord avec M. le Maire de la Ville de Lyon, il conviendrait de compléter la dénomination de cette voie. Je vous propose la dénomination suivante : - « Rue Sabine et Miron Zlatin » : située au Sud de l’avenue Berthelot, entre cette dernière et la rue du Repos (dans l’axe du boulevard des Tchécoslovaques et longeant les voies SNCF). Sabine Zlatin (1907-1996) et Miron Zlatin (1904-1944) : Fondateurs et directeurs de la Maison des Enfants d’Izieu. Née à Varsovie (Pologne), Sabine Chwast quitte son pays natal et arrive en France vers 1925 où elle rencontre Miron Zlatin, originaire de Russie et alors étudiant en agronomie à Nancy. Ils se marient et exploitent une ferme avicole à Landas (Nord). En 1939, Sabine Zlatin décide de suivre des cours de formation d’infirmière militaire à la Croix-Rouge à Lille. En 1940, le couple fuit pour Montpellier et entre en contact avec l’Œuvre de Secours aux Enfants (OSE). Sabine et Miron Zlatin s’installent ensuite à Izieu (Ain) et fondent la Colonie des Enfants d’Izieu qui abrite des enfants juifs orphelins. -

Why Are There So Many Diverse Holocaust Museums?: a Journey Through the Holocaust Museums of Five Nations
State University of New York College at Buffalo - Buffalo State College Digital Commons at Buffalo State History Theses History and Social Studies Education 12-2012 Why Are There So Many Diverse Holocaust Museums?: A Journey through the Holocaust Museums of Five Nations Marjorie E. Carignan State University of New York, Buffalo State College, [email protected] Advisor Cynthia Conides, Ph.D., Associate Professor First Reader Cynthia Conides, Ph.D., Associate Professor Second Reader John Abromeit, Ph.D., Assistant Professor Department Chair Andrew D. Nicholls, Ph.D., Professor of History To learn more about the History and Social Studies Education Department and its educational programs, research, and resources, go to http://history.buffalostate.edu/. Recommended Citation Carignan, Marjorie E., "Why Are There So Many Diverse Holocaust Museums?: A Journey through the Holocaust Museums of Five Nations" (2012). History Theses. 12. https://digitalcommons.buffalostate.edu/history_theses/12 Follow this and additional works at: https://digitalcommons.buffalostate.edu/history_theses Part of the History Commons, and the Jewish Studies Commons Why Are There So Many Diverse Holocaust Museums?: A Journey through the Holocaust Museums of Five Nations by Marjorie E. Carignan An Abstract of a Thesis in Museum Studies Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts December 2012 State University of New York College at Buffalo Department of History and Social Studies Education 1 Abstract of Thesis Holocaust museums around the world are unique in their respective missions, funding, architecture and exhibitions. Some of these distinctions are extreme, leaving museums seemingly opposites of each other. To better understand these diversities, this thesis analyzes Holocaust museums in France, Germany, Poland, Israel and the United States.