LA CHATRE Chli Um..Llan S Cfluib
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
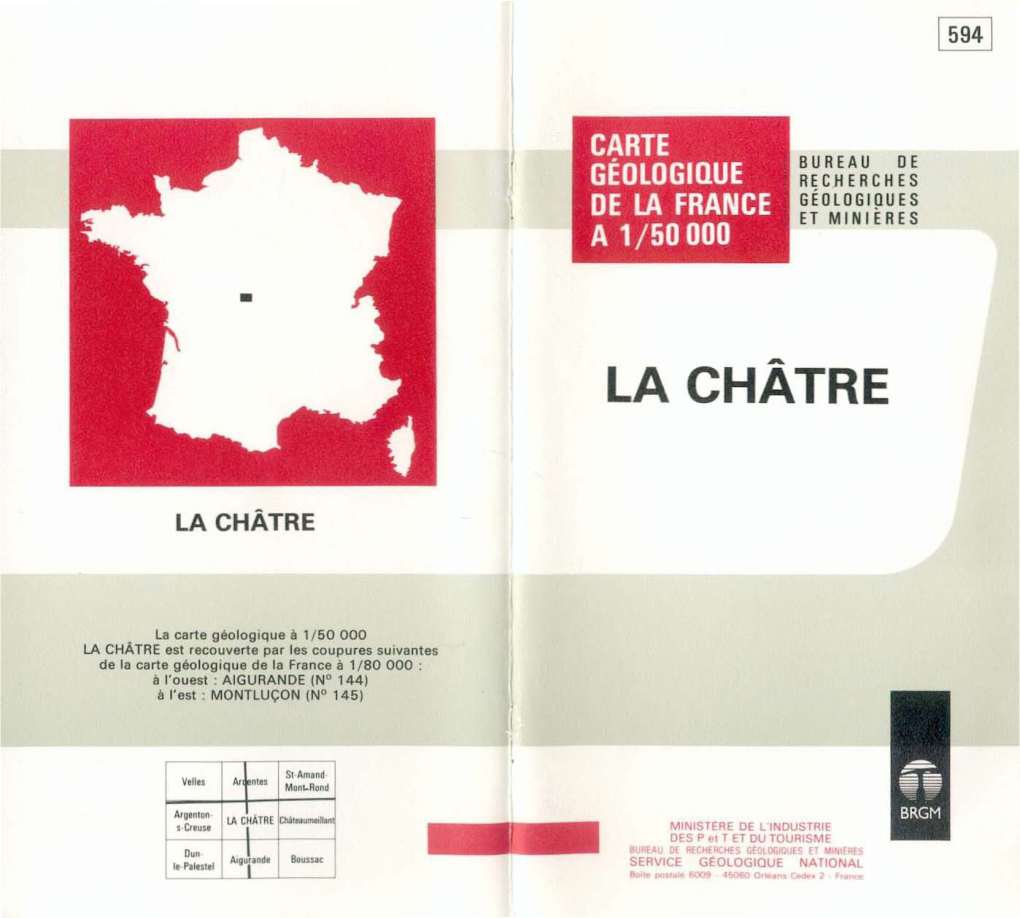
Load more
Recommended publications
-

Date Epoux Père Mère Ex
Date Epoux Père Mère Ex.conjoint Origine __________________________________________________________________________________________________________________________________ 30/06/1717 VERNEUIL BAIOUT André NOHANT 19/01/1783 Nicolas Georges GAYAT Marie MADRY Philippe +AUDEBERT Jean 22/01/1644 Pacquette VERNEUIL AUBOY Etienne MONTGIVRAY 22/11/1898 ABRIOUX Paul Antoine PERROCHON Marie THEVET ST JULIEN DAUDONNET Elise Marie Solange Silvain MARTINAT Marie VERNEUIL 23/05/1719 AGEORGES Jean Pierre Guillemette LOUROUER ST LAURENT BARONNET Anne Pierre PILLARD Marguerite VERNEUIL 21/02/1746 AGEORGES Jean +Jean BARONNET Anne ST CHARTIER GUILLEMAIN Françoise Philippe +CHEVRIER Marie 28/11/1747 AGEORGES Pierre +Jean BARONNET Anne VERNEUIL JOUHANNEAU Marie Silvain ALORY Elisabeth VERNEUIL 23/01/1720 AGOBERT Catherine Silvain Marie LAFORGE Chartier PUTTÉ LACS 22/01/1765 AGOBERT Catherine +Pierre PENEROUX Catherine MOREAU Bertrand +Thomas DEMAY Catherine 09/02/1719 AGOBERT Pierre ROUX Catherine +MAURIEN Henri VERNEUIL 04/09/1731 AGOBERT Pierre TINTURIER Marie PENEROUX Catherine Jean LA CHATRE 02/03/1734 AGOBERT Pierre +Silvain TINTURIER Marie VERNEUIL AUROY Silvaine +Thomas PICAUDAT Jeanne LA CHATRE 19/02/1737 AGOBERT Pierre +Pierre ROBIN Marie CHATELAIN Julienne +Jean BERTAUD Marie VERNEUIL 26/02/1781 ALABERGERE Etienne Julien +BAVOUZET Catherine VERNEUIL BONNIN Marie Georges LUNEAU Marie VERNEUIL 30/01/1816 ALADENISE François Léonard +LABONNE Catherine ST CHRISTOPHE EN BOUC SOULAT Marie Vincent BERNARDET Marguerite VERNEUIL 04/02/1873 ALADENISE Jules -

Date Epoux Pšre Mšre Ex
Date Epoux PŠre MŠre Ex.conjoint Origine __________________________________________________________________________________________________________________________________ 04/09/1798 Marie NAURIE Etiennette SAZERAY DUFOUR Jean Gilbert +BATE Marguerite POULIGNY NOTRE DAME 27/01/1859 ACLEMENT Jeanne +Antoine +PASQUET Marie +TOURTAT Barth‚l‚my FEUSINES PASQUET Gabriel +Georges +RAFINAT Anne +CHAUMETTE Fran‡oise POULIGNY NOTRE-DAME 25/06/1743 ACLEMENT Marguerite +Jean LHOPITAL Catherine BLAIRON Fran‡ois +Etienne ABONNET Marie POULIGNY NOTRE DAME 22/06/1751 ADENIS Solange Denis +COUTAND Marie CHASSIGNOLLES JACQUET Nicolas +GRANDEAU Jeanne POULIGNY NOTRE DAME 05/05/1764 ADENIS Solange +PAQUET Nicolas POULIGNY NOTRE DAME PIGOIS Pierre +Ren‚ RAGOT Aubine POULIGNY NOTRE DAME 27/04/1885 ADIAS Jean +Jacques CHAUVET Marie URCIERS PION Marie Enfant Naturel +PION Marie THEVET ST JULIEN 02/05/1881 ADIAS Philippe +Jacques CHAUVET Marie +AMARTIN Marie Anne FEUSINES DEFOUGERES Marie Pierre Napol‚on MERCIER Marie CREVANT 04/05/1773 AGENY L‚onard +LENOIRE Gabrielle BETETE DELIGNY Marie Jean +AUCLERE Marie POULIGNY NOTRE DAME 26/06/1787 AGEORGE Charles Charles +DUBUGET Marie POULIGNY NOTRE DAME LUCET Catherine POULIGNY NOTRE DAME 07/03/1791 AGEORGE Silvain +Antoine YVERNEAU Marie CREVANT BOURSEAU Marie Fran‡ois RAFINAT Anne POULIGNY NOTRE DAME 24/09/1877 AGEORGES Marguerite Germain PIROT Th‚rŠse CHASSIGNOLLES GAGNERAULT Jean Anatole Jean BERNARDET Jeanne LA CHATRE 07/05/1765 AGERMAIN Fran‡oise Claude VORNET Marguerite POULIGNY NOTRE DAME DELIGNY Henry Jean -

Relevé Des Contrats De Mariage
Relevé des contrats de mariage Série 2 E (Archives Départementales de l’Indre) LA CHATRE Etude de Maître TAYON Les noms et prénoms des personnes ainsi que les noms des lieux-dits sont écrits comme sur les minutes notariales 2 E 9922 – Années 1675 et 1676 19/01/1675 GABILLON Pierre l’aîné, laboureur de la paroisse de Crevant (Les Mazeaux) et JAUDOUX Andrée, servante, demeurant à La Châtre, veuve de + Noël PAROT. En présence de Pierre Gabillon, frère de Pierre, de Mr Silvain Blanchard, maître d’Andrée. 27/01/1675 BLANCHARD Jean (honnête), La Châtre, fils d’honorable Mr Silvain BLANCHARD, conseiller du roi, élu en l’élection de La Châtre, et de Catherine BARJON et LESNE/LESNEL/LAISNEL Marie (honnête), fille de prudent homme Germain LESNE, maître apothicaire à La Châtre et de + dame Jacquette BLANCHARD. En présence des parents de Jean, Mrs Charles, François, Jean et Marie Blanchard, frères et sœur germains, honnête Françoise Blanchard, veuve Laurant. Le père de Marie, Mrs Symon et Germain Lesné, oncles, dame Marie BOUTET, aïeule maternelle. (En fin d’acte, Marie et les siens signent LAISNEL). 31/01/1675 LEGER Pierre, tisserand, La Châtre et DORE Marie, fille d’Antoine DORE, maréchal et de + Denyse DARPEYS. En présence de Pierre Léger, frère de Pierre, Anthoyne Bézard, beau-frère, Pierre Aufrère, cousin. Le père de Marie, Charles Darpeys, oncle maternel, Charles, Georges Doré, Pierre Pauchet/Pauset ?, cousins germains paternels, Macé Agobert, époux de Marguerite Doré, cousins, Marie LEUILLET, aîeule, Léonard Daudrault, Nicollas Villebasse, beaux-frères. 05/02/1675 GOUNIN/GONIN Laurent, fils de Charles GOUNIN, meunier au moulin neuf, paroisse de Saint-Denis-de-Jouhet et de Gabrielle COLLIN et BARAULT Denise, fille de + Silvain BARAULT et de Marie PETIPEZ, de la paroisse de Chassignolles ; GOUNIN Silvain, fils de Charles et de Gabrielle COLLIN et BARAULT Silvaine, fille de + Silvain et de Marie PETIPEZ. -

Peliau-Decembre-2019
Sur le chemin de Vic à Nohant Le projet porté par la commune est double, créer un sentier et un verger conservatoire au bord du sentier. Faire vivre le patrimoine L’acquisition des parcelles avance, le tracé du sentier est déterminé, il relie le bourg de Vic à Ce patrimoine est fragile, soumis à l’effacement et aux altérations celui de Nohant. du temps ; les fresques ne sont restées « vivantes » que grâce à Il présente le double avantage d’être parallèle plusieurs campagnes de restauration et aux progrès des techniques à la RD 943, très passante, tout en restant de conservation. La commune de Nohant-Vic a porté le projet de éloignée d’elle de quelques centaines de conservation de notre patrimoine, une nouvelle campagne s’est mètres et de conserver toutes les avérée nécessaire afin de préserver ce chef d’œuvre. caractéristiques physiques si bien décrites par La Communauté de Communes en est le financeur et le maitre George Sand (portions de chemin creux, « d’ouvrage, et souhaite mettre en valeur cet ensemble traînes », arbres têtards, talus, murets de exceptionnel, en donnant aux visiteurs des clés de lecture par le pierre, « carroirs », par exemple). biais d’une conception scénographique. Le projet s’articulera dans Le tracé figure dans le Péliau n°35. deux espaces : l’église Saint-Martin et la petite maison berrichonne Suite au retard pris suite aux travaux d’intérêt patrimonial, située au chevet. Cette maison est typique d’enfouissement du champ éolien, ce projet de la région. Elle date probablement de la fin du XVIIe ou du début va donc nécessairement s’étaler dans le du XVIIIe siècle. -

G Chapitre De Saint-Germain De La Châtre
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’INDRE Série G Chapitre de Saint-Germain de La Châtre (1218-1790) Inventaire sommaire par Théodore Hubert Châteauroux 1893 [corrections et compléments M. du Pouget, 2007-2015] [restructuré en 2020] Introduction LA SÉRIE G L’actuel département de l’Indre, qui correspond au Bas-Berry de l’Ancien Régime, n’a jamais comporté sur son territoire de siège épiscopal. La quasi-totalité des paroisses relevait du diocèse de Bourges ; quelques paroisses situées dans les marges du département actuel ressortissaient des diocèses de Limoges, Tours et Poitiers. La série G comprend les archives des églises collégiales et des paroisses de l'actuel département de l'Indre, des origines à la Révolution. À l'exception de quelques paroisses, Lurais, Mérigny, Ingrandes, Saint-Hilaire-sur-Benaize, Jauvard (qui dépendaient du diocèse de Poitiers), Beaulieu, Bonneuil, Bonnu, Lourdoueix-Saint-Michel et Tilly (diocèse de Limoges) et Écueillé (diocèse de Tours), toutes les paroisses de l'Indre dépendaient du diocèse de Bourges. Celui-ci était divisé en neuf archidiaconés et vingt archiprêtrés, dans lesquels se répartissaient les paroisses. Les archives de l'archevêché de Bourges sont conservées aux Archives départementales du Cher (série G) ; de nombreux documents concernant le département de l'Indre s'y trouvent. La série G constitue une source fondamentale pour l'histoire religieuse du département. On observera que les documents relatifs à la gestion des revenus des abbayes y sont majoritaires. Les documents spirituels furent davantage exposés aux destructions révolutionnaires, car ils n'avaient pas valeur juridique. Les archives composant la série G (clergé séculier catholique non soumis à une règle monastique ou conventuelle) proviennent des 9 collégiales et 226 cures, dont les titres, confisqués à la Révolution, furent réunis aux chefs-lieux de district, puis, à la suppression de ceux-ci, au Château-Raoul à Châteauroux. -

5.3. Risques, Pollutions Et Nuisances Anthropiques
Chapitre I - État initial de l’Environnement 5.3. RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES ANTHROPIQUES A. LES RISQUES ET NUISANCES TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS g. La pollution lumineuse POLLUTION LUMINEUSE SUR LE TERRITOIRE ET AUX ENVIRONS Une optimisation de l’éclairage public peut à la fois permettre une diminution des accidents de circulations de la route dus à l’éblouissement ou à la fatigue oculaire, de faire des économies d’énergies et finan- Issoudun ciers, mais aussi de préserver le milieu nocturne (trame étoilée, déplacement des espèces nocturnes) sans diminuer la qualité CHÂTEAUROUX de l’éclairage. Il a également été démontré qu’il pouvait y avoir un impact sur la santé humaine par un dérèglement du rythme bio- logique. Il est donc important de repenser les modes d’éclairages pour à la fois amé- Saint-Amand- Montrond liorer le cadre de vie et maintenir une qualité du service. Il existe plusieurs méthodes pour y parvenir. La carte ci-contre identifie les îlots de pollu- Argenton- La Châtre tion lumineuse sur le territoire intercommu- sur-Creuse nale et dans son contexte immédiat. Sur la Communauté des Communes La Châtre Sainte-Sévère, la pollution lumi- neuse se concentre principalement sur la partie centrale du territoire, et plus particu- lièrement au niveau le l’unité urbaine de La Châtre. Néanmoins, le taux de nuisances apparaît MONTLUÇON relativement modéré. Les répercussions La Souterraine susceptibles d’être induites pour la faune locale sont vraisemblablement assez faibles. NIVEAU DE POLLUTION LUMINEUSE En nombre d’étoiles visible selon les conditions 50 100 200 250 500 1000 1800 3000 5000 Source : Avex-asso, 2016 251 RAPPORT DE PRÉSENTATION // Tome I - Diagnostic Territorial 5.3. -

Carte Ecoles Indre
Ecoles élémentaires Ecoles Elémentaires et Maternelles Ecoles maternelles Ecoles élémentaires accueillant des enfants d’âge maternel Ecoles de RPI Ecoles élémentaires de RPI (1) Ecoles maternelles de RPI (1) Ecoles élémentaires de RPI (1) accueillant des enfants d’âge maternel (1) Hors RPI concentrés ** En bleu écoles Berceaux PES ** Chabris Saint Christophe Dun le La Vernelle en Bazelle Poëlier Lye Val Fouzon Circonscription Anjouin d’Issoudun Villentrois Poulaines Faverolles Valençay Veuil Luçay le Mâle Reuilly Vicq sur Nahon Ecueillé Langé Vatan Paudy Rouvres les Bois Baudres Sainte- Heugnes Lizaigne Bouges le Château Saint-Valentin Pellevoisin Les Bordes Brion Châtillon-sur-Indre Villegouin Levroux La Champenoise Saint- Aoustrille Clion Sougé Issoudun Palluau Vineuil Saint -Genou Argy Mareuil-sur-Arnon Céré- Montierchaume Neuvy- Ségry Saint-Lactencin Coings Pailloux Azay le Ferron Buzançais Chezelles Déols Niherne Pruniers Chezal-Benoît Châteauroux Martizay Villedieu Diors Vendoeuvres Mâron Saint-Maur Etrechet Mézières en Brenne Méobecq Neuillay les é Le Poinçonnet Sassierges Bois Arthon Saint-Germain Ambrault Lureuil Lingé Migné La Pérouille Luant Douadic Tournon Saint Martin Rosnay Saint-Août Nuret le Ferron Velles Ardentes Pouligny Jeu les Bois Saint-Christophe Saint Gaultier en Boucherie Saint-Pierre Mers sur Indre Ruffec Thenay La Berthenoux Verneuil Mérigny Le Blanc Rivarennes Tendu Le Pont Mosnay Montipouret Thevet Ciron Oulches Chrétien Tranzault Saint-Julien Bouesse Saint-Chartier Saint-Marcel Concremiers Nohant-Vic Argenton Neuvy-St-S. Sarzay Lourouer La Châtre Montgivray Saint-Laurent Belâbre Prissac Le Pêchereau Chavin Lacs Cluis Le Magny INDRE Le Menoux Malicornay Circonscription Roussines Chassignolles Briantes Lignac du Blanc Urciers Ceaulmont Badecon Saint-Denis Pouligny de Jouhet Notre Dame Feusines Saint-Benoît Celon Orsennes Chaillac du Sault Crevant Vigoux Cuzion Perassay La Châtre Sainte-Sévère l’Anglin Eguzon Aigurande Circonscription Mouhet Circonscription De Châteauroux de La Châtre . -

Télechargez Notre Guide Activités
3. La salle de fitness L'Hôtel Les Dryades dispose d'une salle de fitness. Vous aurez la possibilité de faire du « sport à deux » car nous possédons deux exemplaires de plusieurs équipements tels que les vélos elliptiques, les vélos de remise en forme, les tapis de course et les steps. Jours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi et le dimanche, de 9h à 19h ; tous les samedis et tous les jours du mois d'août, de 9h à 20h Téléphone : 02 54 06 60 60 / 4601 (depuis l'hôtel) 4. Les courts de tennis Pour les amoureux du sport, la ville de Pouligny Notre Dame met à votre disposition ses courts de tennis qui se trouvent à 300 mètres de l'hôtel, près de la Mairie. Si vous avez besoin de raquettes et de balles, n'hésitez pas à les demander à la réception du Spa (prêt gratuit). Pour récupérer les clés des courts de tennis situés près de la Mairie, merci de vous rendre à la réception de l'hôtel. Jours et heures d'ouverture : tous les jours, de 9h à 19h Téléphone : 02 54 06 60 60 / 4601 (depuis l'hôtel) 5. Le pingpong Une table de pingpong est mise à la disposition des résidents de l'hôtel. L'accueil du Spa vous prêtera gratuitement balles et raquettes. Jours et heures d'ouverture : tous les jours, de 9h à 19h Téléphone : 02 54 06 60 60 / 4601 (depuis l'hôtel) 6. Le véloLe vélo Autour de l'Hôtel Les Dryades, les résidents pourront arpenter les chemins et petites routes en vélo et se plonger, ainsi, dans la nature verdoyante du Berry (carte des circuits disponible à la réception de l'hôtel). -

Chapitre 2 : Diagnostic Territorial
CHAPITRE 2 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL Plan Local d’Urbanisme de La Châtre PLU La Châtre-2018-09-07-Page 63 CONTENU Chapitre 2 : Diagnostic territorial ............................................................................................................................ 63 2.1. L’ORGANISATION TERRITORIALE ..................................................................................................... 65 2.1.1. IDENTITE DE LA COMMUNE ......................................................................................................... 65 2.1.2. RESEAU URBAIN ET DE COMMUNICATION ....................................................................... 67 2.1.3. STRUCTURES COMMUNALES ET SUPRACOMMUNALES ........................................ 74 2.2. LES DYNAMIQUES TERRITORIALES ................................................................................................ 80 EVOLUTION ET STRUCTURE DE LA POPULATION ..................................................................... 82 ECONOMIE, EMPLOI et MODES DE DEPLACEMENTS .............................................................. 89 HABITAT .................................................................................................................................................................. 92 CADRE DE VIE ET VIE ASSOCIATIVE ................................................................................................... 96 2.3. LES ENTITES PAYSAGERES ................................................................................................................ -

Date Epoux Père Mère Ex
Date Epoux Père Mère Ex.conjoint Origine __________________________________________________________________________________________________________________________________ 12/07/1740 Etienne +MARTINET Jeanne GRAVELON Jeanne +Etienne +VILLEBASSE Silvaine 05/08/1886 ACCOLAS François Mathurin (div BOITARD Marie Pauline (divorce 21/06/1880 ACCOLAS François Mathurin Eugè Mathias +SENOT Joséphine LA CHATRE BOITARD Pauline Désirée Paul Désiré PATERNAULT Marie MURS 25/02/1754 ACCOLAS Marie +Jean +ROBERT Catherine AUVIEUX André +DAUDET Catherine 05/02/1821 ACLEMENT Françoise Jean ALICHON Elisabeth LE MAGNY BLANCHET Mathieu +Mathurin CHAUSSÉ Marie MONTLEVIC 11/02/1896 ACLEMENT Jean Antoine PION Marguerite BRIANTES MERCIER Hortense Marie Françoi Charles CHAUSSÉ Valentine CHASSIGNOLLES 01/07/1827 ADRACHE François Thomas SIMONSU Anne LA CHATRE MARIERE Marie +Pierre LEGROS Jeanne LE MAGNY 29/09/1839 AGEORGES André +Silvain +ROTINAT Marie LE MAGNY BLERON Marie Solange +Pierre +BIJOTAT Marie CHASSIGNOLLES 14/02/1774 AGEORGES Anne François ROTINAT Marie LE MAGNY DUPLAIX Jean +François AUJUS Marie BRIANTES 27/02/1783 AGEORGES Catherine +François +ROTINAT Marie DORÉ Laurent +Silvain +GRAZON Catherine MONTGIVRAY 01/03/1745 AGEORGES François Pierre +YVERNAULT Jeanne ROTINAT Marie Vincent DODON Charlotte 04/02/1771 AGEORGES François +ROTINAT Marie LE MAGNY CHICAUD Solange +LAMY Pierre CREVANT 23/06/1795 AGEORGES Germain Germain YVERNAULT Marie CROZON LAUBIERE Antoinette +Jean +RIPOTEAU Françoise MONTCHEVRIER 23/06/1887 AGEORGES Jean Baptiste Silvain CAILLAUD -

Of Council Regulation (EC)
C 311/18 EN Official Journal of the European Union 16.11.2010 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an application pursuant to Article 6(2) of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (2010/C 311/09) This publication confers the right to object to the application pursuant to Article 7 of Council Regulation (EC) No 510/2006 ( 1). Statements of objection must reach the Commission within six months from the date of this publication. SINGLE DOCUMENT COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 ‘PORC D’AUVERGNE’ EC No: FR-PGI-0005-0697-02.06.2008 PGI ( X ) PDO ( ) 1. Name: ‘Porc d'Auvergne’ 2. Member State or Third Country: France 3. Description of the agricultural product or foodstuff: 3.1. Type of product: Class 1.1. Fresh meat (and offal) 3.2. Description of product to which the name in (1) applies: Porc d’Auvergne pigs are outdoor-reared pigs whose meat is characterised by its firmness, its homo geneous red colour, being neither light nor dark, and its white and firm residual back fat. Once cooked, porc d’Auvergne meat is characterised by a tender and juicy texture, with a pleasant taste typical of a good pig. Porc d’Auvergne pigs are slaughtered at a minimum age of 26 weeks. The carcasses have a hot weight of at least 75 kg. The muscle ratio is between 53 and 64. Porc d’Auvergne is sold as whole carcasses, half-carcasses, wholesale following a primary cut or in pieces following a secondary cut or in the form of consumer portions. -
Documentation Historique
Documentation historique Documentation historique Eléments de l'instrument de recherche Page de titre Présentation Plan de classement Corps de l'instrument de recherche Page de titre retour Archives départementales de l'Indre Documentation historique par Carole Lochet Châteauroux 2017 file:///C/Perso_AGerardot/Inventaires/FRAD036_DOC_HIST.htm[04/10/2018 09:49:27] Documentation historique Présentation retour DOC HIST Lieu de conservation FRAD036 Cotes extrêmes DOC HIST 1-1449 Intitulé Documentation historique Date début cachée 1466 Date fin cachée 2016 Dates extrêmes 1466-2016 Niveau de description Fonds Producteur, nom 1 Collection constituée par les Archives départementales de l'Indre Modalités d'accès Librement communicable Statut juridique Archives privées Rédacteur Carole Lochet Date de création jeudi 25 août 2016 description Plan de classement retour Dossiers classés par lieux Département de l'Indre Autres départements Département de l'Allier Département du Cher Département de la Creuse Département de l'Indre-et-Loire Département du Loir-et-Cher Département de Paris Département du Haut-Rhin Département de la Vienne Autres lieux Dossiers classés par thèmes Dossiers classés par personnes file:///C/Perso_AGerardot/Inventaires/FRAD036_DOC_HIST.htm[04/10/2018 09:49:27] Documentation historique Corps de l'instrument de recherche retour Dossiers classés par lieux retour Niveau description : Série organique Département de l'Indre retour Niveau description : Sous-sous-série organique DOC HIST 1 Aigurande 1/ Note sur un manuscrit conservé à la cure d'Aigurande. Ce document est l'oeuvre de M. MEUNIER, curé doyen d'Aigurande. Octobre 1974. 2/ Vue générale d'Aigurande. Dépliant historique et touristique réalisé par les élèves du collège Frédéric Chopin d'Aigurande, dans le cadre d'un projet d'action éducative.