Hommes & Migrations, 1319
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
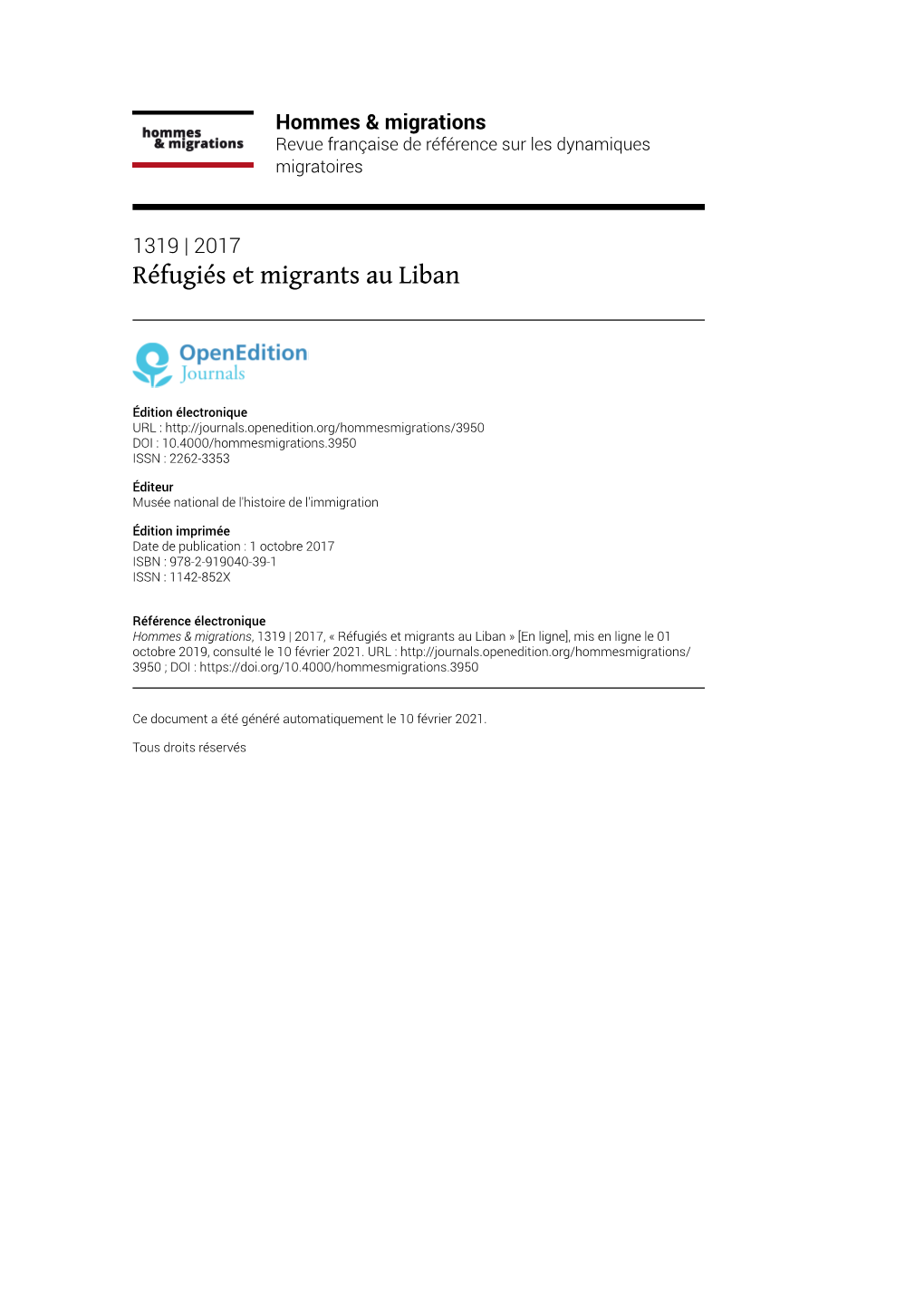
Load more
Recommended publications
-

Official General Report on Northern Iraq (April 2000) Contents Page
Official general report on Northern Iraq (April 2000) Contents Page 1. Introduction 4 2. Information on the country 6 2.1. Basic facts 6 2.1.1. Country and people 6 2.1.2. History 8 2.2. System of government 17 2.3. Political developments 20 2.3.1. Internal relations 20 2.3.2. External forces 31 2.4. Security situation 36 2.5. Social and economic situation 48 2.6. Conclusions 53 3. Human rights 55 3.1. Safeguards 55 3.1.1. Constitution 55 3.1.2. Other national legislation 55 3.1.3. Conventions 56 3.2. Monitoring 56 3.3. Respect and violations 58 3.3.1. Freedom of opinion 58 3.3.2. Freedom of association and of assembly 59 3.3.3. Freedom of religion 60 3.3.4. Freedom of movement 73 3.3.5. Judicial process 83 3.3.6. Arrest and detention 84 3.3.7. Maltreatment and torture 87 3.3.8. Extra-judicial executions and murders 87 10804/00 dre/LG/mc 2 DG H I EN 3.3.9. Death penalty 87 3.4. Position of specific groups 88 3.4.1. Turkmens 88 3.4.2. Staff of international organisations 91 3.4.3. Conscripts, deserters and servicemen 96 3.4.4. Independent intellectuals and journalists 98 3.4.5. Prominent political activists 99 3.4.6. Fayli Kurds 99 3.4.7. Women 101 3.4.8. Orphaned minors 104 3.5. Summary 104 4. Refugees and displaced persons 106 4.1. Motives 106 4.2. -

Seismic Reflections | 5 August 2011
1 | Edison Investment Research | Seismic reflections | 5 August 2011 Seismic reflections Confidence in Kurdistan grows Iraq, including the autonomous Kurdistan region, probably has the world’s largest concentration of untapped, easily recoverable oil reserves. Pioneering moves were made into Kurdistan in the 2000s by the likes of Gulf Keystone and Hunt Oil, with considerable drill-bit success. In late July, two important Kurdistan exploration and development deals were announced. These involve Afren acquiring interests in two PSCs with sizeable contingent reserves and a Hess-Petroceltic partnership signing two PSCs for exploration purposes. With increasing production and Analysts improving relations between the regional and Iraqi federal governments, Ian McLelland +44 (0)20 3077 5756 these deals reflect growing confidence in Kurdistan’s potential as a major Peter J Dupont +44 (0)20 3077 5741 new petroleum province. Elaine Reynolds +44 (0)20 3077 5700 Krisztina Kovacs +44 (0)20 3077 5700 Anatomy of the Kurdistan oil province [email protected] 6,000 Kurdistan is located in the North Arabian basin and is on same fairway as the 5,500 prolific oilfields of Saudi Arabia’s Eastern Province, Kuwait, southern Iraq and Syria. 5,000 4,500 The geological backdrop to Kurdistan tends to be simple and is characterised by 4,000 3,500 large anticlinal structures, deep organic-rich sediments and carbonate reservoirs 3,000 mainly of Jurassic to Cretaceous age. Drilling commenced in the region in 2006. So far, 28 wells have been drilled, of which 20 have been discoveries, resulting in A pr/11 Oct/10 Jun/11 Fe b/11 Aug/10 Dec/10 Aug/11 estimated reserves of over 5.8bn boe. -

Kurdish Oppression Against Assyrians
Oppression, Assassination, Torture, Harassment, Unfair, and Undemocratic Acts by Kurds and Kurdistan Democratic Party (KDP) Against the Assyrians (also known as Chaldeans and Suryan) in North of Iraq. Compiled by Fred Aprim (ZINDA) After the 1991 uprising, Assyrians had good working relations with the various political groups in North Iraq. All the same, elections in the spring of 1992 would be a harbinger of problems to come - ultra-nationalists among some Kurdish parties tried and succeeded in exerting their influence over any Assyrian involvement in North Iraqi politics by creating a puppet "Christian Kurdish" party linked to the Kurdistan Democratic Party (KDP), the so-called United Kurdistan Christians (UKC). (http://www.zindamagazine.com/html/archives/2002/6.3.02/index.php#ZindaSays) (ATOUR) In 1992 some intellectual Assyrians published a communiqué, in it they warned against the continuous process of the Kurdification of the Iraqi people in north of Iraq. Then the ethnic and linguistic map of northern Iraq was not as it is today; some ten years after the no-fly zone has been established. For its importance, here is a passage from that communiqué: “The Kurdish leadership, and in a well-planned program, had begun to settle Kurds and in large numbers around Assyrian regions like Sarsank, Barwari Bala and others. This Kurdish housing project was naturally to change the demographic, economic, and civic structure of the Christian regions in only few short years; a process that forced the Christian to emigrate as the vacant homes were overtaken by the Kurds.” (http://www.atour.com/news/assyria/20030617a.html) (ATOUR) Francis Yusuf Shabo: born 1951 in Mangesh (Duhok Province), married with four children. -

Christians and Yazidis in Iraq: Current Situation and Prospects
OTMAR OEHRING CHRISTIANS AND YAZIDIS IN IRAQ: CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OTMAR OEHRING CHRISTIANS AND YAZIDIS IN IRAQ: CURRENT SITUATION AND PROSPECTS Published by the Konrad Adenauer Foundation Cover photo: © Ibrahim Shaba Lallo, Qaraqosh (currently Ashti Camp, Ankawa, Autonomous Region of Kurdistan) Caption of cover photo: Vertically: We work together Horizontally: We are proud Diagonally: We love, we forgive .(nun), stand for Nazara (Christ) ن The three Arabic characters, starting with The black IS flag bears the words: There is no God but Allah Allah Prophet Mohammed Islamic State in Iraq and As-Sham (i.e. Syria) Published by: Konrad Adenauer Foundation 2017, Sankt Augustin and Berlin, Germany This publication has been licensed under the terms and conditions of Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Germany (CC BY-SA 3.0 DE), website: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en Design: SWITSCH Kommunikationsdesign, Cologne, Germany Typesetting: Janine Höhle, Communications Department, Konrad Adenauer Foundation Printed by: Bonifatius GmbH, Paderborn, Germany Printed in Germany Printed with financial support from the German Federal Government ISBN 978-3-95721-328-0 CONTENTS 1. Introduction 2. Legal Framework 2.1 International law 2.2 National law 3. Reduced scope for non-Muslim minorities after 2003 3.1 Drastic decline in the non-Muslim minorities’ share of the population 3.2 Changes in Baghdad’s religious power structure 4. Crucial for the future of Iraq: the recapture of Mosul 4.1 Capture of Mosul by the IS in June 2014 4.2 Capture of Yazidi settlements in Sinjar District by the IS in August 2014 4.3 Capture of Christian settlements in the Nineveh Plains by the IS in August 2014 4.4 Classification of the IS attacks on religious minorities as genocide 4.5 Campaign to retake Mosul 5. -

The Mineral Industry of Iraq in 2012
2012 Minerals Yearbook IRAQ U.S. Department of the Interior May 2015 U.S. Geological Survey THE MINERAL INDUSTRY OF IRAQ By Mowafa Taib Iraq was a significant supplier of crude oil to the world in steel imports was 4 Mt in 2012 (Annous, 2012; International 2012 and was the world’s ninth-ranked producer in terms Monetary Fund, 2013, p. 25; Organization of the Petroleum of volume. The country produced 3.1 million barrels per Exporting Countries, 2013, p. 55, 82; World Steel Association, day (Mbbl/d) of crude oil and condensate and accounted 2013, p. 26). for 3.7% of the world’s total output. Iraq, which exported 2.43 Mbbl/d of crude oil in 2012, was the world’s fourth-ranked Government Policies and Programs crude oil exporter after Saudi Arabia (7.56 Mbbl/d), Russia The Iraq Geological Survey (Geosurv-Iraq) identified (5.86 Mbbl/d), and the United Arab Emirates (2.66 Mbbl/d). 12 investment opportunities in the industrial mining sector in The country’s proved crude oil reserves, which were estimated Iraq and called for investors to develop mining operations under to be 150.1 billion barrels (Gbbl) and accounted for 9.0% of Investment Law No. 13 of 2006 and its modifications and Law the world’s total reserves, ranked Iraq as the fifth country in of Mineral Investment No. 91 of 1988. These potential projects the world in terms of the volume of petroleum reserves after were phosphate rock mining and beneficiation at the Al Hirri Venezuela (297.6 Gbbl), Saudi Arabia (265.9 Gbbl), Canada Wadi in Al Anbar Governorate and the Swab Wadi; a mining (173.9 Gbbl), and Iran (157.0 Gbbl). -

THE 11Th March, 2013 EARTHQUAKE in NORTH of MOSUL VICINITY, NORTH IRAQ
Iraqi Bulletin of Geology and Mining Vol.10, No.1, 2014 p 59 − 72 THE 11th March, 2013 EARTHQUAKE IN NORTH OF MOSUL VICINITY, NORTH IRAQ 1 1 1 Jamal Gh. Mohammed , Ayda D. Abdul Ahad and Basim R. Jabbo Received: 19/ 05/ 2013, Accepted: 28/ 11/ 2013 Keywords: Earthquake, Shocks, Seismicity, Mosul, Iraq ABSTRACT Iraq is located in the northeastern corner of the Arabian Plate, which is in collision with the Iranian (Eurasian) Plate. The contact between the two plates exhibits active seismicity forming active Zagros Seismic Belt. Mosul city and surroundings, although being far enough from this active seismic belt, still suffer from many earthquakes, which can be felt in a diameter of about 100 Km, the center being in Mosul city. On the 11th of March 2013, at 5:58 pm, Monday a shock was felt in Mosul city and its surroundings to the northeast, north and northwest. The shock lasted for 5 seconds and was registered in Mosul Seismological Center with magnitude of 4.9 degrees on Richter scale. Two other shocks were recorded after few days. People in the villages located north of Mosul have heard high roaring, which accompanied the shock. Many old buildings, among them the church of Tell Asquf village was cracked and the plaster of the church's dome fell down in fragments. Many other mud huts and some buildings showed severe cracks in many other villages. No rupturing on the Earth's surface was reported in the involved areas. No live causalities and/ or wounded people were reported. In this study, the historic seismicity of Mosul and near surroundings is reviewed. -

Under the Mountains: Kurdish Oil and Regional Politics
January 2016 Under the Mountains: Kurdish Oil and Regional Politics OIES PAPER: WPM 63 Robin Mills* The contents of this paper are the authors’ sole responsibility. They do not necessarily represent the views of the Oxford Institute for Energy Studies or any of its members. Copyright © 2016 Oxford Institute for Energy Studies (Registered Charity, No. 286084) This publication may be reproduced in part for educational or non-profit purposes without special permission from the copyright holder, provided acknowledgment of the source is made. No use of this publication may be made for resale or for any other commercial purpose whatsoever without prior permission in writing from the Oxford Institute for Energy Studies. ISBN 978-1-78467-049-8 *Non-Resident Fellow for Energy at the Brookings Doha Center, CEO of Qamar Energy (Dubai) and Research Associate, Oxford Institute for Energy Studies Under the Mountains: Kurdish Oil and Regional Politics i Contents Acknowledgements ............................................................................................................................. iii 1. Introduction ....................................................................................................................................... 1 2. Background: a Brief History of Oil and Gas in the Kurdish Region of Iraq ................................ 2 2.1. Political history ........................................................................................................................ 2 2.2. Petroleum history ................................................................................................................... -

A Rocky Road: Kurdish Oil & Independence
ARockyRoad:Kurdish Oil&Independence 19February2018 PublicationNumber:IEI190218 ARockyRoad:Kurdish Oil&Independence 19February2018 @IraqEnergy facebook.com/IraqEnergy www.iraqenergy.org [email protected] Thecontentsofthispaperaretheauthorsʼsoleresponsibility.Theydonotnecessarilyrepresent theviewsoftheIraqEnergyInstituteoranyofitsmembers. Thispublicationmaybereproducedinpartforeducationalornon-profitpurposeswithout specialpermissionfromthecopyrightholder,providedacknowledgmentofthesourceismade. Nouseofthispublicationmaybemadeforresaleorforanyothercommercialpurposewhatsoever withoutpriorpermissioninwritingfromtheIraqEnergyInstitute. *Non-ResidentFellowattheIraqEnergyInstituteandCEOofQamarEnergy(Dubai). Copyright©2018IraqEnergyInstitute Contents 1. Introduction ................................................................................................................................................................................... 1 2. Political and Petroleum History of the Kurdistan Region of Iraq...................................................................... 3 2.1. Political history ................................................................................................................................................................... 3 2.2. Politics in the KRI ........................................................................................................................................................... 10 2.3. Petroleum history......................................................................................................................................................... -

The British Betrayal of the Assyrians Yusuf Malek
The British Betrayal Of The Assyrians THE BRITISH BETRAYAL OF THE ASSYRIANS YUSUF MALEK FORMERLY OF THE IRAQI CIVIL SERVICE JUNE 1917 - SEPTEMBER 6, 1930 Author of Les Consequences Tragiques du Mandat en Iraq 1932 With introduction by William A. Wigram, DD Published by the Joint Action of The Assyrian National Federation and The Assyrian National League of America - 1758 North Park Avenue, Chicago IL (Books may be secured by application of this address only) First published in 1935. Copyright 1936 By the Author No part of the book may be reproduced in any manner whatsoever without written permission. All Rights Reserved Printed in the United States of America, The Kimball Press, Warren Point, N.J. Dedicated to the Assyrian People in commemoration of the Assyrians who suffered martyrdom at the hands of the Iraqi Government. Y.M. Assyrian International News Agency Books Online www.aina.org 1 AUTHOR’S PREFACE The atrocities deliberately perpetrated by the forces of Faisal, the puppet king on a shaky throne, led by their ill-bred officers against the Assyrians in Iraq during August 1933, the month that should mark a black spot in British history, have necessarily accelerated the publication--as an urgent necessity--of a part of a comprehensive book on the Iraqi minorities which I have in view. The British Government has betrayed, and has certainly proved herself unworthy of, the trust that other Eastern peoples have placed in her. She received many warnings as to the precarious position of the Iraq minorities in an emancipated Iraq, but it continued to ignore the appeals made to it and set aside the apprehensions felt even by the members of the Permanent Mandates Commission. -

Situation in Northern Iraq (April 2000)
COUNCIL OF Brussels, 10 August 2000 (21.09) THE EUROPEAN UNION (OR. nl) 10804/00 LIMITE CIREA 52 NOTE from : Netherlands delegation to : CIREA Subject : Situation in Northern Iraq (April 2000) Delegations will find attached a report 1 from the Netherlands delegation on the present situation in Northern Iraq. This report updates the earlier official general reports of 31 March and 13 November 1998 on Northern Iraq (13493/98 CIREA 98). ________________________ 1 Translated into English only. This report may be released to the public. 10804/00 lby/LG/mc 1 DG H I EN Official general report on Northern Iraq (April 2000) Contents Page 1. Introduction 4 2. Information on the country 6 2.1. Basic facts 6 2.1.1. Country and people 6 2.1.2. History 8 2.2. System of government 17 2.3. Political developments 20 2.3.1. Internal relations 20 2.3.2. External forces 31 2.4. Security situation 36 2.5. Social and economic situation 48 2.6. Conclusions 53 3. Human rights 55 3.1. Safeguards 55 3.1.1. Constitution 55 3.1.2. Other national legislation 55 3.1.3. Conventions 56 3.2. Monitoring 56 3.3. Respect and violations 58 3.3.1. Freedom of opinion 58 3.3.2. Freedom of association and of assembly 59 3.3.3. Freedom of religion 60 3.3.4. Freedom of movement 73 3.3.5. Judicial process 83 3.3.6. Arrest and detention 84 3.3.7. Maltreatment and torture 87 3.3.8. Extra-judicial executions and murders 87 10804/00 lby/LG/mc 2 DG H I EN 3.3.9. -

Erkenntnisliste Irak
Erkenntnismittel Irak, Stand: 1. Mai 2020 Dem Gericht liegen folgende Auskünfte und Erkenntnisse zu der den Staat Irak betreffenden asyl- und abschiebungsrelevanten Lage vor. Hinweise: Die aufgeführten Schlagworte dienen lediglich als Orientierungshilfe. Alle aufgeführten Dokumente können außer zu den genannten Schlagworten auch Aussagen zu anderen Themen enthalten. Die Einführung weiterer Erkenntnisse in das Verfahren bleibt vorbehalten. Datum Institution/Autor Titel Thema Schlagwörter Quellen Spra Stand VS typ che 02.03.2020 AA Bericht über die asyl- und Allgem. Lage Bericht D 16.04.2020 VS abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak (Stand: März 2020) 12.01.2019 AA Bericht über die asyl- und Allgem. Lage Bericht D 12.02.2020 VS abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak (Stand Dezember 2018) 12.02.2018 AA Bericht über die asyl- und Allgem. Lage Bericht D 12.02.2020 VS abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak (Stand: Dezember 2017) 07.02.2017 AA Bericht über die asyl- und Allgem. Lage Bericht D 12.02.2020 VS abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak (Stand Dezember 2016) 18.02.2016 AA Bericht über die asyl- und Allgem. Lage Bericht D 12.02.2020 VS abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak (Stand: Dezember 2015) 08.06.2018 AA Amtshilfeersuchen in Asyl- und Bewaff. schiit. Milizen; Zwangsrekrutierung; Einzelau D 12.02.2020 VS 29.01.2020 AA Amtshilfeersuchen in Asyl- und Echtheit Registrierungswesen; Meldesystem; Einzelau D 12.02.2020 VS Rückführungsangelegenheiten; Antwort an Dokumente Familienregistrierung; Karti Zaniyari; skunft 14.01.2020 AA Amtshilfeersuchen in Asyl- und Echtheit Echtheit Dokumente; Polizei Kirkuk; Einzelau D 12.02.2020 VS Rückführungsangelegenheiten; Antwort an Dokumente Einheit "Die Kirchen"; Saddam- skunft 18.10.2019 AA Amtshilfeersuchen in Asyl- und Ethn./relig. -

Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities, Palgrave Studies In
INDEX1 A Adani clan, 271, 277, 304, 305, 310, Abd el-Kadir al-Gilani, 278 315n74, 318n106 Abd Shams, 284, 296, 314n59 Adi, Abu Sa’d ‘Abd al-Karim Abdoka, Ano, 225, 229, 232, 235, al-Sam’ani, 261 250n46 Adi ibn Musafir, Sheikh, 75, 261–264, Abdul Hamid II, 265 272, 273, 276–279, 293–295, Abdulla, Qasang, 126 303, 304, 310, 316n80, 317n105 Abdulrahman, Kareem, 96n33 ADM, see Assyrian Democratic Abnaa al-Nahrain Party (ANP, The Movement Descendants of Mesopotamia), Aflakadian, Kavine, 204 218, 225, 230, 231 Afrin, 3, 26, 31, 174 Abraham, 304 Aghajan, Sarkis, 221, 225, 228, Abu Firas ‘Abd Allah ibn Shibl, 294 229, 232 Abu Hamid al-Ghazali, 316n88 Aghas, 161 Abu Sufyan, 284, 296, 304 Ahle Haqq, 12, 13, 31n1, 43, 74, 135 Academics for peace, 159 Ahmad, Kajal, 76, 79 ACE, see Assyrian Church of the East Ahmed, Osman, 131 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP, Ahmadzadeh, Hashem, viii, 8, 37, 47, Justice and Development Party), 65, 95n29 18, 110, 158, 161 Aid to the Church in Need, 249n30 Adam, 74, 280, 281, 287–292, 302, Ain Sifni, 289 304, 305 Akito holiday, 236 1Note: Page numbers followed by ‘n’ refer to notes. © The Author(s) 2018 327 J. Bocheńska (ed.), Rediscovering Kurdistan’s Cultures and Identities, Palgrave Studies in Cultural Heritage and Conflict, https://doi.org/10.1007/978-3-319-93088-6 328 INDEX AKP, see Adalet ve Kalkınma Partisi 229, 233, 241, 245, 248n14, (AKP, Justice and Development 261, 262, 264, 269, 282, 293, Party) 304, 305, 318n106 Alevi, 12, 13, 43, 135 Arab Spring, 25 Ali ibn Abi Talib, 284, 296 Arakelova, Victoria, 270,