Fonabesuccburkinafasosdac
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
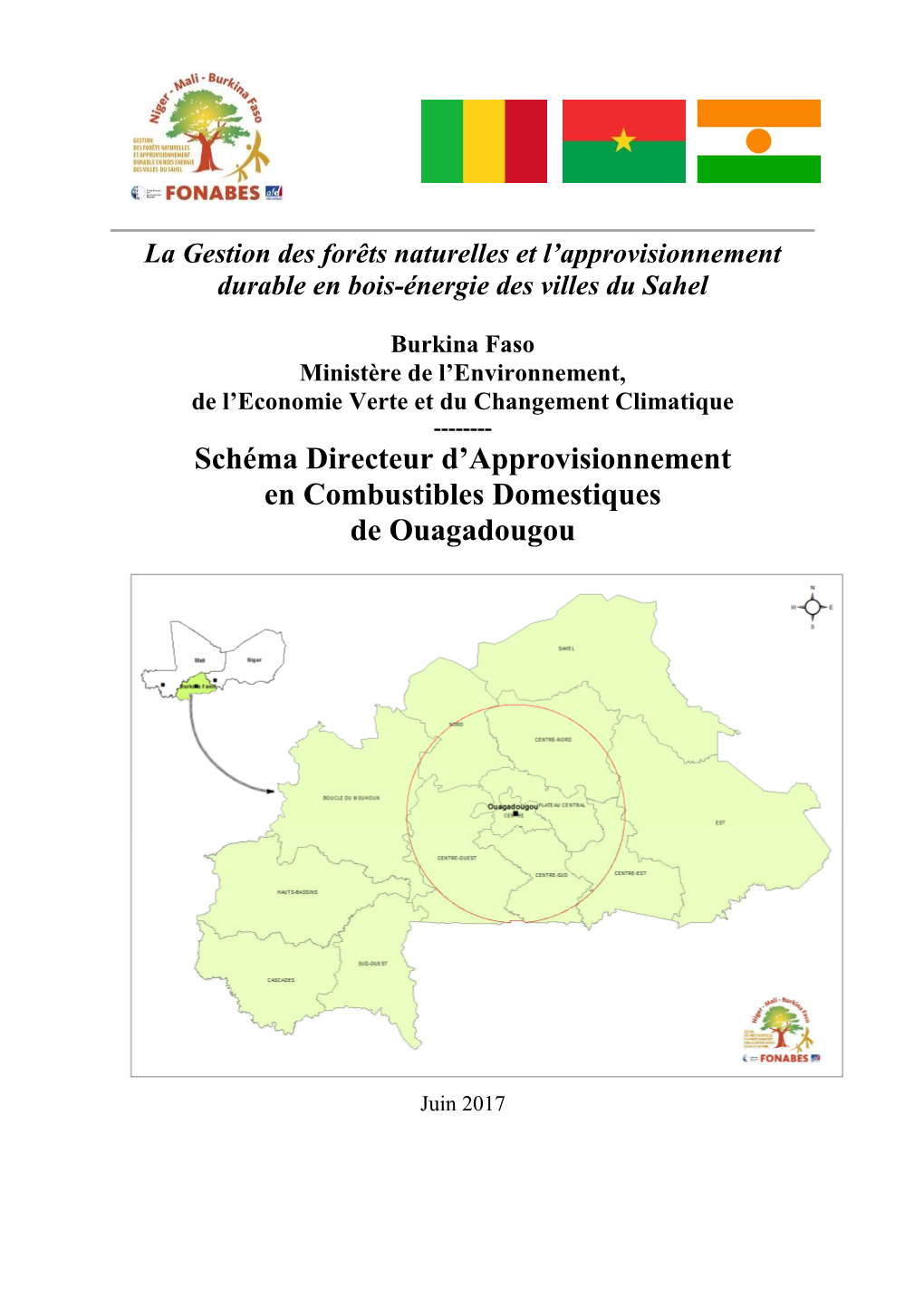
Load more
Recommended publications
-

Burkina Faso)
Caractérisation et modélisation des nappes d’eau souterraine au voisinage de petites retenues d'eau d'irrigation en zone de socle : cas de Kierma et de Mogtédo (Burkina Faso) Thèse présentée en vue de l’obtention du grade de Docteur en sciences de l'ingénieur Par Apolline BAMBARA Thèse défendue le 25 février 2021 devant le jury composé : Prof. Alain DASSARGUES, Université de Liège (Belgique) – Président Dr. Serge BROUYÈRE, Université de Liège (Belgique) – Promoteur Dr. Philippe ORBAN, Université de Liège (Belgique) – membre Dr. Benjamin DEWAL, Université de Liège (Belgique) – membre Dr. Eric HALLOT, Institut Scientifique de Service Public (Belgique) – membre Dr. Florence HABETS, Ecole Normale Supérieure (France) – membre Prof. René THERRIEN, Université Laval (Canada) – membre Dr. Youssouf KOUSSOUBÉ, Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso) – membre Année académique 2020-2021 Avec l’appui de : Je dédie chaleureusement cette thèse à : Ma chère amie Samira Ouermi, décédée le 18 juin 2020 en attente de la soutenance de sa thèse de doctorat, Mon défunt père G. Aristide, Ma chère fille Haoua Charlène Sangaré, Ma mère Pascaline Compaoré, Ma chère amie Lucette Degré, « C’est quand le puits est sec que l’eau devient une richesse » Proverbe français Résumé Les petites retenues d’eau ont été massivement construites en Afrique subsaharienne pour disposer de sources alternatives d’eau pour l’irrigation et l’abreuvement du bétail en période de sécheresse. Elles contribuent au développement socio-économique et à la sécurité alimentaire des populations à travers la pratique de l’agriculture irriguée en saison sèche. Malheureusement, ces retenues d’eau ont tendance à s'assécher prématurément avant les dernières récoltes. -

Repartition Spatiale Des Infrastructures Et Des Services Sociaux De Base Dans La Region
MINISTERE DE L’ECONOMIE BURKINA FASO ET DES FINANCES ………..……….... ………..……….... Unité-Progrès-Justice SECRETARIAT GENERAL ………..……….... DIRECTION GENERALE DES POLES DE CROISSANCE ET DE L’APPUI A LA DECENTRALISATION REPARTITION SPATIALE DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES SOCIAUX DE BASE DANS LA REGION DU CENTRE-OUEST EN 2014 Rapport définitif Programme de Renforcement de la Gouvernance Sous-composante Gouvernance Economique (PRG-GE) 1 Novembre 2014 TABLE DES MATIERES LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS ........................................................................................................................... 4 LISTE DES CARTES .......................................................................................................................................................... 5 LISTE DES GRAPHIQUES ................................................................................................................................................. 5 LISTE DES TABLEAUX ...................................................................................................................................................... 6 LISTE DES PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES ................................................................................................................ 6 AVANT-PROPOS ............................................................................................................................................................... 7 RESUME ............................................................................................................................................................................ -

Annexe-5 Notes Techniques A-70
ANNEXE-5 NOTES TECHNIQUES A-70 A-71 A-72 A-73 A-74 A-75 A-76 A-77 A-78 A-79 A-80 ANNEXE-6 DOSSIER DU PROGRAMME D’ANIMATION ET DE SENSIBILISATION 1. Raisons pour la réalisation des activités d’animation et de sensibilisation Nous avons constaté des problèmes suivants concernant la gestion et la maintenance des installations d’approvisionnement en eau potable dans les zones de cible. La gestion est différente suivant les forages et beaucoup de CPEs ne fonctionnent pas. Il manque des maintenances quotidiennes. Il existe des concurrences entre le système d’AEPS et des forages équipés de PMH dans un village et l’AEPS n’arrive pas à vendre suffisamment d’eau pour qu’il soit rentable. Les usagers ne rendent pas comte des problèmes sur la gestion actuelle des installations d’approvisionnement en eau potable Les communes ne possèdent pas de compétences sur la gestion et la maintenance des installations d’approvisionnement en eau potable de façon quantitative et qualitative. Nous allons réaliser des formations dans le Programme d’animation et de sensibilisation pour résoudre ces problèmes. L’aperçu des activités est le suivant : ① Activités d’animation et de sensibilisations pour les forages équipés de PMH ¾ Reconnaissance du Projet et du système de réforme pour la gestion d’approvisionnement en eau potable (ci-après, « le système de réforme ») à l’échelle communale ¾ Préparation des manuels et du matériel audio-visuel ¾ Atelier pour la sensibilisation des villageois, établissement du CPE par des réunions villageoises. ¾ Formation auprès des personnes chargées d’hygiène et de trésorier du CPE ¾ Formation auprès d’AR ¾ Suivi/appui de gestion ② Activités d’animation et de sensibilisation pour le système AEPS ¾ Reconnaissance du Projet et du système de réforme pour la gestion d’approvisionnement en eau potable (ci-après, « le système de réforme ») à l’échelle communale ¾ Préparation des manuels et du matériel audio-visuel ¾ Atelier pour la sensibilisation des villageois, établissement de l’AUE par des réunions villageoises. -

Etablissements Post-Primaires Et Secondaires Prives Reconnus
ETABLISSEMENTS POST-PRIMAIRES ET SECONDAIRES PRIVES RECONNUS N° REGION ETABLISSEMENTS PROVINCES COMMUNES SECTEUR/VILLE 1 CENTRE SUD COLLEGE PRIVE L’EXPERIENCE BAZEGA DOULOUGOU LAMZOUDO 2 CENTRE SUD COLLEGE PRIVE DU COMPLEXE SCOLAIRE PRIVE ALPHA OMEGA BAZEGA TOECE TOECE 3 CENTRE SUD COLLEGE PRIVE EVANGELIQUE RAYI-ZALLEM BAZEGA SAPONE SAPONE 4 CENTRE SUD COLLEGE PRIVE LA FRATERNITE DE KOMBISSIRI BAZEGA KOMBISSIRI KOMBISSIRI 5 CENTRE SUD COLLEGE PRIVE LA SOLIDARITE DE KOMBISSIRI BAZEGA KOMBISSIRI KOMBISSIRI 6 CENTRE SUD COLLEGE PRIVE LA VOIE DU SUCCES BAZEGA KOMBISSIRI KOMBISSIRI 7 CENTRE SUD COLLEGE PRIVE LES PATRIOTE DE KAYAO BAZEGA KAYAO BASSAM 8 CENTRE SUD COLLEGE PRIVE L'EVEIL DE DOUMDOUNIE BAZEGA DOUMDOUNI DOUMDOUNI 9 CENTRE SUD COLLEGE PRIVE NABYOURE BAZEGA KOMBISSIRI SECTEUR 5 10 CENTRE SUD COLLEGE PRIVE WINDYAAM DE KOULPELE BAZEGA KOULPELE KOULPELE 11 CENTRE SUD COLLEGE PRIVE YAM WEKRE DE TIM-TIM BAZEGA KAYAO TIM-TIM 12 CENTRE SUD COLLEGE PRIVE YENNENGA DE KOMBISSIRI BAZEGA KOMBISSIRI SECTEUR 3 LYCEE PRIVE BANGRE NOOMA DE GOUMSIN Ex COLLEGE PRIVE 13 CENTRE SUD BANGRE NOOMA BAZEGA KAYAO GOUMSI 14 CENTRE SUD LYCEE PRIVE BOBLAWENDE BAZEGA DOULOUGOU KAGAMZINCE 15 CENTRE SUD LYCEE PRIVE DU GROUPE SCOALIRE SAINT ANATOLE DE NORYIDA BAZEGA NOBERE NORYIDA 16 CENTRE SUD LYCEE PRIVE MANEGBA DE KOMBISSIRI BAZEGA KOMBISSIRI KOMBISSIRI 17 CENTRE SUD LYCEE PRIVE SABILOUL HOUDA DE KOASSA BAZEGA KOMBISSIRI KOASSA 18 CENTRE SUD LYCEE PRIVE VIVE LE PAYSAN BAZEGA SAPONE SECTEUR 1 19 CENTRE SUD LYCEE PRIVE MANEGD-ZANGA DE SAPONE BAZEGA SAPONE SECTEUR -

Quality of Care and Client Willingness to Pay for Family Planning Services at Marie Stopes International in Burkina Faso
Population Council Knowledge Commons Reproductive Health Social and Behavioral Science Research (SBSR) 2013 Quality of care and client willingness to pay for family planning services at Marie Stopes International in Burkina Faso Placide Tapsoba Population Council Dalomi Bahan Emily Forsyth Queen Gisele Kaboré Population Council Sally Hughes Follow this and additional works at: https://knowledgecommons.popcouncil.org/departments_sbsr-rh Part of the Demography, Population, and Ecology Commons, Family, Life Course, and Society Commons, International Public Health Commons, Maternal and Child Health Commons, Obstetrics and Gynecology Commons, and the Women's Health Commons How does access to this work benefit ou?y Let us know! Recommended Citation Tapsoba, Placide, Dalomi Bahan, Emily Forsyth Queen, Gisele Kaboré, and Sally Hughes. 2013. "Quality of care and client willingness to pay for family planning services at Marie Stopes International in Burkina Faso." Ouagadougou: Population Council. This Report is brought to you for free and open access by the Population Council. Quality of care and client willingness to pay for family planning services at Marie Stopes International in Burkina Faso Authors: Placide Tapsoba, Dalomi Bahan, Emily Forsyth Queen, Gisèle Kaboré, Sally Hughes i Authors and acknowledgements Acronyms EPI Info A public domain statistical software for NGO Non governmental organisation epidemiology SPSS Statistical Package for the Social FCFA Franc de la Communauté Financière Sciences d’Afrique (West African CFA Franc)1 SRH Sexual and reproductive health FP Family planning USAID United States Agency for International IUD Intrauterine device Development LAPM Long-acting and permanent method WTP Willingness to pay MSI Marie Stopes International Acknowledgements The Population Council would like to thank all the organisations and individuals who contributed to the success of this study. -

Burkina Faso Ministère De L'eau Et De L'assainissement Direction Générale
Burkina Faso Ministère de l’Eau et de l’Assainissement Direction Générale de l’Eau Potable Projet de Renforcement de la Gestion des Infrastructures Hydrauliques de l’Approvisionnement en Eau Potable et de Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement en milieu rural Phase II (PROGEA II) RAPPORT FINAL Avril 2020 Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) Earth and Human Corporation Japan Techno Co.,Ltd. GE JR 20-032 Photos de la mise en œuvre des activités du projet (1) Atelier-Bilan sur la mise en œuvre de la Réforme Atelier national de validation et de réflexion sur la mise en (12 au 15 Janvier 2016) œuvre de la Réforme (23 au 24 Mars 2016) Travaux de la relecture du document cadre et des outils de la Etude de Base (Village de Wanonghin, Commune de Laye, Réforme par un comité technique Province du Kourwéogo, Région du Plateau Central, 01 (21 Août au 16 Septembre 2017, Koudougou) Février 2016) Session de formation des communes de la région du Centre- Atelier régional sur la Réforme dans la région du Centre-Sud (08 au Sud sur la Réforme 09 Décembre 2017 à Manga) (23 Février 2017 à Kombissiri) i Photos de la mise en œuvre des activités du projet (2) Suivi des activités de la commune de la région du Centre-Sud Formation des maintenanciers sur la mise en œuvre de la Réforme (21 Mars 2018, Kombissiri) (26 Avril 2017 à la commune de Toécé, province du Bazéga) Formation des maintenanciers de la région du Centre-Sud sur Formation de l’association des maintenanciers l’entretien des PMH de la région du Centre-Sud (26 Avril 2017 à la -

1 Fao/Global Environment Facility Project Document
FAO/GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY PROJECT DOCUMENT PROJECT TITLE: Integrating Climate Resilience Into Agricultural and Pastoral Production for Food Security in Vulnerable Rural Areas Through the Farmers Field School Approach. PROJECT SYMBOL: GCP/BKF/054/LDF Recipient Country: Burkina Faso Resource Partner: Global Environment Facility/Least Developed Country Fund (GEF/LDCF) FAO project ID: 617677 GEF/LDCF/SCCF Project ID: 5014 Executing Partner(s): Ministry of Agriculture and Food Security (MASA), in connection with the Ministry of Aquatic and Animal Resources (MRAH), the Ministry of Environment and Sustainable Development (MEDD) and other national partners. Expected EOD (starting date): September 2014 Expected NTE (End date): August 2018 Contribution to FAO’s a. Strategic objective/Organizational Result: (SO-2), Sustainable Agricultural Strategic Framework1 Production Systems. b. Regional Result/Priority Area: Priority 1 for Africa, Increase production and productivity of crops, livestock and fisheries c. Country Programming Framework Outcome: (1) strengthening resistance amongst vulnerable populations to food and nutritional insecurity and (2) improving the revenue of the rural population through improved productivity in agro-sylvo-pastoral systems and fisheries. GEF Focal Area/LDCF/SCCF: Climate Change (Adaptation) GEF/LDCF/SCCF Strategic Objectives: CC-A – 1: Reduce vulnerability to the adverse impacts of climate change, including variability, at local, national, regional and global level. CC-A – 2: Increase adaptive capacity to respond -

4-Liste Des Forages Non Encore Équipés De Pompe En 2017
4_Liste de tous les forages non encore équipés de pompe REGION PROVINCE COMMUNE Village BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BADIE BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BANOU BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI KAHO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI KAYIO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI MANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI MOKO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI MOKO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI VIRWE BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOROMO-SECTEUR 2 BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOROMO-SECTEUR 2 BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO KOHO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO OUROUBONO BOUCLE DU MOUHOUN BALE FARA BOUZOUROU BOUCLE DU MOUHOUN BALE FARA PIA BOUCLE DU MOUHOUN BALE FARA TONE BOUCLE DU MOUHOUN BALE OURY SANI BOUCLE DU MOUHOUN BALE OURY ZINAKONGO BOUCLE DU MOUHOUN BALE PA DIDIE BOUCLE DU MOUHOUN BALE PA DIDIE BOUCLE DU MOUHOUN BALE PA KOPOI BOUCLE DU MOUHOUN BALE PA PA BOUCLE DU MOUHOUN BALE POMPOI BATTITI BOUCLE DU MOUHOUN BALE POMPOI PANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE POMPOI PANI BOUCLE DU MOUHOUN BALE POMPOI POMPOI BOUCLE DU MOUHOUN BALE POMPOI POMPOI-GARE BOUCLE DU MOUHOUN BALE POMPOI SAN BOUCLE DU MOUHOUN BALE SIBY BALLAO BOUCLE DU MOUHOUN BALE SIBY SIBY BOUCLE DU MOUHOUN BALE YAHO BONDO BOUCLE DU MOUHOUN BALE YAHO BONDO BOUCLE DU MOUHOUN BALE YAHO GRAND-BALE BOUCLE DU MOUHOUN BALE YAHO MADOU BOUCLE DU -

Document Du Fonds International De Développement Agricole Burkina
A Document du Fonds International de Développement Agricole Burkina Faso Programme spécial Conservation des eaux et des sols – agroforesterie (PS CES/AGF) Rapport d’évaluation intermédiaire Juillet 2004 Rapport No 1471-BF Photo sur page de couverture: Burkina Faso Arrosage d’une pépinière au village de Ribou, près de Yako, où les jeunes plants d’eucalyptus, de lucaena, de prosopis, de papayer et d’acacia poussent Source : Jeremy Hartley (FIDA) Burkina Faso Programme Spécial « Conservation des Eaux et des Sols – Agroforesterie » (PS CES/AGF) Prêts n° SRS 044 BF et 369 BF Évaluation intermédiaire Table des matières Sigles et Acronymes iii Cartes v Accord conclusif xvii Agreement at completion point xxi Résumé (versions française et anglaise) xxv I. INTRODUCTION 1 A. Contexte et objectifs de l’évaluation intermédiaire 1 B. Approche et méthodologie 2 II. CONTEXTE ET CONCEPTION DU PROJET, MISE EN ŒUVRE ET RÉSULTATS 4 A. Zone et contexte d’intervention, pauvreté et dynamiques locales, groupe cible 4 B. Raison d’être du projet, stratégie d’intervention, objectifs et composantes initiaux 5 C. Montage institutionnel et Partenariat 8 D. Évolution du contexte au cours de la mise en œuvre 8 E. Évolution de la conception du projet et capacité d’adaptation au cours de la mise en oeuvre 10 F. Moyens mis en oeuvre et principaux résultats obtenus 10 II. IMPACT DU PROJET 17 A. Impact sur les ressources matérielles et financières des ménages 17 B. Impact sur les ressources humaines 20 C. Impact sur le capital social et les capacités collectives 23 D. Impact sur la sécurité alimentaire et économique des ménages 27 E. -

Fasi-Paejf-Centre-Sud
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION BURKINA FASO ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLES -------------- -------------------- Unité - Progrès - Justice SECRETARIAT GENERAL -------------------- FONDS D'APPUI AU SECTEUR INFORMEL -------------------- LISTE DES BENEFICIAIRES DU PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES JEUNES ET DES FEMMES REGION DU CENTRE SUD N° DU CONTACT SECTEUR MONTANT RANG NOM ET PRENOM(S) N° CNIB SEXE LOCALISATION PROVINCE REGION DOSSIER TEL D'ACTIVITE ACCORDE FASI/PAE1 - Artisanat de 1 ZONGO BOUREIMA 68043804 B3450113 M NOBERE Zoundwéogo Centre-Sud 500 000 15373 service FASI/PAE1- 2 TONDE Lucienne 74669776 B2558196 F Commerce Secteur 3, Manga Zoundwéogo Centre-Sud 250 000 2911 FASI/PAE1- 3 ZOUNGRANA Sambila 76543731 B4499871 M Agropastoral Secteur 03, Manga Zoundwéogo Centre-Sud 1 000 000 2979 FASI/PAE1 - 4 KABRE TALATO 76333254 B6068229 F Agropastoral SECT 30 Zoundwéogo Centre-Sud 1 000 000 15805 FASI/PAE1- secteur 5 COMPAORE Fatoumata 68000297 B3179491 M Agropastoral Bazèga Centre-Sud 250 000 1486 2,KOMBISSIRI FASI/PAE1- 6 KABRE Moussa 78291447 B1062339 M Agropastoral Saponé Zoundwéogo Centre-Sud 1 000 000 2776 FASI/PAE1- TIENDREBEOGO Yembi 7 79558217 B6422515 M Agropastoral Koussaba- Toécé Bazèga Centre-Sud 500 000 2807 Issa FASI/PAE1- 8 NACOULMA Marata 57221069 B5668421 F Commerce MANGA Zoundwéogo Centre-Sud 200 000 2874 FASI/PAE1- 9 COMPAORE Saïdou 78329830 B2774628 M Agropastoral Secteur 1, Kombissiri Bazèga Centre-Sud 800 000 2953 FASI/PAE1- 10 BALORA Bassido Oscar 78066489 B0349750 M Agropastoral SECTEUR 07, -

Ii-3- Liste Nominative Des Etablissements Post-Primaires Et Secondaires D'enseignement General Prives Reconnus
II-3- LISTE NOMINATIVE DES ETABLISSEMENTS POST-PRIMAIRES ET SECONDAIRES D'ENSEIGNEMENT GENERAL PRIVES RECONNUS N° REGION NOM DE L'ETABLISSEMENT PROVINCES COMMUNES SECTEUR/VILLE 1 BOUCLE DU MOUHOUN COLLEGE PRIVE COULIBALY AMADOUBA BANWA SOLENZO SOLENZO 2 BOUCLE DU MOUHOUN COLLEGE PRIVE DE BENA BANWA BENA BENA 3 BOUCLE DU MOUHOUN COLLEGE PRIVE DOFINIHANMOU BANWA BENA BENA 4 BOUCLE DU MOUHOUN COLLEGE PRIVE DOFINITA DE DABOURA BANWA SOLENZO DABOURA 5 BOUCLE DU MOUHOUN COLLEGE PRIVE DOMINIQUE SYANO KONATE BANWA SOLENZO SOLENZO 6 BOUCLE DU MOUHOUN COLLEGE PRIVE EVANGELIQUE LA RESTAURATION BANWA SOLENZO SOLENZO 7 BOUCLE DU MOUHOUN COLLEGE PRIVE EVANGELIQUE SION BANWA SOLENZO SECTEUR 4 8 BOUCLE DU MOUHOUN COLLEGE PRIVE GRACE DIVINE BANWA SANABA SANABA 9 BOUCLE DU MOUHOUN COLLEGE PRIVE LABARAKA DE DIRA BANWA SOLENZO DIRA 10 BOUCLE DU MOUHOUN COLLEGE PRIVE LANAYA DE SANABA BANWA SANABA SANABA 11 BOUCLE DU MOUHOUN COLLEGE PRIVE LE SOLEIL LEVANT BANWA TANSILA TANSILA 12 BOUCLE DU MOUHOUN COLLEGE PRIVE MODERNE LES PROFESSIONNELS BANWA SOLENZO SECTEUR 2 13 BOUCLE DU MOUHOUN COLLEGE PRIVE SAINTE EDWIGE DE TOUGAN BANWA BENA BENA 14 BOUCLE DU MOUHOUN COLLEGE PRIVE SOL BENI BANWA SOLENZO SOLENZO 15 BOUCLE DU MOUHOUN LYCEE PRIVE ARC-EN-CIEL BANWA KOUKA SECTEUR 1 16 BOUCLE DU MOUHOUN LYCEE PRIVE CATHOLIQUEBERACA SCHOOL NOTRE DAME DE BANWA SOLENZO SECTEUR 3 17 BOUCLE DU MOUHOUN LYCEESOLENZO PRIVE EZER DE KOUKA Ex LYCEE PRIVE BANWA SOLENZO SOLENZO 18 BOUCLE DU MOUHOUN KESSEL DE KOUKA BANWA KOUKA SECTEUR 5 19 BOUCLE DU MOUHOUN LYCEE PRIVE WIOLOHO BANWA BONDOUKUI BONDOUKUI 20 BOUCLE DU MOUHOUN COLLEGE PRIVE ANSELME TITIAMA SANOU BANWA TANSILA TANSILA 21 BOUCLE DU MOUHOUN COLLEGE PRIVE ADEODAT KOSSI NOUNA SECT 3 22 BOUCLE DU MOUHOUN COLLEGE PRIVE CHARLES LWANGA KOSSI NOUNA SECT 3 23 BOUCLE DU MOUHOUN COLLEGE PRIVE FRANCO-ARABEEVANGELIQUE CANAAN KADIDJATOU DE KOSSI DJIBASSO SECT. -

Secretariat General ---Direction D
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE BURKINA FASO ET DE L’ALPHABETISATION ------------ ---------------- Unité - Progrès - Justice SECRETARIAT GENERAL ---------------- DIRECTION DE L’INFORMATION, DE L’ORIENTATION SCOLAIRE, PROFESSIONNELLE ET DES BOURSES Arrêté n°2018-__________/MENA/SG/DIOSPB portant proclamation de la liste des élèves du post primaire bénéficiaires de la bourse scolaire au titre de l’année scolaire 2017-2018 ============================= LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2016-001/PRES du 6 janvier 2016 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2018-0035 /PRES/PM du 31 janvier 2018 portant remaniement du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-0148/PRES/PM/SGG-CM du 23 mars 2017 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-0039/PRES/PM/MENA du 27 janvier 2017 portant organisation du Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation ; Vu la loi n°13/2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d’orientation de l’éducation ; Vu le décret n°2017-0818/PRES/PM/MENA/MINEFID du 19 septembre 2017 portant définition du régime des bourses dans les enseignements post-primaire et secondaire et son modificatif n°2017-1072/PRES/PM/MENA/MINEFID du 10 novembre 2017 ; ARRETE 1 Article 1 : Sous réserve de contrôle approfondi les élèves du post-primaire dont les noms suivent sont déclarés par ordre de mérite, bénéficiaires de la bourse scolaire, au titre de l’année scolaire 2017-2018 : REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN Bénéficiaires de la