Lesieur. Une Marque Dans L'histoire
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
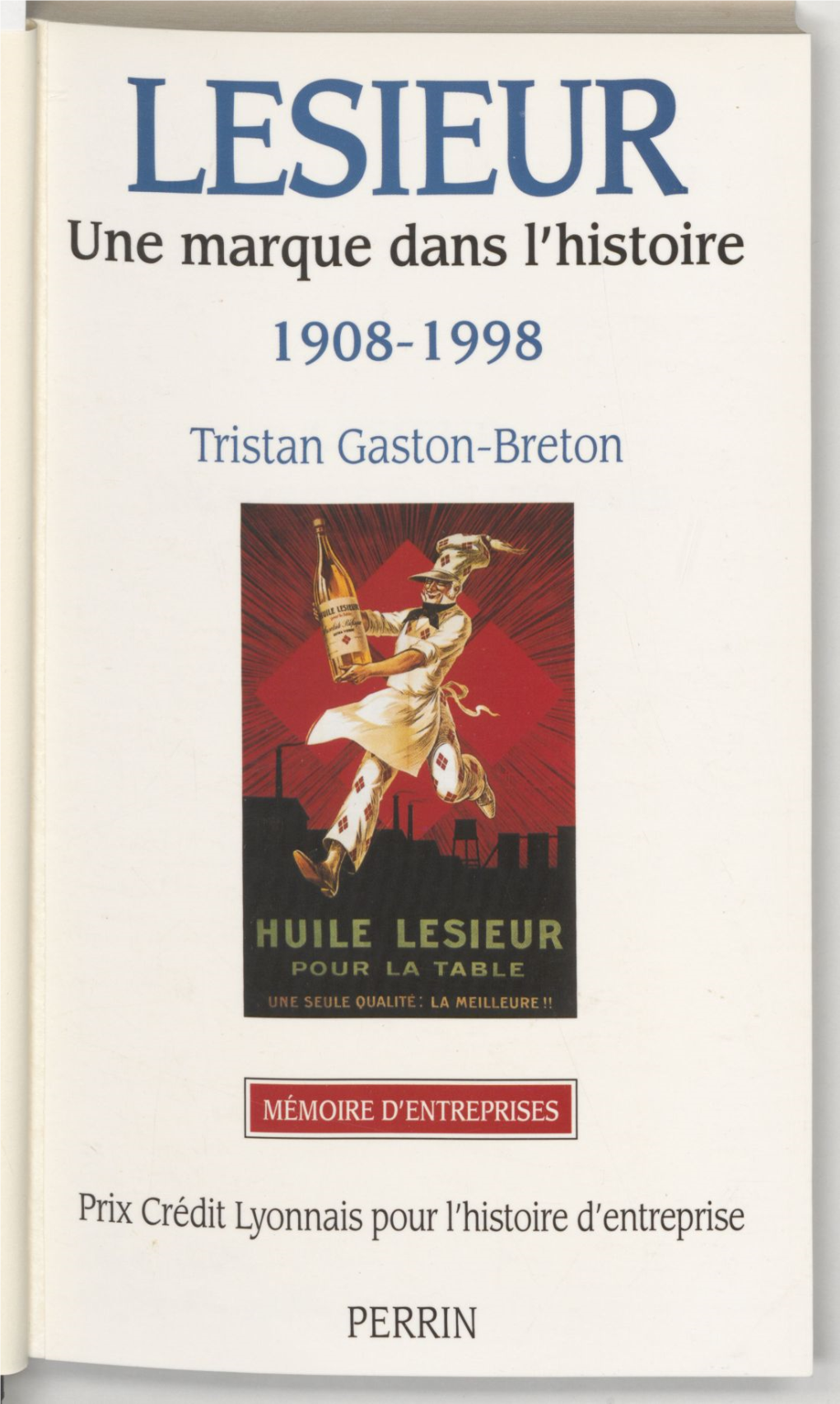
Load more
Recommended publications
-

Fonds Jacques Lemaigre Dubreuil (1914-2009)
Fonds Jacques Lemaigre Dubreuil (1914-2009). Répertoire numérique détaillé de la sous-série 763AP (763AP/1-763AP/41). Établi par Anne-Marie Enaux, conservateur du patrimoine, complété par Zénaïde Romaneix, conservateur du patrimoine, avec la collaboration de Franck Brissard, adjoint technique. Première édition électronique. Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 1986, 2018 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_055792 Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Ce document est écrit en français. Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales. 2 Archives nationales (France) Préface Introduction d'Anne-Marie Enaux à l'inventaire de 1986 (763AP/1-763AP/26). Les papiers personnels de Jacques Lemaigre Dubreuil sont le reflet de la vie mouvementée et passionnante de cet homme aux engagements multiples. Ils en sont également la justification puisque la majeure partie des documents présentés ici avait été assemblée et inventoriée à l'initiative de leur détenteur lui-même, pour répondre aux attaques et aux poursuites que lui valurent son rôle dans la préparation du débarquement en Afrique du Nord et sa position à l'égard du C.F.L.N. Outre ce premier classement, des séries de copies avaient été effectuées par précaution, ce qui permet à la collection actuelle de comporter un nombre de lacunes somme toute assez inférieur aux risques courus. Jacques Lemaigre Dubreuil fait en effet allusion à des saisies opérées à Alger après son départ clandestin d'Afrique du Nord, puis évoque la confiscation d'une valise de dossiers en Espagne (voir série E IV). -

Recueil Des Actes Administratifs De La Préfecture Du Nord Année 2019- Recueil N°208 Du 28 Août 2019
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ANNÉE 2019 – NUMÉRO 208 DU 27 AOÛT 2019 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD ANNÉE 2019- RECUEIL N°208 DU 28 AOÛT 2019 TABLE DES MATIÈRES SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DE LA CITOYENNETÉ - Commission départementale d’aménagement commerciale : Ordre du jour du lundi 9 septembre 2019 - Arrêté préfectoral fixant la circonscription de chacun des bureaux de vote et les lieux de réunion des électeurs pour le département du Nord à compter du 1er janvier 2020 SOUS-PRÉFECTURE DE VALENCIENNES BUREAU DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL - Arrêté préfectoral portant adhésion de la commune d’Emerchicourt et modification statutaire du syndicat mixte d’assainissement des communes d’Abscon, d’Emerchicourt, Mastaing et Roeulx PRÉFET DU NORD DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE CITOYENNETE BUREAU DE LA REGLEMENTATION COMMISSION DEPARTEMENTALE GENERALE ET DE LA CIRCULATION ROUTIERE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL Affaire suivie par Mme Sandrine BROCART Réf. : SB - CDAC Téléphone : 03.20.30.52.37. Télécopie : 03.20.30.53.72. O R D R E DU J O U R DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 ► 14h00 : DOSSIER PC-AEC N° 411 - demande d’autorisation d’exploitation commerciale de la SCI LEZO portant création, d’un ensemble commercial composé d’un magasin INTERMARCHE de 3 500m², de 3 cellules commerciales de secteur non alimentaires, de 250 m², 632 m² et 250 m² pour atteindre une sur - face de vente totale de 5 588 m², et d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail com- mandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile (drive) comprenant 2 pistes de ravitaille- ment à JEUMONT, Lieu-dit « La Justice » - Rue du Maréchal Leclerc ► 15h00 : DOSSIER PC-AEC N° 412 - demande d’autorisation d’exploitation commerciale de la SCI AVENIR PONT-A-MARCQ portant extension, par création d’un ensemble commercial de 10 cellules d’une surface de vente de 2 900 m² à PONT-A-MARCQ, rue d’Avelin – Les Hauts de Marcq. -

Exploring the Global Petroleumscape
15 PETROLEUMSCAPE AS HERITAGE LANDSCAPE The Case of the Dunkirk Port City Region Carola Hein, Christine Stroobandt, and Stephan Hauser In 2009, Jean-Francois Vereecke, an economist with the Urbanism Agency of Flanders-Dunkirk (Agence d’urbanisme de la région Flandre-Dunkerque [AGUR]), de- veloped the Toile Industrielle (Industrial Canvas®), a visualization of the interindustrial network of Dunkirk, an industrial city in northern France (Figure 15.1).1 The illustration situated the economic network of Dunkirk in the context of international markets, subcon- tractors, and competing ports. The accompanying analysis revealed the economic impact of the proposed closure of the Total refinery, particularly on the port of Dunkirk.2 This helped local actors negotiate with the national government, which agreed to the construction of a liquefied natural gas (LNG) terminal in the city to strengthen the local industrial ecosystem. Furthermore, in 2016, when the Total refinery finally closed most of its activities in Dunkirk, the company kept part of the refinery running as a training center called “Oleum”—the first in Europe—therefore retaining some of the local oil-related knowledge in the city.3 While the Toile Industrielle visualizes the economic presence of oil in Dunkirk, it does not capture oil’s spatial impact—inscribed in the pollution of its soils—or its impact on the narrative of the city. There is a need to further explore the physical reality of a place where the petroleum economy is coming (or must come) to an end and where the oil industry has vacated large sites, upsetting the long-standing economic, spatial, and social structure of the city. -
Répertoire Numérique Du Fonds, De L'église Réformée De France (E.R.F
Archives nationales Répertoire numérique du fonds de l’Église réformée de France (E.R.F.) 107AS/585-956 Inventaire par Valentine Weiss, conservateur aux Archives nationales et Éric Landgraf, secrétaire de documentation Avec le concours d’Évelyne Ratti, chargée des archives de l’E.R.F. et de Stéphane Le Flohic, adjoint-technique Avril 2010 INTRODUCTION Dates extrêmes : 1800-2006. Importance matérielle : 372 cartons, soit 42,20 mètres linéaires. Modalités d’entrée : dépôts de l’Église réformée de France du 31 octobre 2005 et du 31 mai 2007. Conditions d’accès : – 107 AS 585-591, 606-613, 615-642, 648-650, 652-747, 749-901, 903-904, 906, 908, 910-956 : libre. – 107 AS 592-605, 614, 643-647, 651, 748, 902, 905, 907, 909 : sur autorisation du déposant. Conditions de reproduction : sur autorisation du déposant. Historique. Désireux de préserver son patrimoine historique, le siège national de l’Église réformée de France (E.R.F.) a pris la décision de déposer ses archives historiques dans un centre d’archives publiques. Dans un premier temps, de 1998 à 2001, elles ont été déposées aux Archives de Paris. Ce dépôt a fait l’objet de deux entrées distinctes, auxquelles correspondent deux fonds, alors respectivement cotés D 74Z et D 4J. Tous deux ont fait l’objet d’un récolement. Puis, en 2001, les deux fonds de l’Église réformée de France ont été transférés aux Archives nationales. Ce transfert n’a pas modifié le statut du fonds de l’Église réformée de France : il reste un fonds d’archives privées d’associations déposé. -

La Désindustrialisation : Une Fatalité ?
29 Les Cahiers de la MSHE Ledoux Les fermetures d’usines, les délocalisations, les destructions massives d’emplois industriels et le rachat de fleurons de l’industrie nationale par La désindustrialisation : des groupes étrangers nourrissent l’inquiétude de l’opinion devant le déclin industriel de la France qui est sans équivalent en Europe. Pour comprendre ce une fatalité ? processus aux conséquences dramatiques, ce livre en étudie les causes, analyse le désengagement de Les Cahiers de la MSHE Ledoux l’État et le rôle du patronat, ausculte les dynamiques sous la direction de d’entreprises et de territoires industriels, décortique les réactions ouvrières, et compare l’évolution Dynamiques territoriales Jean-Claude DAUMAS, Ivan KHARABA française à celle de plusieurs pays européens. Au et Philippe MIOCHE terme de ce parcours, une question s’impose : la réindustrialisation est-elle encore possible ? Jean-Claude Daumas : professeur émérite à l’université de Franche-Comté et membre honoraire de l’Institut universitaire de France, est spécialiste de l’histoire des entreprises et du patronat. Ivan Kharaba : directeur de l’Académie François Bourdon (Le Creusot), ses recherches concernent l’histoire de l’industrie en Provence. Philippe Mioche : professeur émérite à l’université d’Aix- Marseille et titulaire de la chaire Jean Monnet, ses travaux portent sur l’histoire de l’industrie et de la construction de l’Europe. MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME ET DE L'ENVIRONNEMENT Dynamiques territoriales 11 CLAUDE NICOLAS LEDOUX La désindustrialisation : une -

Édouard Leclerc
THÈSE / UNIVERSITÉ DE RENNES 1 sous le sceau de l’Université Bretagne Loire pour le grade de DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE RENNES 1 Mention Sciences de gestion École doctorale des Sciences de l’Homme, des Organisations et de la Société présentée par Yves Soulabail Préparée à l’unité de recherche CREM UMR CNRS 6211 Centre de Recherche en Économie et Management IGR-IAE Thèse soutenue à Rennes Édouard Leclerc : le 28 avril 2016 naissance d’un devant le jury composé de : compagnonnage Jean-Yves DUYCK Professeur émérite, Université de La Rochelle / marchand rapporteur Marc FILSER pour les prix bas Professeur, Université de Bourgogne / rapporteur François BOBRIE (1949 – 1960) Professeur associé, Université de Poitiers / suffragant Joël JALLAIS Professeur émérite, Université de Rennes I / suffragant Gérard CLIQUET Professeur, Université de Rennes I / directeur de thèse NOTES Thèse de doctorat – Yves Soulabail | Notes 2 RÉSUMÉ - SUMMARY Édouard Leclerc : naissance d’un compagnonnage marchand pour les prix bas (1949-1960) Résumé Cette thèse de doctorat intitulée « Édouard Leclerc : naissance d’un compagnonnage pour les prix bas (1949- 1960) » vise à comprendre le processus ayant permis la constitution du mouvement des Centres Distributeurs Édouard Leclerc au travers de l’analyse de la démarche originale de leur fondateur. Nous avons ainsi cherché à comprendre pourquoi il souhaitait remplacer le commerce capitaliste et spéculateur par une formule constituée autour d’entreprises familiales. Nous avons cherché à comprendre qui était l’homme, ses principes et sa vision religieuse, son entourage et les appuis qui lui ont permis de constituer ce qui est devenu la première enseigne commerciale française à dominante alimentaire tout en s’interdisant d’utiliser initialement le terme de commerce. -

Arrondissement D'avesnes Page 1 De 6 Commune Circonscription Canton Bureau Circonscription Du Bureau Lieu De Vote Cousolre 3 19 - FOURMIES 0002 Rue Du Vieux Couvent
ARRONDISSEMENT D’AVESNES SUR HELPE Commune Circonscription Canton Bureau Circonscription du bureau Lieu de vote Aibes 3 19 - FOURMIES 0001 (unique) L’ensemble de la commune Mairie Amfroipret 3 5 - AULNOYE AYMERIES 0001 (unique) L’ensemble de la commune Mairie Anor 3 19 - FOURMIES 0001 Périmètre comprenant: rues de Trélon, Clémenceau, Pasteur, St-Roch, Revin, Neuve Forge, etc …. Jusqu'aux limites territoriales de la commune Salle des Fêtes Robert Dubar vers la Belgique. Anor 3 19 - FOURMIES 0002 Le reste de la commune jusqu’aux limites de Fourmies, Mondrepuis et Hirson Salle des Fêtes Robert Dubar Assevent 3 30 - MAUBEUGE 0001 (unique) L’ensemble de la commune Centre Socio-Culturel, salle Georges Brassens Audignies 3 5 - AULNOYE AYMERIES 0001 (unique) L’ensemble de la commune Mairie Aulnoye-Aymeries 12 5 - AULNOYE AYMERIES 0001 Rond Point des Acacias, rue Ampère, rue des Anciens, impasse d'Arsonval, rue Louis Blanc, impasse Delvigne, rue Paul Doumer, allée de Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville l’Ermitage, rue Jules Ferry, rue des Fleurs, impasse Foucault, rue du Foyer, rue Anatole France, Place et rue du Dr Guersant, rue de l’Hôtel de Ville, rue de l’Industrie, rue Louis Lumière, impasse Mercier, rue Parmentier (Du n° 1 au n° 45 et du n° 2 au n°48), rue Saint Martin, rue Henri Barbusse, rue Suzanne Lanoy. Aulnoye-Aymeries 12 5 - AULNOYE AYMERIES 0002 Chemin de Bachant, rue Hector Berlioz, rue Louise de Bettignies, rue Hélène Boucher, impasse et chaussée Brunehaut, rue du Dr Calmette, rue Ecole L. Socquet, Albert Camus, bloc Les Chardonnerets, la Sapinière, les Primevères, rue Jean Coquelin, rue Henri Dunant, rue Youri Gagarine, bloc Le Grillon, rue Serge Juste avenue Joliot Curie, rue Serge Juste, rue des Martyrs, allée des Sapins, allée des Tilleuls, rue Elsa Triolet, rue Albert Schweitzer du 1 au 29 et du 2 au 16, rue Martin Luther King du 2 au 6 et du 1 au 11, rue Cassin du 1 au 23 et du 2 au 22, rues du 19 mars 1962, Willy Brandt, Desmond Tutu, des Hortensias, Mère Térésa. -

Records of the Office of Strategic Services (Record Group 226) 1940- 1947
Records of the Office of Strategic Services (Record Group 226) 1940- 1947 Entry 210. Boxes 1-538. Location: 250 64/21/1. CIA Accession: 79-00332A. Box # Subject/Record/Information 1 Records relating to Francisco Mijare Fernandez, a double agent controlled by the FBI, whose German-assigned area was Mexico, April 25 – May 3, 1945, 3 pp. [WN#00001 – 00003] Records relating to Project DOCTOR, which sought to send two Belgian SI agents into Austria to organize Belgian workers for intelligence purposes, ca. November 1944 – May 1945, ca. 150 pp. [WN#00004 – WN#00025, and WN#00801 – WN#00832] Records relating to Project PAINTER, which sought to send two Belgian SI agents into Germany to organize Belgian workers for intelligence purposes, ca. November 1944 – May 1945, ca. 400 pp. [WN#00833] 2 Reports in French, with some English translations, from source Vulture relating to developments in France, the Middle East, and Spain, ca. November 1944 – August 1945, ca. 100 pp. [WN#00026] Records relating to the TWILIGHT Project, ca. March 1944 – June 1945, ca. 100 pp. The Twilight Project called for X-2 trained agents to live in German cities and keep track of underground movements that could hamper the Allied occupation. [WN#00027] Paris, France, SI Branch records relating to the COMET, ECLIPSE, HURRICANE, SUNSPOT, and TYPHOON Missions against Germany, ca. October 1944 – November, 1945, ca. 300 pp. [WN#00028 – WN#00030, WN#00032, and WN#00033] 3 Weekly Activity Report of the Field Analysis Unit, Brussels, Belgium, January 21 to February 3, 1945, 2 pp. [WN#00083] Memorandum from 110 [Allen W. -

Entrepôts Et Magasins Généraux De Paris (EMGP) a Été Fondée Le 22 Août 1860
ARCHIVES DE PARIS Archives privées Entrepôts et magasins généraux de Paris (E.M.G.P.) (1825 – 1992) [principalement vers 1860-1970] D.8 J 1 à 871 Répertoire numérique détaillé réalisé avec la collaboration de Christine BAL , Isabelle DE SOUSA , Jean-Philippe DUMAS , Evelyne EL BÈZE , Elisabeth NAJAR , Louis-Gilles PAIRAULT , Elisabeth PHILIPP , Jean-Jacques WEBER et Jean YANSEAUD . Septembre 2002 communicabilité : - immédiate : 1 à 41, 44 à 53, 58 à 63, 65 68, 71 à 74, 75 à 78, 80, 81, 85, 87 à 95, 97 à 110, 112 à 119, 121 à 133, 135, 136, 138, 139, 141 à 145, 147 à 150, 152 à 173, 182 à 184, 187 à 199, 201 à 208, 215, 230 à 248, 251 à 327, 329 à 331, 335, 350, 356 à 362, 364 à 369, 376 à 381, 391, 395 à 411, 413 à 420, 425 à 497, 503 à 506, 516, 520 à 547, 549, 551, 553 à 756, 801 à 869. - 30 ans : 42, 43, 54 à 57, 69, 70, 79, 96, 140, 146, 174 à 181, 200, 209 à 214, 216 à 228, 249, 250, 332 à 334, 336 à 349, 351, 352, 363, 370 à 375, 382 à 390, 392 à 394, 412, 421 à 424, 498 à 502, 507 à 515, 517 à 519, 548, 550 et 552. - 60 ans : 64, 111, 120, 151, 185, 186, 328, 353 à 355 et 757. 36 PRESENTATION CONTEXTE 1 La compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris (EMGP) a été fondée le 22 août 1860. Sa création répondait à la nécessité d’assurer à la capitale un approvisionnement et des lieux de stockage sûrs et réguliers de produits agricoles et de matières premières (blés, farines, sucres, alcools, bois, charbons, métaux…), au moment où la France du Second Empire était en plein essor industriel, économique et commercial. -

N°281 Avril 2014
Lab.RII UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D’OPALE Laboratoire de Recherche sur l’Industrie et l’Innovation CAHIERS DU LAB.RII – DOCUMENTS DE TRAVAIL – N°281 Avril 2014 INNOVATIONS DANS L’AGROALIMENTAIRE LE PARCOURS DE QUATRE ENTREPRENEURS HEROIQUES INITIATIVE INDIVIDUELLE ET TRAJECTOIRE TECHNO- ECONOMIQUE SECTORIELLE Sophie BOUTILLIER Dimitri UZUNIDIS 1 INNOVATIONS DANS L’AGROALIMENTAIRE LE PARCOURS DE QUATRE ENTREPRENEURS HEROIQUES INITIATIVE INDIVIDUELLE ET TRAJECTOIRE TECHNO-ECONOMIQUE SECTORIELLE AT THE ORIGINS OF THE FOOD INDUSTRY THE TRAJECTORY OF FOUR HISTORICAL ENTREPRENEURS – AN ANALYSIS BASED ON THE POTENTIAL OF RESOURCES Sophie BOUTILLIER Dimitri UZUNIDIS Résumé : Les produits agroalimentaires constituent la base de la reproduction physique et économique des sociétés humaines. La révolution industrielle du 19ème siècle a largement contribué à transformer les habitudes alimentaires en industrialisant des procédés de production traditionnels et contribuant ainsi à tracer de nouvelles trajectoires techno-industrielles. Ce document est centré sur le parcours de quatre entrepreneurs historiques (Nicolas Appert, Joseph Fry, Henri Nestlé et Georges Lesieur) qui ont été à l’origine d’innovations incrémentales dans le domaine de l’agroalimentaire : la conserve, la tablette de chocolat, la farine lactée et l’huile en bouteille. Comment ont-ils transformé l’industrie agroalimentaire ? Avec quelles ressources (en connaissances, financières et en relations sociales) ? Dans quel contexte historique ? Abstract: Food-produces constitute the framework of physical and economic reproduction of human societies. The industrial revolution of the 19th century radically transformed food habits by the industrializing traditional processes, and defining new techno-industrial paths. This paper is focused on the biographical analysis of four historical entrepreneurs (Nicolas Appert, Joseph Fry, Henri Nestlé and Georges Lesieur) who were at the origin of incremental innovations in food-produces activity: canned food, chocolate bar, milky flour and oil in bottle.