Book Reviews – Bulletin Bibliographique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
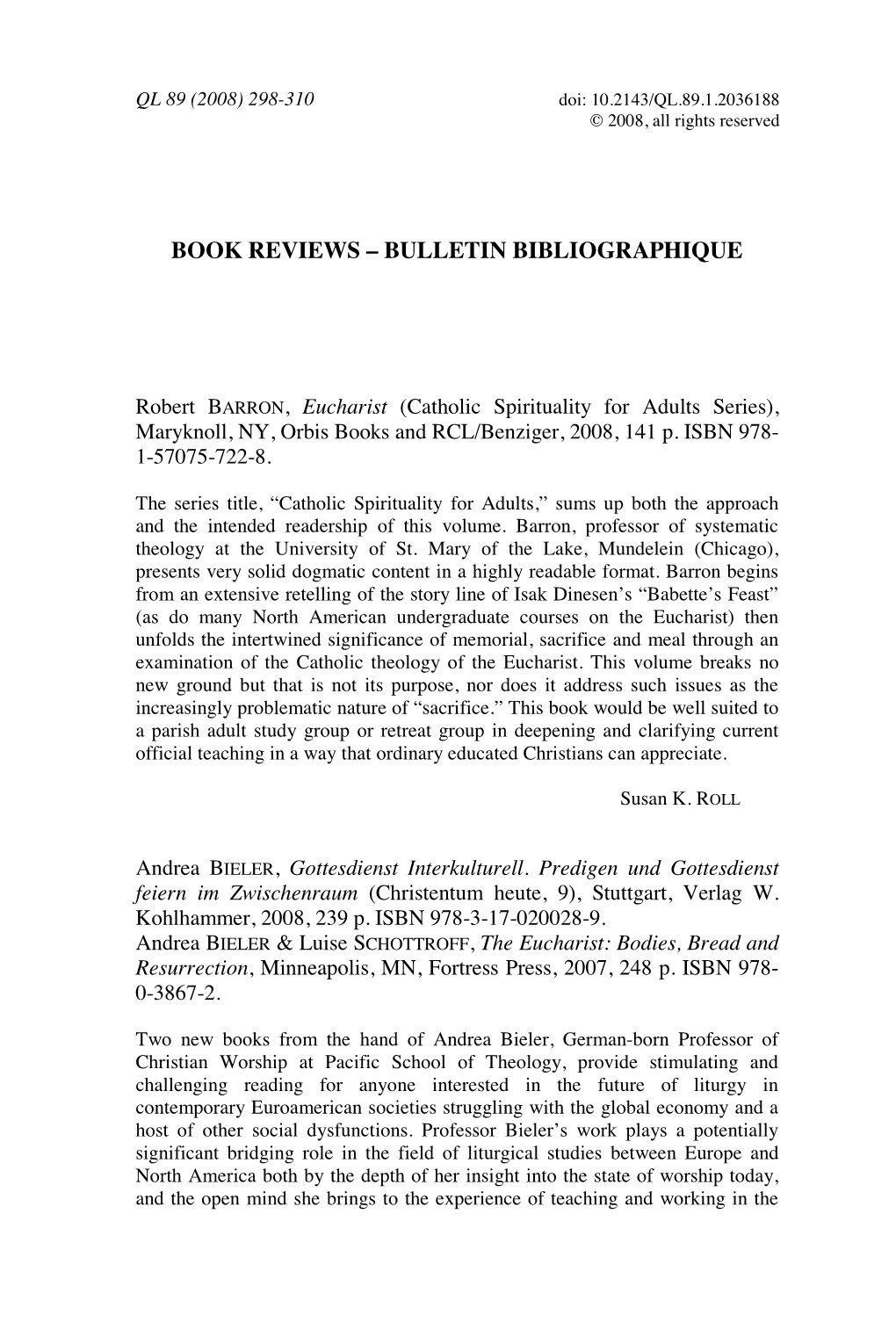
Load more
Recommended publications
-

The Restored Order: Preparing for Confirmation and Eucharist
The Restored Order Preparing for Confirmation and Eucharist TABLE OF CONTENTS Using This Resource 3 For the Program Director 4 Letter to Parents 5 The Restored Order: The Historical and Theological Vision 6 Handouts for Younger Children 7-13 Guide Notes for Catechists Working With Younger Children 14-19 Guide Notes for Parents of Younger Children 20 Handouts for Older Children 21-25 Guide Notes for Catechists Working With Older Children 26-31 Guide Notes for Parents of Older Children 32 Celebrating Confirmation 33-37 Role of Godparents and Sponsors 38 Frequently Asked Questions 39 Additional Resources: Preparing for the Scripture Play 40 The Spirit of the Lord (a Scripture Play) 41 Sample Prayer of the Faithful 42-43 ACKNOWLEDGMENTS Scripture quotations contained herein are from the New Revised Standard Version Bible: Catholic Edition, copyright © 1989, 1993 Division of Christian Education SACRAMENT PREPARATION of the National Council of the Churches of Christ in the United States of America. All rights reserved. DEVELOPMENT TEAM Excerpts from the Rite of Baptism for Children © 1969, International Committee on English in the Liturgy, Inc. Developing a Sacrament program requires the talents (ICEL); excerpts from the English translation of the General Instruction of the Roman Missal © 2010, ICEL; of many gifted people working together as a team. RCL Benziger excerpts from the Rite of Christian Initiation of Adults is proud to acknowledge these dedicated people who originally © 1985 ICEL; excerpts from the English translation of the contributed to the development of these materials. Roman Missal © 2010, ICEL. All rights reserved. Excerpts from “Letter to Families from Pope John Paul Peter M. -

NCCL's 78Th Annual
NCCL’s 78th Annual Conference and Exposition Professional Development Conference The For Catechetical Leaders May 19-22, 2014 Pre-conference: Sunday, May 18, 2014 • Post-conferences: Thursday, May 22, 2014 Renaissance St. Louis Grand Hotel 800 Washington Ave • St. Louis, Missouri Encontrando a Encontrando a Grades 1–6 Our Response to God’s Gifts GRADOS 1–6 Grades 1–6 Our Response to God’s Gifts GRADOS 1–6 ¡NUEVO! ¡NUEVO!EDICIÓN BILINGÜEEDICIÓN BILINGÜE Encontrando a Dios: Nuestra respuesta Encontrandoa los dones de aDios Dios: es Nuestraun programa respuesta abilingüe los dones de de formación Dios es un en programa la fe que bilingüefomenta deuna formación relación encon la Diosfe que fomentade por vida. una Provee relación conocimiento con Dios deauténtico por vida. y completo Provee conocimiento de las auténticoenseñanzas y decompleto la Iglesia de católica. las enseñanzas de la Iglesia católica. Finding God: Our Response to God’s FindingGifts is a God: bilingual Our Responsefaith formation to God’s Giftsprogram is a bilingualthat fosters faith a lifelongformation programrelationship that with fosters God a lifelong and knowledgerelationship of with the full God and and authentic knowledgeteachings of of the the Catholicfull and authenticChurch. teachings of the Catholic Church. Stop by the LoyolaStop by Press the Loyolabooth Pressfor a boothpreview! for a preview! 8697-6 8697-6 www.FindingGod.com | 800.621.1008 www.FindingGod.com | 800.621.1008 86976_NCCL_Ad.indd 1 2/11/14 9:45 AM 86976_NCCL_Ad.indd 1 2/11/14 9:45 AM National Conference for Catechetical Leadership Welcome 3031 Fourth Street NE to our Suite B Washington DC 20017 Annual Conference & Exposition Phone: 202-524-4628 May 18-22, 2014 Fax: 202-269-0209 Email: offi [email protected] Website: www.nccl.org NCCL is a Catholic Association dedicated to advancing the Church’s teaching mission in the United States, especially by promoting excellence in catechetical leaders. -

2019 Brochure Bible.Pdf
GOD’S WORD TODAY: ALIVE AND ACTIVE ! CATHOLIC BIBLE CONFERENCE ~ ARCHDIOCESE OF NEWARK LA PALABRA DE DIOS HOY: ¡VIVA Y ACTIVA! CONFERENCIA CATÓLICA DE LA BIBLIA ~ ARQUDIÓCESIS DE NEWARK Saturday, June 22, 2019 Sabado, 22 de junio de 2019 SETON HALL UNIVERSITY ~ JUBILEE HALL SOUTH ORANGE, NJ ON-LINE REGISTRATION IS AVAILABLE AT 2 Rev. Msgr.Thomas P. Nydegger, Ed.D. Vicar General and Moderator of the Curia, will preside at our Morning Prayer Service Vicario General y Moderador de la Curia presidirá nuestro servicio de oración de la mañana Conference Schedule / Horario de la Conferencia Registration and Hospitality 8:30 a.m.—9:00 a.m. Registración/Hospitalidad Welcome and Opening Prayer 9:00 a.m.—9:45 a.m. Bienvenida/Oración de Apertura SESSION 1 Keynote Address in Spanish 10:00 a.m.—11:20 a.m. Orador Principal en español Workshops in English 10:00 a.m.—11:20 a.m. Talleres en Inglés SESSION 2 Keynote Address in English 11:30 a.m.—12:50 p.m. Orador Principal en Inglés Workshops in Spanish 11:30 a.m.—12:50 p.m. Talleres en Español SESSION 3 Lunch / Almuerzo 1:00 p.m.—1:45 p.m. SESSION 4 Workshops in English and Spanish 2:00 p.m.—3:20 p.m. Talleres en Inglés y en Español Closing Prayer / Evaluations 3:20 p.m.—3:30 p.m. Oración Final / Evaluaciónes 3 Discurso Principal en Español / Keynote Address in Spanish Rev. Dempsey Rosales Acosta, S.S.L., S.T.D. Profesor Asociado de Teología Universidad St Thomas, Houston, Texas Associate Professor of Theology University of St Thomas, Houston, Texas “La Existencia Híbrida del Cristiano” El Padre Dempsey va a presentar el paradigma del Cristiano como debe vivir su identidad y fe en un ambiente multicultural, que muchas veces se presenta hostil, y esta articulado en los siguientes puntos de exposición: a)-El paradigm paulino; b)-El paradigma marcano; c )-Las latinidades y la identidad; d)-Los desafíos y la propuesta El Padre Dempsey Acosta es sacerdote católico nacido en Maracaibo, Venezuela. -

OLGC Parish Library Book Collection
OLGC Parish Library Book Collection We have books in the following categories: Activities / Courses / Classroom Apologetics (how to explain and defend the faith) Bible & Bible Study Booklet Catholic Faith / Faith Formation Children / Youth / Teen Family Religious Fiction Historical Inspirational (readings to uplift you) Liturgy / Liturgical Prayer Magazine Marian (readings about Mary) Men, Women / Marriage / Sexuality Papal & Pastoral Writings / Church Documents Personal Growth, Grief & Suffering, Healing Prayer ProLife / Moral & Social Issues Reference (dictionaries, directories, etc.) Religious Architecture and Art Religious Life and Community Saints, Holy People, Biographies Seasonal (readings specific to seasons of the Church year) Small Groups / Faith Community / Ministry Spanish Spanish Booklet Spanish Magazine Spirituality (how to grow in holiness) Theology / Philosophy How to Search for a Word or Name Note: The following instructions will not work if you are viewing this file in your Web browser. If you wish to search for a specific word or name, you'll need to go back to the webpage about the resource center, find the link you originally clicked on, right-click it, and choose “save as.” Then save this file to your computer and open it from there. The list is sorted by the categories on the previous page. To search the list for a certain word or name, press Ctrl + F on your keyboard. A search box will pop up in the upper right-hand corner. Type in the word or name you want to search for (such as “Bible” or “Chesterton”), and press “enter.” Note: the search will only find exact matches for what you type in, so for best results, try only one word at a time. -

Scope and Sequence • School
Scope and Sequence • School 1-8 Scope and Sequence Grade 1 Unit 1: We Believe, Part One Unit 2: We Believe, Part Two CHAPTER 1 - The Bible CHAPTER 5 - Mary, the Mother of Jesus Faith Concepts: Faith Concepts: • The Bible is God’s Word to us. • God chose Mary to be the mother of Jesus. • Stories in the Bible teach us about God’s love. • The Bible tells us about Mary’s faith in God. • We listen to the Bible at Mass. • Mary loves and trusts God. Sacred Scripture: Sacred Scripture: Luke 11:28 (Listen to God’s Word); 1 John 4:8–9, 21 Luke 1:28, 31, 35, 38 (The Annunciation); Luke 11: 28 (Blessed are the (God is love); Acts 8:26–40 (Saint Philip converts an African man); people who listen to God’s Word); Psalm 1:1-2 (Happy are the people who John 13:34b–35 (Love one another); Ephesians 6:1–2a (Obey your parents) listen to God’s Word) Disciple Power: faithful (Fruit of the Holy Spirit) Disciple Power: courage (Cardinal Virtue) Faith Vocabulary: Bible Faith Vocabulary: angels, trust Faith-Filled People: Saint Philip the Apostle Faith-Filled People: Saint Juan Diego Catholics Believe: Readings at Mass Catholics Believe: Feast Days The Church Follows Jesus: Saint Augustine The Church Follows Jesus: Mother Théodore Guérin Prayer: A Listening Prayer Prayer: Psalm Prayer Catechism of the Catholic Church (CCC): 101-133 Catechism of the Catholic Church (CCC): 484-507 U.S. Catholic Catechism for Adults (USCCA): pp. 11-15 U.S. Catholic Catechism for Adults (USCCA): pp. -

Parish Religion Education Curriculum
Diocese of Austin Parish Religious Education Curriculum Sixth Grade CCC Domai Mastery Scripture Mary, Saints, Chaste n Date Legend ID Student Outcome Assessment CST Role Models & Heroes Living (2001) REL-06.01.00 Goal 1 Creed: Understand, believe and proclaim the Triune God as revealed in the signs of creation, Sacred Scriptures, Catholic Tradition and Human experience. Doctrine REL-06.01.01 Describe works of a Trinitarian God as Describe God as One. Describe each Person of the 202, 234, 252, 254, St. Ausustine of Hippo 1: Trinity revealed in Scripture and Tradition and Trinity as wholly and entirely God yet distinct from one 257-260, 254-267 4: stated in the Nicene Creed. another. Articulate understanding that this is a mystery that cannot be fully understood and can only be accepted through the gift of faith. Creation REL-06.01.02 Describe God as the Creator of the State that there are two accounts of creation in the Book 54, 74 Michangelo 1: universe and as the Creator of humanity. of Genesis. Distinguish the creation accounts as mythic Gn 1-4 4: accounts telling us that creation is good, intended by God and loved by God. State how myths communicate basic truths. Original Sin REL-06.01.03 Describe the Fall and the doctrines of Show familiarity with the story of Adam and Eve 396-412, 1869 Maximillian Kolbe 4: Scriptures Son Original Sin. (Genesis 3), Cain and Abel (Genesis 4). Define Original Gn 3, 4 5: Social Justice Sin. Give examples of systemic human sinfulness. CST 3 8: Doctrine REL-06.01.04 State how God shows deep love and care Describe how despite human sinfulness God is faithful 302 Part I 3: God Humanity for humankind regardless of our sinfulness. -

Workshop A: 11:15 – 12:30
Engaging Parents in Faith Formation: Take Advantage of Opportunities Not all parents take on their role as primary educators of the faith; unfortunately many do not have the capacity to talk about, model and witness their faith with their children. They need faith formation too! In our programs we continue to nurture growth in faith in our students and we can also support families and nurture their growth as primary educators of the faith in the home. It all depends on "how" we do "what " we do. In this session, John will share some ideas and suggestions for engaging parents in their A1 child's faith formation. JOHN COLLINS, National Religion Consultant, William H. Sadlier, Inc. John is a retired elementary school principal and grade 2 teacher, former Director of Curriculum, and former DRE and catechist. He has worked with Sadlier in the northeast for many years and has presented at numerous catechetical congresses. He provides catechist training in parishes giving practical ideas, strategies & activities on how to teach & be a catechist. He is now a full-time National Religious Consultant with Sadlier. Sponsored by Sadlier Sunday Celebration of Liturgy of the Word with Children Celebrate and then take a closer look at a Sunday celebration of the Liturgy of the Word With Children. Presenter Mary Malloy will engage participants in the sharing of Scripture, song, and prayer as she leads a celebration for the Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time, Cycle A. Mary will engage participants in the celebration, lead an unpacking of the ritual and offer practical reminders and tips. -
OLGC Parish Library Book Collection
OLGC Parish Library Book Collection We have books in the following categories: Activities / Courses / Classroom Apologetics (how to explain and defend the faith) Bible & Bible Study Booklet Catholic Faith / Faith Formation Children / Youth / Teen Family Religious Fiction Historical Inspirational (readings to uplift you) Liturgy / Liturgical Prayer Magazine Marian (readings about Mary) Men, Women / Marriage / Sexuality Papal & Pastoral Writings / Church Documents Personal Growth, Grief & Suffering, Healing Prayer ProLife / Moral & Social Issues Reference (dictionaries, directories, etc.) Religious Architecture and Art Religious Life and Community Saints, Holy People, Biographies Seasonal (readings specific to seasons of the Church year) Small Groups / Faith Community / Ministry Spanish Spanish Booklet Spanish Magazine Spirituality (how to grow in holiness) Theology / Philosophy How to Search for a Word or Name Note: The following instructions will not work if you are viewing this file in your Web browser. If you wish to search for a specific word or name, you'll need to go back to the webpage about the resource center, find the link you originally clicked on, right-click it, and choose “save as.” Then save this file to your computer and open it from there. The list is sorted by the categories on the previous page. To search the list for a certain word or name, press Ctrl + F on your keyboard. A search box will pop up in the upper right-hand corner. Type in the word or name you want to search for (such as “Bible” or “Chesterton”), and press “enter.” Note: the search will only find exact matches for what you type in, so for best results, try only one word at a time. -

Eucharist We Give Thanks and Praise
Eucharist We give Thanks and Praise PROGRAM DIRECTOR’S MANUAL For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until he comes. 1 Corinthians 11:26 General Editors Sister Catherine Dooley, O.P. Monsignor Thomas McDade, Ed.D. The Subcommittee on the Catechism, United States Conference of Catholic Bishops, has found this catechetical series, copyright 2015, to be in conformity with the Catechism of the Catholic Church. Nihil Obstat: Sister Karen Wilhelmy, CSJ, Censor Deputatus Imprimatur: † Roger Cardinal Mahony, Archbishop of Los Angeles, September 2005 The nihil obstat and imprimatur are official declarations that the work contains nothing contrary to Faith and Morals. It is not implied, thereby, that those who have granted the nihil obstat and imprimatur agree with the contents, statements, or opinions expressed. Acknowledgments Consultants: James Gaffney, Enrico Hernandez, Monica Hughes, David Michael Thomas Contributors: Jane Ayer, Sylvia DeVillers, Janie Gustafson, Marianne Lenihan, Joanne McPortland, Margaret Savitskas, Rita Burns Senseman Music: Gary Daigle Spanish: José Segovia, María Elena Carrión Scripture passages are taken from the New American Bible with Revised New Testament. Revised New Testament of the New American Bible, copyright © 1986 by the Confraternity of Christian Doctrine, Washington, D.C. All rights reserved. Old Testament of the New American Bible, copyright © 1970 by the Confraternity of Christian Doctrine, Washington, D.C. No part of the Revised New Testament of the New American Bible can be reproduced in any form without permission in writing from the copyright owner. Lectionary for Masses with Children, Cycles A, B, C, and Weekdays, copyright © 1994, Archdiocese of Chicago, Liturgy Training Publications. -

August 19, 2012
August 19, 2012 ST. JOHN THE BAPTIST CHURCH ASCENSION OF OUR LORD CHURCH ST. JOHN , TEXAS MORAVIA , TEXAS DIOCESE OF VICTORIA IN TEXAS REV . JOHN C. PETERS , PASTOR REV . TOMMY CHEN , PAROCHIAL VICAR P.O. BOX H HALLETTSVILLE , TEXAS 77964 (361) 798-5888 (361) 798-4970 FAX WEBSITE : WWW .SHCATHOLICCHURCH .ORG E-MAIL : RECTORY @SHCATHOLICCHURCH .ORG MASS SCHEDULE Twentieth Sunday in Ordinary Time Saturday August 18 6:00 P.M. Dominic Loth Moravia Sunday August 19 9:30 A.M. Irene Mendel St. John Twenty-First Sunday in Ordinary Time Saturday August 25 6:00 P.M. Renee Sternadel Knezek St. John Sunday August 26 9:30 A.M. Joe & Irene Drozd Barcak Moravia Twenty Second Sunday in Ordinary Time Saturday Sept. 1 6:00 P.M. Sylvester Janak Moravia Sunday Sept. 2 9:30 A.M. Rose Melnar St. John THE WORD OF GOD Twentieth Sunday in Ordinary Time Readings: Proverbs 9:1-6 Psalm 34:2-7 Ephesians 5:15-20 John 6:51-58 Wisdom has prepared a banquet of food and wine, an image expressive of God’s communion with us. For those who desire life, Jesus gives his own flesh and blood. Thus we shall be filled with the Spirit. Twenty-First Sunday in Ordinary Time Readings: Joshua 24:1-2a,15-17,18b Psalm 34:2-3,16-21 Ephesians 5:21-32 or 5:2a,25-32 John 6:60-69 Joshua confronts the tribes of Israel: Will you desert your covenant with Yahweh? The desertion of disciples is a prelude to the paschal mystery. -

VIRTUAL CATECHESIS Online Material and Resources
VIRTUAL CATECHESIS Online Material and Resources The Challenge Articles: · The Challenge The COVID19 Pandemic has brought many challenges in our world. Prior to the Pandemic, Digital Technology in · The Planning Catechetical Ministry was seen as something that was needed as we entered a Digital Era where we use the internet in so · Publishers many areas of our life. The Pandemic not only accelerated the Loyola Press need to use technology in ministry but has made the use of these tools essential in the next catechetical year to continue Sadlier the catechetical processes in the parishes. RCL Benziger Therefore, this newsletter will present how publishers are Pflaum moving toward “Digital Catechesis” and what resources and St. Mary's Press tools will help us continue providing faith formation to children, youth, and families in our time. · Online Applications First, we will explore the main publishers that are in demand · Upcoming Events in our parishes. These publishers support a high percentage of parishes in the Diocese of San Jose and other Dioceses. Then, we will present the most prominent digital tools to establish communication at a time when social distancing and sheltering in place is so vital. Contact Information: This newsletter is the first step of a work in process as new ways and improvements to catechize in a digital world are Irma Alarcon de Rangel being developed. Also, sharing the best practices that we find throughout the parishes will contribute to this work in the [email protected] future. 4089830111 We pray to the Lord, that these resources and tools will move us in the right direction, enhancing the way that we make Him present in our society. -

Overview of 2012 Safe Environment Training Programs Diocese Program Name Creator/Type Priests Deacons Employees Volunteers Parents Children Albany, NY S.E
Overview of 2012 Safe Environment Training Programs Diocese Program Name Creator/Type Priests Deacons Employees Volunteers Parents Children Albany, NY S.E. Training Program Self generated x Child Lures Commercial x VIRTUS Commercial x x x x x Alexandria, LA VIRTUS Commercial x x x x x x Allentown, PA VIRTUS Commercial x x x x Praesidium Commercial x x Child Lures Commercial x Altoona-Johnstown, PA VIRTUS Commercial x x x x x x Amarillo, TX S.E. Training Program Self generated x x x x x x Anchorage, AK You Matter! Archdiocese of Atlanta x x Circle of Grace Archdiocese of Omaha x Learning About L.I.F.E. Commercial x x Praesidium Commercial x x Safe & Sacred Commercial x x x x Arlington, VA You Matter! Archdiocese of Atlanta x Formation in Christian Chastity Diocese of Harrisburg x VIRTUS Commercial x x x x x Atlanta, GA Praesidium Commercial x VIRTUS Commercial x You Matter! Self generated x x x x x x Austin, TX Praesidium Commercial x x x x x x Baltimore, MD Family Life Catechesis Self generated x Created to Love Self generated x Worthy of the Call Self generated x STAND Self generated x x x x x Baton Rouge, LA Circles of Care Self generated x Safe in Place Self generated x x x x x Dynamics of Disclosure Self generated x CDC on Safe Teen Driving Self generated x Beaumont, TX For Pete's Sake, Tell Commercial x Beaumont, TX Tricky People Commercial x Breaking the Silence Diocese of Orange x Learning About Life Commercial x Can't Fool Me Commercial x Praesidium Commercial x VIRTUS Commercial x x x x x Belleville, IL Presentations by various (Various) local agencies x x Initial Child Protection Policy Self generated x x x x x Biloxi, MS Diocese of Biloxi Child Protection Catechesis Self generated x Self generated- Mobile, Commitment to Protect Our Davenport & New Young People Orleans x x x x Birmingham, AL Child & Adolescents Child Protection Program Archdiocese of Mobile x Reducing the Risk Commercial x x x x x Bismarck, ND Dakota Children's Advocacy Center resources Commercial x Strong Voices, Smart Choices Diocese of St.