1 LA MORT EN PARTAGE a Propos Du Tombeau De Théophile Gautier
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
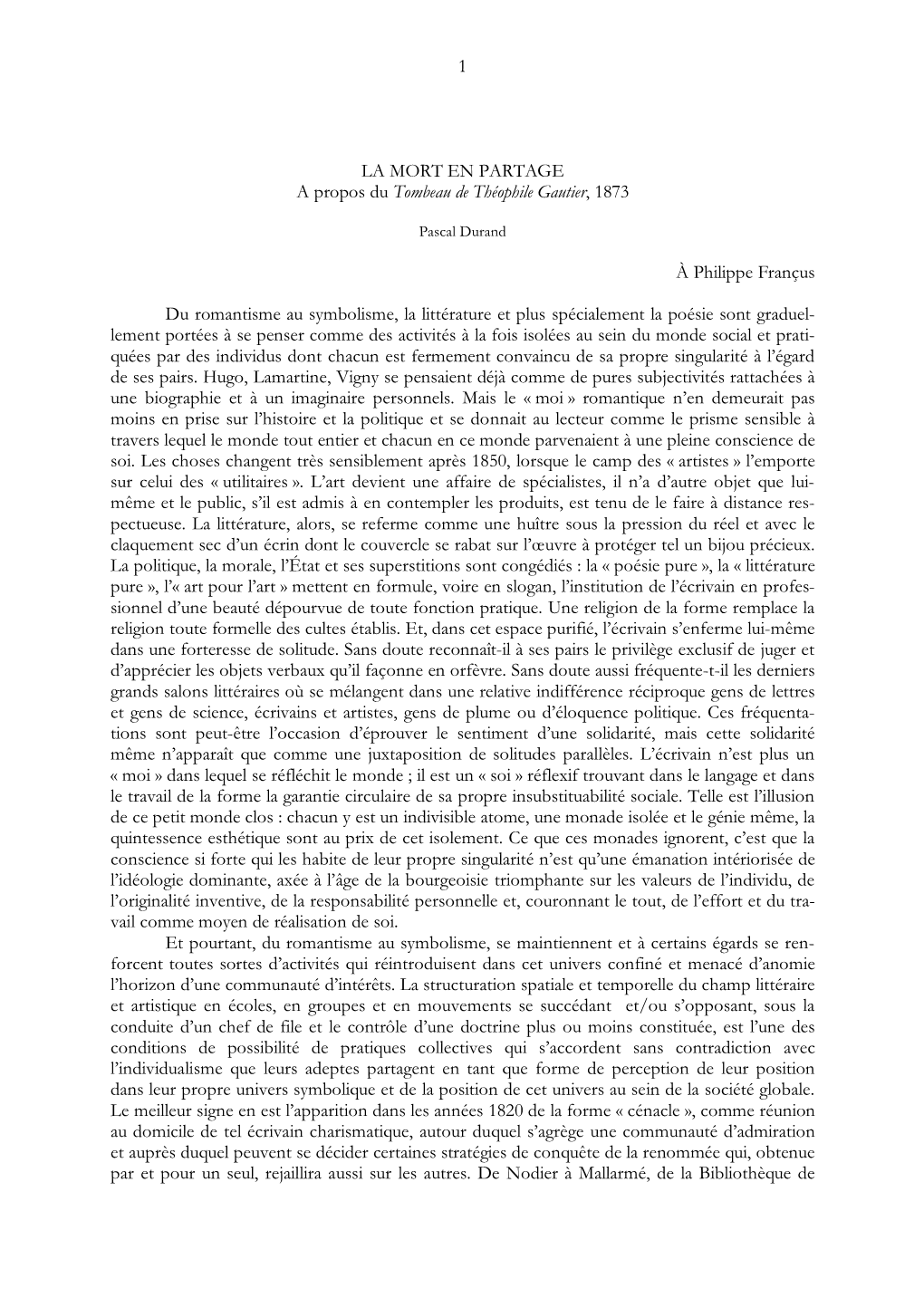
Load more
Recommended publications
-
June 1962 Acknowledgments
A CRITICAL ANALYSIS OF FIVE POEMS BY ALFRED DE VIGNY "MOISE," "LA MAISON DU BERGER," "LA COLERE DE SAMSON," "LE MONT DES OLIVIERS," AND "LA MORT DU LOUP" A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF ATLANTA UNIVERSITY IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS BY ELAINE JOY C. RUSSELL DEPARTMENT OF FRENCH ATLANTA, GEORGIA JUNE 1962 ACKNOWLEDGMENTS In the preparation of this thesis I have received generous as sistance from many persons, and it is my wish to acknowledge their kind efforts. I am indebted to Doctor Benjamin F. Hudson, Chairman, Department of French, Atlanta University, to Mrs. Jacqueline Brimmer, Professor, Morehouse College, and to Mrs. Billie Geter Thomas, Head, Modern Language Department, Spelman College, for their kind and help ful suggestions. In addition to my professors, I wish to thank the Library staff, especially Mrs. Annabelle M. Jarrett, for all the kind assistance which I have received from them. ii TABLE OF CONTENTS Page ACKNOWLEDGMENTS ±± Chapter I. INTRODUCTION ! II. THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE ROMANTIC THEMES 5 III. THE FUNCTION OF THE POET 21 IV. THE PHILOSOPHY OF ALFRED DE VIGNI AS REVEALED IN: "LA MAISON DU BERGER, •' AND "LA COLERE DE SAMSON" 30 V. THE PHILOSOPHY OF ALFRED DE VIGNY AS REVEALED IN: »LE MONT DES OLIVIERS,» AND "LA. MORT DU LOUP" £2 Conclusion 5j^ BIBLIOGRAPHY 57 iii CHAPTER I INTRODUCTION Each literaiy movement develops its favorite themes. Love, death, religion, nature and nationalism became the great themes of the romantic period. The treatment of these themes by the precursors of romanticism was later interpreted and developed by the major romantic poets, Alphonse de Lamartine, Victor Hugo, Alfred de Musset and Alfred de Vigny. -

A Banquet for Alphonse Lemerre, the Poets' Publisher
Document generated on 09/29/2021 6:06 p.m. Mémoires du livre Studies in Book Culture A banquet for Alphonse Lemerre, the poets’ publisher Ruth-Ellen St. Onge Le livre et l’imprimé engagés Article abstract Committed Books and Publications The Banquet offert à M. Alphonse Lemerre is a document associated with an Volume 3, Number 1, Fall 2011 event which took place at the Palais d’Orsay on the 24 January 1902 in order to celebrate the promotion of the publisher Lemerre to the rank of Officier in the URI: https://id.erudit.org/iderudit/1007580ar Légion d’honneur. The document is printed with great care in order to display DOI: https://doi.org/10.7202/1007580ar the taste and the art of the publishing house of Lemerre, known for its editions of contemporary poets (above all, the Parnassians), as well as the poets of the Pléiade. In addition, it reproduces the speeches and toasts given by Lemerre See table of contents and his guests José-Maria de Heredia, André Theuriet and other poets. The analysis of the discourse proffered by Lemerre in his speech, as well as that of his guests, will help us to understand his role as publisher, which, under Publisher(s) pressure by the opposition of symbolic and material values, became more and more contradictory as the century wore on. Above all, the article will show Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec how the Banquet highlights the ambivalence at the heart of Lemerre’s posture as an artistic, honest and paternal publisher of poets. -

Nineteenth-Century French Challenges to the Liberal Image of Russia
Ezequiel Adamovsky Russia as a Space of Hope: Nineteenth-century French Challenges to the Liberal Image of Russia Introduction Beginning with Montesquieu’s De l’esprit des lois, a particular perception of Russia emerged in France. To the traditional nega- tive image of Russia as a space of brutality and backwardness, Montesquieu now added a new insight into her ‘sociological’ otherness. In De l’esprit des lois Russia was characterized as a space marked by an absence. The missing element in Russian society was the independent intermediate corps that in other parts of Europe were the guardians of freedom. Thus, Russia’s back- wardness was explained by the lack of the very element that made Western Europe’s superiority. A similar conceptual frame was to become predominant in the French liberal tradition’s perception of Russia. After the disillusion in the progressive role of enlight- ened despotism — one must remember here Voltaire and the myth of Peter the Great and Catherine II — the French liberals went back to ‘sociological’ explanations of Russia’s backward- ness. However, for later liberals such as Diderot, Volney, Mably, Levesque or Louis-Philippe de Ségur the missing element was not so much the intermediate corps as the ‘third estate’.1 In the turn of liberalism from noble to bourgeois, the third estate — and later the ‘middle class’ — was thought to be the ‘yeast of freedom’ and the origin of progress and civilization. In the nineteenth century this liberal-bourgeois dichotomy of barbarian Russia (lacking a middle class) vs civilized Western Europe (the home of the middle class) became hegemonic in the mental map of French thought.2 European History Quarterly Copyright © 2003 SAGE Publications, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, Vol. -

The Franco-Prussian War in French and German Literature, 1871-1900
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Carolina Digital Repository Cultural Memory and National Representation: The Franco-Prussian War in French and German Literature, 1871-1900 Christina B. Carroll A thesis submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Department of History. Chapel Hill 2010 Approved by: Karen Hagemann Lloyd Kramer Donald Reid © 2010 Christina B. Carroll ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT CHRISTINA CARROLL: Cultural Memory and National Representation: The Franco- Prussian War in French and German Literature, 1871-1900 (under the direction of Lloyd Kramer) This thesis examines the memory of the Franco-Prussian War in nineteenth-century French and German literature from a transnational and comparative perspective. It focuses on how four writers – Alphonse Daudet, Émile Zola, Theodor Fontane, and Detlev von Liliencron – used representations of the war to construct visions of their respective nations, which they defined against the enemy “other” and delineated in political, social, gendered, and racial terms. As it makes clear, although these authors directed their texts at a national audience, many of their works crossed the border – so even as the writers posited themselves against each other, they remained in dialogue. The thesis also incorporates reviewers’ responses to these writers’ representations, and considers the scope of their popular appeal. It contends that this ongoing, contested, and transnational process of negotiation between writers, reviewers, and readers helped shape the memory of the war and understandings of nation in nineteenth-century France and Germany. -

Bindings & Illustrated Books
BERNARD QUARITCH LTD 40 SOUTH AUDLEY STREET, LONDON W1K 2PR Tel: +44 (0)20 7297 4888 e-mail: [email protected]; [email protected] Web: www.quaritch.com Bankers: Barclays Bank Plc, Level 27, 1 Churchill Place, London E14 5HP Sort Code: 20-65-90 Account Number: 10511722 Swift: BUKB GB22 Sterling Account: IBAN GB71 BUKB 2065 9010 5117 22 U.S. Dollar Account: IBAN GB19 BUKB 2065 9063 9924 44 Euro Account: IBAN GB03 BUKB 2065 9045 4470 11 Mastercard and Visa accepted Cheques should be made payable to ‘Bernard Quaritch Ltd’ VAT number: GB 840 1358 54 Recent Catalogues: 1437 Continental Books & Manuscripts 1436 Travel, Natural History & Scientific Exploration 1435 Music 1434 Medieval & Renaissance Manuscripts Recent Lists: 2018/10 Medicine and Quackery 2018/9 English Books & Manuscripts Summer 2018 2018/8 Photo London 2018 2018/7 Travel & Exploration List 2018/11 Front cover image from no. 8; back cover image from no. 12; inner cover detail from no. 21 EXTRA-ILLUSTRATED BY ROPS 1. AUREVILLY, J. Barbey d’. Les diaboliques: portrait de l’auteur gravé sur bois par P.-Eug. Vibert. Paris, Georges Crès et Cie, les Maitres du Livre, 1912. 8vo, pp. [6 (blank)], [6], 470, [6], [4 (blank)], with 2 portraits of the artist, of which one a woodcut by Vibert, 9 etchings by and after Rops, large folding facsimile of the author’s manuscript preface, and numerous woodcut ornaments by Vibert; short tear to facsimile; contemporary black morocco by Vermorel (front turn-in signed in gilt), spine lettered directly in gilt, morocco onlay of a devil with gilt eyes, board-edges and end-caps double filleted in gilt, top-edge gilt, broad turn-ins with elaborate morocco onlays of leaves and flowers tooled in blind, marbled endpapers within a single gilt fillet, sewn on four raised cords and one sunken, publisher’s printed wrappers bound in; a little rubbed at extremities, nonetheless a very good copy; provenance: –Jacques Odry (paper book-label printed in gilt). -

1 Stéphane Mallarmé Self-Appointed Publisher Of
Stéphane Mallarmé self-appointed publisher of one’s work: 1865-1898, the editorial epic of The Afternoon of a Faun Brigitte Ouvry-Vial, Le Mans University Published in Quaerendo, Brill Vol. 44 (2014): Issue 1-2 (Oct 2014) pp. 1-36 Stéphane Mallarme’s intense and thirty-six years long correspondence with his friends, fellow writers, successive publishers and printers depicts the editorial and publishing epic of his short but most cherished and acclaimed masterpiece, a poem in verse of 110 lines entitled L’Aprés-midi d’un Faune (The Afternoon of a Faun). A canonical figure in the legacy of modernism1, Mallarmé (1842–98) was indeed a French Symbolist poet, theorist, and teacher whose ideas and legendary salons set the stage for twentieth-century experimentation in poetry, music, theater and art and a lifelong champion of the book as both a literary endeavor and a carefully crafted material object. Scholars have pointed to the place occupied in his writing by “the ideal Book2”, the total Book to which he aspired and the Album, a collection of disjointed pieces to which he had to resign himself, but always a constellation, a spiritual instrument3, a vessel for a writing project, in other words having two dimensions or meanings, both material and poetic: “The book, a total expansion of the letter, must draw a mobility directly from it and, spacious, in its correspondences, institute a game, unknown, which confirms the fiction. […] The making of the book, which will evolve into a whole, begins with a sentence. Since time immemorial, the poet has known the place of this line in the sonnet, which is recorded for the mind or on a pure space. -

Writing Against the Reader: Poetry and Readership in France 1840-1880
Writing Against the Reader: Poetry and Readership in France 1840-1880 Jacqueline Michelle Lerescu Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2015 © 2015 Jacqueline Michelle Lerescu All rights reserved ABSTRACT Writing Against the Reader: Poetry and Readership 1840-1880 Jacqueline Michelle Lerescu This dissertation examines the changing ways in which nineteenth-century French poets addressed readers and constructed relationships with them from the late Romantic period through the rise of the Symbolist movement. While poetry’s increased isolation from the public is recognized as an important facet of the evolution of nineteenth-century poetry, the specific reasons for this have not been broadly studied. This dissertation first examines the poet-reader relationship in prefaces to poetic works, examining the shift from Romantic poets such as Victor Hugo and Alphonse de Lamartine, who considered addressing humanity an important part of their vocation, to mid-century poets such as Charles Baudelaire, Lautréamont and Charles Cros, who used prefaces to criticize and chase away readers, to later poets such as Stéphane Mallarmé and Arthur Rimbaud, who abstained from addressing readers by not writing prefaces or publishing their poetry. In order to understand the reasons for this shift, this dissertation examines new media and new readers which these poets rejected as the antithesis of poetry: the press, women and working-class readers. This dissertation studies poetry and critical articles in the mainstream press, women’s publications and publications by and for workers to reveal the models of the poet-reader relationship they presented. -

Origine Du Nom Histoire Du Mouvement
Origine du nom Le nom Parnasse est, à l'origine, celui d'un massif montagneux de Grèce. Dans la mythologie grecque, ce massif était, comme Delphes, consacré à Apollon et il était considéré comme la montagne des Muses, le lieu sacré des poètes. Le Parnasse devenu le séjour symbolique des poètes, fut finalement assimilé à l'ensemble des poètes, puis à la poésie elle-même. Lorsque, dans les années 1860 , il fut question de donner un titre au premier recueil de poésie qui devait faire suite à la revue L'Art de Louis-Xavier de Ricard , plusieurs solutions furent envisagées : Les Impassibles , reprenant un nom utilisé par des adversaires, fut jugé peu pratique ; dans les recueils analogues publiés depuis le XVI e siècle , on pouvait penser aux Parnasses , aux Cabinets de muses , aux Étrennes de l'Hélicon ; Les Poètes français aurait pu convenir, mais une anthologie récente 2 portait déjà ce nom ; quelqu'un, peut-être Leconte de Lisle, aurait proposé La Double cime . Louis-Xavier Ricard raconte comment le choix final fut opéré 3 : « Enfin, un beau jour, pendant une ascension en masse, et naturellement tumultueuse, par le petit escalier en colimaçon, une voix ironique jeta au hasard le titre : Le Parnasse contemporain . De qui était cette voix ? Ni Lemerre, ni personne de nous s'en souvient. Point d'un poète à coup sûr, mais d'un des amis qui venaient plus ou moins assidûment se mêler à nos séances, où ils faisaient office de public. Cette proposition intempestive causa d'abord une stupeur, puis des rires ironiques, et, finalement, elle fut, à l'unanimité des présents, acclamée, révolutionnairement, comme un défi. -

000540601.Pdf
UNIVERSITE DU QUEBEC MEMOIRE PRESENTE A UNIVERSITE DU QUEBEC A TROIS-RIVIERES COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAITRISE ES ARTS (PHILOSOPHIE) PAR DANIEL CLOUTIER LA PLACE DE LA MORT DANS LE SURREALISME AOUT °1983 Université du Québec à Trois-Rivières Service de la bibliothèque Avertissement L’auteur de ce mémoire ou de cette thèse a autorisé l’Université du Québec à Trois-Rivières à diffuser, à des fins non lucratives, une copie de son mémoire ou de sa thèse. Cette diffusion n’entraîne pas une renonciation de la part de l’auteur à ses droits de propriété intellectuelle, incluant le droit d’auteur, sur ce mémoire ou cette thèse. Notamment, la reproduction ou la publication de la totalité ou d’une partie importante de ce mémoire ou de cette thèse requiert son autorisation. à Hélène TABLE DES MATIERES Page REMERCIEMENTS ........................................ INTRODUCTION . .. ............. 1 CHAPITRES 1. LA LIBERTE ET LA MORT •..•.•...•.............••. 8 (ou la révolte contre la réalité extérieure) 1.1 L 'Humour no ir ••....•...•...•.•.••••.•..••• 9 1.2 Le suicide ............................... 21 II. L'AMOUR ET LA MORT .. ........................ 34 III. LA POESIE ET LA MORT .. ...................... 57 IV. UN PREDECESSEUR ROMANTIQUE : ALPHONSE RABBE • •• 115 V. LE SURREALISME ET L'AU-DELA ................... 124 5.1 La rel igion .............................. 124 5.2 Le Grand Jeu ............................. 130 5.3 Immanence et transcendance •....•.......... 132 VI. ESOTERISME ET DIALECTIQUE: LE POINT SUPREME • • 139 CONCLUSION ••••••• 1 ( ' •••••••••••••••••••••••••••••••••• 154 BIBLIOGRAPHIE . .. .. .. .. .. ........ 168 ANNEXES 1. L'amour et la mort • •••••••••••••••••••••••••••• 162 II. Résumé du mythe de Mélusine ................... 163 III . My th e d' l sis et d' 0 sir i s • • . 0. 164 IV. -

Parnasse Contemporain Et Symbolisme Parnasse Contemporain
Parnasse contemporain et Symbolisme Parnasse contemporain Le Parnasse est un mouvement poétique apparu en France dans la seconde moitié du XIXe siècle qui avait pour but de valoriser l’art poétique par la retenue et l'impersonnalité et le rejet de l'engagement social et politique de l'artiste. Le Parnasse apparaît en réaction aux excès lyriques et sentimentaux du romantisme imité de la poésie de Lamartine et de Musset, qui met en avant les épanchements sentimentaux aux dépens de la perfection formelle du poème. Pour les Parnassiens l'art n'a pas à être utile ou vertueux et son seul but est la beauté. C'est la théorie de « l'art pour l'art » de Théophile Gautier. Ce mouvement réhabilite aussi le travail acharné et minutieux de l'artiste et il utilise souvent la métaphore de la sculpture pour indiquer la résistance de la « matière poétique ». Le nom apparaît en 1866 quand l'éditeur Alphonse Lemerre publie le recueil poétique le Parnasse contemporain. Le nom de parnasse provient de la mythologie grecque, dans laquelle la montagne où résidait Apollon et ses neuf muses s’appelait : Parnasse. Elle serait le séjour de l’art et de la poésie, ce qui s’avère, pour les parnassiens, un nom adéquat pour leur nouvelle école poétique. Les précurseurs Théophile Gautier, Théodore de Banville. Les parnassiens les plus célèbres Leconte de Lisle, considéré comme la tête de file du mouvement, Sully Prudhomme, Les grands poètes associés Le mouvement fut accompagné par quelques grands poètes, qui l'ont côtoyé à des titres divers, sans être réductibles à ses thèses, comme : Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé. -

Ljuba POPOVIC / Popis Knjiga Biblioteke - Ljuba POPOVIĆ
Inventaire des livres de la bibliothèque - Ljuba POPOVIC / Popis knjiga biblioteke - Ljuba POPOVIĆ Carton / Kutija Biblioteka/Collection Izdavač/Editeur Broj/Numéro Naslov/Titre Autor/Auteur God/Année Kniževni Časopis GRADAC GRADAC , Čačak 17-18 Mediala NA 1977 A1 Kniževni Časopis GRADAC GRADAC , Čačak 21 Ešer NA 1978 Kniževni Časopis GRADAC GRADAC , Čačak 22-23 bez naslova NA 1978 Kniževni Časopis GRADAC GRADAC , Čačak 24-25 bez naslova NA 1978 Kniževni Časopis GRADAC GRADAC , Čačak 26-27 Savremena svetska priča NA 1979 Kniževni Časopis GRADAC GRADAC , Čačak 31 Istok i zapad NA 1979 Kniževni Časopis GRADAC GRADAC , Čačak 33 bez naslova NA 1980 Kniževni Časopis GRADAC GRADAC , Čačak 37-38 bez naslova NA 1981 Kniževni Časopis GRADAC GRADAC , Čačak 39-40 Svetska poezija danas NA 1981 Časopis Gradac od 17 do 121 do Časopis Gradac 17 od Kniževni Časopis GRADAC GRADAC , Čačak 41 Mauzolej borbe i pobede NA 1981 Kniževni Časopis GRADAC GRADAC , Čačak 42-43 Ljuba NA 1981 Kniževni Časopis GRADAC GRADAC , Čačak 46 bez naslova NA 1982 Revue littéraire Gradac du N° 17 à 121 17 N° littéraire GradacRevue du Kniževni Časopis GRADAC GRADAC , Čačak 49 bez naslova NA 1982 Kniževni Časopis GRADAC GRADAC , Čačak 51-52 Dvojnik NA 1983 Kniževni Časopis GRADAC GRADAC , Čačak 53 bez naslova NA 1983 Kniževni Časopis GRADAC GRADAC , Čačak 54+55 Žan Žene NA 1983 Kniževni Časopis GRADAC GRADAC , Čačak 56 Jackson Pollock NA 1984 Kniževni Časopis GRADAC GRADAC , Čačak 57-58 Apokalipsa NA 1984 Kniževni Časopis GRADAC GRADAC , Čačak 59 Savremena mađarska književnost -

José-María De Heredia: Perfección Formal Y Exaltación Del Colonialismo
Anales de Filología Francesa, n .º 17, 2009 ARTURO DELGADO CABRERA José-María de Heredia: perfección formal y exaltación del colonialismo ARTURO DELGADO CABRERA Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Résumé: Abstract. Heredia, placé entre la culture cubaine et la Halfway between Cuba and France, Heredia is France, est l’un des poètes les plus significatifs one of the most outstanding poets of the “Par- du Parnasse contemporain à la fin du XIXe siè- nasse” in late 19th century French literature . Fo- cle . Cette «école» poétique suivait les précep- llowing Leconte de Lisle’s precepts, this poetic tes de Leconte de Lisle, particulièrement con- trend is especially concerned about form, and cernée par la forme poétique, et considérait le considers the sonnet the ideal strophe, due to sonnet comme la strophe idéale, à cause de sa its long tradition and prestige in the Western longue tradition et son prestige dans le monde world . Heredia places himself in this tradition occidental . Heredia compose des sonnets d’une and succeeds in giving the sonnet an unusually rare perfection . Il est question ici de ceux qui achieved quality . We present here the poems sont inclus dans «Les Conquérants», une par- included in “Les Conquérants”, a part of his co- tie de son recueil Les Trophées (1893) . Nous llected poems Les Trophées (1893) . We empha- faisons remarquer que les modernes «Études size that most trends of modern “Cultural Stu- culturelles» ne seraient guère d’accord avec les dies” would not agree with Heredia’s point of points de vue de ce poète . view .