Le Niger, Espace D'émigration Et De Transit Vers Le Sud Et
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
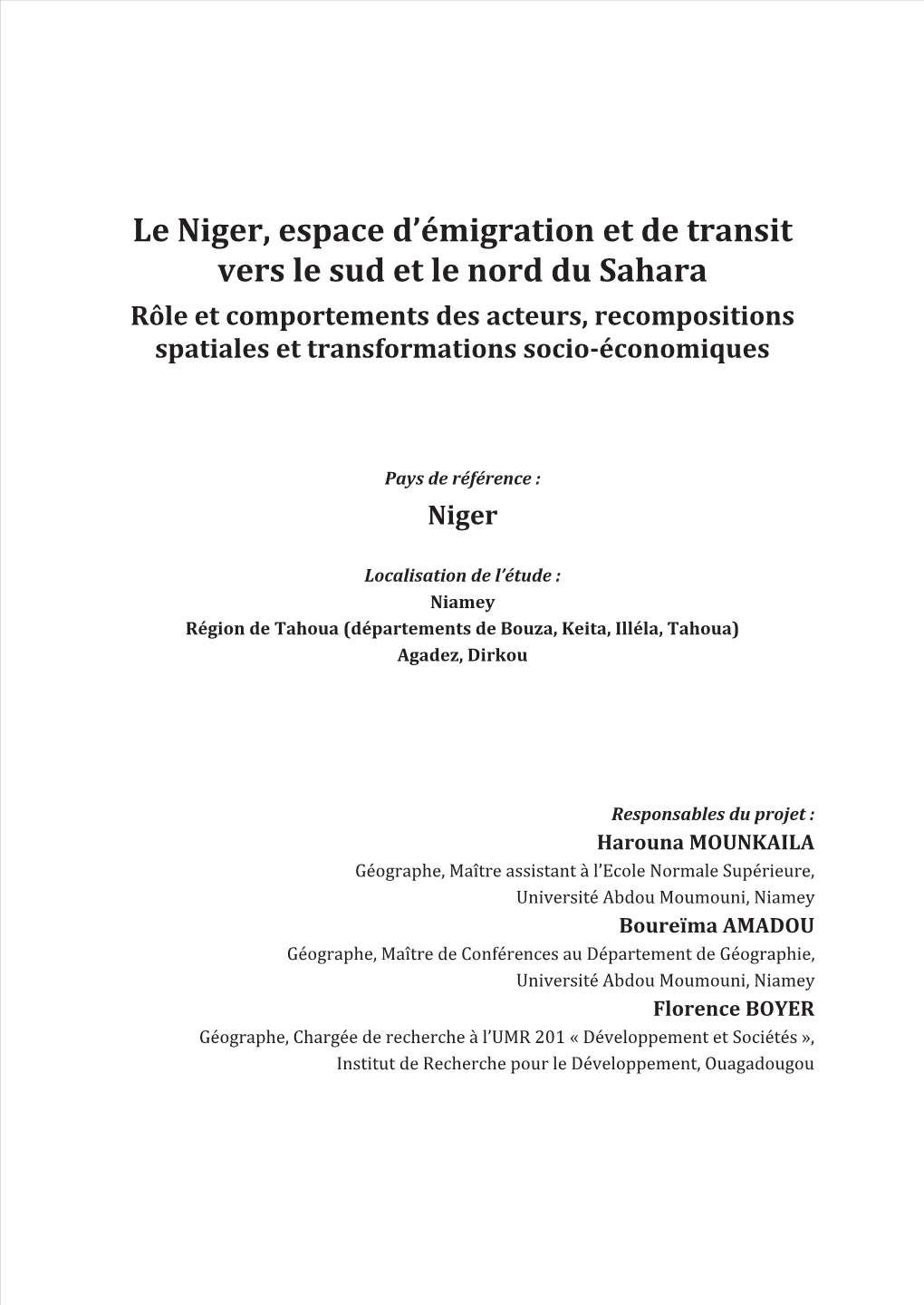
Load more
Recommended publications
-

NIGER : REGION DE TAHOUA Rapport Mensuel Au 30 Septembre 2020
NIGER : REGION DE TAHOUA Rapport mensuel Au 30 Septembre 2020 Ce rapport est produit par OCHA Niger en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 1er au 30 septembre 2020. FAITS SAILLANTS Chiffres clés 4M Habitants 113k MALI TASSARA Agadez Superficie (en km2) TILLIA Incidents* de sécurité (au 31/08) TCHINTABARADEN 56k ABALAK Personnes déplacées internes Zinder TAHOUA nnes déplacées internes KEITA Tillabery BAGAROUA BOUZA 20k ILLELA Maradi Personnes MADAOUA MALBAZA Dosso réfugiées BIRNI N'KONNI NIGERIA The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Source : UNHCR, Carte 1: Carte référentielle de Tahoua cluster Protection, INS Situation sécuritaire La situation sécuritaire est toujours volatile dans la région de Tahoua. Les forces de défense et de sécurité poursuivent les opérations de ratissage, des patrouilles régulières sont organisées dans les zones nord et nord-ouest qui sont encore sous état d’urgence. Néanmoins, les exactions des GANES contre la population civile à travers des razzias de bétail en guise de prélèvement de la Zakat, les violences physiques et autres extorsions ont continué. www.unocha.org/niger Le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires a pour mission de mobiliser et coordonner une réponse efficace et fondée sur des principes humanitaires en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. Rapport bimensuel – Tahoua | 2 Les populations vulnérables qui ont un accès limité aux services sociaux de base font également face à des opportunités économiques réduites. Dans la région d’Agadez, les actes récurrents de banditisme urbain et d’attaques à main armée sur les axes routiers continuent d’inquiéter les populations. -

Rapport Sur Les Indicateurs De L'eau Et De L'assainissement
REPUBLIQUE DU NIGER ----------------------------------------- FRATERNITE – TRAVAIL - PROGRES ------------------------------------------- MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT ---------------------------------------- COMITE TECHNIQUE PERMANENT DE VALIDATION DES INDICATEURS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE L’EAU ET L'ASSAINISSEMENT POUR L’ANNEE 2016 Mai 2017 Table des matières LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES I. INTRODUCTION ................................................................................................................ 1 II. DEFINITIONS ..................................................................................................................... 1 2.1. Définitions de quelques concepts et notions dans le domaine de l’hydraulique Rurale et Urbaine. ................................................................................................................ 1 2.2. Rappel des innovations adoptées en 2011 ................................................................... 2 2.3. Définitions des indicateurs de performance calculés dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable ................................................................................... 3 2.4. Définitions des indicateurs de performance calculés dans le domaine de l’assainissement .................................................................................................................... 4 III. LES INDICATEURS DES SOUS – PROGRAMMES DU PROSEHA .......................... 4 IV. CONTRAINTES ET PROBLEMES -

RGO 01 Waziri Migration Alak
RG Revue de Geographie de l’université de Ouagadougou n°00 octobre 2012 WAZIRI M, HAMBALLY Y., OUMAROU G. Impacts socio-économiques des migrations dans la commune rurale d’Allakaye au Niger Avertissement Les articles figurant sur ce site peuvent être consultés et reproduits sur un support papier ou numérique sous réserve qu’ils soient strictement réservés à un usage soit personnel, soit scientifique ou pédagogique excluant toute exploitation commerciale. La reproduction devra mentionner l’éditeur, le nom de la revue, l’auteur et la référence du document. Toute autre reproduction est interdite sauf accord préalable de l’éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur au Burkina Faso Référence électronique WAZIRI M, HAMBALLY Y., OUMAROU G., « Impacts socio- économiques des migrations dans la commune rurale d’Allakaye au Niger » in RGO [en ligne] n°00 2012, mis en ligne le ?2012. http://rgo- geocifid.org La pagination ne correspond pas à la pagination de l’édition papier. Editeur : Centre de Formation et d’Investigations géographiques pour le Développement (Géo-CFID), Université de Ouagadougou. ISSN : 0796-9694 IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES MIGRATIONS DANS LA COMMUNE RURALE D’ALLAKAYE AU NIGER WAZIRI MATO Maman, Département de Géographie, HAMBALLY Yacouba, Département de Sociologie OUMAROU Gambo, Département de sociologie Faculté des Lettres et Sciences Humaines Université Abdou Moumouni de Niamey – Niger RÉSUMÉ Au Niger, à travers les discours, la migration est perçue négativement par le pouvoir public. Dans la région de Tahoua, le solde migratoire est négatif selon les données du recensement de la population de 2001. La commune rurale d’Allakaye située dans la partie ouest du département de Bouza se particularise par son flux migratoire de plus en plus important. -

F:\Niger En Chiffres 2014 Draft
Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 1 Novembre 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Direction Générale de l’Institut National de la Statistique 182, Rue de la Sirba, BP 13416, Niamey – Niger, Tél. : +227 20 72 35 60 Fax : +227 20 72 21 74, NIF : 9617/R, http://www.ins.ne, e-mail : [email protected] 2 Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Pays : Niger Capitale : Niamey Date de proclamation - de la République 18 décembre 1958 - de l’Indépendance 3 août 1960 Population* (en 2013) : 17.807.117 d’habitants Superficie : 1 267 000 km² Monnaie : Francs CFA (1 euro = 655,957 FCFA) Religion : 99% Musulmans, 1% Autres * Estimations à partir des données définitives du RGP/H 2012 3 Le Niger en Chiffres 2014 4 Le Niger en Chiffres 2014 Ce document est l’une des publications annuelles de l’Institut National de la Statistique. Il a été préparé par : - Sani ALI, Chef de Service de la Coordination Statistique. Ont également participé à l’élaboration de cette publication, les structures et personnes suivantes de l’INS : les structures : - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques (DSEE) ; - Direction des Statistiques et des Etudes Démographiques et Sociales (DSEDS). les personnes : - Idrissa ALICHINA KOURGUENI, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique ; - Ibrahim SOUMAILA, Secrétaire Général P.I de l’Institut National de la Statistique. Ce document a été examiné et validé par les membres du Comité de Lecture de l’INS. Il s’agit de : - Adamou BOUZOU, Président du comité de lecture de l’Institut National de la Statistique ; - Djibo SAIDOU, membre du comité - Mahamadou CHEKARAOU, membre du comité - Tassiou ALMADJIR, membre du comité - Halissa HASSAN DAN AZOUMI, membre du comité - Issiak Balarabé MAHAMAN, membre du comité - Ibrahim ISSOUFOU ALI KIAFFI, membre du comité - Abdou MAINA, membre du comité. -

Arrêt N° 012/11/CCT/ME Du 1Er Avril 2011 LE CONSEIL
REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité – Travail – Progrès CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION Arrêt n° 012/11/CCT/ME du 1er Avril 2011 Le Conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière électorale en son audience publique du premier avril deux mil onze tenue au Palais dudit Conseil, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LE CONSEIL Vu la Constitution ; Vu la proclamation du 18 février 2010 ; Vu l’ordonnance n° 2010-01 du 22 février 2010 modifiée portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition ; Vu l’ordonnance n° 2010-096 du 28 décembre 2010 portant code électoral ; Vu l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de Transition ; Vu le décret n° 2011-121/PCSRD/MISD/AR du 23 février 2011 portant convocation du corps électoral pour le deuxième tour de l’élection présidentielle ; Vu l’arrêt n° 01/10/CCT/ME du 23 novembre 2010 portant validation des candidatures aux élections présidentielles de 2011 ; Vu l’arrêt n° 006/11/CCT/ME du 22 février 2011 portant validation et proclamation des résultats définitifs du scrutin présidentiel 1er tour du 31 janvier 2011 ; Vu la lettre n° 557/P/CENI du 17 mars 2011 du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante transmettant les résultats globaux provisoires du scrutin présidentiel 2ème tour, aux fins de validation et proclamation des résultats définitifs ; Vu l’ordonnance n° 028/PCCT du 17 mars 2011 de Madame le Président du Conseil constitutionnel portant -
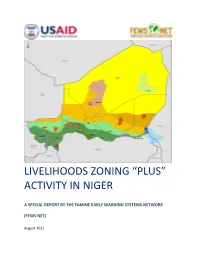
Livelihoods Zoning “Plus” Activity in Niger
LIVELIHOODS ZONING “PLUS” ACTIVITY IN NIGER A SPECIAL REPORT BY THE FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK (FEWS NET) August 2011 Table of Contents Introduction .................................................................................................................................................. 3 Methodology ................................................................................................................................................. 4 National Livelihoods Zones Map ................................................................................................................... 6 Livelihoods Highlights ................................................................................................................................... 7 National Seasonal Calendar .......................................................................................................................... 9 Rural Livelihood Zones Descriptions ........................................................................................................... 11 Zone 1: Northeast Oases: Dates, Salt and Trade ................................................................................... 11 Zone 2: Aïr Massif Irrigated Gardening ................................................................................................ 14 Zone 3 : Transhumant and Nomad Pastoralism .................................................................................... 17 Zone 4: Agropastoral Belt ..................................................................................................................... -

BROCHURE Dainformation SUR LA Décentralisation AU NIGER
REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES brochure d’INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION AU NIGER Edition 2015 Imprimerie ALBARKA - Niamey-NIGER Tél. +227 20 72 33 17/38 - 105 - REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES brochure d’INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION AU NIGER Edition 2015 - 1 - - 2 - SOMMAIRE Liste des sigles .......................................................................................................... 4 Avant propos ............................................................................................................. 5 Première partie : Généralités sur la Décentralisation au Niger ......................................................... 7 Deuxième partie : Des élections municipales et régionales ............................................................. 21 Troisième partie : A la découverte de la Commune ......................................................................... 25 Quatrième partie : A la découverte de la Région .............................................................................. 53 Cinquième partie : Ressources et autonomie de gestion des collectivités ........................................ 65 Sixième partie : Stratégies et outils -

Women Empowerment in Niger: from Markets to Households to Communities
Fighting Hunger Worldwide Women Empowerment in Niger: from Markets to Households to Communities VAM Gender and Market Study #11 2017 VAM Gender and Market Study 1 The Zero Hunger Challenge emphasizes the importance of strengthening economic empowerment in support of the Sustainable Development Goal 2 to double small-scale producer incomes and productivity. The increasing focus on resilient markets can bring important contributions to sustainable food systems and build resilience. Participation in market systems is not only a means for people to secure their livelihood, but it also enables them to exercise agency, maintain dignity, build social capital and increase self-worth. Food security analysis must take into account questions of gender-based violence and discrimination in order to deliver well-tailored assistance to those most in need. WFP’s Nutrition Policy (2017-2021) reconfirms that gender equality and women’s empowerment are essential to achieve good nutrition and sustainable and resilient livelihoods, which are based on human rights and justice. This is why gender-sensitive analysis in nutrition programmes is a crucial contribution to achieving the SDGs. The VAM Gender & Markets Initiative of the WFP Regional Bureau for West and Central Africa seeks to strengthen WFP and partners’ commitment, accountability and capacities for gender- sensitive food security and nutrition analysis in order to design market-based interventions that empower women and vulnerable populations. The series of regional VAM Gender and Markets Studies is an effort to build the evidence base and establish a link to SDG 5 which seeks to achieve gender equality and empower all women and girls. -

Stratégie De Développement Rural
République du Niger Comité Interministériel de Pilotage de la Stratégie de Développement Rural Secrétariat Exécutif de la SDR Stratégie de Développement Rural ETUDE POUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF INTEGRE D’APPUI CONSEIL POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL AU NIGER VOLET DIAGNOSTIC DU RÔLE DES ORGANISATIONS PAYSANNES (OP) DANS LE DISPOSITIF ACTUEL D’APPUI CONSEIL Rapport provisoire Juillet 2008 Bureau Nigérien d’Etudes et de Conseil (BUNEC - S.A.R.L.) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 10.600.000 FCFA 970, Boulevard Mali Béro-km-2 - BP 13.249 Niamey – NIGER Tél : +227733821 Email : [email protected] Site Internet : www.bunec.com 1 AVERTISSEMENTS A moins que le contexte ne requière une interprétation différente, les termes ci-dessous utilisés dans le rapport ont les significations suivantes : Organisation Rurale (OR) : Toutes les structures organisées en milieu rural si elles sont constituées essentiellement des populations rurales Organisation Paysanne ou Organisation des Producteurs (OP) : Toutes les organisations rurales à caractère associatif jouissant de la personnalité morale (coopératives, groupements, associations ainsi que leurs structures de représentation). Organisation ou structure faîtière: Tout regroupement des OP notamment les Union Fédération, Confédération, associations, réseaux et cadre de concertation. Union : Regroupement d’au moins 2 OP de base, c’est le 1er niveau de structuration des OP. Fédération : C’est un 2ème niveau de structuration des OP qui regroupe très souvent les Unions. Confédération : Regroupement les fédérations des Unions, c’est le 3ème niveau de structuration des OP Membre des OP : Personnes physiques ou morales adhérents à une OP Adhérents : Personnes physiques membres des OP Promoteurs ou structures d’appui ou partenaires : ce sont les services de l’Etat, ONG, Projet ou autres institutions qui apportent des appuis conseil, technique ou financier aux OP. -

Steering of Quality in Basic Education: Some
« Learn from promising practices to ensure effective use of large-scale learning assessment data for educational policy and practice » Regional support Programme for Quality Management in Basic Education *** Some examples of data utilization to identify priority areas of intervention Use of standardized assessment data to identify priority areas for intervention – Highlighting disparities with SNERS data in Senegal (i) SNERS assessment in Senegal : National System for the Evaluation of School Performance (SNERS from the French acronym): To understand the thresholds of students' proficiency in language and communication, mathematics and education for science and social life in order to remedy or strengthen their skills. Monitor the learning outcomes of BE and SE students in the core subjects targeted by previous editions. SNERS I (1994) à VII (2015) (ii) The analysis approach 1. Identification of the most vulnerable Academies Inspectorates (IA) from the point of view of learning, in other words, inspections that have a high proportion of students with learning challenges 2. Highlighting disparities between Education and Training Inspectorates (IEF) within Academies Inspectorates (IA). (iii) Some results (1/4) Chart 1 : Distribution of IAs by proportion of students with "learning disabilities" or "lack of mastery of basic skills" in SE 100% 90% 80% 72% 72% 70% 61% 62% 60% 52% 47% 48% 50% 43% 38% 39% 40% 34% 37% 29% 29% 30% 21% 23% 24% 20% 10% 0% (iii) Some Results (2/4) Although the Dakar IA is one of the least vulnerable IAs in terms of learning… Table 1 : IA of DAKAR : Proportion of students with "learning difficulties" or "lack of mastery of basic skills" in SE IA DAKAR 29% IEF Grand Dakar 51% IEF Dakar Plateau 34% IEF Parcelles Assainies 23% IEF Almadies 13% …. -

«Fichier Electoral Biométrique Au Niger»
«Fichier Electoral Biométrique au Niger» DIFEB, le 16 Août 2019 SOMMAIRE CEV Plan de déploiement Détails Zone 1 Détails Zone 2 Avantages/Limites CEV Centre d’Enrôlement et de Vote CEV: Centre d’Enrôlement et de Vote Notion apparue avec l’introduction de la Biométrie dans le système électoral nigérien. ▪ Avec l’utilisation de matériels sensible (fragile et lourd), difficile de faire de maison en maison pour un recensement, C’est l’emplacement physique où se rendront les populations pour leur inscription sur la Liste Electorale Biométrique (LEB) dans une localité donnée. Pour ne pas désorienter les gens, le CEV servira aussi de lieu de vote pour les élections à venir. Ainsi, le CEV contiendra un ou plusieurs bureaux de vote selon le nombre de personnes enrôlées dans le centre et conformément aux dispositions de création de bureaux de vote (Art 79 code électoral) COLLECTE DES INFORMATIONS SUR LES CEV Création d’une fiche d’identification de CEV; Formation des acteurs locaux (maire ou son représentant, responsable d’état civil) pour le remplissage de la fiche; Remplissage des fiches dans les communes (maire ou son représentant, responsable d’état civil et 3 personnes ressources); Centralisation et traitement des fiches par commune; Validation des CEV avec les acteurs locaux (Traitement des erreurs sur place) Liste définitive par commune NOMBRE DE CEV PAR REGION Région Nombre de CEV AGADEZ 765 TAHOUA 3372 DOSSO 2398 TILLABERY 3742 18 400 DIFFA 912 MARADI 3241 ZINDER 3788 NIAMEY 182 ETRANGER 247 TOTAL 18 647 Plan de Déploiement Plan de Déploiement couvrir tous les 18 647 CEV : Sur une superficie de 1 267 000 km2 Avec une population électorale attendue de 9 751 462 Et 3 500 kits (3000 kits fixes et 500 tablettes) ❖ KIT = Valise d’enrôlement constitués de plusieurs composants (PC ou Tablette, lecteur d’empreintes digitales, appareil photo, capteur de signature, scanner, etc…) Le pays est divisé en 2 zones d’intervention (4 régions chacune) et chaque région en 5 aires. -

Partenaires D'information
D’INFORMATION E Edition spéciale N° 015 Juin 2019 LETTRE S PPAARRTTEENNAAIIRREESS MATRICE DES INTERVENTIONS DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS DU SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL -2019 COOPERATION FINANCIERE GERMANO-NIGERIENNE-KFW Intervention 1 Intervention 2 Partenaire Coopération financière germano-nigérienne KFW Statut du partenaire Programme Contact BP : 723 Niamey Tel : 20 72 21 44 Programme d’Investissement et de Capacita - Programme d’Investissement et de Capacitation des Collectivi - Libellé tion des Collectivités Territoriales PICCT I tés Territoriales PICCT II Promouvoir la mise à disposition pérenne des in - frastructures socio-économiques conformes aux Promouvoir la mise à disposition pérenne des infrastructures socio- priorités des populations et en respectant les prin - économiques conformes aux priorités des populations et en respec - cipes de bonne gouvernance et - par la suite - une tant les principes de bonne gouvernance et - par la suite - une amélioration des conditions de vie de la population amélioration des conditions de vie de la population bénéficiaire. Les bénéficiaire. Les communes et régions mettent à Objectif du programme communes et régions mettent à disposition les infrastructures, au - disposition les infrastructures, auront accès – à ront accès – à moyen terme - à un mécanisme national de finance - moyen terme - à un mécanisme national de finan - ment des collectivités locales pour financer ces infrastructures et cement des collectivités locales pour financer ces renforcent leurs