Octave Mirbeau Et Les Impressionnistes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
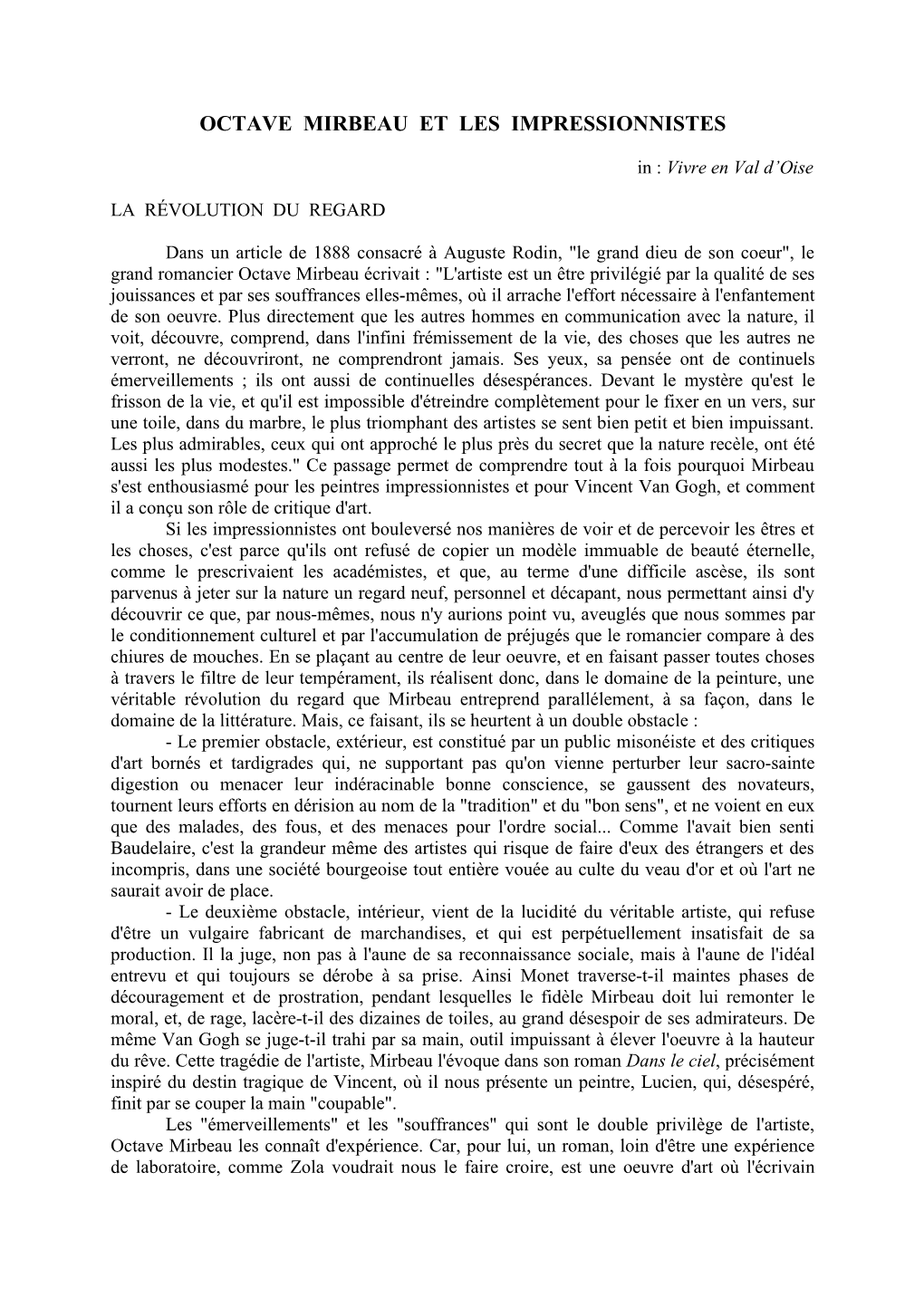
Load more
Recommended publications
-

Review Volume 20 (2020) Page 1
H-France Review Volume 20 (2020) Page 1 H-France Review Vol. 20 (December 2020), No. 217 Jennifer Forrest, Decadent Aesthetics and the Acrobat in Fin-de-Siècle France. New York: Routledge, 2020. 216 pp. Figures, notes, and index. $160.00 U.S. (hb). ISBN 9780367358143; $48.95 U.S. (eb). ISBN 9780429341960. Review by Charles Rearick, University of Massachusetts, Amherst. Jennifer Forrest takes us back to a time when many of the artistic avant-garde in Paris frequented the circus and saw acrobatic performances. Her argument in this new book is that innovative writers and artists found much more than images and themes in those popular entertainments. They also found inspiration and models for a new aesthetics, which emerged full-blown in works of the fin-de-siècle movement known as Decadent. First of all, I must say that anyone interested in the subject should not take the title as an accurate guide to this book. The word “acrobat” likely brings to mind a tumbler, tight-rope walker, or trapeze artist, but in Forrest’s account it includes others: the sad clown, the mime, the stock character Pierrot, and the circus bareback rider. The words saltimbanque and funambule (as defined by the author) would cover more of the cast of performers than “acrobat,” though neither French term is quite right for all of them or best for a book in English. The author begins with the year 1857 and a wave of notable works featuring clowns and funambules--works by Théodore de Banville, Honoré Daumier, Charles Baudelaire, Thomas Couture, and Jean-Léon Gérôme. -

Vincent Van Gogh the Starry Night
Richard Thomson Vincent van Gogh The Starry Night the museum of modern art, new york The Starry Night without doubt, vincent van gogh’s painting the starry night (fig. 1) is an iconic image of modern culture. One of the beacons of The Museum of Modern Art, every day it draws thousands of visitors who want to gaze at it, be instructed about it, or be photographed in front of it. The picture has a far-flung and flexible identity in our collective musée imaginaire, whether in material form decorating a tie or T-shirt, as a visual quotation in a book cover or caricature, or as a ubiquitously understood allusion to anguish in a sentimental popular song. Starry Night belongs in the front rank of the modern cultural vernacular. This is rather a surprising status to have been achieved by a painting that was executed with neither fanfare nor much explanation in Van Gogh’s own correspondence, that on reflection the artist found did not satisfy him, and that displeased his crucial supporter and primary critic, his brother Theo. Starry Night was painted in June 1889, at a period of great complexity in Vincent’s life. Living at the asylum of Saint-Rémy in the south of France, a Dutchman in Provence, he was cut off from his country, family, and fellow artists. His isolation was enhanced by his state of health, psychologically fragile and erratic. Yet for all these taxing disadvantages, Van Gogh was determined to fulfill himself as an artist, the road that he had taken in 1880. -

Vmcent Van Gogh's Published Letters: Mythologizing the Modem Artist
Vmcent van Gogh's Published Letters: Mythologizing the Modem Artist Margaret Fitzgerald Often the study of modem art entails an examination of he became associated with the symbolists. Neo-impres the artist along with his works. This interpretive method sionism and symbolism had in common. above all. their involves the mythology of an a.rtistic temperament from existence as variations of impressionism. They might even which all creative output proceeds. Vincent van Gogh ·s be seen as attempting 10 improve imprc.~sionism by making dramatic life, individual painting style. and expressive it more scientific. on the one hand. and by stressing the correspondence easily lend themselves to such a myth universal Idea over the personal vision. on the other.• The making process. This discussion bricHy outl ines the circum first critics 10 write about van Gogh's art in any depth were stances surrounding tbe pubLication of van Gogh ·s let1ers in symbolist writers. Once this association is made. the the 1890s io order to suggest that a critkal environment categorization persists in the criticism and forms the pre existed ready 10 receive the leucrs in a particular fashion. an dominant interpretation for van Gogh's art works . environment that in tum produced an interpretation for the In the initial issue of the Mercure de France, a paintings. symbolist publication that made its debut in January 1890. TI1roughou1 the 1890s. excerpts from van Gogh ·s Albert Aurier printed an article entitled ''The Isolated Ones: leners 10 his brother Theo and 10 the symbolist painter Vincent van Gogh ..., First in a seric.~ about isolated artists, Emile Bernard were published in the symbolist journal and fonuirously limed, since some of Vincent's works were Mercure de France. -

What Would the Dreyfus Affair Have Been Without Octave Mirbeau?
What Would the Dreyfus Affair Have Been Without Octave Mirbeau? Robert S. APRIL The Mount Sinai School of Medicine RÉSUMÉ Cet essai se propose d’explorer la contribution de Mirbeau au mouvement dreyfusard de la fin des années 1890, en envisageant en particulier le renforcement de l’alliance entre ses différentes factions. De nombreux anarchistes et socialistes ont tout d’abord prétendu que la traduction en cour martiale d’un officier de cavalerie était une affaire interne à l’armée. D’autre part, ils considéraient qu’en dépit d’une possible injustice et d’attitudes antisémites, le Capitaine Dreyfus, qu’on avait accusé, condamné et dégradé, était un membre privilégié de la riche bourgeoisie dont le combat ne les intéressait pas. Mirbeau s’exprima avec éloquence dans L’Aurore, prit part à des réunions avec des intellectuels et afficha une persuasion morale vigoureuse qui encouragea un grand nombre à se joindre à l’alliance dreyfusarde. Il est permis de supposer que, sans lui, le camp des dreyfusards serait difficilement parvenu à obtenir un nombre suffisant de participants pour faire face aux procès Zola et Esterhazy ainsi qu’au second procès de Dreyfus. Nous avancerons que la contribution mirbellienne à l’Affaire Dreyfus consiste à avoir rapproché le camp anarchiste- socialiste de celui des modérés dreyfusards. Le roman Le Jardin des supplices (1899) fut le commentaire allégorique de l’Affaire Dreyfus par Mirbeau, l’expression de la réaction et de la pensée qu’inspira à l’écrivain ce moment historique et littéraire de la France moderne. Octave Mirbeau was a novelist, an essayist, and an active member of the Dreyfusard literary circle. -

Paul Gauguin and Octave Mirbeau : Two Men Brave Enough to Stun the “Society of the Spectacle” »
« Paul Gauguin and Octave Mirbeau : Two Men Brave Enough To Stun the “Society of the Spectacle” » The "spectacle" of nineteenth-century France, though revered and accepted by so many members of the bourgeois class, was met with harsh opposition and resentment by those on the outside--the disempowered, including the artists, the poor, and those viewed as disenfranchised members of the other class looking in. Many of the artists, whether they were writers, painters, or musicians, chose to voice their opinions about this unjust, immoral society which they despised, through their personal means of escape and rebellion--their works of art. By writing or creating other works of visual art, these artisans were able to clearly express their discontent with the government and the society of the spectacle. This despondency, felt intensely by artist Paul Gauguin and writer Octave Mirbeau, led each man to his own, private escape. For Gauguin, this artistic mission in response to his frustration with the social aspects of life in France, involved traveling to Tahiti, a place of solitude and isolation, and living among the native Maori people. Mirbeau, on the other hand, chose to express his disgust with the French government by writing a horrific, radical fin-de-siècle novel, The Torture Garden. Each man chose to escape from reality in his own, unique way. Gauguin’s escape was to an idealized Utopia—a place seen by Gauguin as primitive—a place where he hoped to forget the harsh realities of modern France. Mirbeau chose a much different approach to diversion. His novel, which terrorizes the reader, represented the society as a nightmare. -

Paul Gauguin's Genesis of a Picture: a Painter's Manifesto and Self-Analysis
Dario Gamboni Paul Gauguin's Genesis of a Picture: A Painter's Manifesto and Self-Analysis Nineteenth-Century Art Worldwide 2, no. 3 (Autumn 2003) Citation: Dario Gamboni, “Paul Gauguin's Genesis of a Picture: A Painter's Manifesto and Self- Analysis,” Nineteenth-Century Art Worldwide 2, no. 3 (Autumn 2003), http://www.19thc- artworldwide.org/autumn03/274-paul-gauguins-genesis-of-a-picture-a-painters-manifesto- and-self-analysis. Published by: Association of Historians of Nineteenth-Century Art Notes: This PDF is provided for reference purposes only and may not contain all the functionality or features of the original, online publication. ©2003 Nineteenth-Century Art Worldwide Gamboni: Paul Gauguin‘s Genesis of a Picture: A Painter‘s Manifesto and Self-Analysis Nineteenth-Century Art Worldwide 2, no. 3 (Autumn 2003) Paul Gauguin's Genesis of a Picture: A Painter's Manifesto and Self-Analysis by Dario Gamboni Introduction There is an element of contradiction in the art historian's approach to interpreting the creative process. While artistic creativity is seen as stemming from the psychology of the creator, there is a tendency to deny the artist possession of direct or rational access to its understanding. Both attitudes have their roots in romantic art theory. These attitudes imply, on the one hand, that the artist's psyche is the locus of creation, and, on the other, that intuition and the unconscious play the major roles. Such ideas remained prevalent in the twentieth century, as attested, for example, by the famous talk given in April 1957 by Marcel Duchamp under the title "The Creative Act," which defined the artist as a "mediumistic being."[1] This element of contradiction explains the frequently ambivalent treatment of artists' accounts of their own creation: although we recognize that they possess a privileged and even unique position, we tend to dismiss their explanations as "rationalizations" and to prefer independent material evidence of the genesis of their works, such as studies or traces of earlier stages. -

La 628-E8”: Un Récit D’Avant-Garde?
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OpenEdition Studi Francesi Rivista quadrimestrale fondata da Franco Simone 185 (LXII | II) | 2018 OCTAVE MIRBEAU: UNE CONSCIENCE AU TOURNANT DU SIÈCLE - sous la direction de Ida Merello “La 628-E8”: un récit d’avant-garde? Marie-Bernard Bat Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/studifrancesi/12579 DOI : 10.4000/studifrancesi.12579 ISSN : 2421-5856 Éditeur Rosenberg & Sellier Édition imprimée Date de publication : 1 août 2018 Pagination : 234-242 ISSN : 0039-2944 Référence électronique Marie-Bernard Bat, « “La 628-E8”: un récit d’avant-garde? », Studi Francesi [En ligne], 185 (LXII | II) | 2018, mis en ligne le 01 septembre 2019, consulté le 06 septembre 2019. URL : http:// journals.openedition.org/studifrancesi/12579 ; DOI : 10.4000/studifrancesi.12579 Studi Francesi è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale. Marie-Bernard Bat “La 628-E8”: un récit d’avant-garde? Abstract La 628-E8 breaks with the conventional narrative rules and rejects the aesthetic legacy of the past. Octave Mirbeau dedicates this hybrid novel to Ferdinand Charron, the man who de- signed Mirbeau’s motorcar. The title of the novel comes from his car’s number plate. This innovative work is an example of Mirbeau’s literary modernity at the turn of the century. It is a mise en abyme of the Futurist aesthetic thanks to the speed of the car that establishes a new relationship to the world. Whereas Mirbeau makes a clean sweep of the past and praises speed and technology, he is not blinded by the myth of Progress and superman. -

The Scopophilic Garden from Monet to Mirbeau in His Attempt
CHAPTER 7 Hysterical Vision: The Scopophilic Garden from Monet to Mirbeau In his attempt to give ocular disorders a psychoanalytical inter pretation, Freud cited the tale of Lady Godiva. This "beautiful legend," he wrote, "tells how all the town's inhabitants hid behind their shuttered windows, so as to make easier the lady's task of riding naked through the streets in broad daylight, and how the only man who peeped through the shutters at her revealed loveli ness was punished by going blind."1 For Freud, the fate of the renegade voyeur illustrated how scopophilia (the "love of looking") is punished by the ego with blindness or, in the term popularized by his teacher Jean-Martin Charcot, with scotomization (from the Greek skotos, meaning "darkness"; signifying partial, distorted, or peripheral vision within the fieldof ophthalmology). Moving beyond the studies of hysterical vision made by Charcot and Pierre Janet between 1887 and 1889, which merely identified characteristic symptoms such as color blindness, dilated pupils, strabismus, and the twisting of the orb to reveal the whites of the eye, Freud inferred the law of lex talionis (Urteilvenverfung), literally, "retaliation," in the condemnation of a visual representation deemed sexually culpable by the faculty of judgment. This "verdict of guilty," strangely recalling the old wives' tale that masturbation leads to blindness, also evokes as its corollary the equally proverbial notion 1. Sigmund Freud, "The Psycho-Analytic View of Psychogenic Disturbance of Vision" (1910), Standard Edition 11:217. Further references to this essay will be to this edition and will be abbreviated "DY.'' 147 148 Feminizing the Fetish of "turning a blind eye." For Freud, however, these sayings were the folkloric expressions of a malady that was not only individual but also collective. -

Octave Mirbeau Et Vincent Van Gogh Jugement De Valeur Culturelle Et Stratégie Institutionnelle
Octave Mirbeau et Vincent van Gogh Jugement de valeur culturelle et stratégie institutionnelle (à paraître dans : Johnnie Gratton & Derval Conroy eds., L’œil écrit, Slatkine, septembre 2005) Leo H. Hoek Pour analyser la construction du jugement de valeur que prononcent par exemple les critiques d’art, je partirai de l’hypothèse institutionnelle de Pierre Bourdieu. Selon lui, ce jugement, contrairement à l’opinion reçue, ne repose pas sur l’évaluation des qualités d’une œuvre d’art mais sur la considération des intérêts institutionnels du critique. Un tel fonctionnement, qui n’est ni un défaut ni une qualité de la critique d’art, est inhérent à l’organisation de toute culture institutionnalisée, dans le passé comme de nos jours. Tout jugement de valeur culturelle est motivé institutionnellement, c’est-à-dire que l’orientation de l’argumentation choisie pour légitimer ce jugement dépend fortement de la distribution des forces dans le champ artistique. La position qu’a prise un critique d’art comme Octave Mirbeau vis-à-vis de Vincent van Gogh, et notamment les arguments qu’il a avancé pour défendre l’œuvre du peintre hollandais, me permettront d’illustrer la part de la stratégie institutionnelle dans la construction du jugement de valeur culturelle. À cette fin, je commencerai par présenter brièvement Octave Mirbeau et je résumerai sa conception de l’art. Ensuite, je mettrai en lumière les deux articles de critique d’art que Mirbeau a consacrés à Van Gogh. Et finalement, j’en tirerai des conclusions quant au fonctionnement de la conception artistique, quant à l’hypothèse institutionnelle, et quant aux stratégies rhétoriques déployées par le critique pour augmenter la crédibilité de l’argumentation. -

Jag Final Draft
Copyright by Jason Alan Goldstein 2017 The Dissertation Committee for Jason Alan Goldstein Certifies that this is the approved version of the following dissertation: Translating Art into Words: The Work of Claude Monet in the Writings of Gustave Geffroy and Octave Mirbeau Committee: Richard Shiff, Supervisor Michael Charlesworth Kurt Heinzelman Linda Dalrymple Henderson Alexandra Wettlaufer Translating Art into Words: The Work of Claude Monet in the Writings of Gustave Geffroy and Octave Mirbeau by Jason Alan Goldstein Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin December 2017 Dedication To my parents Acknowledgements In these rather uncertain times, I consider myself particularly fortunate to devote my life to the study and teaching of art and literature. Careful looking and close reading slow down our frenetic pace and encourage creative thought. I have found few things more rewarding than spending an unbroken hour in front of one of Claude Monet’s magnificent canvases. Experiencing Monet through the eyes and words of two of his staunchest critical supporters Gustave Geffroy and Octave Mirbeau has enriched my understanding of his paintings in ways I never could have imagined. I would have lacked the means to complete a project of this nature without the following magnanimous individuals and institutions. The libraries and the remarkable people who keep them running at the University of Texas at Austin deserve a great deal of credit for my ability to research and write this dissertation. -

Octave Mirbeau the Love of a Venal Woman
OCTAVE MIRBEAU THE LOVE OF A VENAL WOMAN Translated by Bérangère de Grandpré Notes by Pierre Michel Société Octave Mirbeau 2005 I ORIGINS OF THE PROSTITUTE1 What makes the prostitute is not her bed, not her nudity: it is the necessity of exchanging her body for money. The little plebeian girl of the suburbs, skipping along with other urchins in the sordid and twisting lanes, nibbling the crust of bread in her hand, far from having reached the age of maturity, already knows how to answer, without fear or repugnance, the appeal of the lecherous old man who lures her with money or food. For this little girl is a precocious flirt and knows how to simulate rejection and extort money2. The young girl, or the shop-girl, has no morals anymore3. Women from that social milieu, whether they work in workrooms or factories, or succumb to the weight of domestic chores, see prostitution as the only way to obtain certain conveniences, and they are morally prepared to enter that life. What could "honesty" mean to them? Nothing more than irremediable destitution: revolting food, a bed in a sordid place, a complexion turned leaden by confinement, slaps and blows from a drunken father or a furious husband, exhausting children, disability, the uncertainty of old age. These women constantly live in an atmosphere of debauchery and barter: rapacious procurers continually proposition them, they mix with unscrupulous employers, their friends proudly display their perversion and the riches they acquire through prostitution… At the age of ten, these girls already know it all and have started to feel the irresistible temptation of sex, which makes women from the working class an inexhaustible source of prostitutes4. -

Anarchism and Culture, 1840–1939
Anarchism and Culture, 1840–1939 Jesse Cohn 2009 Contents References And Suggested Readings ............................ 4 2 Anarchism has traditionally laid great emphasis on the construction of a “counterculture” – a sphere of imagery, symbolism, and sensory experience imbued with its own emancipatory values. In this respect, it does not differ essentially from other social movements with vastly different aims. More unique is the tendency of anarchist culture to blur distinctions between the creation and reception of culture as well as between the ideal and the real in representation. These tendencies are present from the first phase of the modern anarchist movement, when Pierre Joseph Proudhon argued for the abolition of distinctions between artistic industrial cre- ation. This meant refusing the romantic notion of the artist as solitary genius, apart fromand above society. At the same time, Proudhon wanted an art that would refuse to accommodate itself to the social status quo either in the manner of religious art, which averted its eyes from injustice in the world to contemplate divine ideals, or in the manner of a superficial realism that does not look beyond the misery of the present. A revolutionary art, Proudhon argued, would evoke the processes of movement and transformation inherent to life, suggesting the potential for the ideal that is dormant within the real. Conversely, this art would undercut the claim of “the real” to be the entire “truth.” One face of anarchist art, thus, was constructive, utopian, ges- turing from the real toward the ideal; the other was deconstructive and iconoclastic. The visual art produced by anarchists from the late nineteenth through the early twentieth centuries bears traces of both impulses.