Feuilleton DADVSI
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
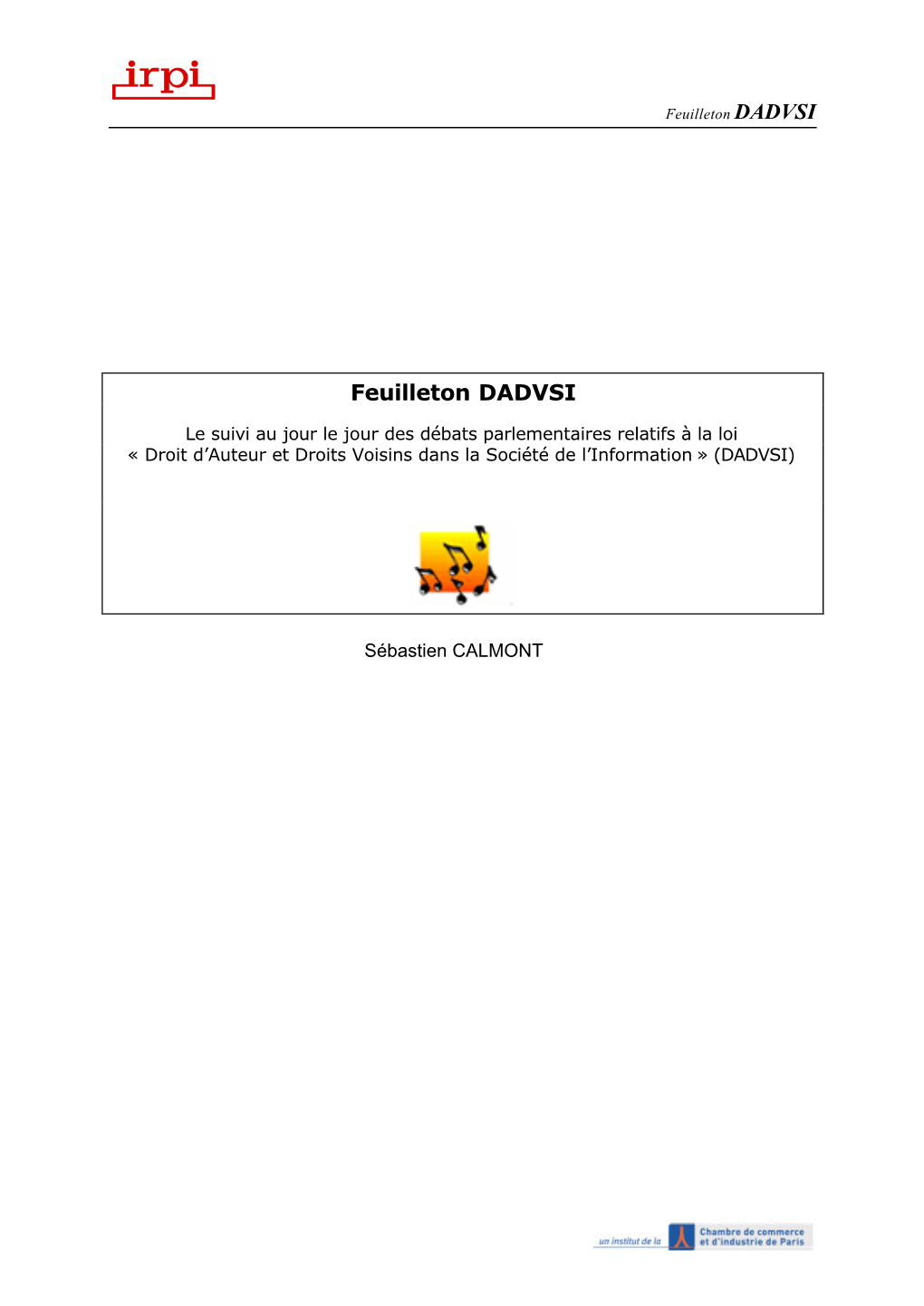
Load more
Recommended publications
-

Fabrice Di Vizio Cet Avocat Très Chrétien Mène Vu Venir De Loin La Crise
2,00 € Première édition. No 12082 Vendredi 10 Avril 2020 www.liberation.fr coronavirus travailler la peur au ventre Livreurs, caissières, conducteurs Photo Céline ESCOLANO . saif images saif . ESCOLANO Céline Photo de bus… ils continuent à faire tourner l’économie depuis un mois. Mais face aux risques pris, ils exigent des garanties. PAGES 2-5 Vendredi dernier, dans un supermarché de Montpellier. Montpellier. de supermarché un dans dernier, Vendredi CHLOROQUINE MENACES, DEUIL Macron- AGRESSIONS… En Seine- Raoult, Les Saint-Denis, étrange soignants l’impossible rencontre se cachent dernier à Marseille pour guérir voyage pages 10-11 AP . Cole Daniel Enquête, pages 12-13 pages 14-15 IMPRIMÉ EN FRANCE / PRINTED IN FRANCE Allemagne 2,50 €, Andorre 2,50 €, Autriche 3,00 €, Belgique 2,00 €, Canada 5,00 $, Danemark 29 Kr, DOM 2,80 €, Espagne 2,50 €, Etats-Unis 5,00 $, Finlande 2,90 €, Grande-Bretagne 2,20 £, Grèce 2,90 €, Irlande 2,60 €, Israël 23 ILS, Italie 2,50 €, Luxembourg 2,00 €, Maroc 22 Dh, Norvège 30 Kr, Pays-Bas 2,50 €, Portugal (cont.) 2,90 €, Slovénie 2,90 €, Suède 27 Kr, Suisse 3,40 FS, TOM 450 CFP, Tunisie 5,00 DT, Zone CFA 2 500 CFA. 2 u Événement France Libération Vendredi 10 Avril 2020 éditorial Des avions FedEx à Roissy, Par en janvier. Photo Laurent Joffrin Covid-19 et salariat Gilles ROLLE. RéA Egards spéciaux Ce sont les autres combattants du front. Chaque soir la France applaudit ses soignants. De plus en plus, ces ma- nifestations de solidarité sont aussi adressées aux «petites mains» de l’épi- démie, qui assurent aux Français confi- Les deux nés les services et les approvisionne- ments sans lesquels la vie quotidienne, déjà éprouvante, deviendrait impossi- ble. -

Commentaire De La Décision Du 4 Avril 2002 Election Présidentielle De 2002
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 13 Commentaire de la décision du 4 avril 20022 Arrêtant la liste des candidats a l'élection présidentielle En application des dispositions de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, le Conseil constitutionnel a, lors de sa séance plénière du 4 avril 2002, arrêté la liste des candidats à l'élection présidentielle du 21 avril 2002. Pour établir cette liste, le Conseil constitutionnel a effectué les vérifications qui lui incombaient : - tant en ce qui concerne les présentations de candidats par les élus habilités (procédure dite des « parrainages »); - qu'au regard des autres conditions auxquelles la loi organique subordonne la validité des candidatures (âge, possession des droits civiques, inscription sur une liste électorale, déclaration patrimoniale...). Conformément à la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 février 1981, l'ordre dans lequel figurent les candidats sur cette liste a été tiré au sort au cours de sa séance du 4 avril 2002. Cette liste est la suivante : 1. Monsieur Bruno MÉGRET 2. Madame Corinne LEPAGE 3. Monsieur Daniel GLUCKSTEIN 4. Monsieur François BAYROU 5. Monsieur Jacques CHIRAC 6. Monsieur Jean-Marie LE PEN 7. Madame Christiane TAUBIRA 8. Monsieur Jean SAINT-JOSSE 9. Monsieur Noël MAMÈRE 10. Monsieur Lionel JOSPIN 11. Madame Christine BOUTIN 12. Monsieur Robert HUE 13. Monsieur Jean-Pierre CHEVÈNEMENT 14. Monsieur Alain MADELIN 15. Madame Arlette LAGUILLER 16. Monsieur Olivier BESANCENOT 1 I - Contrôle des présentations Le nombre des présentations s' est élevé à 17815, chiffre supérieur à ceux enregistrés lors des trois élections précédentes. -

Cultural, Political, Religious – Became Louder and More Assertive
France While acceptance remained high overall, homophobic and transphobic voices – cultural, political, religious – became louder and more assertive. As anti-equality groups and politicians (right-wing and far-right) continued efforts to undermine equal marriage and adoption rights acquired in 2013, the government shied away from further LGBT-friendly reforms. Positively, local, national, and European courts delivered several rulings affirming family rights. But lesbian couples remained barred from using medically assisted procreation despite earlier governmental promises, and legal gender recognition remained fraught with serious obstacles. The Ministry of Education also failed to take resolute action against discrimination in schools. ILGA-Europe Annual Review 2015 73 Bias-motivated speech amendment was ruled inadmissible as it would have cost l In April, Christian Democratic Party honorary implications and therefore needed to be put forward as president Christine Boutin (PCD, Christian conservative) an amendment to the budget law. said in an interview that homosexuality was “an abomination”. NGO Inter-LGBT sued her for incitation to Education hatred, and the police received over 10,000 individual l The government fell short of its promise to extend a complaints. Court hearings were scheduled for 2015. pilot programme for sexuality and diversity education to l In May, a court found the magazine Minute guilty of all schools in 2014–2015, with the new plan focusing only insult and incitement to hatred for a 2012 cover showing on sexism and gender-based stereotypes, leaving out two men almost naked at a Pride march, alongside sexual orientation and gender identity. derogatory terms. The magazine was fined EUR 7,000. -

Queer Citizenship in Contemporary Republican France
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Stirling Online Research Repository The PACS and (Post-)Queer Citizenship in Contemporary Republican France Cristina Johnston, University of Stirling, UK Abstract This article examines the theoretical debates that have arisen from the development and subsequent implementation of same-sex partnership legislation in France in 1999. The significance of these debates extends far beyond the specific legislation that triggered them and can be understood as contributing to a far broader analysis of the relevance of traditional French republican ideologies to the realities of contemporary, metropolitan France. The article outlines the socio-political climate against which the legislation evolved and demonstrates how its detail engages with, and challenges, key notions at the heart of French republicanism such as, for instance, the public/private division and questions of kinship, filiation, and the family. Through analysis of the writings of three key figures at the interface of sociological analysis and queer studies in France – Frédéric Martel, Eric Fassin, and Maxime Foerster – I examine how same- sex couples have come to act as figureheads for the problematic status of minority groupings more generally. Ultimately, the article seeks to examine whether this legislation can, through the dialogue and debate it has provoked, pave the way for what can be termed ‘post-queer’ French citizenship, a renegotiation of the relationship between queer citizens and the republic. Keywords: Citizenship; French republicanism; PACS; post-queer; same-sex partnerships 1 The PACS and (Post-)Queer Citizenship in Contemporary Republican France This article examines the theoretical debates that have arisen from the development and subsequent implementation of same-sex partnership legislation in France in 1999. -
Que Proposent Les Candidats ?
Que proposent les candidats ? François Bayrou François Hollande Eva Joly Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon Nicolas Sarkozy... 2012 ARGENT Présidentielle Extrait de la publication ARGENT Que proposent les candidats ? François Bayrou, François Hollande, Eva Joly, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Sarkozy… Ce livre citoyen rassemble des extraits choisis de dis- cours et de programmes des candidats à l’élection présidentielle sur le thème de l’argent, sans parti pris ni idéologie. À droite, à gauche, au centre et aux extrêmes, à chacun sa réponse pour sortir de la crise. Comment réduire la dette ? Quelle position adopter face aux marchés ? Quelle politique fiscale privilégier ? Comment relancer le pouvoir d’achat et améliorer le quotidien des Français ? Un tour d’horizon indis- pensable pour s’informer, comprendre et comparer avant d’aller voter. Ouvrage dirigé par David d’Équainville. 2012 Présidentielle Conception graphique : Kamy Pakdel Illustration de couverture : © Plainpicture ExtraitImprimé de la publication et broché en Italie ARGENT Que proposent les candidats ? 2012 Présidentielle Extrait de la publication Merci à Cécile Faudais, Sylvain Levieux, France Mochel et Adèle Phelouzat. © Éditions Autrement, Paris, 2012. www.autrement.com ARGENT Que proposent les candidats ? Sous la direction de David d’Équainville Avec la collaboration de Jihad Gillon 2012 Présidentielle Éditions Autrement Extrait de la publication Extrait de la publication Avertissement Dans une élection à la majorité, la nécessité de réu- nir le plus de voix démultiplie les programmes des candidats en autant de discours qu’il y a de pro- blématiques. C’est un jeu à facettes qui éclaire le citoyen, mais peut aussi l’aveugler. -

Et Au Format
o Année 2008. – N 84 S. (C.R.) ISSN 0755-544X – CPPAP 0103 B 05089 Jeudi 30 octobre 2008 SÉNAT JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009 COMPTE RENDU INTÉGRAL Séance du mercredi 29 octobre 2008 (15e jour de séance de la session) 6304 SÉNAT – SÉANCE DU 29 OCTOBRE 2008 SOMMAIRE PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER Discussion générale : MM. Yvon Collin, auteur de la propo- sition de loi ; Daniel Soulage, rapporteur de la commis- 1. Procès-verbal (p. 6305). sion des affaires économiques ; Yvon Collin, Daniel Raoul, Gérard Le Cam, Gérard César. 2. Candidatures à des commissions mixtes paritaires (p. 6305). M. Michel Barnier, ministre de l’agriculture et de la pêche. 3. Modifi cation de l’article 3 du règlement du Sénat. – Adoption Adoption des conclusions du rapport de la commission des conclusions du rapport d’une commission (p. 6305). tendant à ne pas adopter la proposition de loi. Discussion générale : MM. Patrice Gélard, rapporteur de la Suspension et reprise de la séance (p. 6338) commission des lois ; Jean-Pierre Michel, Michel Mercier, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. 6. Nomination de membres de commissions mixtes paritaires (p. 6338). Clôture de la discussion générale. PRÉSIDENCE DE M. BERNARD FRIMAT Article unique (p. 6309) Amendement no 3 de M. Jean-Pierre Michel. – MM. Jean- 7. Conférence des présidents (p. 6339). Pierre Michel, le rapporteur, Michel Charasse, Jean- Jacques Hyest, président de la commission des lois ; 8. Diffusion et protection de la création sur internet. – Discussion Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Bernard Frimat, d’un projet de loi déclaré d’urgence (p. -

Patrick Roy Député Métal
Portrait PosthumE patrick roy député métal Décédé en 2011, Patrick roy restera comme le premier député à avoir osé parler de hard rock au cœur de l’Assemblée nationale. Portrait posthume d’un parlementaire qui citait Bernie Bonvoisin de Trust dans ses discours et jouait sur scène avec Mass Hysteria. Par Pascal Mateo © DR 54 numéro 4 — 55 Charles Patrick roy DEUx MINISTRES EN ExERCICE (Roselyne Bachelot danS Sa jeuneSSe et Patrick Ollier), le président de l’Assemblée nationale (Bernard Accoyer), deux anciens Premiers denaiSienne, patRick Roy ministres (Laurent Fabius et Pierre Mauroy), la première secrétaire du PS (Martine Aubry), mais anime une émiSSion de Radio aussi une ribambelle de parlementaires et une armada d’élus locaux… Ce 7 mai 2011, c’est conSacRée au Rock toute la République qui s’est donné rendez-vous à Denain. Rien de bien réjouissant, néanmoins, dans ce rassemblement. Tout ce beau monde est venu rendre un dernier hommage à un enfant du pays : député (PS) du Nord depuis 2002, maire de Denain depuis 2008, Patrick Roy vient d’être emporté par un cancer du pancréas à l’âge de 53 ans. Aux côtés de cette brochette de personnalités, Patrick Roy plusieurs dizaines d’anonymes ont pris place dans et Christian la salle Baudin, réquisitionnée pour l’occasion. Ins- Décamps, tallés par la municipalité sur la pelouse du stade chanteur voisin, trois écrans géants permettent en outre du groupe à plus de 2000 Denaisiens de suivre eux aussi Ange, 1976 la cérémonie des funérailles. Aucun d’entre eux n’est surpris d’entendre, entre deux discours offi- ciels saluant la mémoire de leur député-maire, des Outre Mass Hysteria, c’est toute la commu- la précédente édition du Hellfest. -

Formation Nécessaire Pour Bien Légiférer
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Actes des « TABLES RONDES SUR LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT » JEUDI 24 JANVIER 2008 ◊ ◊ ◊ organisées sous le haut patronage et en présence de M. Bernard ACCOYER, Président de l’Assemblée nationale À l’initiative conjointe de M. Christian JACOB M. Pierre LEQUILLIER M. Patrick OLLIER Président de la Président de la Délégation Président de la Délégation de de l’Assemblée nationale Commission des affaires l’Assemblée nationale à pour l’Union européenne économiques, de l’aménagement et au l’environnement et du développement durable territoire du territoire — 3 — SOMMAIRE ___ Pages OUVERTURE................................................................................................................... 5 M. Bernard Accoyer, président de l’Assemblée nationale................................. 5 M. Jean-Louis Borloo, ministre d’État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables ................................................ 7 DÉBAT GÉNÉRAL SUR L’UNION EUROPÉENNE ET LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE.......................................................................... 13 M. Pierre Lequiller, président de la Délégation pour l’Union européenne......... 13 M. Nicolas Théry, conseiller principal à la Direction générale « Environnement » de la Commission européenne .............................................................................. 15 Mme Françoise Grossetête, membre de la commission temporaire du changement climatique au Parlement -

The French Spring of La Manif Pour Tous: Conservative Protests Against Same-Sex Marriage and Adoption in France
The French Spring of la Manif pour tous: Conservative Protests against Same-Sex Marriage and Adoption in France Posted on November 26, 2013 Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services 6 Click on the images below to navigate the articles in this special feature. by Léa Morabito On September 14th and 15th 2013, la Manif pour tous, a French protest group fighting against same-sex marriage, organized a summer school near Paris to celebrate a year of mobilization against the Taubira law. This law, named after the French Minister of Justice, Christiane Taubira, passed in April 2013, legalizing same-sex marriage and the adoption of children by same-sex married couples. In August, le Printemps français, another group protesting against the law, had also organized a summer school, which lasted a week and took place in a castle in the countryside. The summer schools were opportunities to take stock of the protests organized for the past year, but also to plan new offensives against the socialist government and its projects dealing with family and education. These groups’ new bêtes noires are now the extension of medically assisted procreation to lesbian couples – which was excluded from the Taubira law but is demanded by LGBT groups – and what conservative groups call ‘gender ideology’, especially at school. These conservative groups denounce the promotion of sex and sexual undifferentiation leading to the normalization of homosexuality, transgenderism and queerness. In spite of their failure to prevent the passing of the law, la Manif pour tous and le Printemps français display a willingness to keep on protesting and consider their year-lasting mobilization to be a victory. -

The Rectum Is for Gravediggers: Homicide, HIV, Homophobia and Identity in Late Twentieth Century France1
1 The Rectum Is for Gravediggers: Homicide, HIV, Homophobia and Identity in Late Twentieth Century France1 Jack D. Kiely - University College London Abstract: In June 2000, the French Senator Françoise Abadie defined homosexuals as ‘les fossoyeurs de l’humanité’ [‘the gravediggers of humanity’]. This definition, which came as the Senator’s reaction to the recently enacted PaCS or Civil Partnership legislation, neatly circumscribes the homophobia of the twenty-year period that had preceded it from the beginning of the HIV/AIDS crisis. Concentrating on gay men, this paper focusses on the connections between HIV/AIDSphobia and homophobia in France by focussing firstly in particular on one case of homicide in the late 1980s – that of ‘le tueur de vieilles dames’ [‘the killer of old ladies’], Thierry Paulin, who admitted to at least twenty-one killings, but whose murderous acts were imbricated indissociably by the press not only with his ‘identity’ as a homosexual, but also with his serological status – thought perhaps to have rendered him disturbed. In this period, HIV infection, homophobia and identity become intertwined with murder, be it in the literal bludgeonings of Paulin, or the fear of gays as spreaders of a deadly disease to the ‘innocent’ heterosexual population in what ACT Up-Paris call ‘le fantasme du séropositif meurtrier’ [‘the fantasy of the murderous HIV-positive person’]. More worryingly, this logic extended to isolationist and even homicidal logic against HIV sufferers around the world, leading Leo Bersani to ask in in 1987 – ‘Is the rectum a grave?’ Just over a decade later, the Pacte Civil de Solidarité (PaCS) [‘Civil Union’] debates saw similar amalgamations between HIV/AIDS and gay identity, mixed with the homicidal rage of certain of the anti-PaCS demonstrators. -

Dossiers De Fayçal Daouadji Conseiller Parlementaire
Dossiers de Fayçal Daouadji conseiller parlementaire Répertoire numérique détaillé numéro 20150496 édité par Clémence Demilly, sous la direction de la Mission des Archives du ministère de la Culture et de la Communication Première édition électronique Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 2015 1 Mention de note éventuelle https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054097 Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte. Ce document est écrit en français. Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales, il a reçu le visa du Service interministériel des Archives de France le ..... 2 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence 20150496/1-20150496/48 Niveau de description sous-fonds Intitulé Fayçal Daouadji, conseiller parlementaire Date(s) extrême(s) 2002-2007 Nom du producteur • Cabinet de Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la Communication Importance matérielle et support 5 ml (16 cartons dimabs) Localisation physique Pierrefitte-sur-Seine Conditions d'accès Communicable sur autorisation de M. Renaud Donnedieu de Vabres jusqu'en 2032, conformément au protocole signé entre lui et le ministre de la Culture et de la communication (direction des Archives de France), représenté par Mme Martine de Boisdeffre. Conditions d'utilisation Selon le règlement de la salle de lecture. DESCRIPTION Présentation du contenu Ce répertoire permet de suivre l'activité de Fayçal Daouadji en tant que conseiller parlementaire de Renaud Donnedieu de Vabres. Il souligne principalement les relations entre le conseiller et le Parlement. Type de classement Ce versement est constitué de trois parties. -

Making Sense of the Anti-Same-Sex-Marriage Movement in France Scott Ung Ther [email protected]
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Wellesley College Wellesley College Wellesley College Digital Scholarship and Archive Faculty Research and Scholarship Summer 2019 Making Sense of the Anti-Same-Sex-Marriage Movement in France Scott unG ther [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.wellesley.edu/scholarship Version: Post-print Recommended Citation Gunther, Scott. “Making Sense of the Anti-same-sex-marriage Movement in France,” French Politics, Culture and Society, Summer 2019, Volume 37, Issue 2. This Article is brought to you for free and open access by Wellesley College Digital Scholarship and Archive. It has been accepted for inclusion in Faculty Research and Scholarship by an authorized administrator of Wellesley College Digital Scholarship and Archive. For more information, please contact [email protected]. Making Sense of the Anti-Same-Sex-Marriage Movement in France Scott Gunther [“Making Sense of the Anti-same-sex-marriage Movement in France,” French Politics, Culture and Society, summer 2019, Volume 37, Issue 2] Abstract This article examines the political style and rhetoric of the Manif pour tous (MPT), the main organization opposing same-sex marriage in France, from summer 2013 to the present. It exposes how the MPT's style and rhetoric differ from those of their American counterparts, and what this tells us about the different strategies of political movements in France and the United States generally. It is based on an analysis of the language used by activists whom I interviewed in 2014 and 2015 and on a discourse analysis of the MPT’s website, Facebook page, Twitter feed, and press releases since 2013.