Le-Bal-De-Sceaux-1835-Image
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-
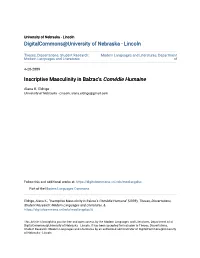
Inscriptive Masculinity in Balzac's Comédie Humaine
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Theses, Dissertations, Student Research: Modern Languages and Literatures, Department Modern Languages and Literatures of 4-20-2009 Inscriptive Masculinity in Balzac’s Comédie Humaine Alana K. Eldrige University of Nebraska - Lincoln, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss Part of the Modern Languages Commons Eldrige, Alana K., "Inscriptive Masculinity in Balzac’s Comédie Humaine" (2009). Theses, Dissertations, Student Research: Modern Languages and Literatures. 6. https://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/6 This Article is brought to you for free and open access by the Modern Languages and Literatures, Department of at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Theses, Dissertations, Student Research: Modern Languages and Literatures by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. INSCRIPTIVE MASCULINITY IN BALZAC’S COMÉDIE HUMAINE by Alana K. Eldrige A DISSERTATION Presented to the Faculty of The Graduate College at the University of Nebraska In Partial Fulfillment of Requirements For the Degree of Doctor in Philosophy Major: Modern Languages and Literature (French) Under the Supervision of Professor Marshall C. Olds Lincoln, Nebraska May, 2009 INSCRIPTIVE MASCULINITY IN BALZAC’S COMÉDIE HUMAINE Alana K. Eldrige, Ph.D. University of Nebraska, 2009. Adviser: Marshall C. Olds This reading of La Comédie humaine traces the narrative paradigm of the young hero within Balzac’s literary universe. A dynamic literary signifier in nineteenth-century literature, the young hero epitomizes the problematic existence encountered by the individual in post-revolutionary France. At the same time, he serves as a mouth-piece for an entire youthful generation burdened by historical memory. -

Balzac Et La Comédie Humaine 4 : « Un But, L’Histoire ; Un Moyen, Le Roman » : Organisation Et Composition De La Comédie Humaine I
Balzac et La Comédie humaine 4 : « Un but, l’histoire ; un moyen, le roman » : organisation et composition de la Comédie humaine I. Architecture d’un édifice littéraire Le plan de la Comédie humaine dont Balzac parle pour la première fois en 1834 se concrétise après 1840 pour trouver sa forme finale dans l’Avant-propos de 1842 et dans le catalogue pour l’édition Furne de 1845. Il s’agit d’un ensemble structuré et méthodique qui témoigne des ambitions de l’auteur. I.1 Catalogue de 1845 (disponible sur http://www.v1.paris.fr/commun/v2asp/musees/balzac/furne/protocole.htm) Observez d’abord le catalogue : comment se compose le plan de La Comédie humaine ? Quelles parties de La Comédie sont, au moment de la publication de ce catalogue, les plus complètes et quelles parties en revanche les plus lacunaires ? CATALOGUE DES OUVRAGES QUE CONTIENDRA LA COMEDIE HUMAINE. (ORDRE ADOPTE EN 1845 POUR UNE EDITION COMPLETE EN 26 TOMES) —— Les ouvrages en italiques sont ceux qui restent à faire. —— PREMIERE PARTIE : ETUDES DE MŒURS. DEUXIEME PARTIE : ETUDES PHILOSOPHIQUES. TROISIEME PARTIE : ETUDES ANALYTIQUES. —— Première partie : ETUDES DE MŒURS Six livres : 1. Scènes de la Vie Privée ; 2. de Province ; 3. Parisienne ; 4. Politique ; 5. de la Vie Militaire ; 6. de la Vie de Campagne. SCENES DE LA VIE PRIVEE. (Quatre volumes, tomes 1 à 4.) – 1. Les Enfants. – 2. Un Pensionnat de demoiselles. – 3. Intérieur de Collège. – 4. La Maison-du-Chat-qui-Pelote. – 5. Le Bal de Sceaux. – 6. Mémoires de Deux Jeunes Mariées. – 7. La Bourse. – 8. Modeste Mignon. -

HONORÉ DE BALZAC (1799-1850, Fransa)
HONORÉ DE BALZAC (1799-1850, Fransa) Zeki Ɀ Kırmızı, 1 Ocak 2021 İLK YAYIN KOMEDYADA KOMEDYADA TÜRKÇE YAYIN SAYI ÖZGÜN AD TÜRKÇE AD ÇEVİRİ YILI YERİ ÜST YERİ ALT YAYINEVİ YILI 1 Le Cure de Village Köy Papazı 1829 Töre İncelemeleri Köy Yaşamı Sahneleri MEB 1952 Kazım N.Duru 2 Le Elixir de longue vie Uzun Yaşam İksiri 1829 Felsefe İncelemeleri Felsefe İncelemeleri 3 Les Chouans ou le Bretagne en 1799 Şuanlar (Köylü İsyanı) 1829 Töre İncelemeleri Asker Yaşamı Sahneleri Cem 1974 Nesrin Altınova 3 Les Chouans ou le Bretagne en 1799 Şuanlar (Köylü İsyanı) 1829 Töre İncelemeleri Asker Yaşamı Sahneleri Kültür Bak. 1977 Vahdi Hatay 3 Les Chouans ou le Bretagne en 1799 Şuanlar (Köylü İsyanı) 1829 Töre İncelemeleri Asker Yaşamı Sahneleri Oda 1984 Nesrin Altınova 3 Les Chouans ou le Bretagne en 1799 Şuanlar (Köylü İsyanı) 1829 Töre İncelemeleri Asker Yaşamı Sahneleri Oda 1990 Nesrin Altınova 3 Les Chouans ou le Bretagne en 1799 Şuanlar (Köylü İsyanı) 1829 Töre İncelemeleri Asker Yaşamı Sahneleri Oda 1994 Nesrin Altınova 3 Les Chouans ou le Bretagne en 1799 Şuanlar (Köylü İsyanı) 1829 Töre İncelemeleri Asker Yaşamı Sahneleri Oda 1999 Nesrin Altınova 3 Les Chouans ou le Bretagne en 1799 Köylü İsyanı 1829 Töre İncelemeleri Asker Yaşamı Sahneleri İmge 2013 Nesrin Altınova 4 Physiologie du marriage Evliliğin Fizyolojisi 1829 Çözümlemeli İnceleme Çözümlemeli İnceleme Kaf 1999 Sema Rıfat 5 Adieu Elveda 1830 Felsefe İncelemeleri Felsefe İncelemeleri 6 El Verdugo El Verdugo (Gobseck ve Üç Öykü) 1830 Felsefe İncelemeleri Felsefe İncelemeleri MEB 1949 Mücahit -

II Cette Bibliographie Générale Ne Comprend Pas Les Éditions
II ÉTUDES PHILOSOPHIQUES [Titre apparaissant en 1835]. 1831. La Peau de chagrin, roman philosophique. 2 volumes. ÉDITIONS 1831. Romans et contes philosophiques, 2e édition. 3 volumes. Cette Bibliographie générale ne comprend pas les éditions 1831. Romans et contes philosophiques, 3e édition. 3 volumes. séparées des romans publiés du vivant de Balzac (voir, sur ce 1832. Nouveaux contes philosophiques. 1 volume. point, l’ouvrage cité de Stéphane Vachon, Les Travaux et les jours e d’Honoré de Balzac, CNRS, 1992). Nous nous sommes efforcé de 1833. Romans et contes philosophiques, 4 édition. 4 volumes. classer les éditions collectives de façon à montrer comment a été 1835. Le Livre mystique. 2 volumes. constituée La Comédie humaine. 1835-40.Études philosophiques. 20 volumes. A. Avant l’edition furne Détail des éditions Tableau général Nous indiquons, précédées du sigle B.F., les dates d’enregistrement à la Bibliographie de la France, qui, sans donner les Etudes de Mœurs [ Titre apparaissant en 1834]. dates certaines de mise en vente, sont plus précises que de simples millésimes. 1830. Scènes de la vie privée. 1re édition. 2 volumes ScÈnes de la vie privEe, publiée par M. Balzac [sic], auteur du e 1832. - - 2 - 4 - Dernier Chouan ou la Bretagne en 1800. - Paris, Mame et Delaunay- 1834-35. - 3e - 4 - Vallée, Levavasseur, 1830. 2 vol. in-8°. 1839. - [4e ] - 2 - I. Préface. La Vendetta. Les Dangers de l’inconduite [Gobseck]. 1834-37. Scènes de la vie de province. 1re édition. 4 volumes Le Bal de Sceaux. e 1839. - - [2 ] - 2 - II. Gloire et malheur [La Maison du chat-qui-pelote]. -
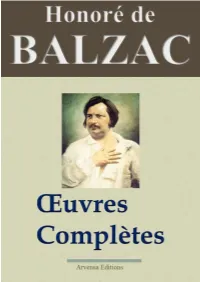
Extrait Honore De Balzac.Pdf
Extrait Honoré de Balzac : Oeuvres complètes Honoré de Balzac ARVENSA ÉDITIONS Plate-forme de référence des éditions numériques des oeuvres classiques en langue française Retrouvez toutes nos publications, actualités et offres privilégiées sur notre site Internet www. arvensa. com ©Tous droits réservés Arvensa® Éditions ISBN Epub : 9782368410004 ISBN Pdf : 9782368410257 Page 2 Copyright Arvensa Editions Extrait Honoré de Balzac : Oeuvres complètes Honoré de Balzac NOTE DE L'ÉDITEUR L’objecf des Édions Arvensa est de vous faire connaître les œuvres des plus grands auteurs de la liérature classique en langue française à un prix abordable, tout en vous fournissant la meilleure expérience de lecture sur votre liseuse. Nos titres sont ainsi relus, corrigés et mis en forme spécifiquement. Cependant, si malgré tout le soin que nous avons apporté à cee édion, vous noez quelques erreurs, nous vous serions très reconnaissants de nous les signaler en écrivant à notre Service Qualité : servicequalite@arvensa. com Pour toutes autres demandes, contactez : editions@arvensa. com Nos publicaons sont régulièrement enrichies et mises à jour. Si vous souhaitez être informé de nos actualités et des mises à jour de cee édition, nous vous invitons à vous inscrire sur le site : www. arvensa. com Nous remercions aussi tous nos lecteurs qui manifestent leur enthousiasme en l'exprimant à travers leurs commentaires. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Arvensa Editions Page 3 Copyright Arvensa Editions Extrait Honoré de Balzac : Oeuvres complètes Honoré de Balzac LISTE DES TITRES Page 4 Copyright Arvensa Editions Extrait Honoré de Balzac : Oeuvres complètes Honoré de Balzac AVERTISSEMENT : Vous êtes en train de parcourir un extrait de cette édition. -

Lebaldesceaux,Oulapolitiquedelavieprivée
Romanische Studien 5, 2016 Lektüren Le Bal de Sceaux, ou la politique de la vie privée Anne-Marie Baron (Paris) mots clés : Balzac, Honoré de ; Le Bal des Sceaux Le Bal de Sceaux est un des plus anciens textes de La Comédie humaine. Sa date finale : Paris, décembre 1829, qui apparaît dans la troisième édition de 1835, semble exacte. Ce texte a toujours figuré dans les Scènes de la vie privée. Il a la particularité de relater des événements contemporains de la date de son écri- ture. L’intrigue peut se résumer ainsi : sous le règne de Louis XVIII, en 1824, un ancien vendéen, le comte de Fontaine a 60 ans. Il a été l’un des chefs de la Chouannerie sous le sobriquet de « Grand Jacques » (qu’on verra apparaître dans Les Chouans, Béatrix, César Birotteau). Mais il évolue avec son temps, et son adhésion au régime de la Restauration est totale. Il sait concilier sa fi- délité aux principes légitimistes avec les pratiques de la monarchie constitu- tionnelle, mises en œuvre par le roi, son conseiller et protecteur. Ses trois fils font carrière dans la magistrature, l’armée et l’administration, et épousent des roturières fortunées. Quant à ses trois filles, les deux aînées se mésal- lient sans état d’âme, au désespoir de leur mère, née de Kergarouët, beau- coup moins avancée d’idées que son époux. Quant à sa plus jeune fille, Émi- lie de Fontaine, héroïne de cette histoire, née en 1802, fille cadette du comte, elle entre dans le monde avec la Restauration. Elégante, orgueilleuse, imbue de son rang, c’est une jeune fille pleine de charme et d’insolence. -

Romanische Studien 5, 2016 Lektüren
Romanische Studien 5, 2016 Lektüren Le Bal de Sceaux, ou la politique de la vie privée Anne-Marie Baron (Paris) mots clés : Balzac, Honoré de ; Le Bal des Sceaux Le Bal de Sceaux est un des plus anciens textes de La Comédie humaine. Sa date finale : Paris, décembre 1829, qui apparaît dans la troisième édition de 1835, semble exacte. Ce texte a toujours figuré dans les Scènes de la vie privée. Il a la particularité de relater des événements contemporains de la date de son écri- ture. L’intrigue peut se résumer ainsi : sous le règne de Louis XVIII, en 1824, un ancien vendéen, le comte de Fontaine a 60 ans. Il a été l’un des chefs de la Chouannerie sous le sobriquet de « Grand Jacques » (qu’on verra apparaître dans Les Chouans, Béatrix, César Birotteau). Mais il évolue avec son temps, et son adhésion au régime de la Restauration est totale. Il sait concilier sa fi- délité aux principes légitimistes avec les pratiques de la monarchie constitu- tionnelle, mises en œuvre par le roi, son conseiller et protecteur. Ses trois fils font carrière dans la magistrature, l’armée et l’administration, et épousent des roturières fortunées. Quant à ses trois filles, les deux aînées se mésal- lient sans état d’âme, au désespoir de leur mère, née de Kergarouët, beau- coup moins avancée d’idées que son époux. Quant à sa plus jeune fille, Émi- lie de Fontaine, héroïne de cette histoire, née en 1802, fille cadette du comte, elle entre dans le monde avec la Restauration. Elégante, orgueilleuse, imbue de son rang, c’est une jeune fille pleine de charme et d’insolence. -

URSULE MIROUËT Du Même Auteur Dans La Même Collection
URSULE MIROUËT Du même auteur dans la même collection ANNETTE ET LE CRIMINEL. BÉATRIX. CÉSARBIROTTEAU. LECHEF-D’ŒUVRE INCONNU.–GAMBARA.–MASSIMILLADONI. LESCHOUANS. LECOLONELCHABERT (édition avec dossier). LECOLONELCHABERT suivi de L’INTERDICTION. LECONTRAT DE MARIAGE. LECOUSINPONS. LACOUSINEBETTE. LECURÉ DETOURS.–LAGRENADIÈRE. – L’ILLUSTREGAUDISSART. LECURÉ DE VILLAGE. LADUCHESSE DELANGEAIS. EUGÉNIEGRANDET (édition avec dossier). LEFAISEUR. LAFEMME DE TRENTE ANS. FERRAGUS.LAFILLE AUX YEUX D’OR. GOBSECK.UNE DOUBLE FAMILLE. ILLUSIONS PERDUES. LELYS DANS LA VALLÉE. LAMAISON DU CHAT-QUI-PELOTE.–LEBAL DESCEAUX.–LAVEN- DETTA.–LABOURSE. LEMÉDECIN DE CAMPAGNE. MÉMOIRES DE DEUX JEUNES MARIÉES. NOUVELLES(ELVERDUGO.–UN ÉPISODE SOUS LA TERREUR. –ADIEU.–UNE PASSION DANS LE DÉSERT.–LERÉQUISITION- NAIRE. – L’AUBERGE ROUGE.–MADAMEFIRMIANI.–LEMES- SAGE.–LABOURSE.–LAFEMME ABANDONNÉE.–LA GRENADIÈRE.–UN DRAME AU BORD DE LA MER.–LAMESSE DE L’ATHÉE.–FACINOCANE.–PIERREGRASSOU. – Z. MARCAS). LESPAYSANS. LAPEAU DE CHAGRIN. PEINES DE CŒUR D’UNE CHATTE ANGLAISE. LEPÈREGORIOT. PHYSIOLOGIE DU MARIAGE. PIERRETTE. LARABOUILLEUSE. LARECHERCHE DE L’ABSOLU. SARRASINE suivi de L’HERMAPHRODITE. SPLENDEURS ET MISÈRES DES COURTISANES. UN DÉBUT DANS LA VIE. UNE FILLE D’ÈVE. LAVIEILLEFILLE.–LECABINET DES ANTIQUES. BALZAC URSULE MIROUËT Présentation, notes, bibliographie et annexes par Philippe BERTHIER Chronologie par André LORANT GF Flammarion © Flammarion, Paris, 2013. ISBN : 978-2-0812-5026-0 PRÉSENTATION Être, avoir … le monde surnaturel, ce monde qui pèse tant sur l’autre, que nous étouffons sous son poids ! Barbey d’Aurevilly, Un prêtre marié. Ursule Mirouët est victime de son titre, plus encore qu’Eugénie Grandet avec qui, forcément, elle forme dip- tyque dans l’esprit du lecteur, comme d’ailleurs dans celui de Balzac lui-même, qui voyait en Ursule la « sœur heureuse » d’Eugénie 1. -
The Cambridge Companion to Balzac Edited by Owen Heathcote , Andrew Watts Frontmatter More Information
Cambridge University Press 978-1-107-06647-2 — The Cambridge Companion to Balzac Edited by Owen Heathcote , Andrew Watts Frontmatter More Information the cambridge companion to balzac One of the founders of literary realism and the serial novel, Honoré de Balzac (1799–1850) was a prolific writer who produced more than a hundred novels, plays and short stories during his career. With its dramatic plots and memorable characters, Balzac’s fiction has enthralled generations of readers. La Comédie humaine, the vast collection of works in which he strove to document every aspect of nineteenth-century French society, has influenced writers from Flaubert, Zola and Proust to Dostoevsky and Oscar Wilde. This Companion provides a critical reappraisal of Balzac, combining studies of his major novels with guidance on the key narrative and thematic features of his writing. Twelve chapters by world-leading specialists encompass a wide spectrum of topics such as the representation of history, philosophy and religion, the plight of the struggling artist, gender and sexuality, and Balzac’s depiction of the creative process itself. owen heathcote is Honorary Senior Research Fellow in Modern French Studies at the University of Bradford. He researches on the relation between violence, gender, sexuality and representation in French literature from the nineteenth century to the present. His many publications include Balzac and Violence. Representing History, Space, Sexuality and Death in ‘La Comédie humaine’ (2009) and From Bad Boys to New Men? Masculinity, Sexuality and Violence in the Work of Éric Jourdan (2014). andrew watts is Senior Lecturer in French Studies at the University of Birmingham. -

Balzac EMBERI SZÍNJÁTÉK
EMBij1{l SZíNJÁTEi< X Balryc =\IBERI szÍxlÁrÉr § , i_!)?]()1ll_\T i.\N |-1 i. j,,{.1 N ] O( \1!DIC I Ii.1l .\ ]_ l N .\Z ÉLEl,]]LIIÍR .\ SZ,í,lti,lZö l T]-.( LoLIs l-.'!r'\tiaR ]- sER.\P}Ij]-{ ELE TA i\ L]l,^{ÁNYO K ^4Zaj ,\ H ÁZ.^, s S.i G F]ZlL]Ló(]1.ilA iJ i7],\saLEl, t:IS ci).ljl.R i. L l,] ], I ] ]lll]i ]i ] l MEDICI KATALIN Fóűhotta KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL s Z É1, Mű VÉs zE T r A KAD ÉMl A T ÁCJ ÁN AK . ::,-]aljuk, miu neglepően so| kőnyet altah ki, l)ou limuldssáA, íIdnnib,il - .::-::l nl\ik pontjón k t át an;lAül, lou mdnd1)lág tulni lcbetae, wjon a :,, :: Ril'< íeltít,l,4e L)on C J_s<kt-Bernát is a1 ,|oxai tőlg1, wnalát ,..:.o,; " : - I*tonne, Follar1, SainrSinon és Faltia d'Ulban s<lint a<Isile- ' , - - : S:tnt-Bannx }[.Jftt-Clt;ve-Frncstrellc és a su4-i slgros tonalát; ua21 :,::.! :<rint d Mc t-Cenir-S ta21 _ Strabon, Po$brcs k D ut - < ^lonalat; - ,; : Rrólre Vienne_Yenne-Mant-tht-Chat .t'21 , , - wnalat; nlháry s:.glbmes en- ::!1e s4rint, nejx NapóIeox k elJogadut, s nagan is a,<ok - Ccno^Ja, ": i Scti^lia ,,lonalát, nem is bulv a1esetről, alnelb€I nltán, tudós a<dlpesi - -- .j|at,bbi 1.1k: ?<.k u!áa mtqllpőd\aüna+ a1on, ni,Ii , ",a-.haya.;j ::,:|llmlt tlhanla1olják, Losr a l1Jantosabb pafltjai mí2 knályban lanna|, s : ,!|űlőletesebb rágalom s4nge<;b o\ netelx, amclleket tís3,:lnnnk kelhne? -, :::jryle1lik nq, hogy HatnibáL ótkelíse a tőmíalxbn sck mayará4Lt kővet- ,ll.ilnem ':: kirlistssí últ. -

For Love Or for Money
For Love or for Money For Love or for Money Balzac’s Rhetorical Realism Armine Kotin Mortimer THE OHIO STATE UNIVERSITY PRESS | COLUMBUS Copyright © 2011 by The Ohio State University. All rights reserved. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Mortimer, Armine Kotin, 1943– For love or for money : Balzac’s rhetorical realism / Armine Kotin Mortimer. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-8142-1169-4 (cloth : alk. paper)—ISBN 978-0-8142-9268-6 (cd) 1. Balzac, Honoré de, 1799–1850. Comédie humaine. 2. Realism in literature. 3. Love in literature. 4. Money in literature. I. Title. PQ2159.C72M57 2011 843'.7—dc23 2011019881 Cover design by James Baumann Text design by Juliet Williams Type set in Adobe Sabon Printed by Thomson-Shore, Inc. The paper used in this publication meets the minimum requirements of the American National Standard for Information Sciences—Permanence of Paper for Printed Library Mate- rials. ANSI Z39.48–1992. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Contents List of Illustrations vii Acknowledgments ix Chapter 1 Introduction: The Prime Movers 1 I Rhetorical Forms of Realism Chapter 2 Mimetic Figures of Semiosis 15 Chapter 3 From Heteronomy to Unity: Les Chouans 32 Chapter 4 Tenebrous Affairs and Necessary Explications 47 Chapter 5 Self-Narration and the Fakery of Imitation 63 Chapter 6 The Double Representation of the History of César Birotteau 80 Chapter 7 La Maison Nucingen, a Financial Narrative 94 II Semiotic Images of Realism Chapter 8 Myth and Mendacity: Pierrette and Beatrice Cenci 109 Chapter 9 The -

Répertoire Géographique De La Comédie Humaine DU MEME AUTEUR
Répertoire géographique de la Comédie humaine DU MEME AUTEUR ROMANTIQUE ESPAGNE — L'image de l'Espagne en France entre 1800 et 1850, Paris, 1961. LA PESTE A BARCELONE — En marge de l'histoire politi- que1964. et littéraire de la France sous la Restauration, Paris, H. de Latouche et L.-F. Lhéritier : DERNIERES LETTRES DE DEUX AMANS DE BARCELONE ; introduction et notes de L.-F.H., Paris, 1966.. ÉTUDES BALZACIENNES : REPERTOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMEDIE HUMAI- NE, I, L'étranger, Paris, José Corti, 1965. Les Métaphores animales dans « Le Père Goriot », L'Année balzacienne, 1963. Mignonne et Paquita, L'Année balzacienne, 1964. Balzac et les Noirs, L'Année balzacienne, 1966. Eros en filigrane : « Le Curé de Tours », L'Année balzacienne, 1967. EN PRÉPARATION : L'Eros balzacien. LÉON-FRANÇOIS HOFFMANN RÉPERTOIRE GÉOGRAPHIQUE DE LA COMÉDIE HUMAINE ii LA PRO VINCE LIBRAIRIE JOSÉ CORTI 11, RUE DE MÉDICIS - PARIS 1 1968 @ Librairie José Corti, 1968 Tous droits réservés N° d'édition : 367 Dépôt légal : 1er trimestre 1968 J'ai tâché de donner une idée des diffé- rentes contrées de notre beau pays. Avant-propos de La Comédie humaine. AVANT-PROPOS Le deuxième volume du Répertoire géographique de « La Comédie humaine », qui comprend les noms des lieux situés en France, devait à l'origine inclure les références à la ville de Paris. Ce projet a été modifié pour deux raisons : d'abord, il aurait étendu démesurément les limites du volume, ensuite, la parution du Guide to Balzac's Paris de M. George B. Raser 1 rend inutile ce travail supplémentaire. Voilà pourquoi le deu- xième volume porte le sous-titre de « La Province » et non pas celui de « La France » sous lequel il avait été annoncé.