Document D'objectifs Du Site FR7200705 « Carrières
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
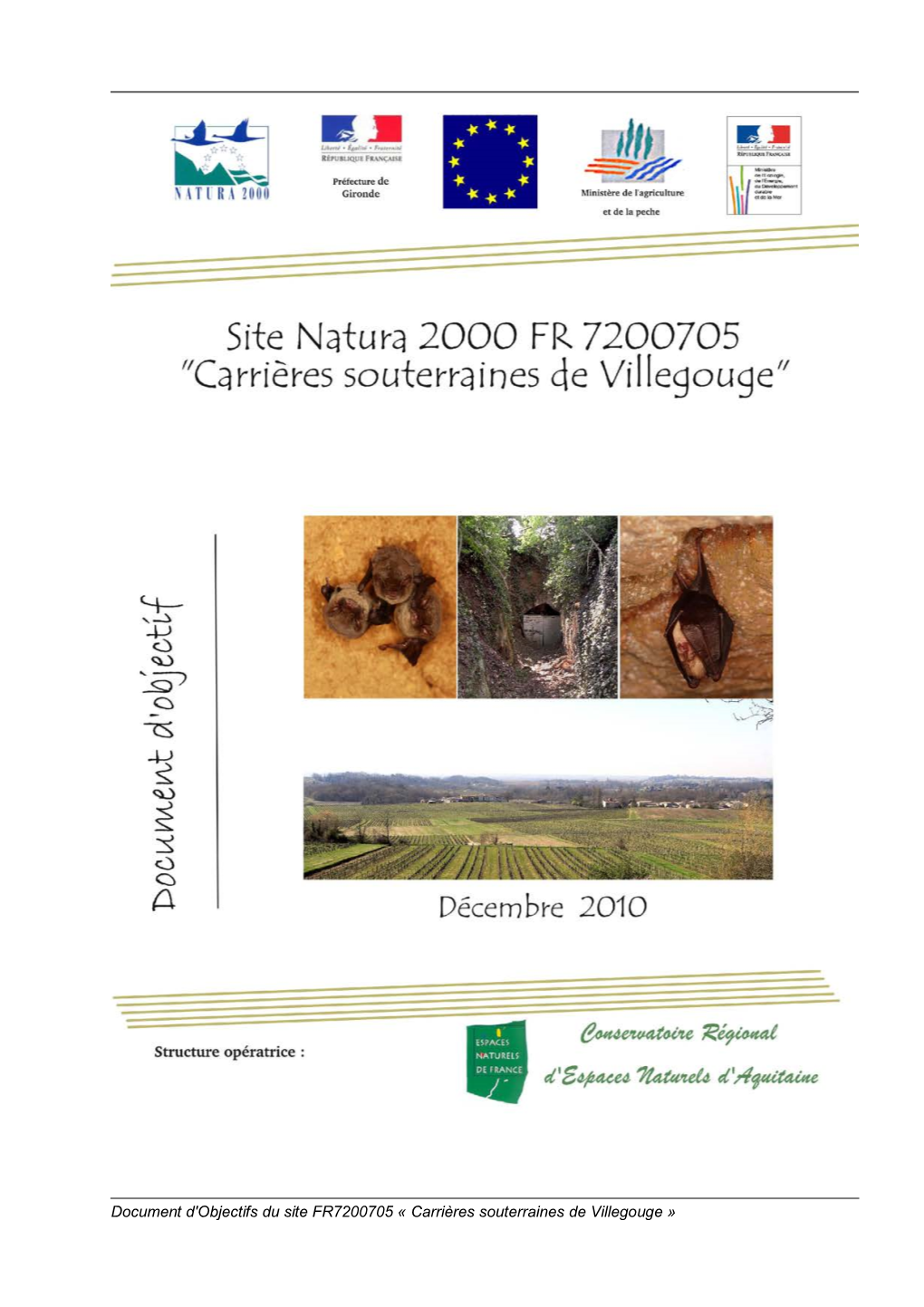
Load more
Recommended publications
-
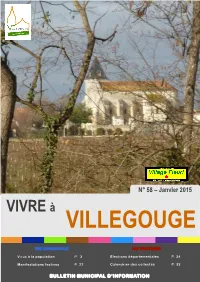
Vivre À Villegouge N° 58 - Janvier 2015
Vivre Villegougeà n° 58 N° 58 – Janvier 2015 VIVRE à - VILLEGOUGEJanvier 2015 VIE MUNICIPALE VIE PRATIQUE Vœux à la population P. 3 Elections départementales P. 24 Manifestations festives P. 22 Calendrier des collectes P. 32 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION VIE MUNICIPALE……….p.03 Vœux à la population Invitation Compte-rendus du Conseil Municipal : Le dimanche 22 février 2015, à partir de 12 heures, - Réunion du 4 novembre dans la salle des fêtes, nos aînés de 60 ans et plus sont conviés au repas offert par la commune. - Réunion du 16 décembre Il y a quelques jours déjà, les personnes concernées CULTURE…….………....p.20 ont dû recevoir une invitation personnelle dans leurs boîtes aux lettres. -Concours de dessin Celles et ceux, âgés de 60 ans et plus qui n’auraient Le P’tit biblio pas reçu d’invitation sont priés de se faire connaître auprès du secrétariat de la Mairie. MANIFESTATIONS FESTIVES.….………..….p.22 Les personnes accompagnantes de moins de 60 ans devront payer la somme de 28 € pour le repas. Gigi the star Cérémonie du 11 novembre Nous vous remercions de nous retourner vos coupons réponses au plus tard le 13 Février à 18 heures. Fête de Noël à l’école Pour notre plus grand plaisir, ce repas sera animé par VIE PRATIQUE ……...…..p.24 Albert et Lorian du Duo « Y’a de la voix », au programme ; magie, chansons, imitations et danses. 2 Elections départementales Nous vous attendons nombreux pour ce moment festif Monoxyde de carbone La commission fêtes et cérémonies. VIE DES ASSOCIATIONS ………. P. 27 Tennis club intercommunal du Fronsadais Les Canailles Le Fusil Villegougeois Le Comité des fêtes Football club Villegougeois Janvier 2015 - S.C.L. -

Sans Titre-1
16 octobre 2015 Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Gironde ERRATA L'article 10 est modifié comme suit : Extension du périmètre du syndicat intercommunal du Bassin Versant du Gestas aux communes de Izon, Pompignac, Loupes, Camiac-et-Saint- Denis, Bonnetan, Baron, Saint-Quentin-de-Baron, Nérigean, Tizac-de-Curton, Espiet, Grézillac, Daignac, Dardenac, Blésignac, Saint-Léon, Beychac-et-Caillau, Saint-Loubès, Montussan, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Sainte-Eulalie, Arveyres, Cadarsac, Moulon, Génissac et Targon. Cf Carte au verso L’article 12 est supprimé, en raison de la procédure de fusion actuellement en cours dans le cadre du droit commun, concernant le Syndicat intercommunal d’Aménagement Hydraulique du bassin de la Dronne et le Syndicat intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Sud Charente : bassins Tude et Dronne (16), fusion devant prendre effet au 1er janvier 2016. LE VERDON- Blaye SUR-MER Dissolution du SI de défense de la digue des Quenouilles et Reprise SOULAC-SUR-MER par la CC issue de la fusion des CC du canton de Blaye, du canton de Bourg, TALAIS Latitude Nord Gironde, de l’Estuaire-canton de Saint-Ciers-sur-Gironde et du Cubzaguais SAINT- VIVIEN- GRAYAN- DE-MÉDOC ET-L’HÔPITAL JAU-DIGNAC- ET-LOIRAC Dissolution du SIGBV du Moron et du Blayais VENSAC VALEYRAC et Reprise par la CC issue de la fusion des CC du canton de Blaye, QUEYRAC BÉGADAN du canton de Bourg, Latitude Nord Gironde, SAINT-CHRISTOLY- MÉDOC de l’Estuaire-canton de Saint-Ciers-sur-Gironde et du Cubzaguais. gestion des bassins versants -

Session on Post-Accident
Your logo here Main results from the French panel of Blayais Post-accident (D9.71) session Mélanie MAÎTRE, Pascal CROÜAIL, Eymeric LAFRANQUE, Thierry SCHNEIDER (CEPN) Sylvie CHARRON, Véronique LEROYER (IRSN) TERRITORIES Final Workshop 12-14 November 2019, Aix-en-Provence This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 662287. Quick reminders about WP3 Your logo here ▌ FIRST STEPS Ref. Ares(2018)542785 - 30/01/2018 This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant ► agreement No 662287. Feedback analysis (post-Chernobyl, post-Fukushima) allowing to: EJP-CONCERT • European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Identify uncertainties and local concerns at stake in contaminated Research H2020 – 662287 D 9.65 – Decision processes/pathways TERRITORIES: Synthesis report of CONCERT sub-subtask 9.3.3.1 territories ; Lead Authors: Jérôme Guillevic (IRSN, France), Pascal Croüail, Mélanie Maître, Thierry Schneider (CEPN, France) • Develop a typology of uncertainties (deliverable D.9.65): With contributions from: Stéphane Baudé, Gilles Hériard Dubreuil (Mutadis, France), Tanja Perko, Bieke Abelshausen, Catrinel Turcanu (SCK•CEN, Belgium), Jelena Mrdakovic Popic, Lavrans Skuterud (NRPA, Norway), Danyl Perez, Roser Sala (CIEMAT, Spain), Andrei Goronovski, Rein Koch, Alan Tkaczyk (UT, Estonia) radiological characterization and impact assessment, zoning of affected Reviewer(s): CONCERT coordination team areas, feasibility and effectiveness of the remediation options, health consequences, socio-economic and financial aspects, quality of life in www.concert- the territories, social distrust. h2020.eu/en/Publications ▌ INTERACTIONS WITH STAKEHOLDERS ► Organization of panels, case studies, serious games: collect stakeholders' expectations and concerns to better consider the uncertainties in the management of contaminated territories. -

Rapport D'activités 2018
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 www.cdc-fronsadais.com SOMMAIRE EDITO DE MADAME LA PRÉSIDENTE Chères Fronsadaises, Chers Fronsadais, La Communauté de Communes du Au travers de nos réalisations riches Fronsadais existe depuis décembre et diversifiées que sont le pôle en- 2002 et j’ai l’immense honneur de la fance à La Lande de fronsac, l’agran- EDITO DE MADAME LA PRÉSIDENTE ........................................................... 03 présider depuis octobre 2017. dissement de la crèche à Villegouge, le gymnase « Michel Frouin » à Vérac, le Je suis bien consciente que les ci- complexe tennistique à Villegouge, la toyens se sentent plus concernés par LA COMPOSITION DE LA CDC DU FRONSADAIS .............................. ZAC à Lugon et enfin le nouvel « Office 04 l’échelon communal et qu’il y a souvent de Tourisme » à Saint Germain de la une méconnaissance de l’intercom- Rivière, émane notre volonté affichée munalité mais j’espère qu’au travers L’ORGANISATION INSTITUTIONELLE............................................................. de doter notre territoire d’équipements 06 de nos réalisations et de nos projets à de qualité, dans le respect de la bonne venir, nous avons su ou saurons vous utilisation des deniers publics et au convaincre de la pertinence de l’action LES COMPÉTENCES DE LA CDC DU FRONSADAIS ........................... bénéfice de nos administrés. 08 communautaire. Je tiens tout particu- D’autant plus que la loi lièrement à remercier L’ORGANISATION DES SERVICES ...................................................................... 10 NOTRe renforce le rôle J’adhère pleinement le personnel qui œuvre des Intercommunalités chaque jour avec beau- qui se voient désormais aux valeurs de coup de professionna- 2018 EN UN CLIN D’OEIL ................................................................................................. 12 dotées de nombreuses lisme et qui grâce à la Marie-France RÉGIS compétences. -

Nouveaux Horaires 05 24 24 22 20
LIBOURNE > TIZAC-DE-LAPOUYADE Ligne 319 *SERVICE EN TRANSPORT À LA DEMANDE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES : réservation obligatoire au plus tard la veille avant 17h, ou le vendredi avant 17h pour le lundi au 05 24 24 22 20 ** * Libourne) (à urbain Calibus ARRÊT --M---- LMMJV-- réseau le sur gratuitement circulez Cali, La de Habitants Correspondance avec le TER en provenance de Bordeaux 12:15 17:24 MODALIS carte la pour Tbc commerciales agences les > aux distributeurs de titres sur les quais du tramway et dans dans et tramway du quais les sur titres de distributeurs aux > Correspondance avec la ligne 302 en provenance de Bordeaux 12:20 17:35 Libourne. de routière gare la à et > aux points de vente de la Buttinière à Lormont à Buttinière la de vente de points aux > LIBOURNE Gare Routière 12:25 17:40 cars des bord à > > sur la boutique en ligne du site transgironde.fr site du ligne en boutique la sur > Lycée Max Linder 12:29 17:44 ? transport de titre son recharger ou acheter Où Sauvagnac 12:32 17:47 routière gare la à / TBC agences les Dans 033 500 0974 Les Castors 12:34 17:49 : Transgironde Réseau 05 24 24 22 20 22 24 24 05 Du lundi au vendredi au au vendredi au lundi Du ZI La Balastière 12:35 17:50 www.lacali.fr : Cali La de transport Service Réseau Calibus Réseau 319 312, 311, lignes : ST MARTIN DU BOIS Bourg 12:52 18:07 Libourne - Gallieni avenue 62, 05 57 51 00 24 00 51 57 05 Calibus Agence Ploiseau 12:58 18:13 ST CIERS D'ABZAC Bourg 13:00 18:15 horaires / Renseignements ST MARTIN DU BOIS La Garrigue 13:03 18:18 pratiques Infos MARANSIN -

The Libournais and Fronsadais
108 FRANCE THE LIBOURNAIS AND FRONSADAIS The right bank of the Dordogne River, known as THE GARAGISTE EFFECT the Libournais district, is red-wine country. In 1979, Jacques Thienpont, owner of Pomerol’s classy Vieux Château Certan, unintentionally created what would become the Dominated by the Merlot grape, the vineyards “vin de garagiste” craze, when he purchased a neighboring plot here produce deep-colored, silky- or velvety-rich of land and created a new wine called Le Pin. With a very low yield, 100 percent Merlot, and 100 percent new oak, the wines of classic quality in the St.-Émilion and decadently rich Le Pin directly challenged Pétrus, less than a mile Pomerol regions, in addition to wines of modest away. It was widely known that Thienpont considered Vieux Château Certan to be at least the equal of Pétrus, and he could quality, but excellent value and character, in the certainly claim it to be historically more famous, but Pétrus “satellite” appellations that surround them. regularly got much the higher price, which dented his pride. So Le Pin was born, and although he did not offer his fledgling wine at the same price as Pétrus, it soon trounced it on the auction IN THE MID-1950S, many Libournais wines were harsh, and market. In 1999, a case of 1982 Le Pin was trading at a massive even the best AOCs did not enjoy the reputation they do today. $19,000, while a case of 1982 Château Pétrus could be snapped Most growers believed that they were cultivating too much up for a “mere” $13,000. -

Tirage Du 28 02 2020 Libourne
TIRAGE AU SORT DU VENDREDI 28/02/2020 – ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE Numéro du panneau Nom de la commmune Nom de la liste Nom du tête de liste d'affichage attribué Ensemble continuons à Abzac Jean-Louis d'Anglade 1 moderniser Abzac Demain Abzac : Construisons-le Abzac Jean-Michel PEREZ 2 ensemble Abzac Liste citoyenne Abzac 2020 Lyonel MÜNZER 3 Arveyres Agir ensemble pour Arveyres Marie-Hélène SAGE 2 Arveyres Arveyres à venir Bernard GUILHEM 1 Baron Avec vous, Baron demain ! Emmanuel LE BLOND DU PLOUY 1 Branne Un nouvel air pour Branne Marie-Christine FAURE 2 Branne Branne ensemble Serge MAUGEY 1 Cadillac en Fronsadais Vivre à Cadillac Richard BARBE 1 Nous construisons l'avenir Castillon la bataille Jacques BREILLAT 2 ensemble Castillon la bataille Castillon, notre bataille Patricia COURANJOU 1 Coutras Agir et entreprendre pour Coutras Jérôme COSNARD 3 Coutras Unis participons et réalisons Hervé FAUDRY 2 Coutras Coutras Autrement Mme LACOSTE Michelle 1 Fronsac Ensemble pour Fronsac Marcel DURANT 1 Poursuivre et construire Galgon Jean-Marie BAYARD 1 ensemble Galgon Agir pour Galgon Serge BERGEON 2 Génissac Vivre bien à Génissac Jean-Pierre PALLARO 2 Génissac L'essentiel c'est vous ! Jean-Jacques TALLET 1 Une énergie commune avec Guîtres Philippe BERTEAU 2 Philippe BERTEAU Guîtres Pour Guîtres ! Source d'avenir Hervé ALLOY 1 Guîtres Agir et entreprendre pour Guîtres Marie-Françoise RANCHOU 3 Izon Au coeur d'Izon Frédéric MALVILLE 1 Izon Ensemble vivons Izon Laurent DELAUNAY 2 Numéro du panneau Nom de la commmune Nom de la liste Nom du tête -

Site Natura 2000 FR7200705 « Carrières Souterraines De Villegouge »
Site Natura 2000 FR7200705 « Carrières souterraines de Villegouge » SITE NATURA 2000 «C ARRIERES SOUTERRAINES DE VILLEGOUGE » MISE EN ŒUVRE DES OPERATIONS D 'ANIMATION ANNEE 2012 Maitrise d’ouvrage Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt Direction Régionale de l’Ecologie, de l’Aménagement et du Logement d’Aquitaine Préfecture du Département de la Gironde Direction Départementale des Territoires et de la Mer du département de la Gironde Structure porteuse Préfecture du Département de la Gironde Direction Départementale des Territoires et de la Mer du département de la Gironde Animateur Natura 2000 Structure : Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine Présidente : Elliane VILLAFRUELA Directeur : Hervé CODHANT Chargée de secteur pour la Gironde : Julie WALKER Chargé de mission Natura 2000 : Pascal TARTARY Antenne Gironde : 5 allée Ronsard – 33 230 LE TAILLAN MEDOC Animateur agricole : Vitinnov Rédaction du bilan Rédaction : TARTARY Pascal, Chargé de mission Natura 2000 – Animateur du site (CEN Aquitaine) FULCHAIN Emma, Co Animatrice du site (Vitinnov) Validation : WALKER Julie, Chargée de secteur de l’antenne Gironde (CEN Aquitaine) Référent DDTM 33 : Nicolas KLEIN Cartographie TARTARY Pascal, Chargé de mission Natura 2000 – Animateur du site Natura 2000 de Villegouge BELANGUIER Luc, Chargé de mission Natura 2000. Illustrations TARTARY Pascal, Chargé de mission Natura 2000 – Animateur du site Natura 2000 de Villegouge Référence à utiliser TARTARY, P & FULCHAIN E. 2012 – Bilan d’activité 2012 de la mise en œuvre du DOCOB du site Natura 2000 des carrières souterraines de Villegouge. CEN Aquitaine & Vitinnov, DREAL Aquitaine, DDTM33. 45 p + annexes. -

Bulletin Municipal
JANVIER 2021 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION N°2 VILLEGOUGE Partageons Villegouge n° 2 P. 20 - janvier 2021 Conseils Etat Mairie Ecoles Environnement Municipaux civil Associations Voirie Sport Vie Locale Informations VIE MUNICIPALE……………………. p. 04 Comptes-rendus du Conseil Municipal : - Réunion du 24 septembre - Réunion du 10 décembre TRAVAUX DES COMMISSIONS………………………. p. 17 Du côté de la vie locale Du côté des écoles Du côté du développement durable Du côté de la voirie Du côté des bâtiments Du côté du sport Commission sanitaire / COVID 19 Côté festivités et cérémonies Côté patrimoine et cimetière Quelques rappels.. Mairie VIE DES ASSOCIATIONS ……..……………… p. 25 Les Canailles Villegouge Bouge 2 Le Tennis Club Intercommunal du Fronsadais La poussinière Club de Football E.S.F.F Le théâtre Pierre Latour Du Moulin Le Fusil Villegougeois Comité des fêtes Ecole de Musique de Galgon Association « Danse à deux en Fronsadais » Association « Ronde des Vignobles en Fronsadais » janvier janvier 2021 - Association « le fil à la main » VILLEGOUGE DANS LA PRESSE ………………………………………….. p. 27 INFORMATIONS DIVERSES ……………………………. p. 28 Recensement militaire Partageons Villegouge Inscriptions sur les listes électorales Conçu et réalisé par la Mairie de Villegouge Inscriptions scolaires Partageons Villegouge n°2 Directeur de la publication : Etat Civil année 2020 Guillaume VALEIX APPEL AUX ADMINISTRES ………………………. p. 30 Responsable de la communication : DU COTE DE LA CDC..…………….. p. 31 Bahija KHATTABI En collaboration avec Alicia GRILLET S O M M A I R E LES VOEUX DU MAIRE Madame, Monsieur, Chers Villegougeois En ce début d’année 2021, le Conseil municipal de Villegouge se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année à venir, ainsi que nos meilleurs vœux de santé, de réussite dans vos projets personnels, profes- sionnels, et le souhait d'un renouvellement des relations humaines que nous tissons les uns envers les autres dans notre belle commune, au vu de l'année difficile que nous venons de traverser. -

Vin Appellation Mill Concours / Presse Note
Wine Portfolio Vignobles Beaulieu History Family winery since 1910, now runned by Philippe Person the fifth generation. The estate grew from 20ha to160 nowadays. Located in the commune of Galgon, the 160-hectare vineyard is close to Fronsac and Villegouge in the area of Bordeaux in France. Mainly Merlot planted, the annual production reaches around 1 million bottle per year, Chateau David Beaulieu – Bordeaux Chateau Jalousie Beaulieu – Bordeaux Chateau Pascaud – Bordeaux Superieur Superieur Superieur Rich an powerful wine, full bodied with a Château David Beaulieu is comprised a Beautiful deep ruby color. Elegant deep colour and intense ripe fruits aromas. beautiful and deep color, and a nose at aromas of spices and red fruits. once blossomed, delicate and intense The taste is powerful with fine tannins. that delicately incorporates the aromas BLEND of red fruits and violets. BLEND 90% Merlot, 10% Cabernet Franc 70 % Merlot, 11 % Cabernet Franc, 19 BLEND % Cabenert Sauvignon SOIL 80% Merlot, 15% Cabernet Franc, 5% Clay – limestone Cabernet Sauvignon, SOIL Clay Limestone AGEING SOIL Ageing in French oak barrels Clay – Limestone AGEING 12 - 18 months in tanks AGEING Ageing in stainless steel tanks Vignoble Mingot History Following his grandfather Raymond and his father Michel, Julien is now leading the family winery. Julien stands for the new generation of the family business and brings a cross view from the winemaking, highly focused on quality, to the sales with a customer service approach Now Julien is running Chateau Marechaux and had acquiered Chateau La Pensée with his first vintage in 2013 Terroir The vineyard is located in the Savignac de l’Isle commune, close to Libourne, on what is historically called “the Bordeaux right bank”. -

LISTE DES COMMUNES ET LIEUX DITS DE LA GIRONDE D'après Le Bottin Des Communes 2004 Et La Nomenclature Des Communes De 1826 LIEUX Arrondissement Canton
LISTE DES COMMUNES ET LIEUX DITS DE LA GIRONDE d'après le Bottin des communes 2004 et la Nomenclature des communes de 1826 LIEUX Arrondissement Canton A L'AVOCAT voir PINEUILH AU GRAVA voir JAU DIGNAC ET LOIRAC ABATILLES (LES) voir ARCACHON ABEAUX (LES) voir COUTRAS ABEILLON (L') voir St PIERRE DE MONS ABRAHAM (LES) voir MESTERRIEUX ABZAC LIBOURNE COUTRAS ACERIES (LES) voir PESSAC ACHON voir BARP (LE) ADAM voir TIZAC DE LAPOUYADE AGATHES (LES) voir CAMIRAN AIGUILLE (L') voir St CHRISTOLY DE BLAYE AIGUILLE (L') voir St SAVIN AILLAN voir St ESTEPHE AILLAS LANGON AUROS AILLAS LE VIEUX voir AILLAS AIR (L') voir PLASSAC ALAIRES voir REIGNAC ALET voir BARSAC ALEXANDRE voir CESTAS ALLANS (LES) voir VILLENEUVE ALLANTS (LES) voir St VIVIEN DE BLAYE ALLARDS (LES) voir SALIGNAC ALLEBERT voir DONNEZAC ALLEGRET voir SAUVE (LA) Allemagne (L') voir MERIGNAC Allemagne (L') voir TAILLAN MEDOC (LE) ALLIBERTS (LES) voir MAZION ALLINS (LES) voir BRAUD ET St LOUIS ALLINS (LES) voir PLEINE SELVE ALLOUET voir REIGNAC ALOUETTE (L') voir PESSAC ALTY voir St LOUIS DE MONTFERRAND AMANTS (LES) voir MONGAUZY AMBARES ET LAGRAVE BORDEAUX CARBON BLANC AMBAUD voir SALIGNAC AMBES BORDEAUX LORMONT AMBLARDS (LES) voir FOSSES ET BALEYSSAC AMBROIS voir MONTAGNE AMBROIS voir MONTAGNE AMELIE (L') voir SOULAC S/MER AMEREAUX (LES) voir LALANDE DE POMEROL ANCEILLAN (D') voir PAUILLAC ANCLAUSES (AUX) voir CAMPUGNAN ANCOINS (LES) voir St MICHEL DE LAPUJADE ANDAULE voir St PEY DE CASTETS ANDERNOS LES BAINS BORDEAUX AUDENGE ANDIOTTE voir St SEURIN DE CURSAC ANDOISSE voir BARSAC ANDONS -

PLU Villegouge
Département de la Gironde VILLEGOUGE RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 5 - RÉGLEMENT : PIÈCE ECRITE Mise en révision Arrêt du projet Approbation 10 novembre 2010 12 novembre 2012 01 juillet 2013 Vu pour être annexé le ....................... DOSSIER D’APPROBATION Le Maire, 24-26 rue de Marlacca 33620 CAVIGNAC 05.57.68.69.73 - [email protected] Vincent BUCHMANN Architectecte dplg Révision du Plan Local d’Urbanisme de VILLEGOUGE – Juin 2013 - APPROBATION 5- Règlement : pièce écrite SOMMAIRE TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ______________________________________________________ 2 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE ______________________________________ 7 DES ZONES ____________________________________________________________________________ 7 TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES ____________________________________________________ 9 AUX ZONES URBAINES __________________________________________________________________ 9 ZONE UA ___________________________________________________________________________ 10 ZONE UB ___________________________________________________________________________ 15 ZONE UE ___________________________________________________________________________ 21 ZONE UY____________________________________________________________________________ 26 TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER __________________________ 32 ZONE 1AU __________________________________________________________________________ 33 ZONE 1AUsp ________________________________________________________________________ 39 ZONE 1AUY