L'auteur Dramatique Et La Conscience Professionnelle (1610-1640)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
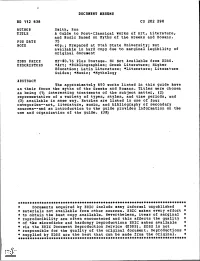
A Guide to Post-Classical Works of Art, Literature, and Music Based on Myths of the Greeks and Romans
DOCUMENT RESUME ED 112 438 CS 202 298 AUTHOR Smith, Ron TITLE A Guide to Post-Classical Works of Art, Literature, and Music Based on Myths of the Greeks and Romans. PUB DATE 75 NOTE 40p.; Prepared at Utah State University; Not available in hard copy due to marginal legibility of original document !DRS PRICE MF-$0.76 Plus Postage. HC Not Available from EDRS. DESCRIPTORS *Art; *Bibliographies; Greek Literature; Higher Education; Latin Literature; *Literature; Literature Guides; *Music; *Mythology ABSTRACT The approximately 650 works listed in this guide have as their focus the myths cf the Greeks and Romans. Titles were chosen as being (1)interesting treatments of the subject matter, (2) representative of a variety of types, styles, and time periods, and (3) available in some way. Entries are listed in one of four categories - -art, literature, music, and bibliography of secondary sources--and an introduction to the guide provides information on the use and organization of the guide.(JM) *********************************************************************** Documents acquired by ERIC include many informal unpublished * materials not available from other sources. ERIC makes every effort * * to obtain the best copy available. Nevertheless, items of marginal * * reproducibility are often encountered and this affects the quality * * of the microfiche and hardcopy reproductions ERIC makes available * * via the ERIC Document Reproduction Service (EDRS). EDRS is not * responsible for the quality of the original document. Reproductions * * supplied -

|||GET||| Vergil Aeneid Book V 1St Edition
VERGIL AENEID BOOK V 1ST EDITION DOWNLOAD FREE Ganiban | 9781585102297 | | | | | Aeneid I Vi Then Aeneas is shown the fates of the wicked in Tartarus and is warned by the Sibyl to bow to the justice of the gods. Possible clean ex-library copy, with their stickers and or stamp s. Aeneas, with the guidance of the Cumaean Sibyldescends into the underworld. Juno, unhappy with the Trojans' favourable situation, summons the fury Alecto from the underworld to stir up a war between the Trojans Vergil Aeneid Book V 1st edition the locals. Download as PDF Printable version. The city has only recently been founded by refugees from Tyre and will later become a great imperial rival and enemy to Rome. Cornell Chronicle. Retrieved 25 December A council of the gods is held, in which Venus and Juno speak before Jupiter, and Aeneas returns to the besieged Trojan camp accompanied by his new Arcadian and Tuscan allies. Online books Resources in your library Resources in other libraries. At the behest of Vergil Aeneid Book V 1st edition apparition, he leaves clandestinely at night. Hence, although Aeneas wishes to avoid a war, hostilities break out. Brand new Book. Supplemental materials are not guaranteed with any used book purchases. Since so many students now begin Latin in college, they approach Vergil with an interest in interpretation, developed through years of high school and college literature coursework, that easily exceeds their ability in translation. Her heart broken, Dido commits suicide by stabbing herself upon a pyre with Aeneas's sword. The first full and faithful rendering of the poem in an Anglic language is the Scots translation by Gavin Douglas Vergil Aeneid Book V 1st edition Eneadoscompleted inwhich also included Maffeo Vegio's supplement. -

Travestis and Caractères in the Early Modern French Theatre
Early Theatre 15.1 (2012) Virginia Scott Conniving Women and Superannuated Coquettes: Travestis and Caractères in the Early Modern French Theatre In his 1651 Roman comique that depicts the adventures of an itinerant theat- rical troupe in the French provinces, Paul Scarron describes a conventional representation of older female characters in French comedy: ‘Au temps qu’on était réduit aux pièces de Hardy, il [La Rancune] jouait en fausset et, sous les masques, les roles de nourrice’ [In the period when troupes were reduced to the plays of Hardy, he played in falsetto, wearing a mask, the roles of the nurse].1 The nourrice was a character type from Roman and Italian Renais- sance comedy, often an entremetteuse or go-between as well as a confidant. Juliet’s Nurse in Romeo and Juliet, although she participates in a story that ends tragically, is an essentially comic character and a familiar example from the English repertory. La Rancune, an actor of the second rank, also played confidents, ambas- sadors, kidnappers, and assassins. This mixed emploi — confidents et nour- rices — was not an unusual line of business for an actor in the early years of the seventeenth century. A comparable emploi at the end of that century would be known as confidentes et caractères. The difference is that the former was an emploi for men while the latter was for women. Female character roles became more and more important in the last decades of the seventeenth century, when comedy dominated the Paris repertory and the bourgeoisie dominated the Paris theatre audience. When the professional theatre was established in Paris in the 1630s, no women specialized in comic charac- ter roles; by the end of that century, the troupe of the Comédie-Française included Mlles Desbrosses, Godefroy, Champvallon, and Du Rieu in the emploi of caractères. -

Powerpoint Guidance
A Londoner Joseph Mallord William Turner was born in April 1775 in Covent Garden, London. His father, William, was a barber and wigmaker and his mother was called Mary. Joseph’s father was supportive of his artistic talent and would display his son’s early drawings in his shop. Joseph Turner kept his Cockney accent all his life. Did You Know? The Royal Academy of Arts Joseph attended the Royal Academy of Arts school in 1789 and was accepted into the academy the following year. Although Joseph was interested in architecture, he was advised to carry on painting watercolour pictures. He sold some of his watercolour paintings to help pay for his fees at the Academy. Joseph Turner was only fourteen years old when he started studying at Did You Know? the Academy. Capturing the Light Joseph Turner began sketching outside, using these as a basis for his paintings, indoors. This led to him touring the country during the summer and working in the studio in the winter. He became known as “The Painter of Light”. In 1796, he exhibited his first painting in oils: ‘Fishermen at Sea’. As you look at the following paintings, think about why Turner was known as Did You Know? “The Painter of Light”. Fishermen at Sea What are your thoughts about this painting? Painter of Light One of Joseph Turner’s most famous paintings is called ‘The Fighting Temeraire Tugged to Her Last Berth to Be Broken Up’ and is on display at the National Gallery in London. How would you describe Turner’s painting technique? JMW TURNER (1775-1851) GREAT YARMOUTH HARBOUR, NORFOLK 1840 Travel Turner began to travel around Europe, becoming known as one of the greatest masters of watercolour landscapes. -

Bibliographie Zum Nachleben Des Antiken Mythos
Bibliographie zum Nachleben des antiken Mythos von Bernhard Kreuz, Petra Aigner & Christine Harrauer (Tschechische Literatur: Petr Kindlmann) Version vom 23.09.2013 Wien, 2013 Inhaltsverzeichnis I. Allgemeine Hilfsmittel .............................................................................................................. 3 I.1. Hilfsmittel zum 16.–18. Jhd. .............................................................................................. 3 I.1.1. Lexika zur Rennaissance .............................................................................................. 3 I.1.2. Biographische Lexika ................................................................................................... 3 I.1.3. Bibliographische Hilfsmittel ........................................................................................ 4 I.1.4. Neulateinische Literatur im Internet ............................................................................ 4 I.2. Moderne Lexika zur Mythologie (in Auswahl) ................................................................. 4 I.2.1. Grundlegende Lexika zur antiken Mythologie und Bildersprache .............................. 4 I.2.2. Lexika zur antiken Mythologie und ihrem Nachleben ................................................. 5 Spezialwerke zur bildenden Kunst ......................................................................................... 5 Spezialwerke zur Musik ......................................................................................................... 6 I.2.3. -

Travestis and Caractãšres in the Early Modern French
Early Theatre 15.1 (2012) Virginia Scott Conniving Women and Superannuated Coquettes: Travestis and Caractères in the Early Modern French Theatre In his 1651 Roman comique that depicts the adventures of an itinerant theat- rical troupe in the French provinces, Paul Scarron describes a conventional representation of older female characters in French comedy: ‘Au temps qu’on était réduit aux pièces de Hardy, il [La Rancune] jouait en fausset et, sous les masques, les roles de nourrice’ [In the period when troupes were reduced to the plays of Hardy, he played in falsetto, wearing a mask, the roles of the nurse].1 The nourrice was a character type from Roman and Italian Renais- sance comedy, often an entremetteuse or go-between as well as a confidant. Juliet’s Nurse in Romeo and Juliet, although she participates in a story that ends tragically, is an essentially comic character and a familiar example from the English repertory. La Rancune, an actor of the second rank, also played confidents, ambas- sadors, kidnappers, and assassins. This mixed emploi — confidents et nour- rices — was not an unusual line of business for an actor in the early years of the seventeenth century. A comparable emploi at the end of that century would be known as confidentes et caractères. The difference is that the former was an emploi for men while the latter was for women. Female character roles became more and more important in the last decades of the seventeenth century, when comedy dominated the Paris repertory and the bourgeoisie dominated the Paris theatre audience. When the professional theatre was established in Paris in the 1630s, no women specialized in comic charac- ter roles; by the end of that century, the troupe of the Comédie-Française included Mlles Desbrosses, Godefroy, Champvallon, and Du Rieu in the emploi of caractères. -

De Pierre Bayle
études littéraires françaises • 22 études littéraires françaises collection dirigée par Wolfgang Leiner avec la collaboration de Jacqueline Leiner et d'Ernst Behler Essai sur le rôle des Allemands dans le Dictionnaire Historique et Critique (1697) de Pierre Bayle par Jean F. Goetinck Préface d'Ernst Behler Gunter Narr Verlag • Tübingen Editions Jean-Michel Place - Paris CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek Goetinck, Jean F. : Essai sur le rôle des Allemands dans le Dictionnaire historique et critique (1697) [mille six cent quatre-vingt-dix-sept] de Pierre Bayle / par Jean F. Goetinck. Préf. d'Ernst Behler. -Tubingen : Narr ; Paris : Place, 1982. (Etudes littéraires françaises ; 22) ISBN 3-87808-960-0 NE: GT @ 1982 - Gunter Narr Verlag • Tübingen Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfaltigung. auch auszugsweise. in allen Formen wie Mikrofilm, Xérographie, Mikrofiche. Mikrocard, Offset verboten. Tous droits de reproduction réservés pour tous pays. Druck : Müller + Bass - 7400 Tùbingen - Hechinger StraBe 25 ISBN 3-87808-960-0 PREFACE From Voltaire to Feuerbach, Marx, and far beyond, Pierre Bayle's Dictionnaire his- torique et critique of 1697 has again and again appeared as the arsenal of the Enligh- tenment providing the age of reason with that anti-religious and anti-authoritarian ammunition which eventually destroyed the foundations of the ancien regime. There is obviously no doubt how smoothly Bayle's thought fused with that part of rationa- lism which became identical with irreligiosity. Karl Marx and Friedrich Engels in The Holy Family of 1845 depicted Bayle as an author who not only discredited the metaphysics of the seventeenth century, but all metaphysics, and as one who became the historiographer of metaphysics in order to write the history of its death. -

Boyle's Books
BOYLE’S BOOKS: THE EVIDENCE OF HIS CITATIONS Iordan Avramov Michael Hunter Hideyuki Yoshimoto Robert Boyle Project Occasional Papers No. 4 Boyle’s Books: The Evidence of his Citations Robert Boyle’s extensive library was irrevocably dispersed within fifteen months of his death in 1691, and only a few volumes from it can now be identified. However, clues to Boyle’s ownership of books are provided by his citations of the writings of others by page, sometimes using the formula ‘pagina mihi’, ‘page in my copy’. This publication collects such evidence both from Boyle’s published writings and from his manuscript reading notes to give details of some 125 books which he is likely to have owned. It thus offers a significant contribution to the reconstruction of Boyle’s library. The authors are Iordan Avramov, Research Fellow at the Centre for Science Studies and History of Science, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia; Michael Hunter, Professor of History at Birkbeck, University of London, and Director of the Robert Boyle Project; and Hideyuki Yoshimoto, Professor in the Division of Culture and Literary Studies at the Tokyo University of Foreign Studies. Robert Boyle, Of the Reconcileableness of Specifick Medicines to the Corpuscular Philosophy (London, 1685), p. 70, showing a typical example of a citation by him in the form ‘Pag[ina] mihi’, ‘page in my copy’. Wellcome Library, London, 15066/B. BOYLE’S BOOKS: THE EVIDENCE OF HIS CITATIONS Iordan Avramov Michael Hunter Hideyuki Yoshimoto Robert Boyle Project Occasional Papers No. 4 2010 No. 4 of the Occasional Papers of the Robert Boyle Project Published by the Robert Boyle Project, Department of History, Classics and Archaeology, Birkbeck, University of London, Malet Street, London, WC1E 7HX, UK © Iordan Avramov, Michael Hunter and Hideyuki Yoshimoto All rights reserved ISBN: 978-0-9551608-3-7 British Library Cataloguing in Publication Data. -

Art Basel 11 Min
FILM & MUSIC FESTIVALS • CIRCUS KNIE • EXERCISE IN PARKS • ENGLISH THEATER Volume 7 Issue 9 CHF 6 6 A Monthly Guide to Living in Basel June 2019 50 Years of Appreciating Art Basel 11 min. from Basel SBB Saturdays & Evenings Prevention Dental Hygiene Dentures & Implants Dental Restorations Smile Makeovers Urgent Appointments +49 7623 469 240 Hebelstraße 19a, 79618 Rheinfelden, Germany cliniusdentalcare.com 2 Basel Life Magazine / www.basellife.com LETTER FROM THE EDITOR Dear Readers, Summer is right around the corner, and this can only mean one thing in Basel—time to embrace the arts! Both local art lovers and the inter- June 2019 Volume 7 Issue 9 national art world—including many celebrities—focus their attention on the prestigious Art Basel show in the middle of the month, which is TABLE OF CONTENTS accompanied by a host of exhibitions, indoor and outdoor art events, as well as a multitude of related art fairs. For roughly a week, the city will Feature Event: Art Basel 4–7 be transformed into one huge art gallery where you can expect the unex- pected, and unusual expressions of art abound throughout the squares and streets. Be sure to take a stroll through Art Basel Parcours in the city Events in Basel: June 2019 8–13 center and to check out the video art presented by Videocity.bs in several public spaces throughout the city. Art Basel is a great way to get an in- sight into today’s art scene! Fun Outings: Beyond Basel 14–15 The month of June also brings with it a great number of festivals that celebrate art and culture in a variety of ways, including the Bildrausch Markets and Fairs 16–17 Filmfest, which emphasizes films as an art form; the Imagine festival where youths are invited to take a stand against racism; an oldtimer car festival across the French border; as well as several open-air music fes- Calendar: June 2019 18–19 tivals in and beyond Basel. -

{PDF EPUB} Dido Doomed Queen of Carthage by Ingrid De Haas the Story of Dido, Queen of Ancient Carthage
Read Ebook {PDF EPUB} Dido Doomed Queen of Carthage by Ingrid de Haas The Story of Dido, Queen of Ancient Carthage. Dido (pronounced Die-doh) is known best as the mythical queen of Carthage who died for love of Aeneas, according to "The Aeneid" of the Roman poet Vergil (Virgil). Dido was the daughter of the king of the Phoenician city-state of Tyre, and her Phoenician name was Elissa, but she was later given the name Dido, meaning "wanderer." Dido was also the name of a Phoenician deity named Astarte. Who Wrote About Dido? The earliest known person to have written about Dido was the Greek historian Timaeus of Taormina (c. 350–260 BCE). While Timaeus's writing did not survive, he is referenced by later writers. According to Timaeus, Dido founded Carthage in either 814 or 813 BCE. A later source is the first-century historian Josephus whose writings mention an Elissa who founded Carthage during the rule of Menandros of Ephesus. Most people, however, know about the story of Dido from its telling in Viergil’s Aeneid . The Legend. Dido was the daughter of the Tyrian king Mutto (also known as Belus or Agenor), and she was the sister of Pygmalion, who succeeded to the throne of Tyre when his father died. Dido married Acerbas (or Sychaeus), who was a priest of Hercules and a man of immense wealth; Pygmalion, jealous of his treasures, murdered him. The ghost of Sychaeus revealed to Dido what had happened to him and told her where he had hidden his treasure. -

Tate Britain
Tate Britain The Paintings of J.M.W. Turner 15:00-15:45 Laurence Shafe 1 The Paintings of J.M.W. Turner The Paintings of J.M.W. Turner.......................................................................................................................... 2 Joseph Mallord William Turner (1775-1851) in the Clore Gallery ..................................................................... 5 ‘Self-Portrait’, c. 1799 ........................................................................................................................................ 6 ‘England: Richmond Hill, on the Prince Regent’s Birthday’, exhibited 1819 ..................................................... 9 ‘Snow Storm: Hannibal and his Men crossing the Alps’, exhibited 1812 ........................................................ 12 ‘The Decline of the Carthaginian Empire’, exhibited 1817 .............................................................................. 15 ‘The Angel Standing in the Sun’, exhibited 1846 ............................................................................................. 18 ‘Crossing the Brook’, exhibited 1815 ............................................................................................................... 21 ‘Ploughing up Turnips near Slough’, exhibited 1809 ....................................................................................... 24 ‘The Sun of Venice Going to Sea’, exhibited 1843 ........................................................................................... 29 ‘Norham Castle, Sunrise’, -

Preaching for the Eyes: Priests, Actors, and Ceremonial Splendor in Early Modern France by Joy Kathleen Palacios a Dissertation
Preaching for the Eyes: Priests, Actors, and Ceremonial Splendor in Early Modern France By Joy Kathleen Palacios A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Performance Studies in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in Charge: Professor Shannon Steen, Chair Professor Shannon Jackson Professor Nicholas Paige Professor Michael Wintroub Fall 2012 i Abstract Preaching for the Eyes: Priests, Actors, and Ceremonial Splendor in Early Modern France by Joy Kathleen Palacios Doctor of Philosophy in Performance Studies University of California, Berkeley Professor Shannon Steen, Chair In 1656, Jean-Jacques Olier, founder of the Seminary of Saint-Sulpice, urged his students and readers to think of the ceremonies of the mass as “preaching for the eyes.” His emphasis on the liturgy as something that should be not just heard but also seen signaled a shift in Catholic worship away from the auditory toward the visual, as well as a call for priests to acquire what we would now call performance skills so as to “preach” with their bodies. This dissertation argues that ecclesiastical action against actors flared in France between the 1660s and 1730s because the foundation of seminaries two decades earlier had turned parish priests into liturgical performers as part of a larger effort to professionalize the secular clergy. This professionalization helps solve a puzzle presented by the cultural history of the theater in early modern France. Although virulent, religiously informed anti-theatrical discourses punctuated France’s golden age of theater, France’s parish priests appear to have applied anti-actor policies inconsistently.