Frappier Daniel 2016 Memoire.Pdf (1.979Mb)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Unobtainium-Vol-1.Pdf
Unobtainium [noun] - that which cannot be obtained through the usual channels of commerce Boo-Hooray is proud to present Unobtainium, Vol. 1. For over a decade, we have been committed to the organization, stabilization, and preservation of cultural narratives through archival placement. Today, we continue and expand our mission through the sale of individual items and smaller collections. We invite you to our space in Manhattan’s Chinatown, where we encourage visitors to browse our extensive inventory of rare books, ephemera, archives and collections by appointment or chance. Please direct all inquiries to Daylon ([email protected]). Terms: Usual. Not onerous. All items subject to prior sale. Payment may be made via check, credit card, wire transfer or PayPal. Institutions may be billed accordingly. Shipping is additional and will be billed at cost. Returns will be accepted for any reason within a week of receipt. Please provide advance notice of the return. Please contact us for complete inventories for any and all collections. The Flash, 5 Issues Charles Gatewood, ed. New York and Woodstock: The Flash, 1976-1979. Sizes vary slightly, all at or under 11 ¼ x 16 in. folio. Unpaginated. Each issue in very good condition, minor edgewear. Issues include Vol. 1 no. 1 [not numbered], Vol. 1 no. 4 [not numbered], Vol. 1 Issue 5, Vol. 2 no. 1. and Vol. 2 no. 2. Five issues of underground photographer and artist Charles Gatewood’s irregularly published photography paper. Issues feature work by the Lower East Side counterculture crowd Gatewood associated with, including George W. Gardner, Elaine Mayes, Ramon Muxter, Marcia Resnick, Toby Old, tattooist Spider Webb, author Marco Vassi, and more. -

Horse Todos a B Alliebelle 23.072 a Big To'do 26.392 a Bit
HORSE TODOS A B ALLIEBELLE 23.072 A BIG TO'DO 26.392 A BIT STORMY 25.592 A BOY NAMED EM 28.675 A BRILLIANT IDEA 31.402 A BRUSH OF BEAUTY 21.393 A CAT NAMED SNIPE 28.551 A CAT THAT FLIES 25.368 A CENTURIAN 29.172 A DEVILISH RIDE 24.916 A DIEHL 34.923 A DOS PUNTAS 42.616 A E PHI SENSATION 23.497 A FLEET OF NINE 23.302 A GIRL NAMED MARIA 29.537 A GLASS OF WATER 22.147 A GOLDEN JET 22.575 A GRAND N' MORE 19.560 A JEALOUS WOMAN 36.719 A LA MODA 28.673 A LIL DUMAANI 27.721 A LISTER 25.068 A LITTLE AT A TIME 26.233 A LITTLE OFF 31.467 A LITTLE TOO LATE 25.373 A LOT OF ACTION 26.490 A LOT OF MON 27.211 A MATTEROFSPEAKING 24.041 A MCCOUGHTRY 25.178 A MI ZORRITO 44.348 A MILLION FIELDS 25.005 A MOMENT IN TIME 29.541 A NATIONALTREASURE 33.592 A NATURAL 29.383 A NEW DAWN 25.094 A NEW YORK PHILLIE 23.229 A P MINK 29.223 A P VALOR 30.045 A PERFECT SQUEEZE 28.415 A PINT FOR MARY 26.393 A PLUS TOPPER 28.873 A QUESTION OF TIME 21.185 A RACING DELIGHT 28.495 A RANG A TANG 26.600 A ROCKY STORM 21.775 A ROD 33.263 A ROGUE SNUCK IN 24.666 A ROYAL FLUSH A 18.962 A SHE'S ADORABLE 33.925 A SHOT AWAY 28.920 A SINGLE MAN 21.532 A SMART JUDGE 23.806 A STAR IS GORN 23.954 A STORY OF REVENGE 29.442 A STUDENT 29.494 A T MONEY 30.054 A TOE BY THREE 25.800 A TOUT L'HEURE 42.875 A TRIPP ROYALE 29.433 A USED GUN 23.246 A WALK ABOVE 25.728 A WINK AND A SMILE 32.705 A WISH FOR KOSUTE 20.514 A WORD TO THE WISE 30.596 A Z WARRIOR 35.400 A'INTYOUDREAMIN 22.520 A. -

His 2008 02 Nd 02.Indd 1 3.3.2008 0:05:32 Deutsch Nepal
editorial obsah Glosář Matěj Kratochvíl 2 Barbez Karel Veselý 4 Volapük / Ovo Petr Ferenc 5 Opening Performance Orchestra Petr Ferenc 6 aktuálně Charalambides Matěj Kratochvíl 7 Vážení a milí čtenáři, Člověk jdoucí za hudebním zážitkem většinou ví, co jej čeká, co má sledovat a očekávat a jak se chovat. Že se bude hrát na harfy či laptopy, že se má tleskat po só- Zvuky v prostoru Jozef Cseres 8 lech či netleskat po větách symfonie, že zvuky se bu- dou linout z pódia a bude víceméně jasné, kdo je vydá- vá. Jsou tu prostě určité jistoty. Zajímá-li nás inspirativní Orbis pictus Petr Ferenc 12 nejistota, je pole zvukových instalací nebo sound artu dobrou volbou. Především můžeme váhat, zda jde vů- bec o hudbu, zvláště když řada tvůrců přichází z výtvar- téma Instalace Alvina Luciera Thomas Bailey 18 ného břehu. Každé jednotlivé dílo pak nabízí svou vlast- ní sadu nejistot a příležitostí k podivu: Jsou tyto zvuky Zvuk – umění – město Karel Veselý 20 elektronické, nebo akustické? Jak souvisí to, co vidím, s tím, co slyším? V takto pomezním oboru je nějaký systematický pře- Steve Roden Pavel Zelinka 22 hled ještě o chlup nemožnější než ve sférách čistě hu- debních, toto číslo tedy nabízí spíše sondy do pestrosti přístupů. Od historických mezníků, jaký představu- je třeba dílo Alvina Luciera Bird And Person Dyning, se dostaneme k autorům výstavy Orbis Pictus, kte- Gordon Monahan Jesse Stewart 25 rá v současnosti s úspěchem koluje po světě, od vy- prázdněných reproduktorů Gordona Monahana přesko- číme k telefonům Dona Rittera, zpívajícím buddhistickou Valentin Silvestrov Vítězslav Mikeš 28 mantru. -

Dancers in the Sky Stories
DANCERS IN THE SKY STORIES DANCERS IN THE SKY STORIES Barry Eysman Copyright 2011 by Barry Eysman All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored, or transmitted by any means— whether auditory, graphic, mechanical, or electronic—without written permission of both publisher and author, except in the case of brief excerpts used in critical articles and reviews. Unauthorized reproduction of any part of this work is illegal and is punishable by law. ISBN 978-1-257-05256-1 EVERYDAY MAGIC. IN THE MERE LIVING. WE TOO. IN LOVING MEMORY OF JASE, JOSHUA, DIEGO, ROB AND BERRITY— MY FRIENDS TABLE OF CONTENTS Before the Fall........................................................................................1 Pirouette .................................................................................................5 Late Night Radio ................................................................................... 8 Something is Really Wrong .................................................................10 My Name is David ...............................................................................13 The Brindling Day ...............................................................................17 Halloween Charade ..............................................................................19 And his Eyes be as Blue as the Sea......................................................20 Paul Finally Gets to Play Basketball ....................................................51 Doing Time in Tooth Ache Town ........................................................52 -

The Young Gods, Des Dieux Toujours Jeunes
UNE PUBLICATION No 10 DU COLLECTIF MAI 2007 MENSUEL Daily Rock GRATUIT TOUTE L’ACTUALITÉ BRÛLANTE DU ROCK EN ROMANDIE Edito THE YOUNG GODS, DES Rockeuses, Rockeurs, Alors que la mode des chaussures à roulettes qui débarque nous agace DIEUX TOUJOURS JEUNES déjà, sans compter le dernier single de ce morveux de Timberlake qui est Conférences soniques, tournée génial et que le CD de Cascada qui acoustique ou relecture du film semble avoir lobotomisé une grande ‘Woodstock’. On avait croisé ces partie de la planète, je me dis qu’on dernières années les Young Gods est mal barré en ce mois de mai. dans des univers à la fois calmes et passablement éloignés de ce Heureusement quelques valeurs sûres nous sauvent qui leur avait ouvert les portes d’une dépression post-lobo certaine. L’ami Reznor qui, soit dit en passant, s’y connaît en dépression, de la notoriété. Voilà qu’un peu arrive à point nommé avec son Year Zero, sans prévenir, Franz Treichler, Al électroniquement vôtre, talonné par les culteux Comet et Bernard Trontin nous locaux Young Gods, qui la méritaient cette couv’ ! balancent un bon vieux coup de rock derrière la tête. Avec les douze Et si les festivals s’en mêlent, on ne va plus savoir où donner de la tête. En vrac, NIN aux Arènes titres d’une efficacité renversante d’Avenches, Arctic Monkeys, Eiffel, Arcade Fire de ‘Super Ready/Fragmenté’, ils et le dieu Rob Plant, sur la plaine de l’Asse, sans prouvent que la jeune garde a compter le toujours très Black-eyed rassemblement encore pas mal de boulot pour sacré d’Interlaken, Greenfield de son prénom et la leur piquer la place. -

The History of Rock Music: 1976-1989
The History of Rock Music: 1976-1989 New Wave, Punk-rock, Hardcore History of Rock Music | 1955-66 | 1967-69 | 1970-75 | 1976-89 | The early 1990s | The late 1990s | The 2000s | Alpha index Musicians of 1955-66 | 1967-69 | 1970-76 | 1977-89 | 1990s in the US | 1990s outside the US | 2000s Back to the main Music page (Copyright © 2009 Piero Scaruffi) The New Wave (These are excerpts from my book "A History of Rock and Dance Music") New York's new Boheme TM, ®, Copyright © 2005 Piero Scaruffi All rights reserved. 1976 was a watershed year: the music industry was revitalized by the emergence of "independent" labels and the music scene was revitalized by the emergence of new genres. The two phenomena fed into each other and spiraled out of control. In a matter of months, a veritable revolution changed the way music was produced, played and heard. The old rock stars were forgotten and new rock stars began setting new trends. As far as white popular music goes, it was a sort of Renaissance after a few years of burgeoisie icons (think: Bowie), conservative sounds (country-rock, southern boogie) and exploitation of minorities (funk, reggae). During the 1970s alternative rock had survived in niches that were highly intellectual, namely German rock and progressive-rock (particularly the Canterbury school). They were all but invisible to the masses. 1976 was the year when most of those barriers (between "low" and "high" rock, between "intellectual" and "populist", between "conservative" and "progressive", between "star" and "anti-star") became not only obsolete but meaningless. -

The Illustrated Man Ray Bradbury
The Illustrated Man Ray Bradbury Contents Prologue: The Illustrated Man The Veldt Kaleidoscope The Other Foot The Highway The Man The Long Rain The Rocket Man The Fire Balloons The Last Night of the World The Exiles No Particular Night or Morning The Fox and the Forest The Visitor The Concrete Mixer Marionettes, Inc. The City Zero Hour The Rocket Epilogue [About this etext] PROLOGUE:The Illustrated Man IT was a warm afternoon in early September when I first met the Illustrated Man. Walking along an asphalt road, I was or the final leg of a two weeks’ walking tour of Wisconsin. Late in the afternoon I stopped, ate some pork, beans, and a doughnut, and was preparing to stretch out and read when the Illustrated Man walked over the hill and stood for a moment against the sky. I didn’t know he was Illustrated then. I only knew that he was tall, once well muscled, but now, for some reason, going to fat. I recall that his arms were long, and the hands thick, but that his face was like a child’s, set upon a massive body. He seemed only to sense my presence, for he didn’t look directly at me when he spoke his first words: “Do you know where I can find a job?” “I’m afraid not,” I said. “I haven’t had a job that’s lasted in forty years,” he said. Though it was a hot late afternoon, he wore his wool shirt buttoned tight about his neck. His sleeves were rolled and buttoned down over his thick wrists. -

Text-Based Description of Music for Indexing, Retrieval, and Browsing
JOHANNES KEPLER UNIVERSITAT¨ LINZ JKU Technisch-Naturwissenschaftliche Fakult¨at Text-Based Description of Music for Indexing, Retrieval, and Browsing DISSERTATION zur Erlangung des akademischen Grades Doktor im Doktoratsstudium der Technischen Wissenschaften Eingereicht von: Dipl.-Ing. Peter Knees Angefertigt am: Institut f¨ur Computational Perception Beurteilung: Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Widmer (Betreuung) Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Andreas Rauber Linz, November 2010 ii Eidesstattliche Erkl¨arung Ich erkl¨are an Eides statt, dass ich die vorliegende Dissertation selbstst¨andig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die w¨ortlich oder sinngem¨aß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. iii iv Kurzfassung Ziel der vorliegenden Dissertation ist die Entwicklung automatischer Methoden zur Extraktion von Deskriptoren aus dem Web, die mit Musikst¨ucken assoziiert wer- den k¨onnen. Die so gewonnenen Musikdeskriptoren erlauben die Indizierung um- fassender Musiksammlungen mithilfe vielf¨altiger Bezeichnungen und erm¨oglichen es, Musikst¨ucke auffindbar zu machen und Sammlungen zu explorieren. Die vorgestell- ten Techniken bedienen sich g¨angiger Web-Suchmaschinen um Texte zu finden, die in Beziehung zu den St¨ucken stehen. Aus diesen Texten werden Deskriptoren gewon- nen, die zum Einsatz kommen k¨onnen zur Beschriftung, um die Orientierung innerhalb von Musikinterfaces zu ver- • einfachen (speziell in einem ebenfalls vorgestellten dreidimensionalen Musik- interface), als Indizierungsschlagworte, die in Folge als Features in Retrieval-Systemen f¨ur • Musik dienen, die Abfragen bestehend aus beliebigem, beschreibendem Text verarbeiten k¨onnen, oder als Features in adaptiven Retrieval-Systemen, die versuchen, zielgerichtete • Vorschl¨age basierend auf dem Suchverhalten des Benutzers zu machen. -

10 Años De Una Performance Flamenca: Morente Y Sonic Youth En El Ca2m
10 AÑOS DE UNA PERFORMANCE FLAMENCA: MORENTE Y SONIC YOUTH EN EL CA2M MARÍA JOSÉ JIMÉNEZ PÉREZ Universidad de Granada Resumen El año 2010 fue significativo para el flamenco: entraba a formar parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO y cerraba un episodio esencial con la muerte de Enrique Morente, quien el 2 de febrero nos legaría un hecho singular al protagonizar, junto a dos miembros de Sonic Youth, una performance inusual en el Centro de Arte 2 de mayo de Móstoles, donde flamenco “primitivo” y Nuevo Flamenco dialogan con el rock experimental de la banda neoyorquina. Palabras clave Postmodernidad; flamenco; arte conceptual; fluxus; performance; música experimental. 10 YEARS SINCE A FLAMENCO PERFORMANCE: MORENTE AND SONIC YOUTH AT THE CA2M Abstract The year 2010 was significant for flamenco: it enters at the Representative List of Intangible Cultural Heritage and Enrique Morente dies. Besides, we should add a singular fact, Morente performed with two members of Sonic Youth, on 2 of February, an unusual performance at the Art Center May 2 of Mostoles, where “primitive” flamenco and new flamenco dialogue with the experimental rock band from New York. Keywords Postmodernism; flamenco; conceptual art; fluxus; performance; experimental music. Ucoarte. Revista de Teoría e Historia del Arte, 9, 2020, pp. 106-124 ISSN: 2255-1905 10 Años de una performance flamenca: Morente y Sonic Youth en el CA2M Introducción La performance realizada por Enrique Morente y Sonic Youth en el Centro de Arte Contemporáneo 2 de mayo de Móstoles el 2 de febrero de 20101, constituye nuestro objeto de estudio, que abundará en su carácter de performance sonora y en la convergencia de estilos musicales y artísticos que presenta. -
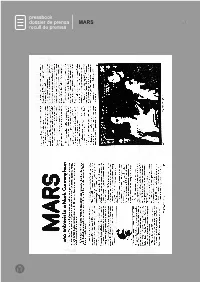
MARS 1 Recull De Premsa Pressbook Dossier De Prensa MARS 2 Recull De Premsa Pressbook Dossier De Prensa MARS 3 Recull De Premsa
pressbook dossier de prensa MARS _1 recull de premsa pressbook dossier de prensa MARS _2 recull de premsa pressbook dossier de prensa MARS _3 recull de premsa MARS The Complete Studio Recordings: NYC 1977-1978 [G3G/Spooky Sound; 2003]. Rating: 7.9 I'm looking up from an interview with William Burroughs, at a mariachi group as they smile and try to find their balance on a downtown train. Their gestures of voice, guitar, and rhythm are promptly drowned in brake drones, the shuddering of the decrepit old tracks, and plastic-protected ads for acne surgery and model-proffered Budweisers. All I can hear through the din is the disquieting roar of Mars and singer China Burg's sinister slurring: "What I put together, I can take apart." Since I refuse to spend the $30 for a CD copy of No New York, I'm grateful to have the complete recordings of Mars (count one seven-inch, four tracks from NNY, and one EP-- a half-hour in total) howling through my headphones. For those keeping track, since the digital age, another complete discography of Mars already came out on the Atavistic label, but with vague sonic tweaking by Foetus scraper Jim Thirlwell. Purists might argue that since band member Mark Cunningham used a different master tape for transferring the Mars EP (even restoring its binaural recording quality), it's still not going to sound like the "murkier" frequencies of the original wax. From the metallic sparkle of the midnight blue card sleeve to the insightful commentary offered by the remaining members (Sumner Crane passed away earlier this year), this limited edition package is too exquisite to overlook, no matter how distressing the aural mess splattered inside. -

Download PDF Booklet
www.zerecords.com UNDER THE INFLUENCE / WHITE SPIRIT The 21st century has produced a new generation of young contenders of all kinds, who have, within months, spread a new string of names across the planet such as The Rapture, Playgroup, LCD Sound system, Liars, Yeah Yeah Yeahs, Radio 4 and the likes, just to name a few. Once again the heat was initiated in NYC, even though its Lower East Side epicenter « cleaned up » by Giuliani and Bloomberg, has moved a few blocks east and across the river to Brooklyn and Williamsburg. It might be wise to remind the younger ones among us that the origins of this new musical cycle is for the most part rooted in the NO WAVE movement of which James Siegfried aka James White, aka James Chance is undoubtedly one of its most prominent figures. New York City was hands down the artistic telluric center of the second half of the 20th century, especially from the 70’s, on. Rising from the ashes of the Velvet Un- derground, a slew of local bands redefined the aesthetics of rock’n’roll which the merchants of the temple hastened to rename under various designations, such as Punk, New Wave, No Wave, Jazz-Funk or even Disco and Disco- Punk without forgetting to mention the original Electro designation pioneered by the band Suicide. One of the indispensable and emblematic figures of the mid-70’s is of course James Chance. James Siegfried, born in Milwaukee in 1953, began his musical journey on the piano at the age of seven. -

Dancecult 8(1) Reviews
Reviews Life and Death on the New York Dance Floor 1980–1983 Tim Lawrence Durham: Duke University Press, 2016. ISBN: 978-0-8223-6202-9 RRP: US$27.95 <http://dx.doi.org/10.12801/1947-5403.2016.08.01.05> Charles de Ledesma University of East London, UK Cultural historian Tim Lawrence’s first book Love Saves the Day adopted a chronological approach to East Coast disco’s dramatic arc through the 1970s. Then his follow-up Hold On to Your Dreams widened the timeline, honing in on a valuable contributor to New York’s downtown music scene—cellist and composer Arthur Russell. While LStD ranged widely across many spaces, DJs, artists, assorted characters and issues, the Russell biography was an intimate portrait of a key player, who died from AIDS-related complications in 1992. Life and Death on the New York Dance Floor 1980–1983 (henceforth Life and Death) is the third segment in Lawrence’s New York project. Now he narrows the timeline and brings a forensic examination to just four years in the party scene. On the title, Lawrence explains, “the reference to life is intended to evoke the way that New York party culture didn’t merely survive the hyped death of disco but positively flourished in its wake”. And he clearly and convincingly argues that the short period was one characterised by a stirring artistic ferment, across music, art, dance and club space innovation. Lawrence explains: “instead of depicting the 1980–1983 period as a mere bridge that connected the big genre stories of 1970s disco and 1980s house and techno, I submitted to its kaleidoscope logic, took my foot off the historical metronome, and decided to take it—the book—to the bridge” (ix).