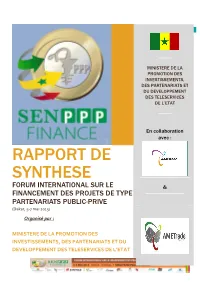ISSN 0850 - 458X
UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
Ecole Normale Supérieure d’Enseignement
Technique et Professionnel
---------------------
BP 5004 Dakar Fann (Sénégal)
Tél : (221) 821 76 69 Fax : (221) 821-70-51
Email : [email protected]
ECHOS DU FORMATEUR
Revue en Sciences de l’éducation
- Numéro 1
- Janvier 2012
1
ECHOS DU FORMATEUR
Revue publiée par l’Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique et Professionnel (ENSETP) de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.
Elle est à vocation internationale et porte sur les Sciences de l’éducation. Elle est semestrielle et a pour objectif de contribuer au développement et à l’amélioration de la qualité de l’éducation.
Directeur de Publication
Ibrahima WADE, Maitre Assistant, ENSET/UCAD
Comité de Patronage
Amadou- Mahtar MBOW, ancien Directeur Général de l’UNESCO Jean -Marie DE KETELE, Professeur Émérite Université Catholique Louvain
Docteur Honoris Causa Université Cheikh Anta DIOP de
Dakar
Amadou Tidiane BA, Professeur Université Cheikh Anta DIOP de Dakar
Ministre de l’Enseignement supérieur, des Universités et des Centres Universitaires Régionaux et de la Recherche Scientifique
Comité Scientifique
Jean-Marie DE KETELE, Professeur (UCL, Belgique) - Xavier ROEGIERS, Professeur (UCL, Belgique) - Didier JOURDAN, Professeur (UBPCF, France) - Abdou Karim NDOYE, Professeur (UCAD, Sénégal) - Mamadou ADJ, Professeur (UCAD, Sénégal) - Rodolphe TOUSSAINT, Professeur (UTR, Canada) - Jacques GINESTIE, Professeur (IUFM, France) - Oumar SANKHARE, Professeur (UCAD, Sénégal) – Boubacar DIOP, Professeur (UCAD, Sénégal) - Mor Talla DIALLO, Professeur (UCAD, Sénégal) - Jean-Emile CHARLIER, Professeur (UMONS, Belgique) - Mariane FRENAY, Professeur (UCL, Belgique) - Christian DEPOVER, Professeur (UMH, Belgique) - Oumar SOCK, Professeur (UCAD, Sénégal) - Claude LISHOU, Professeur (UCAD, Sénégal) - Babacar GUEYE, Professeur (UCAD, Sénégal) - Papa Goumba Lo, Professeur (UCAD, Sénégal) - Bernard HOSTEIN, Professeur (IPNETP, Côte d’Ivoire) - Marjolaine CHATONEY, Professeur (IUFM, France) - Michel BONAMI, Professeur (UCL, Belgique) – Etienne BOURGEOIS, Professeur (UCL, Belgique) Boubacar NIANE, Professeur (UCAD, Sénégal).
2
Comité de Lecture
Belgique : Jean-Marie DE KETELE - Xavier ROEGIERS - Mariane FRENAY - JeanEmile CHARLIER - Christian DEPOVER – Léopold PAQUAY – Jacques GREGOIRE – Michèle GARANT
Canada : Rodolphe TOUSSAINT
France : Marjolaine CHATONEY - Didier JOURDAN – Marguerite ALTET - Jacques GINESTIE
Côte d’Ivoire : Bernard HOSTEIN – Kanvaly FADIGA
Sénégal : Mor Talla DIALLO - Harisoa DEME - Oumar SANKHARE - Papa Goumba Lo - Boubacar DIOP – Babacar GUEYE - Hamidou Nacuson SALL - Abdou Karim NDOYE
Comité de Rédaction
Maïmouna Thiam FADIGA - Youssoupha GUEYE - Sylvain Luc AGBANGLANON - Ndiogou NDIAYE
Assistant Informatique
Youssoupha GUEYE & Sylvain Luc AGBANGLANON Département Sciences et Techniques Industrielles
3
SOMMAIRE
LA PRATIQUE DE L’EVALUATION ET L’AUTOEVALUATION DANS LA FORMATION DES ELEVES PROFESSEURS D’ESPAGNOL AU GABON ............. 5
Eugénie EYEANG Ecole Normale Supérieure (ENS, CRAAL, Libreville-Gabon)
MARKETING DE LA FORMATION DES INSPECTEURS DE SPECIALITE A L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET
PROFESSIONNEL DE DAKAR................................................................................17 Maïmouna FADIGA Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique et Professionnel/UCAD
AXES PARADIGMATIQUES DES POLITIQUES ET DOCTRINES EDUCATIVES COLONIALES AU SENEGAL A TRAVERS L’ANALYSE DE L’ECOLE PRIMAIRE
DE 1817 A 1945........................................................................................................25 Ibrahima WADE Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique et Professionnel/UCAD
LA VALIDATION DES EPREUVES DE SELECTION ET D’ORIENTATION DES CANDIDATS AUX ECOLES DE FORMATION D’ENSEIGNANTS : LES DERIVES
DE L’EVALUATION SCOLAIRE...............................................................................36 Ansumana SANE Coordination Nationale des Blocs d’enseignement Scientifique et Technologique
AMELIORATION DU PROCESSUS D’EDUCATION /APPRENTISSAGE (E/A) EN EFS (ECONOMIE FAMILIALE SOCIALE) A TRAVERS L’UTILISATION DE
L’INTERNET /TICS. ..................................................................................................48 Aminata Ka Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique et Professionnel (ENSETP) / Université Cheikh Anta Diop de Dakar
FEMMES AFRICAINES ET ACCES A LA FORMATION: PEUT-ON AFFIRMER QUE L’ACCES A LA FORMATION PEUT AMELIORER LA REUSSITE PROFESSIONNELLE DES FEMMES TRANSFORMATRICES DES PRODUITS
AGROALIMENTAIRES ?..........................................................................................57 Mme Maty DIA DIALLO Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique et Professionnel (ENSETP) / Université Cheikh Anta Diop de Dakar
11 ANS APRES : IMPACTS DES MESURES RELATIVES AUX ETUDIANTS A LA FST (UCAD) DANS LE CADRE DE LA REFORME DE 1994 ..................................64
Bamba Déthialaw DIENG Faculté des Sciences et Technologies de l’Education et de la Formation/UCAD
4
LA PRATIQUE DE L’EVALUATION ET L’AUTOEVALUATION DANS LA FORMATION DES ELEVES PROFESSEURS D’ESPAGNOL AU GABON1
Eugénie EYEANG Ecole Normale Supérieure (ENS, CRAAL, Libreville-Gabon)
Résumé
La pratique de l’évaluation et l’autoévaluation modifie les comportements et renouvelle les habiletés de l’apprenant. Elle permet au sujet apprenant de connaitre son niveau global dans le module de formation en question. L’entraînement à (s’auto) évaluer développe la réflexivité et permet de mieux appréhender le contenu du cours et le rôle de l’évaluation dans le processus d’apprentissage. L’apprenant acquiert la capacité à interroger sa propre situation pour pouvoir changer de position en comblant lui-même (et avec les autres) ses carences. L’interrogation sur l’action enseignante, par la problématisation des situations pédagogiques et didactiques, favorise la construction d’une compétence de recherche. D’autant plus que l’élève-professeur apprend à questionner ses actes et les objets d’éducation. Une quête d’amélioration qui devient gratifiante et motivante pour la formation professionnelle.
Mots clés
Evaluation, autoévaluation, élève-professeur, formation, compétence de recherche.
Abstract
The practice of self-evaluation and change behaviors and renew the skills of the learner. It allows learners to know about its overall level in the training module in question. The drive (self) evaluate and develop reflexivity to better understand the course content and the role of evaluation in the learning process. The learner acquires the ability to question his own position to be able to change position by closing itself (and other) deficiencies. The questioning of the construction of a research competence. Especially as the student teacher learns to question his actions and objects of education. A quest for improvement that is rewarding and motivating for vocational training.
Key-words
Evaluation, self-evaluation, student teacher, training, research competence.
1. Introduction
La pratique de l’évaluation est aujourd’hui récurrente. Tous les domaines de la société posent des diagnostics, des bilans à mi-parcours, des suivis-évaluations de projets, etc. On entre inexorablement dans un système de valeurs praxéologiques, avec un primat de l’efficacité ou de l’efficience et une quête de l’optimisation sur le plan organisationnel (DANVERS, 2003). En éducation, plusieurs travaux sont publiés sur différents aspects de l’évaluation (DE KETELE, 1986 ; CARDINET, 1988; PERRENOUD, 1998 ; ROEGIERS, 2004; SCALLON, 2004 ; VIAL, 2005 ; TAGLIANTE, 2005). Dans ce domaine, il est question d’évaluation diagnostique, formative, sommative y compris l’autoévaluation qui encourage une attitude réflexive de l’élève sur ses apprentissages. La formation des enseignants exige d’aborder toutes les facettes de l’évaluation. Pour les enseignants de langue notamment, les différentes phases qui caractérisent un cours de langue sont ponctuées d’évaluations. L’évaluation est présente au début, au milieu et à la fin du cours d’espagnol, d’anglais ou d’allemand. C’est un processus qui participe à la formation des apprenants et qui affecte aussi bien les formés que le formateur.
L’évaluation est une partie intégrante du processus d’apprentissage (ABERNOT, 1988). On peut d’ailleurs l’envisager sous deux angles. L’angle behavioriste selon une approche par objectifs ou la perspective constructiviste dans laquelle l’enseignant opte pour une analyse approfondie des résultats des élèves avec le but d’adapter le cours à leurs besoins professionnels en les amenant à se questionner sur leurs productions ou interventions. L’aspect le plus important pour le travail de l’enseignant reste donc les intérêts des apprenants. Par conséquent, l’accent sera mis sur le degré de compétence ou de
1 Certains éléments de cette recherche ont été présentés au XVIIIe Congrès International de l’ASELE en 2007. Une version remaniée est publiée en espagnol dans AULA (Ediciones de la Universidad de Salamanca) et aussi dans la
Revue Gabonaise de Recherche en Education.
5
préparation des élèves professeurs ainsi que la compréhension des contenus prévus. Ainsi, pour le cours, réaliser la tache demandée et identifier ses forces et faiblesses est un élément de compétence. Autrement dit, les élèves-professeurs doivent acquérir la capacité de passer de la pratique (années d’enseignement au collège, application de certaines “recettes”2) à la théorie (concepts didactiques et épistémologiques) et revenir à la pratique (intégration de nouvelles techniques et stratégies d’enseignement), selon le triptyque : pratique → théorie → pratique. De cette manière, l’évaluation intègre l’apprentissage (SUSO LÓPEZ et al., 2001 ; NARCY COMBES, 2005). Elle valorise, par l’autoévaluation, le processus d’enseignement/ apprentissage (E/A).
Cette recherche est le résultat d’une réflexion initiée, il y a plus de quatre ans dans le module de Didactique et Méthodologie de l’enseignement de l’espagnol langue étrangère au Gabon (50 heures/semaine). Nous sommes partie du profil du public-cible qui est représenté de professeurs adjoints3 ayant besoin d’un certain encadrement pour comprendre les exigences d’un programme théorique en didactique. Le présent article nous donne l’opportunité de montrer comment des élèves professeurs qui n’ont jamais pratiqué la méthodologie de la recherche développent leur capacité d’analyse des phénomènes pédagogiques et didactiques en intégrant l’autoévaluation (l’élève professeur lui-même), l’hétéro évaluation (par le groupe classe et l’enseignant) dans l’acte de formation4.
2. Eléments théoriques et conceptuels
Les considérations actuelles en matière d’enseignement/apprentissage mettent l’individu au centre de sa formation . Le rôle prééminent du professeur tend à s’estomper pour laisser plus d’autonomie à l’élève. C’est pourquoi, les domaines réservés autrefois à l’enseignant comme l’évaluation, requièrent aussi l’implication de l’apprenant.
2.1. La question de l’évaluation de nos jours
La pratique de l’évaluation est un processus complexe qui a considérablement fait évoluer la relation maître/élève ou enseignant/ apprenant. Evaluer ne se limite pas seulement à donner une valeur, une note, mesurer (CARDINET, 1988), juger un objet ou un sujet , c’est aussi considérer l’apprenant comme acteur dans sa propre évaluation.
Il s’agit d’abandonner l’idée selon laquelle le maître est le seul détenteur des savoirs, le vecteur des
connaissances, le juge des résultats des élèves, en commençant à penser à un maître qui soit créateur de situations d’apprentissage, respectueux du processus d’apprentissage de chaque élève, critique avec
sa propre façon d’agir (notre traduction) CASSANY, 1998: 77). Le but est de rechercher la façon optimale d’aider l’élève professeur à réfléchir sur ses pratiques. Le devoir du professeur réflexif est de rendre
explicite ce savoir tacite ou implicite par la réflexion sur l’action, en générant des questions constamment et en vérifiant ses théories émergentes avec sa propre expérience passée et avec les réflexions que les
autres font (notre traduction) (WILLIAMS, BURDEN, 1999: 63). C’est une réflexion permanente entre le savoir qu’un individu détient et les connaissances des autres. De cette façon, l’évaluation (et/ou autoévaluation + hetéroévaluation) pratiquée par les apprenants eux-mêmes, après une épreuve orale ou écrite, est un exercice indispensable qui permet à ceux qui sont en formation d’acquérir les règles du «dur métier d’enseignant». De tels actes posés régulièrement favorisent la germination d’une conscience de l’erreur, d’une compétence d’organisation et de construction des connaissances. Comme le dit si bien
A. SANCHEZ PÉREZ (2004: 148), l’acquisition des connaissances ne dépend pas seulement de la volonté d’apprendre, ni de bien comprendre en premier lieu ce que l’on désire apprendre. L’être humain
2
Il arrive que des enseignants appliquent des instructions officielles sans avoir des précisions sur l’origine de telle ou telle innovation. L’exemple de la centration sur l’apprenant qui est revendiquée même par les behavioristes traditionnels.
3
Ces élèves professeurs ont au moins cinq années d’expérience. Titulaires du CAPC (licence plus deux années de formation professionnelle à l’Ecole Normale Supérieure) ils reviennent à l’ENS compléter leur formation et être professeurs de Lycée (CAPES). A la fin de la formation, ils élaborent un mémoire professionnel. 4 L’évaluation implique non seulement les résultats, mais aussi les méthodes, les formateurs et tous les autres acteurs qui interviennent dans le déroulement de l’action.
6
apprend si ce qu’il capte une fois après arrive à se consolider et à s’intégrer dans l’ensemble des
connaissances qu’il possède déjà. Ainsi nous reconnaissons, avec lui, que les corrections qui essaient de mettre en évidence, de façon brutale, les faiblesses de l’élève auront des effets négatifs parce qu’elles peuvent affecter son image et porter préjudice à l’apprentissage. C’est pourquoi, il convient de concevoir une autre forme d’évaluer pour stimuler l’apprentissage et la prise de décisions du propre apprenant. Avec l’ensemble du groupe-classe, l’apprenant peut parvenir à reconnaître son point de départ et le continuum qui le conduit jusqu’à l’appropriation des connaissances en jeu.
SUSO LÓPEZ y al. (2001 : 461) déclarent qu’en introduisant comme objet d’évaluation les propres processus cognitifs d’apprentissage (…), on modifie le concept d’évaluation. Il se transforme en une valorisation sur un processus d’enseignement/apprentissage; une telle valorisation ne peut plus s’effectuer depuis l’extérieur de l’individu qui apprend: il doit l’associer au jugement valorisant, pour que chaque apprenant découvre ses conditions de départ, ses progrès, ses lacunes, ses stratégies d’apprentissage: la participation du propre élève dans l’évaluation se transforme ainsi en une garantie.
(Notre traduction) Dans la cogestion de la classe (enseignant et apprenants), le respect des consignes est un préalable important. L’enseignant qui devient un «coach»5 aide l’apprenant à s’affirmer, à se mettre en confiance pour ses erreurs soient des réussites (VIAL, 2002). Les interrogations conceptuelles du cours se réalisent en groupe et permettent de s’améliorer.6 Il est vrai qu’au début d’un module d’enseignement, l’adhésion du groupe entier semble difficile, à cause de la diversité des niveaux et parfois des parcours de formation7. Mais l’explication du fonctionnement général de la classe et des buts recherchés permet à chaque membre du groupe de s’approprier l’objet d’évaluation et son degré d’implication pour la réussite de l’activité. L’adéquation entre la consigne initiale et son exécution varie selon la personnalité de chaque apprenant et du matériel didactique mis à sa disposition.
La préparation de l’activité d’évaluation par l’enseignant est un préalable. En distinguant l’évaluation de
la notation, il convient de connaître ce que l’on évalue et pourquoi on évalue, sans oublier ce qui est
évalué et/ou qui évalue (NARCY-COMBES, 2005). Les apprenants ont besoin d’une évaluation de leurs progrès d’apprentissage. Pour les enseignants, l’évaluation est le compteur de l’input et le facilitateur de la qualité de l’enseignement. Le professeur réajuste son cours à partir des résultats de l’évaluation (faite par les apprenants). Généralement, les décisions de l’évaluation sont celles que le professeur prend après un cours. Il régule alors son enseignement avec des questions du type : Ça été un bon cours?
Pourquoi oui ou pourquoi non? (RICHARDS, LOCKHART, 2002), Que faut-il faire pour les motiver ? Ce
sont là des interrogations qui aident le formateur à optimiser son enseignement en donnant la possibilité au formé d’avoir plus d’autonomie à travers l’autoévaluation8.
2.2. A propos de l’autoévaluation
Pour nous, l’autoévaluation est une évaluation réflexive. Pour R. LEGENDRE (1993), l’autoévaluation est le processus par lequel un sujet est amené à porter un jugement sur la qualité de son cheminement, de son travail et de ses acquis en regard d’objectifs prédéfinis, et tout en s’inspirant de critères précis d’appréciation. Cette définition est partagée aujourd’hui par tous. Puisqu’on considère, communément,
5
Le “coaching” en éducation apparaît comme une pratique d’intégration pédagogique qui, alors qu’il est rigoureusement appliqué, permet à l’apprenti de se mettre en confiance et d’utiliser valablement son savoir tout en acquérant un savoir-faire et un savoir-être nouveaux (EYEANG, OVA, 2007).
6
Ici, nous allons graduer les types d’erreurs que commet l’apprenant en partant des erreurs grammaticales aux erreurs conceptuelles (et autres). Les erreurs linguistiques sont corrigées de façon plus ou moins traditionnelle (du type: “ça se dit ainsi ou ça ne se dit pas”. Mais, les élèves professeurs doivent développer la conscience linguistique en essayant de reconnaître les déviances linguistiques qu’ils commettent en espagnol pendant les exposés afin de minorer les problèmes liés à l’insécurité linguistique qui caractérise habituellement le locuteur non natif. 7 Le public cible ici est souvent composé d’élèves professeurs sans expérience d’enseignement et d’autres avec plus de 15 ans de pratique sur le terrain. Certains auront exercé uniquement à l’intérieur du pays (province), d’autres jamais. 8 C’est l’enseignant qui délivre l’évaluation mais l’apprenant doit y être associé par l’autoévaluation, le jugement de lui-même» (PORCHER, 2004: 14).
7
l’autoévaluation comme une imposition du formateur au formé afin que ce dernier dise qu’il a acquis, ce qui a été prévu par le formateur (VIAL, 2005). En réalité, c’est la valorisation d’une personne par ellemême, de sa propre prestation en fonction d’une tache, d’une activité ou d’un projet. Nous tentons de passer ici de l’évaluation d’un expert (enseignant/ formateur) à celle d’un novice (élève professeur) par lui-même.
La vision traditionnelle de l’enseignement ne prépare pas l’élève dans ce domaine, puisque le seul détenteur du savoir (savoir, savoir faire, savoir être) est, dit-on, l’enseignant. Actuellement, il y a une certaine évolution des pratiques de classe. La pratique de l’évaluation formative (récurrente en classe de langue, DABENE, 1984) est avantageuse car, elle décentre, d’une certaine manière, l’élève de la
note/sanction pour le centrer sur les appréciations du professeur (Bien! Très bien! Pas mal! Encore un
effort ! Etc.), ce qui offre à l’élève d’autres perspectives sur l’évaluation. En plus, la fonction formative de l’évaluation exige beaucoup plus qu’une simple gestion et un singulier contrôle de la progression de chaque élève. La régularisation des apprentissages peut favoriser une meilleure responsabilisation de l’élève (SCALLON, 2004: 23). On peut admettre que l’autoévaluation est un acte pédagogique qui incite l’apprenant à réfléchir sur ses performances et ses erreurs. Elle aide non seulement à construire son apprentissage (formation) mais aussi à forger son identité professionnelle9. C’est un acte de formation qui le met en mouvement qu’il soit en situation productive ou réceptive10. Cet exercice, difficile pour beaucoup d’apprenants au début, les oblige à se regarder dans le miroir et à dire ainsi ce que leurs yeux voient. Ils doivent s’exercer et apprendre à le faire (VIAL, 2005). Nous remarquons en outre que la pratique de l’autoévaluation peut être prometteuse en cas de concertation entre le formateur et les formés. Elle ne s’oppose pas à l’hétéro évaluation. L’autoévaluation doit être considérée comme une évaluation valorisée (JORRO, 2007). En réalité, l’autoévaluation s’organise à partir des règles établies par un sujet pour d’autres sujets. Elle tourne autour du sujet. Elle est avantageuse pour l’évaluateur. L’autoévaluation qui fait un vas-et-viens entre l’autre et moi n’est pas du tout simple, ni naturelle ; elle s’apprend, se construit et c’est seulement de cette façon qu’elle favorise les apprentissages des savoirs en situation (VIAL 2005). Nous pourrons débattre encore sur les représentations en vigueur à propos de l’autoévaluation comme stratégie de formation qui facilite les performances dans l’apprentissage. Nous voulons tout simplement souligner que l’auto questionnement est un mode qui oblige l’apprenant à savoir s’interroger sur son rôle. Il s’agit de savoir formuler de bonnes questions pour son projet. L’auto questionnement est la faculté que possède un sujet de s’interroger de manière opportune sur ses actions. Nous pouvons penser à quelques questions du type :