Morts De Rire
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sur Choron, Dernière
ChoronPour restera beaucoup, le monsieur chauve et ivre qui mettait sa bite dans les flûtes de champagne. horOn, Remarquez, y a pire comme trace C laissée sur terre. BHL, exemple au hasard, ne laissera-t-il pas derniÈre l’image d’un triste sire LE FILM qui montrait sa chemise blanche documentaire dans les postes de télévision ? de Pierre Carles Quoi qu’il en soit, le Prof et Martin, était bien plus que cela. Avec Georges Bernier, Quand j’étais jeune (et vrai) journaliste, de la bande des dit Choron, Cavanna, Cabu, Siné, NAbe, Hara-Charlie-Kiri-Hebdo, Vuillemin, Wolinski, Val… c’était lui qu’on voulait tous Choron, dernière - 1 h 38’, couleur. 1,33, mono, 2008. Réalisation : Pierre Carles et Martin. rencontrer. Entretiens : Xavier Naizet. Image : Éric Maizy. Son : Bertrand Bourdin, Fabien Briand, Marie- Parce qu’il avait la classe. Pierre Thomat. Montage : Pierre Carles (assistant : Ludovic Raynaud). Mixage : Cristinel Sirli. Le panache. L’esprit vif. Production : Muriel Merlin, 3B productions. Coproduction : Pages et Images, Yorame Merovach, Créative Sound. Avec le soutien de la Région Picardie et du Festival de la BD d’Angoulême. La grande gueule qui cogne. Distribution : Tadrart Films, 01 43 13 10 68. [email protected] Les autres étaient bien gentils www.choronderniere.com de dessiner et d’exprimer leurs idées, mais qui leur fournissait le papier ? C’était bien lui. Escroc, menteur, voleur, peut-être. Mais qui avait les Bête et méchant couilles d’être leur directeur de Charlie Hebdo appartient maintenant à l’histoire. Dans cinquante ans, on étudiera en cercles de sociologues ce phénomène qui sau- publication ? D’aller jusqu’aux va le journalisme de la fin du siècle. -
La Bande À Charlie
LA BANDEÀ CAVANNA CHORON REISER GEBÉ MÉCHAMMENT ROCK ISABELLE Photos 1-2-3-4-5-7-8-12, Roger-Viollet/ 6,Magnum/ 10-11,Giraudon CHARLIE FOURNIER DELFEIL DE TON WOLINSKI CABU PAULE WILLEM Du même auteur aux Éditions Stock Messieurs du Canard Jean Egen LA BANDE À STOCK Tous droits réservés pour tous pays © 1976, Éditions Stock « Oui, oui, je lis Charlie-Hebdo. Ce n'est pas exactement le style que je préfère, mais dans les textes de Cavanna - je dois lui ren- dre cette justice -, il y a, assez souvent, de bonnes, de saines réactions. » HUBERT BEUVE-MÉRY (interrogé par Jacques Chancel). « On peut certes trouver irritantes, insup- portables même, la verve célinienne, la har- gne universelle, la vulgarité outrageusement provocante de Charlie-Hebdo, qui mêle à plaisir la dérision, la scatologie et l'humour noir. On peut se demander si cette volonté de choquer pour se faire remarquer et cette manière de hurler pour se faire entendre sont bien dans la ligne du gauchisme version Mai 68 revue et adaptée pour 1974. « Mais, qu'il soit ou non pré-rétro, Charlie- Hebdo constitue en matière journalistique la création la plus originale, et peut-être la seule qu'on ait enregistrée depuis bien des années ; et cela pour la simple raison que ses anima- teurs ainsi que bon nombre de ses rédacteurs et dessinateurs possèdent incontestablement ce don rare, ce petit rien de plus qui se nomme le talent. » PIERRE VIANSSON-PONTÉ (Le Monde). « Charlie-Hebdo a apporté une nouvelle formule dans le journalisme moderne... Il a intégré, pour en faire une arme dont il se sert avec talent, le mauvais goût. -

La Caricature Et Le Dessin De Presse
#je dessine kit pédagogique La caricature et le dessin de presse Les dessinateurs de presse, à la fois artistes et journalistes, forgent des armes de concision et s’appuient sur une connivence avec le public. Les élèves peuvent avoir du mal à comprendre ce genre très codé. En France, la caricature est une tradition républicaine, protégée par la loi sur la liberté de la presse de 1881 et par la jurisprudence des tribunaux. LA CARICATURE ET LE DESSIN DE PRESSE Historique Le mot caricatura (de l’italien caricare : charger, exagérer) a été employé pour la première fois dans la préface d’un album d’Annibal Carrache en 1646. Il donnera les mots français « charge » et « caricature », ce dernier mot apparaissant pour la première fois dans les Mémoires de d’Argenson en 1740. Mais le traitement déformé de la physionomie s’inscrit dans la tradition de la satire visuelle et on en trouve des traces dans l’Antiquité égyptienne, grecque et romaine. Historiquement, en France, l’essor de la caricature politique a toujours correspondu à des périodes de crises sociales et politiques : mouvement de la Réforme, Révolution française, monarchie de Juillet, affaire Dreyfus. Au XIXe siècle, le développement de la presse et l’invention de la lithographie vont donner naissance à un grand nombre de journaux et, de 1901 à 1914, L’Assiette au Beurre, hebdoma- daire de seize pages en couleurs à tendance anarchiste, peut être considéré comme un ancêtre de publications issues des mouvements sociaux ou étudiants des années 1960 comme Hara-Kiri (1960) et Charlie Hebdo (1970). 1 1 : Honoré Daumier (1808-1879), Les Poires, caricature d’après un dessin original de Charles Philippon (1806-1862), La Caricature, janvier 1832, Paris, musée Carnavalet. -
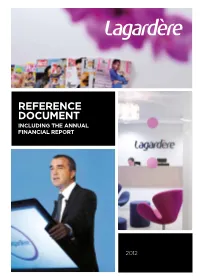
Reference Document Including the Annual Financial Report
REFERENCE DOCUMENT INCLUDING THE ANNUAL FINANCIAL REPORT 2012 PROFILE LAGARDÈRE, A WORLD-CLASS PURE-PLAY MEDIA GROUP LED BY ARNAUD LAGARDÈRE, OPERATES IN AROUND 30 COUNTRIES AND IS STRUCTURED AROUND FOUR DISTINCT, COMPLEMENTARY DIVISIONS: • Lagardère Publishing: Book and e-Publishing; • Lagardère Active: Press, Audiovisual (Radio, Television, Audiovisual Production), Digital and Advertising Sales Brokerage; • Lagardère Services: Travel Retail and Distribution; • Lagardère Unlimited: Sport Industry and Entertainment. EXE LOGO L'Identité / Le Logo Les cotes indiquées sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entrepreneurs. Ceux-ci devront soumettre leurs dessins Echelle: d’éxécution pour approbation avant réalisation. L’étude technique des travaux concernant les éléments porteurs concourant la stabilité ou la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux, devra être vérifié par un bureau d’étude qualifié. Agence d'architecture intérieure LAGARDERE - Concept C5 - O’CLOCK Optimisation Les entrepreneurs devront s’engager à executer les travaux selon les règles de l’art et dans le respect des règlementations en vigueur. Ce 15, rue Colbert 78000 Versailles Date : 13 01 2010 dessin est la propriété de : VERSIONS - 15, rue Colbert - 78000 Versailles. Ne peut être reproduit sans autorisation. tél : 01 30 97 03 03 fax : 01 30 97 03 00 e.mail : [email protected] PANTONE 382C PANTONE PANTONE 382C PANTONE Informer, Rassurer, Partager PROCESS BLACK C PROCESS BLACK C Les cotes indiquées sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entrepreneurs. Ceux-ci devront soumettre leurs dessins d’éxécution pour approbation avant réalisation. L’étude technique des travaux concernant les éléments porteurs concourant la stabilité ou la Echelle: Agence d'architecture intérieure solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux, devra être vérifié par un bureau d’étude qualifié. -

C'est Leur Vie, C'est Notre Histoire
© Benjamin Decoin c’est leurvie,notrehistoire 10 ANS DE PORTRAITS C’EST LEURS VISAGES, C’EST NOTRE HISTOIRE La collection documentaire « Un jour, un destin » fête son centième film cette saison. À partir du 3 septembre 2017, elle revient chaque dimanche en deuxième partie de soirée avec des films inédits qui explorent la face cachée de grandes personnalités. Archives rares, témoignages nouveaux... Vous découvrirez cette année, pour cette onzième saison, les destins hors du commun de Jean-Paul Belmondo, Vincent Lindon, Bernard Blier, Patrick Bruel, Patrick Poivre d’Arvor, ainsi qu’un portrait intime d’une légende du cinéma français, Alain Delon. Collection de documentaires inédits Sur une idée originale de Laurent Delahousse Proposé et présenté par Laurent Delahousse Rédacteurs en chef : Erwan L’Éléouet et Fabien Boucheseiche Directeur artistique : Serge Khalfon Produit par Magnéto Presse Unité documentaires et magazines culturels de France 2 : Catherine Alvaresse et Julie Grivaux 2 3 LES CHIFFRES Entre intervenants en moyenne par film, ce qui représente plus de 2 500 personnes interviewées et des milliers 25 et 30 d’heures de rushes portraits diffusés dans les collections « Un jour, un destin », « Un jour, 100 une histoire » et « 20 h 55 » films en moyenne 7 par collection de téléspectateurs regardent chaque année en 16,1 moyenne au moins un numéro millions d’Un jour un destin depuis 2007 (jusqu’à 20,3 millions en 2011). 4 5 10 ANS D’HISTOIRE : C’EST LEURS VISAGES, C’EST NOTRE HISTOIRE 6 7 Saison 1 (2007) Claude François : la vérité sur -

Le 11-Septembre Français
Vendredi 9 janvier 2015 71e année No 21766 2,20 € France métropolitaine www.lemonde.fr ― Fondateur : Hubert BeuveMéry LE 11-SEPTEMBRE FRANÇAIS ENQUÊTE ÉMOTION CARICATURES DÉBATS RÉCIT 100 000 personnes LA TRAQUE DEUIL NATIONAL ET L’HOMMAGE BHL, VILLEPIN : « ILS ONT TUÉ ont participé à des manifestations (ici à DES DEUX FRÈRES RASSEMBLEMENTS DES DESSINATEURS RÉSISTER À L’ESPRIT “CHARLIE HEBDO” » Toulouse, mercredi). ULRICH LEBEUF/MYOP DJIHADISTES SPONTANÉS DU MONDE ENTIER DE GUERRE POUR « LE MONDE » LE REGARD DE PLANTU sassiné lâchement des journalis teurs » qui osaient moquer leur tes, des dessinateurs, des em Prophète. L’équipe de Charlie ployés ainsi que des policiers Hebdo n’avait pas reculé, pas LIBRES, chargés de leur protection. cédé, pas cillé. Chaque semaine, Douze morts, exécutés au fusil armée de ses seuls crayons, elle DEBOUT, d’assaut, pour la plupart dans les continuait son combat pour la li ENSEMBLE locaux mêmes de ce journal libre berté de penser et de s’exprimer. et indépendant. Certains ne cachaient pas leur par gilles van kote Et, au milieu du carnage, victi peur, mais tous la surmontaient. mes de cette infamie, des collè Soldats de la liberté, de notre li gues, des camarades : Cabu, berté, ils en sont morts. Morts Charb, Honoré, Tignous, Wo pour des dessins. motion, sidération, mais linski, ainsi que l’économiste A travers eux, c’est bien la li aussi révolte et détermi Bernard Maris. Depuis des an berté d’expression – celle de la E nation : les mots peinent nées, des décennies, ils résis presse comme celle de tous les à exprimer l’ampleur de l’onde taient par la caricature, l’hu citoyens – qui était la cible des de choc qui traverse la France, au mour et l’insolence à tous les fa assassins. -

Val, Cabu, Carles, Wolinski, Cavanna, Choron: Bataille À OK Charlie, Épisode 2
L’information de RUE 89 a été reprise par : Val, Cabu, Carles, Wolinski, Cavanna, Choron: bataille à OK Charlie, épisode 2 Philippe Val, Cabu et Wolinski poursuivent le réalisateur Pierre Carles pour avoir utilisé leurs noms sur les affiches de son dernier film consacré au professeur Choron. L'affaire, sur fond de guerre d'héritage, sera jugée cet après-midi. Même mort, Choron fout encore la merde ! Philippe Val, Cabu et Georges Wolinski ont en effet décidé d'attaquer les producteurs de Choron Dernière, le film de Pierres Carles et Eric Martin (sortie le 7 janvier) qui retrace la vie du fameux professeur . Le directeur de Charlie Hebdo et les deux dessinateurs ont assigné les sociétés 3B et Tadrart Films, qui produisent le documentaire, pour « atteinte au droit au nom, à raison de l'utilisation illicite de leur nom dans le cadre de l'affiche du film Choron Dernière ». La présence des patronymes et pseudos de Val, Cabu et Wolinski sur l’affiche du film « induirait une confusion majeure sur leur participation spontanée au film » (auquel, faut-il le préciser, ils n'ont pas participé). « Tout le monde ne connaît pas les rivalités qui les opposent. Dans ce contexte, il faut un minimum d'honnêteté. Ils veulent simplement que leurs noms ne figurent pas sur l'affiche, c'est une façon de tromper le public » estime Richard Malka, l'avocat de Val, Cabu et Wolinski. Ils réclament chacun le versement de 4 000 euros et, solidairement, 1 500 euros ainsi qu'une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée. -

9782800414997.Pdf
Revendiquer le «mariage gay» Belgique, France, Espagne David Paternotte ISBN 978-2-8004-1499-7 © 2011 by Editions de l’Université de Bruxelles Avenue Paul Héger 26 1000 Bruxelles (Belgique) [email protected] http://www.editions-ulb.be Imprimé en Belgique Remerciements On dit souvent qu’écrire une thèse est un exercice solitaire. Il serait pourtant faux de croire qu’il est possible de mener cet exercice sans de nombreux réseaux de soutien, d’amitié, d’échange et de complicité. Cette dissertation doit beaucoup à Bérengère Marques-Pereira, qui a dirigé ces recherches. La relation d’amitié et de complicité tant intellectuelle que personnelle que nous avons construite au fil des années s’est avérée décisive pour le travail mené. Marc, son époux, doit également être remercié. Les membres du jury ont été très présents. Jane Jenson a été une « marraine » extraordinaire. Elle m’a accueilli au sein de la Chaire de recherche du Canada en citoyenneté et gouvernance au cours de l’année académique 2006-2007 et a suivi de près l’évolution de mes recherches. Nathalie Zaccaï-Reyners, présidente de mon comité d’accompagnement, a également suivi l’ensemble de ces travaux. Alors que ma thèse était a priori éloignée de ses objets de recherche, Eric Remacle n’a cessé d’être sincèrement curieux, convaincu que de tels sujets méritent une place en science politique. Enfin, la jovialité et la bonne humeur d’Andrea Rea ont souvent détendu l’atmosphère du 14e étage du bâtiment S. Sans toutes les personnes qui ont accepté de me rencontrer, de me revoir, d’ouvrir les portes de leur mémoire et celles de leurs archives, cette dissertation n’aurait pas pu exister. -

(T) Pres La Cour D'appel De Versailles Annee 2017
LISTE DES EXPERTS DE JUSTICE INTERPRETES (I) ET/OU TRADUCTEURS (T) PRES LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES ANNEE 2017 Cour d’appel de Versailles Albanais Bengalee Hindi Roumain / Moldave HARIZI Denada (I/T) HOSSAIN-COINTRE Farsina (I) SALHOTRA Mala (I/T) ALEXE Catherine née BALAN (I/T) 12, square François Rude - 92350 LE PLESSIS ROBINSON 60 route de Domont - 95460 EZANVILLE 1 rue Pierre Midrin - 92310 SEVRES 2, rue Boileau - Appartement 341 - 92140 CLAMART Tel: 01 46 30 24 48 Fax: 01 46 30 24 48 Port: 06 74 14 23 09 @: [email protected] Port : 06.62.17.08.41 @: [email protected] Tél: 01.74.62.30.51 Port : 06.68.93.81.32 @: [email protected] Tél: 01.46.30.97.18 Fax: 01.46.30.97.18 @: [email protected] KARANXHA Aida (I/T) BASU Chandan (I/T) ALEXE Gavril (I/T) 30 allée Irène Joliot Curie - 92160 ANTONY 23 rue Madame Curie - 92220 BAGNEUX 2, rue Boileau - Appartement 341 - 92140 CLAMART Port: 06 19 10 02 77 @: [email protected] Tél.: 01 46 65 36 87 Fax: 01 46 65 16 97 Port: 06 80 33 66 12@: [email protected] Hongrois Tél: 01.46.30.97.18 Fax: 01.46.30.97.18 Port: 06.60.95.86.64 @: [email protected] CASTELLAN Katalin (I/T) SHALA Argjent (I/T) HAQUE Shihab (I/T) BANU MEUNIER Viorica (I/T) 25, rue du Maréchal Foch - 78000 VERSAILLES 60 rue Edouard Vaillant - 95870 BEZONS 29 rue Mozart - 92110 CLICHY 2 rue Desmont Dupont - 92700 COLOMBES Tél: 01 30 84 99 46 Port: 06.43.33.14.85 @: [email protected] Port: 06 88 33 58 06 @: [email protected] Tél: 09.84.52.18.28 Port: 06 49 83 19 06 -

Jurnal Ilmu Budaya Gambar Sampul Charlie Hebdo
291 | JURNAL ILMU BUDAYA Volume 7, Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN: 2621-5101 P-ISSN:2354-7294 GAMBAR SAMPUL CHARLIE HEBDO SEBAGAI KRITIK TERHADAP FANATISME BERAGAMA Airin Miranda Program Studi Prancis, Universitas Indonesia, Indonesia [email protected] Abstract Charlie Hebdo is a satirical and leftist weekly newspaper in France. This weekly is known for its idealism as opposed to all forms of fanaticism. Since the attack that took place on January 7, 2015, Charlie Hebdo has become a topic of conversation for many. The attack that caused the deaths of 12 famous French caricaturists was easily attributed to Islamophobia and the idea of terrorism. This study analyzes some of Charlie Hebdo covers on the theme of Islam to show its point of view on the ideology and practice of the Islamic religion. Data collection is done online. With the critical discourse analysis, the signs found in Charlie Hebdo's cover image will be related to the context of the event surrounding its publication. The results will show whether the Islamic-themed caricature of some of Charlie Hebdo is a form of Islamophobia or a critique against fanaticism. The results of this study would provide a better understanding of French society, particularly its view of religious life in France. Keywords: Charlie Hebdo, caricatur, fanatisme, islamophobia, French media. PENDAHULUAN Dengan kata lain, tabloid ini tidak anti-Islam semata, namun semua tokoh, baik tokoh Charlie Hebdo adalah mingguan satir agama, politik, maupun selebriti akan diejek Prancis yang terkenal dengan sampul- tanpa pandang bulu. Menurut sebuah artikel sampul kontroversial dan provokatif yang dalam harian Le Monde, terbitan Charlie pertama kali terbit pada tahun 1970. -

GEORGES WOLINSKI (1934-2015) 57 Ouvrages Disponibles Publiés Depuis 1974
BIBLIOGRAPHIE GEORGES WOLINSKI (1934-2015) 57 ouvrages disponibles publiés depuis 1974 BIBLIOGRAPHIE ÉTABLIE PAR NICOLAS GRESLIN, avec Electre Biblio Clémence de Turqueim ; 155 p. : ill. ; 18 x 11 cm ISBN 978-2-84271- ISBN 978-2-226-06375-5 COLLABORATIONS les publicités. de reconnaissance pour l’amour illustrations Wolinski Hoëbeke, 2009 189 p. : ill. en noir et en coul. 327-0 que vous lui portez et les sacri - Br. 15,50 € ET PRÉFACES E874414 ; 31 x 24 cm ISBN 978-2-84230-361-7 Br. 8,95 € fices que vous avez consentis Quand une bourgeoise rencon - Rel. 27,50 € E432142 pour son éducation... Cause toujours ACTES SUD tre une autre bourgeoise, dans E541220 Seghers, 1991 Nouv. éd. 0 p. ; 20 x 15 cm Georges Wolinski un salon de thé, de quoi parlent- PHÉBUS ISBN 978-2-232-10352-0 Radiographie de la société fran - elles ? LE LIVRE DE POCHE Br. 13,50 € çaise à travers des discussions de BABEL Albin Michel, 2000 120 p. : ill. ; 24 x 16 cm Dégage ! : une révolution E824623 bistrot sur toutes sortes de sujets ISBN 978-2-226-10943-9 photograhies de Akram Belaid, : la politique, les femmes, le dés - Palace Cart. 12,75 € LE LIVRE DE POCHE Amine Boussoffara, Saif TEMPS DES CERISES ordre social, l’immigration, le Jean-Michel Ribes ; avec la E1049885 Chaabane ; textes de Colette prix du ballon de rouge... collaboration de Roland Topor, Coluche : l’intégrale des Fellous, Abdelwahab Meddeb, L’ange et l’espion : fables Albin Michel, 1997 160 p. : ill. ; 24 x 19 cm Georges Wolinski, Gébé et al. -

CHEZ COLUCHE HISTOIRE D’UN MEC INOUBLIABLE Illustrations © Philippe Lorin
CHEZ COLUCHE HISTOIRE D’UN MEC INOUBLIABLE Illustrations © Philippe Lorin Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction réservés pour tous pays. © 2016, Groupe Artège Éditions du Rocher 28, rue Comte Félix Gastaldi BP 521 - 98015 Monaco www.editionsdurocher.fr ISBN : 978-2-268-08472-5 ISBN epub : 978-2-268-08514-2 Ces pages ne sont pas disponibles à la pré- visualisation. Honorio Colucci De la rue des Plantes à la rue Didot, le bonheur de la mère de Coluche, jeune parturiente, et la disparition prématurée du paternel appartiennent à l’histoire de ce quartier qu’a chanté Georges Brassens (« Entre la rue Didot et la porte de Vanves »). L’avis de décès indique que Honorio Colucci est domicilié à Montrouge, 5 avenue Émile-Boutroux, et fait profession de calorifugeur. Selon une notice qui lui est consacrée dans le Dictionnaire Coluche, présenté par l’acteur Henri Guybet, un ancien membre du Café de la Gare, il a été également sculpteur sur marbre funéraire et aurait vécu de petites combines4. Monette, veuve à 27 ans, ne s’est jamais remariée. Ses deux enfants seront le centre de son maigre univers. Ils sont logés à l’étroit, avenue Émile-Boutroux, au premier étage d’un immeuble de briques rouges, au-dessus d’une épicerie, à proximité de la mairie et du beffroi. Décédée à Montrouge le 15 février 1994, à l’âge de 74 ans, elle finira ses jours dans un confortable appartement que lui avait acheté son fils, 20 rue du Stade-Buffalo. Il dépend d’une vaste résidence arborée construite par Fernand Pouillon à la fin des années cinquante.