Complexe De La Romaine
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Prof Hanif Kara
•• Professor in Practice of Architectural Technology at Harvard GSD •• Member of Harvard GSD Faculty Board for Executive Education Division •• Visiting Professor of Architectural Technology at KTH Stockholm (2008 – 2012) •• First structural engineer to be appointed as CABE Commissioner (2008 – 2012) •• One of fifteen members of the ‘Design for London’ Advisory Group to the Mayor of London (2007 – 2008) •• Member of the Architecture Foundation’s Board of Trustees •• Member of 2011 RIBA Stirling Awards Jury •• External examiner for the Architectural Association •• Awarded the ACE Engineering Ambassador of the Year 2011 •• Member of Design Council CABE, London Design Panel 2012 •• Member of Aga Khan Award for Architecture Master Jury 2004 and Steering Committee 2015 •• Member of the New London Sounding Board •• Review Panel - Swiss National Science Foundation, NCCR Digital Fabrication Prof Hanif Kara BSc (Hons) CEng FIStructE FICE FREng Hon FRIBA FRSA Co-founder and director of AKT II Hanif Kara is a principal and co-founder of London-based structural engineering practice AKT II, as well as an educator. Under his leadership the practice has, in the last decade, gained an international standing in the field of the built environment. Since forming AKT II (originally as His contribution to the industry has board of trustees for the Architecture Adams Kara Taylor) in 1996, he has been been recognised by professional bodies, Foundation. responsible for a number of innovative where he is a fellow member of the Royal In the global context, the Aga Khan and pioneering projects but also for Academy of Engineering, the Institute Award for Architecture is recognised as raising the profile of ‘design’, both in of Civil Engineers and the Institute of one of the most important awards in the the construction industry and the wider Structural Engineers. -

Waste Rock and Water Management at the Tio Mine Summary of the Project Description
Waste Rock and Water Management at the Tio Mine Summary of the Project Description Rio Tinto Fer et Titane WSP Canada Inc. Adress line 1 Adress line 2 Adress line 3 www.wspgroup.com WSP Canada Inc. 300-3450, boul. Gene-H.-Kruger Trois-Rivières (Qc) G9A 4M3 Tél. : 819 375-1292 www.wspgroup.com Waste Rock and Water Management at the Tio Mine Summary of the Project Description Final Version Approved by: Numéro de projet : 111-20171-02 J U N E 2 01 4 3450, boulevard Gene-H.-Kruger, bureau 300 ~ Trois-Rivières (Québec) CANADA G9A 4M3 Tél. : 819 375-8550 ~ Téléc. : 819 375-1217 ~ www.wspgroup.com Reference to be cited: WSP. 2014. Waste Rock and Water Management at the Tio Mine. Summary of the Project Description. Report produced for Rio Tinto Fer et Titane. 25 p. SUMMARY 1 GENERAL INFORMATION Rio Tinto Fer et Titane inc. (hereinafter “RTFT”) has operated, since 1989, the Havre-Saint-Pierre mine, consisting of a hemo-ilmenite deposit, at its Lake Tio mining property, located 43 km north of Havre-Saint-Pierre (see Figure 1). However, the mine has been in operation since 1950. The most recent data from the mining plan provides for the site to be in operation beyond 2050. According to this plan, the total amount of waste rock which will be generated exceeds the storage capacity available under the current mining leases, which will be reached by the end of 2017. RTFT would therefore like to obtain new land lease agreements for the disposal of waste rock to be generated until the end of the mine’s life. -

C S a S S C C S
C S A S S C C S Canadian Science Advisory Secretariat Secrétariat canadien de consultation scientifique Research Document 2005/051 Document de recherche 2005/051 Not to be cited without Ne pas citer sans permission of the authors * autorisation des auteurs * A Comprehensive Framework for Un protocole d'évaluation des Assessing Changes in Fish Habitat changements de capacité de Productive Capacity Resulting From production de l'habitat du poisson Large Hydroelectric Projects lors de grands projets hydroélectriques Michel Bérubé, Richard Verdon, Gabriel Durocher, Jean-Christophe Guay Hydro-Québec Équipement Direction développement de projet et environnement 855 Sainte-Catherine est, 9ième étage Montréal, Québec H2L 4P5 * This series documents the scientific basis for the * La présente série documente les bases evaluation of fisheries resources in Canada. As scientifiques des évaluations des ressources such, it addresses the issues of the day in the halieutiques du Canada. Elle traite des time frames required and the documents it problèmes courants selon les échéanciers contains are not intended as definitive statements dictés. Les documents qu’elle contient ne on the subjects addressed but rather as progress doivent pas être considérés comme des énoncés reports on ongoing investigations. définitifs sur les sujets traités, mais plutôt comme des rapports d’étape sur les études en cours. Research documents are produced in the official Les documents de recherche sont publiés dans language in which they are provided to the la langue officielle utilisée dans le manuscrit Secretariat. envoyé au Secrétariat. This document is available on the Internet at: Ce document est disponible sur l’Internet à: http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas/ ISSN 1499-3848 (Printed / Imprimé) © Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2005 © Sa majesté la Reine, Chef du Canada, 2005 ABSTRACT The Policy for the management of fish habitat and its No net Loss of habitat productive capacity by the Department of Fisheries and Oceans (DFO) represents a challenge for the hydroelectric industry in general. -

Additional Notes on the Birds of Labrador
THE AUK: A QUARTERLY JOURNAL OF ORNITHOLOGY. VoL. xxw. JANJARY, 1910. NO. 1. ADDITIONAL NOTES ON THE BIRDS OF LABRADOR. ! BY CHARLES W. TOWNSEND• M. I)., AND A. C. BENT. Plates I-III. THE followingnotes are intendedto supplementthe 'Birds of Labrador'2 publishedin 1907. They are the resultof an ornitho- logicalexcursion to the southernLabrador coast in the springof 1909. The itinerary was as follows: Leaving Quebec on the mail steamshipon May 21, 1909, we reachedthe beginningof the LabradorPeninsula on May 23, some345 milesfrom Quebecand 30 miles to the west of SevenIslands. This point is where the 50th parallel strikesthe coastin the Gulf of St. Lawrence. From here, stoppingat a few places,we skirtedthe coastas far as Esqui- lnaux Point, wherewe left the steameron May 24. The next day we startedin a smallsail boat and cruisedfor •t weekalong the coast and ainongthe islandsto the eastwardas far as Natashquan, about85 milesfrom EsquimauxPoint and some255 milesfrom the westernmostpoint on the coastot' the LabradorPeninsula. On thistrip we landedand exploredat Betchewun,Isles des Cornellies, Piashte-bai where we ascended the river five or six miles to the falls, Great Piashte-bai,Quatachoo and Watcheeshoo. We spent two days at Natashquanand returncdby steameron the night • Read before the Nuttall Ornithological Club, November 1, 1909. • Birds of Labrador. By Charles W. Townsend, M.D. and Glover M. Allen. Proc. Boston Soc. Nat. Hist., Vol. 33, No. 7, pp. 277-428, pl. 29. Boston, July, 1907. See also Townsend, Labrador Notes, Auk, Vol. XXVI, p. 201, 1909. 1 THE AUK, VOL. XXVII. PLATE ISLANDSAT WATCHESHOD,LABRADOR. NESTINGSITES FOR GREAT BLACK-BACKED GULLS AND EH)EHS. -
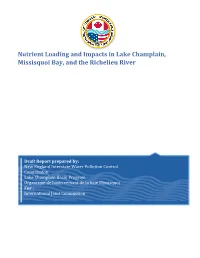
Nutrient Loading and Impacts in Lake Champlain, Missisquoi Bay, and the Richelieu River
Nutrient Loading and Impacts in Lake Champlain, Missisquoi Bay, and the Richelieu River Draft Report prepared by: New England Interstate Water Pollution Control Commission Lake Champlain Basin Program Organisme de basin versant de la baie Missisquoi For : International Joint Commission Table of Contents Executive Summary 1 1 Introduction 2 1.1 Background, Purpose, and Scope 2 1.2 Prior IJC Work in the Lake Champlain Basin 3 1.2.1 Causeway Removal Water Quality Study 3 1.2.2 Identification of Critical Source Areas 4 1.2.3 Lake Champlain-Richelieu River Flood Mitigation Studies 4 1.3 Study Areas 5 1.3.1 Lake Champlain 5 1.3.2 Richelieu River 6 1.3.3 Missisquoi Bay 6 1.4 Literature Review and Quality Assurance 9 2 Key Nutrient Loading and Cyanobacteria Issues 9 2.1 Overview of Nutrient Loading and Cyanobacteria Issues in Lake Champlain and Missisquoi Bay 9 2.2 Detailed Analyses of Missisquoi Bay and Its Sub-Basin 12 2.2.1 Hydrodynamics 14 2.2.2 Nutrient Enrichment 14 Dynamics, Sources, and Causes 14 2.2.3 Cyanobacteria Blooms 19 Cyanobacteria & Cyanotoxins 19 Sources and Causes 22 2.2.4 Health Risks and Recreational Impacts 23 2.2.5 Economic Impacts 25 3 Overview of Potential In-Lake Restoration Measures and Technologies 26 3.1 International Overview of Restoration Efforts and Results 26 3.1.1 Canada 26 3.1.2 U.S. 27 Commonly Used In-Lake Restoration Techniques 27 Regional Lake Restoration Efforts 28 3.2 Effectiveness Results and Analysis, Estimated Cost-Benefit, and Adaptability to Missisquoi Bay 35 4 Programs and Policies Influencing Key -

Compensation Policy Issue
United Nations Environment Programme Dams and Development Project Compendium on Relevant Practices - 2nd Stage Compensation Policy Issue Monetary compensation for lost assets and loss of access to resources Livelihood restoration and enhancement Community development Catchment development Final Report Prepared by: Mr. Vincent ROQUET, Sociologist and Planner, Lead Consultant with Ms. Carine DUROCHER, Anthropologist Vincent Roquet & Associates Inc. 560 Sainte-Croix Avenue, suite 101, Montreal (Quebec) Canada, H4L 3X5 Tel: +1 (514) 849-3030; Fax: +1 (514) 849-3322 Email: [email protected] September 15th, 2006 Table of Contents Page EXECUTIVE SUMMARY....................................................................................................................... vi 1 – INTRODUCTION ................................................................................................................................ 1 1.1 Context........................................................................................................................................ 1 1.2 Study Objective........................................................................................................................... 1 1.3 Study Process.............................................................................................................................. 2 1.4 Contents of Final Report............................................................................................................. 2 2 – METHODOLOGY.............................................................................................................................. -

Discipline Decision 18-013
THE DISCIPLINE FILE Date: December 17, 2018 Case No.: 18-013 RDO IN THE MATTER OF THE ENGINEERING AND GEOSCIENCE PROFESSIONS ACT, AND IN THE MATTER OF THE CONDUCT OF NORMAND N. FALLU, P.ENG. The Investigative Committee of the Association of Profes- the relevant time of the collusion scheme (2005- sional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGA) 2010). has conducted an investigation into the conduct of Nor- 3. The Member voluntarily cancelled his membership mand N. Fallu, P.Eng. (“the Member”). with the OIQ on April 1, 2013, upon his transfer by The investigation was conducted with respect to a Dessau to Calgary, Alberta. complaint initiated by the Deputy Registrar and Chief Reg- 4. The Member became a Professional Member of ulatory Officer (CRO) of APEGA, Matthew Oliver, P.Eng., APEGA on April 9, 2013. (“the Complainant”) on February 22, 2018. The complaint related to a disciplinary proceeding initiated against the 5. In May 2013 the Member was terminated by Member by the Ordre des ingeniéurs du Québec (OIQ). Dessau after he was identified as a person of interest in the Charbonneau Commission. The A. BACKGROUND Charbonneau Commission, which commenced in 2011, was established by the Government of The Complainant filed a complaint against the Member Quebec to investigate corruption in the granting and alleging the Member had participated in a contract management of public contracts in the construction collusion scheme and obstructed the OIQ investigation. industry. B. THE COMPLAINT 6. In the fall of 2013 the Member was hired by Stantec in Alberta. The Complainant referred the matter to APEGA's 7. -

A Major Effort to Harmoniza Communities
30th Annual Meeting – IAIA – April 2010 Environmental Impact Assessment Studies at Hydro-Québec: A Major Effort to Harmonize Communities’ Energy, Economic and Social Development Louise Emond Background By their very nature, environmental impact assessments prompt us to pay a great deal of attention to the impacts of building and operating new power generation facilities. Given the basic concern for applying caution and due care, these assessments tend to look at the ―worst-case scenario‖ in order to induce the proponent to plan appropriate mitigation measures. While they may shed light on the negative effects associated with projects, assessments underplay the extensive work devoted to ensuring that projects are harmoniously integrated into the environment. Here, I would like to focus on the procedures in use at Hydro-Québec and present a review of the methods we favor to help foster the transition to a greener economy and accentuate the positive environmental effects of hydropower development. This will be an opportunity to show an often overlooked aspect of environmental impact assessments: namely, the considerable efforts made to inform the communities affected by our projects, and to implement mitigation measures designed to limit their impacts and maximize their beneficial effects. My demonstration will be based on a recent undertaking, the hydropower complex now being built on the Romaine River. This project is the largest of the current decade in Québec, and the largest infrastructure project in Canada. The impact assessment for the Romaine complex is an in-depth evaluation that runs to 10 volumes totaling nearly 2,500 pages. This assessment is backed by about 60 component studies in over 20 fields of expertise, carried out between 2004 and 2008. -

Geological Report, the Peninsula Titanium Property Geological Report
GM 65652 GEOLOGICAL REPORT, THE PENINSULA TITANIUM PROPERTY GEOLOGICAL REPORT The Peninsula Titanium Property Duplessis County, Puyjalon Township, Quebec NTS sheets 12L06 and 12L11 CANAMARA ERNERGY CORPORATION September 30, 2010 Ressources naturelles et Faune, Québec 3,1 MAI 2011 AU 6\151M1 Service de la Géoinformation REÇU 0 8 MAR. 2011 GM 65 652 Direction du développement minéral Michel Boily, PhD., P. Géo. 1091285 TABLE OF CONTENTS ii SUMMARY iv 1- PROPERTY DESCRIPTION AND LOCATION 1 2-ACCESSIBILITY, CLIMATE, LOCAL RESOURCES, INFRASTRUCTURE AND PHYSIOGRAPHY 2 3- GEOLOGICAL SETTING 4 3.1- Regional Geological Setting 4 3.2-The lac St-Jean Domain 7 3.3-The Havre St-Pierre Anorthosite Suite (HSPAS) 9 3.4-The Allard-Puyjalon Lake Area 12 4- THE PENINSULA TITANIUM PROPSECT 12 4.1-Introduction 12 4.2-History of the Peninsula Property 14 4.3- Geology and Ti-Mineralization 14 5-DEPOSIT TYPE 19 6-GENESIS OF Fe-Ti DEPOSIT ASSOCIATED WITH ANORTHOSITE COMPLEXES 19 7-THE LAKE TiO ILMENITE DEPOSIT 20 8-CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 21 8.1-Budget Breakdown 24 9-REFERENCES 26 10- DATE AND SIGNATURE 29 ii LIST OF FIGURES Figure 1. Localization and bondaries of the designated claims of the Peninsula property. 3 Figure 2. Geological map of the Quebec province illustrating the different geological provinces and subprovinces and the localization of the Peninsula property. 5 Figure 3. Geology of the Grenville Province of Québec showing the location of the Peninsula property. 6 Figure 4. Simplified geological map of lithotectonic domains, stratigraphic units, principal structural elements and anorthositic massifs of the Lower North Shore area. -

A-5 Pierreboucherhospital.Pdf
Section 1 Project Highlights HVAC for new Ambulatory Care Centre at Pierre‐Boucher Hospital Dessau was mandated to design new HVAC systems (heating, ventilation, and air conditioning) for a vital rehabilitation and expansion project at the Pierre‐Boucher Hospital, which is the largest health care facility on Montreal’s South Shore. The project involved a 100,000 ft2 expansion and a 90,000 ft2 rehabilitation of the existing hospital. Aside from designing integrated HVAC systems in a sensitive occupied environment, Dessau’s challenge was to significantly reduce the hospital’s energy consumption. Originality and Innovation Dessau’s designers knew that they needed to undertake a creative integrated design approach since hospitals are one of the heaviest energy consumers among Canadian buildings. One reason for their high energy consumption is the significant rate of outside air, ventilation and filtration that they require to ensure air quality and comfort in accordance with applicable codes and standards. Another reason is their use of medical equipment and high‐density lighting systems that require a lot of energy and increase cooling loads. Simulation models for a number of proposed design options were prepared using EE4 and DOE2.1e simulation software. This specialized software takes into account weather data, building envelope parameters and complex building HVAC system interactions that are almost impossible to estimate by way of traditional methods. By analyzing the building’s behaviour on an hourly basis, designers were able to determine the most energy‐efficient and cost‐effective HVAC system. These simulation models helped the designers interweave a combination of original technologies so efficient that no new heating equipment was necessary despite the 100,000 ft2 expansion of the hospital. -

Romaine Hydroelectric Complex Project
Bureau Joint d’audiences Review Panel publiques sur l’environnement Report 256 Romaine Hydroelectric Complex Project Investigation and Public Hearing Report February 2009 The concept of the environment The commissions of the Bureau d’audiences publiques sur l’environnement examine the projects submitted to them from a sustainable development perspective, applying the concept of the environment used by higher courts, a concept that encompasses biophysical, social, economic and cultural aspects. Acknowledgments The Joint Review Panel thanks the individuals and organizations that contributed to its work, and the staff at the Bureau d’audiences publiques sur l’environnement and the Canadian Environmental Assessment Agency who provided the necessary support for the production of this report. Publication and Distribution Bureau d’audiences publiques sur l’environnement Édifice Lomer-Gouin Telephone: 418-643-7447 575 Saint-Amable, Office 2.10 (Toll-free): 1-800-463-4732 Quebec City, Quebec G1R 6A6 Web site: www.bape.gouv.qc.ca E-mail: [email protected] Canadian Environmental Assessment Agency Place Bell Canada Telephone: 613-957-0700 160 Elgin Street, 22nd Floor Facsimile: 613-957-0941 Ottawa, Ontario K1A 0H3 Web site: www.ceaa-acee.gc.ca E-mail: [email protected] Documentation concerning the Joint Review Panel’s work may be obtained from the Bureau d’audiences publiques sur l’environnement and the Canadian Environmental Assessment Agency. Legal Deposit – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2009 ISBN 978-2-550-55298-7 (printed version) ISBN 978-2-550-55299-4 (PDF) 2 February 27, 2009 Line Beauchamp Minister of Sustainable Development, Environment and Parks Édifice Marie-Guyart, 30th Floor 675 René Lévesque Blvd East Quebec City, Quebec G1R 5V7 Minister: It is with great pleasure that I submit the report on Hydro-Québec’s proposed project to develop a hydroelectric complex on the Romaine River by the Bureau d’audiences publiques sur l’environnement. -

Economic Evaluation of the Potential Impacts of the Erosion of Quebec's
Economic evaluation of the potential impacts of the erosion of Quebec’s maritime coasts in a context of climate change Research report submitted to Ouranos Under the direction of Pascal Bernatchez, Ph.D. May 2015 PRODUCTION TEAM Management and research Pascal Bernatchez, Ph. D. Coastal geomorphology and remote sensing Project manager Professor and Chairholder, Research Chair in Coastal Geoscience Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières (LDGIZC) (coastal zone dynamics and integrated management laboratory) Biology, chemistry and geography department Université du Québec à Rimouski (UQAR) Email: [email protected] Research team Steeve Dugas, B.Sc., Research Professional, LDGIZC, UQAR Data processing and analysis, geomatics, writing Christian Fraser, M.Sc., Research Professional, LDGIZC, UQAR Data analysis, writing Laurent Da Silva, M. Sc., Economist, Ouranos Economic research, processing and analysis and writing Maude Corriveau, M.Sc., Research Professional, LDGIZC, UQAR Data processing and validation Nicolas Marion, B.Sc. student, UQAR Data processing (transfer of assessment roll parcels) Mia Charette, B.Sc. student, UQAR Data processing (Transfer of assessment roll parcels) Tessa Parisé, B.Sc. student, UQAR Data processing (Transfer of assessment roll parcels) Caroline Côté, Master’s degree (DESS) student, UQAR Data processing (Transfer of parcels identifying railways) Collaborators François Morneau, M. Sc., Scientific Coordinator, Ouranos Manon Circé, M. A., Senior Economist, Ouranos Xavier Mercier, M. Sc., Economist, Ouranos Claude Desjarlais, M. Sc., Senior Economist, Consultant, Ouranos Ursule Boyer-Villemaire, M. Sc., Oceanographer, Consultant, Ouranos Susan Drejza, M. Sc., Research Professional, LDGIZC, UQAR Complete reference Bernatchez, P., Dugas, S., Fraser, C. and Da Silva, L. (2015). Economic evaluation of the potential impacts of the erosion of Quebec’s maritime coast in a context of climate change.