La Securite Dans Les Transports a Madagascar
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

TDR Annexe7 Rapport Analyse 322 Communes OATF
ETAT DES LIEUX DES 319 COMMUNES POUR LE FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET CASEF Février 2019 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES .................................................................................................................... i LISTE DES ACRONYMES ................................................................................................................ iii Liste des tableaux ......................................................................................................................... v Listes des Cartes ........................................................................................................................... v Liste des figures ............................................................................................................................vi Liste des photos ...........................................................................................................................vi I INTRODUCTION ....................................................................................................................... 1 II METHODOLOGIES .................................................................................................................... 2 II.1 CHOIX DES 322 COMMUNES OBJETS D’ENQUETE ............................................................... 2 II.2 CHOIX DES CRITERES DE SELECTION DES COMMUNES ........................................................ 5 II.3 METHODOLOGIE DE COLLECTE DE DONNEES ET ACTIVITES ................................................. 6 -

Liste Candidatures Maires Itasy
NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS ARIVONIMAMO ALAKAMISIKELY 1 PATRAM (Parti Travailliste Malagasy) RAKOTONIAINA Rivosoa ARIVONIMAMO ALAKAMISIKELY 1 MMM (Malagasy Miara Miainga) RAKOTOMALALA Rémi ARIVONIMAMO ALAKAMISIKELY 1 IRD (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RAJAONARISON ARIVONIMAMO ALAKAMISIKELY 1 FIVOI (Fiovana Ivoaran'ny Eny Ifotony) RAKOTONIAINA Joseph ARIVONIMAMO AMBATOMANGA 1 FIVOI (Fiovana Ivoaran'ny Eny Ifotony) RATSIMIALOSON Dieu Donné GROUPEMENT DE P.P IRD (Isika Rehetra Miaraka @ ARIVONIMAMO AMBATOMANGA 1 RAVELOJAONA Florent Andry Rajoelina) ARIVONIMAMO AMBATOMANGA 1 TIM (Tiako I Madagasikara) RAHOELISON Zanapanahy ARIVONIMAMO AMBATOMIRAHAVAVY 1 RAKOTOVOLOLONA JEAN MARIE (Independant) RAKOTOVOLOLONA Jean Marie ARIVONIMAMO AMBATOMIRAHAVAVY 1 TIM (Tiako I Madagasikara) RAZAFINDRAKOTO Jean Davida Soa ARIVONIMAMO AMBATOMIRAHAVAVY 1 RAJAONARIVONY SAMUEL (Independant) RAJAONARIVONY Samuel ARIVONIMAMO AMBATOMIRAHAVAVY 1 RASOLONJATOVO LANTOTAHIRY (Independant) RASOLONJATOVO Lantotahiry ARIVONIMAMO AMBOANANA 1 IRD (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RANDRIANJANAHARY Radosoa Stephanie ARIVONIMAMO AMBOHIMANDRY 1 TIM (Tiako I Madagasikara) RABETOKOTANY Jeanson ARIVONIMAMO AMBOHIMANDRY 1 MMM (Malagasy Miara Miainga) RAZAFY Lalao Alexandre ARIVONIMAMO AMBOHIMANDRY 1 IRD (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RANDRIANARISON Alfred ANDRIANANJANAHARY KIADY VOAHARY MISAINA ARIVONIMAMO AMBOHIMASINA 1 ANDRIANANJANAHARY Kiady Voahary Misaina (Independant) ARIVONIMAMO AMBOHIMASINA 1 TIM (Tiako -

Résultats Détaillés Antananarivo
RESULTATS SENATORIALES DU 29/12/2015 FARITANY: 1 ANTANANARIVO BV reçus: 313 sur 313 GASIKA MARINA HVM MAPAR MMM NY AREMA ASSOCI TIM RA MANGA ATION MAINTS RANO MALAG N°BV Emplacement AP AT Inscrits Votants B N S E O MALAZA ASY SAMBA REGION 11 ANALAMANGA BV reçus 140 sur 140 DISTRICT: 1101 AMBOHIDRATRIMO BV reçus24 sur 24 01 AMBATO 0 0 8 7 0 7 0 3 4 0 0 0 0 0 0 02 AMBATOLAMPY 0 0 8 8 0 8 0 1 4 1 0 0 0 0 2 03 AMBOHIDRATRIMO 0 0 10 10 0 10 0 1 8 0 0 0 0 0 1 04 AMBOHIMANJAKA 0 0 6 6 0 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 05 AMBOHIMPIHAONANA 0 0 6 6 0 6 0 0 3 0 0 0 0 1 2 06 AMBOHITRIMANJAKA 0 0 8 8 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 2 07 AMPANGABE 0 0 8 7 0 7 0 1 6 0 0 0 0 0 0 08 AMPANOTOKANA 0 0 8 8 0 8 0 4 2 0 1 0 0 0 1 09 ANJANADORIA 0 0 6 6 0 6 0 0 5 0 0 0 0 0 1 10 ANOSIALA 0 0 8 8 0 8 0 2 2 1 0 0 0 0 3 11 ANTANETIBE MAHAZA 0 0 8 8 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 2 12 ANTEHIROKA 0 0 8 6 0 6 0 0 5 0 0 0 0 0 1 13 ANTSAHAFILO 0 0 6 6 0 6 0 3 2 0 0 0 0 0 1 14 AVARATSENA 0 0 6 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 FIADANANA 0 0 6 6 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 3 16 IARINARIVO 0 0 6 6 0 6 0 2 3 0 0 0 0 0 1 17 IVATO 0 0 8 8 0 8 0 1 4 2 0 0 0 0 1 18 MAHABO 0 0 6 6 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 2 19 MAHEREZA 0 0 6 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 MAHITSY 0 0 8 8 0 8 0 4 3 0 0 0 0 0 1 21 MANANJARA 0 0 6 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 22 MANJAKAVARADRAN 0 0 6 6 0 6 0 1 2 1 0 0 0 1 1 23 MERIMANDROSO 0 0 8 8 0 8 0 2 5 0 1 0 0 0 0 24 TALATAMATY 0 0 8 8 0 8 0 0 3 2 0 0 0 0 3 TOTAL DISTRICT 0 0 172 165 0 165 0 28 98 7 2 0 0 2 28 DISTRICT: 1102 ANDRAMASINA BV reçus14 sur 14 01 ALAROBIA VATOSOLA 0 0 8 8 0 8 0 2 6 0 0 0 0 0 0 02 ALATSINAINY -

“Paraky Gasy” Dans La Commune Rurale De Talata-Dondona, District De Soavinandriana, Région Itasy
La prépondérance de la culture commerciale des tabacs Marylands dit “Paraky gasy” dans la Commune Rurale de Talata-Dondona, District de Soavinandriana, Région Itasy RANAIVOARIMALALA Andriamamihery Tantely Doctorant : Mention Géographie, Université d’Antananarivo (Contact : 033 71 162 72 / Mail : [email protected]) « La prépondérance de la culture commerciale des tabacs Marylands dit “Paraky gasy” dans la Commune Rurale de Talata-Dondona, District de Soavinandriana, Région Itasy ». 1 La prépondérance de la culture commerciale des tabacs Marylands dit “Paraky gasy” dans la Commune Rurale de Talata-Dondona, District de Soavinandriana, Région Itasy RÉSUME La Commune rurale de Talata- claires suivant une procédure légale (poids Dondona se trouve dans la région des des produits, paiement, signature, etc.), Hautes Terres Centrales de Madagascar. avec le soutien et l’aide de l’Etat. Par Elle fait partie d’un secteur rural à contre, les tabac marylands des paysans polyculture traditionnelle qui caractérise en sont interdits par la loi. général le milieu rural malgache. Mots clés : Talata-Dondona, agriculture traditionnelle, tabac maryland, culture L’intérêt de ce travail réside surtout dans marchande, culture des tabacs, filière l’interprétation géographique de tabac, économie monétaire, développement local. l’originalité et la spécificité de la pratique paysanne à Talata-Dondona marquée par le ABSTRACT poids prépondérant de culture des tabacs. The Rural Commune of Talata-Dondona is Elle constitue un avantage comparatif qui located in the Central Highlands of procure une source de revenu substantielle Madagascar. It is part of a traditional pour les paysans producteurs à cause de polyculture rural sector that typically characterizes the rural Madagascar. -
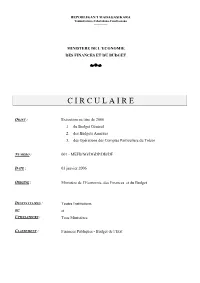
C I R C U L a I R E
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana --------------- MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET [@\ C I R C U L A I R E OBJET : Exécution au titre de 2006 1. du Budget Général 2. des Budgets Annexes 3. des Opérations des Comptes Particuliers du Trésor NUMERO : 001 - MEFB/SG/DGDP/DB/DF DATE : 03 janvier 2006 ORIGINE : Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget DESTINATAIRES : Toutes Institutions OU et UTILISATEURS : Tous Ministères CLASSEMENT : Finances Publiques - Budget de l’Etat SOMMAIRE INTRODUCTION .......................................................................................................................................................................................4 I) LES NOTIONS FONDAMENTALES ...................................................................................................................................................5 A – GESTION DES CREDITS......................................................................................................................................6 1.1 - LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE.......................................................................................................................................................6 1.1.1 - Partie ligne budgétaire ............................................................................................................................................................6 1.1.2 - Partie ordonnateur ..................................................................................................................................................................7 -

1303 Soavinandriana
dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 130301010101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP TSINJOVARY dfggfdgffhCommune: AMBATOASANA CENTRE dfggfdgffhDistrict: SOAVINANDRIANA dfggfdgffhRegion: ITASY dfggfdgffhProvince: ANTANANARIVO Inscrits : 464 Votants: 260 Blancs et Nuls: 4 Soit: 1,54% Suffrages exprimes: 256 Soit: 98,46% Taux de participation: 56,03% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 34 13,28% 25 RAVALOMANANA Marc 222 86,72% Total voix: 256 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 130301020101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMPARARANO S1 dfggfdgffhCommune: AMBATOASANA CENTRE dfggfdgffhDistrict: SOAVINANDRIANA dfggfdgffhRegion: ITASY dfggfdgffhProvince: ANTANANARIVO Inscrits : 328 Votants: 185 Blancs et Nuls: 1 Soit: 0,54% Suffrages exprimes: 184 Soit: 99,46% Taux de participation: 56,40% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 44 23,91% 25 RAVALOMANANA Marc 140 76,09% Total voix: 184 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I -

E136510paper.Pdf
E1 365 REPUBLIQUE DE MADAGASCAR Public Disclosure Authorized MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE Public Disclosure Authorized PROJET BASSINS VERSANTS PERIMETRES IRRIGUES PLAN DE GESTION DESTPEST SESI'- PESTICI ~S. ,.- « ~~-,' e4 ' <-- »w$;t -J@'|ôE;+1lO Public Disclosure Authorized . , , .1. | 1. ~ .t ~ ~ ~lw ~ ~ v v Rapport préliminaire Consultant: Djibril Doucouré /GES Conseil Public Disclosure Authorized Docteur es Sciences Environnement et Santé ddouc(ivrefer.sn. [email protected] Mars 2006 SOMMAIRE 4 RESUME EXECUTIF ..................................................................... EXECUTIVE SUMMARY ..................................................................... 5 6 INTRODUCTION ..... ................................................................ 1- PRESENTATION ..................................................................... 9 9 1-1 PRESENTATION SOMMAIRE PAYS ...................................................................... 13 1-2 METHODOLOGIE D'ELABORATION DU PLAN ..................................................................... Il CADRE POLITIQUE, REGLEMENTAIRE ET CAPACITE INSTITUTIONNELLE ................................................. 14 14 2-1 POLITIQUE DE GESTION DES PESTES ET D'UTILISATION DES PESTICIDES ...................................................... ............... 16 2-2 LE CADRE REGLEMENTAIRE SUR LES PESTES ET PESTICIDES ..................................................................... 2-2-1 Présentation.................................................................... -

Transport Safety in Madagascar
International Forum for Rural Transport and Development (IFRTD) TRANSPORT SAFETY IN MADAGASCAR Assessing Major Transport Safety Problems in the rural areas of the High Plateaux of Madagascar Case Study: Soavinandriana 1. General context (Executive summary) The mobility of a population can be seen as both a factor and an indicator of development. The easier people of a given region or commune move around, the easier they pick up public service jobs especially contracts, the more they feel the drive to work and educate themselves and the better their health situation. Consequently, any obstacle to population mobility particularly in the rural areas where there exist very few opportunities could retard the development of that region. This study focuses on a vital aspect of the movement of goods and people which is transport safety. Poor safety and the very high risk involved in moving from one place to another are a serious deterrent to people who intend to move around. There are two major forms of risk: accidents and attacks. 2. Introduction Madagascar has long been among the ten poorest countries in the world. During the past few years and thanks to enormous efforts, the country has gradually been working its way out of the poverty zone and is now close to the third position. With a surface area of 590,000 km2, the “Great Island” has a population of about 16 million inhabitants with only 10000 kilometres of roads and paths that are permanently impassable. This can be explained by two major factors: - Vast areas of the country are still inaccessible and do not offer enough safety of persons. -

RAZAFIMAHATRATRA Voniharilanto
Université d’Antananarivo SCAC – Ambassade de France FSP PARRUR « Partenariat et Recherche en milieu RURal » RAPPORT FINAL Allocation de recherche, de Septembre 2013 – Juillet 2014. Travaux de terrain, en vue d’une Thèse de Doctorat de Géographe intitulée : TERRITOIRES, POLITIQUES FONCIERES ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE DANS LE MICRO REGION DU LAC ITASY Voniharilanto RAZAFIMAHATRATRA, Géographe, Antananarivo le 11 Juillet 2014. Table des matières INTRODUCTION .......................................................................................................................................................... 3 CONTEXTE DE L ’ALLOCATION DE RECHERCHE ............................................................................................................................. 3 ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE ............................................................................................................................................ 3 ÉTAT DE LA RÉALISATION DES ENGAGEMENTS ............................................................................................................................ 3 PREMIERE PARTIE : RAPPORT TECHNIQUE .................................................................................................................. 5 SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS PRÉVUES .......................................................................................................................................... 5 SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ........................................................................................................................................ -

Evaluation Provisoire Des Degats Et Des Activites Entreprises Intemperies Et Forte Tempete Tropicale "Chedza"
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana ------------------- MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ------------------ BUREAU NATIONAL DE GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES ----------------- CENTRE D’ETUDE DE REFLEXION DE VEILLE ET D’ORIENTATION -------------------- EVALUATION PROVISOIRE DES DEGATS ET DES ACTIVITES ENTREPRISES INTEMPERIES ET FORTE TEMPETE TROPICALE "CHEDZA" Situation à la date du 26 janvier 2015 - 16H00 Page 1 SYNTHESE DE LA SITUATION Région/Districts Décédés Sinistrés déplacés Alaotra Mangoro 122 122 REPRESENTATION GRAPHIQUE Ambatondrazaka 122 122 DES DISTRICTS IMPACTES Amoron'i Mania 168 168 Ambatofinandrahana 168 168 Analamanga 6 49 854 32 577 Ambohidratrimo 1 421 Andramasina 1 28 28 Ankazobe 1 Antananarivo Avaradrano 842 Atsimondrano 1 12 730 5 032 Tana I 12 131 6 565 Tana II 3 750 475 Tana III 3 488 3 488 Tana IV 11 931 10 401 Tana V 1 718 1 773 Tana VI 4 815 4 815 Betsiboka 3 1 194 324 Maevantanàna 3 1 194 324 Boeny 1 4 825 30 Ambato Boeny 1 2 925 30 Mahajanga II 1 900 Bongolava 19 Tsiroanimandidy 19 Diana 1 640 640 Ambanja 1 640 640 Haute Matsiatra 3 244 244 Ambalavao 1 Ambohimahasoa 2 Fianarantsoa 200 200 Ivohibato 44 44 Lalangina Itasy 1 339 Soavindriana 1 339 Melaky 1 Besalampy 1 Menabe 6 7 667 4 563 Belo Sur tsiribihina 2 2 191 Mahabo 155 155 Miandrivazo 2 1 252 1 224 Morondava 2 4 069 3 184 Sofia 2 000 1 500 Mampikony 2 000 1 500 Sud-Est 10 7 835 1 855 Farafangana 3 6 317 1 855 Vangaindrano 3 Vondrozo 4 1 518 Vakinankaratra 12 Antanifotsy 12 En jaune : éléments nouveaux Vatovavy Fitovinany 25 58 220 3 653 Les 17 morts à Ikongo sont dus au glissement de terrain, environ une semaine après le passage de Ikongo 17 2 089 107 "CHEDZA". -

Indicateurs De Coûts Et De Risque Par Stratégie À Fin 2023
STRATEGIE DE LA DETTE A MOYEN-TERME 2021-2023 Annexe 8 : Résultats des 4 stratégies Annexe 8a : Indicateurs de coûts et de risque par stratégie à fin 2023 2020 S1 S2 S3 S4 Dette nominale (% du PIB)* 41,4 46,7 46,8 46,8 46,8 Valeur actualisée de la dette (% du PIB) 28,7 31,5 32,1 32,7 34,1 Intérêts (% du PIB) 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 Taux d´intérêt moyen pondéré (%) 2,1 1,9 2,1 2,4 2,8 Dette amortie dans un an (% du total) 12,0 9,5 9,5 9,8 9,9 Dette amortie dans un an (% du PIB) 5,0 4,4 4,5 4,4 4,6 Risque de refinancement ATM Dette extérieure (ans) 14,4 13,5 12,9 12,3 12,0 ATM Dette intérieure (ans) 3,1 2,2 2,2 2,2 2,2 ATM Dette totale (ans) 12,1 11,9 11,3 10,9 10,6 ATR Dette totale (ans) 11,4 10,9 10,1 9,8 9,5 Dette à refixer dans un an (% du total) 22,4 24,2 28,4 29,7 22,4 Interest rate risk2 Dette à taux d´intérêt fixe (% du total) 89,2 84,3 80,2 78,9 78,2 BTA (% du total) 4,9 3,5 3,5 3,5 3,5 Dette en devises (% du total) 79,1 85,8 85,8 85,8 85,8 FX risk Dette à court-terme (% des réserves) 6,9 8,5 8,7 9,6 10,0 *L’encours des BTA n’inclut pas les intérêts précomptés. -

1303 Soavinandriana
RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: SOAVINANDRIANA Commune: AMBATOASANA CENTRE Code Bureau: 130301010101 VANJA TSIAZOMBORONA EPP TSINJOVARY INSCRITS: 496 VOTANTS: 241 BLANCS ET NULS: 11 SUFFRAGE EXPRIMES: 230 N° Partie Voix Poucentage 1 ANTOKO HARENA 89 38,70% 2 INDEPENDANT RATAFIKA 7 3,04% 3 ANTOKO ZAMA 7 3,04% 4 INDEPENDANT PR RANTO 22 9,57% 5 INDEPENDANT PR ANDRY 42 18,26% 6 IRD 19 8,26% 7 INDEPENDANT OLIVIER 16 6,96% 8 INDEPENDANT RA-LOLOT 2 0,87% 9 TIM 26 11,30% Total des voix 230 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: SOAVINANDRIANA Commune: AMBATOASANA CENTRE Code Bureau: 130301020101 TANAMALAZA EPP AMPARARANO S1 INSCRITS: 380 VOTANTS: 151 BLANCS ET NULS: 9 SUFFRAGE EXPRIMES: 142 N° Partie Voix Poucentage 1 ANTOKO HARENA 8 5,63% 2 INDEPENDANT RATAFIKA 7 4,93% 3 ANTOKO ZAMA 23 16,20% 4 INDEPENDANT PR RANTO 14 9,86% 5 INDEPENDANT PR ANDRY 26 18,31% 6 IRD 24 16,90% 7 INDEPENDANT OLIVIER 8 5,63% 8 INDEPENDANT RA-LOLOT 1 0,70% 9 TIM 31 21,83% Total des voix 142 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: SOAVINANDRIANA Commune: AMBATOASANA CENTRE Code Bureau: 130301020102 TANAMALAZA EPP-AMPARARANO S2 INSCRITS: 443 VOTANTS: 205 BLANCS ET NULS: 6 SUFFRAGE EXPRIMES: 199 N° Partie Voix Poucentage 1 ANTOKO HARENA 13 6,53% 2 INDEPENDANT RATAFIKA 4 2,01% 3 ANTOKO ZAMA 38 19,10% 4 INDEPENDANT PR RANTO 13 6,53% 5 INDEPENDANT PR ANDRY 22 11,06% 6 IRD 28 14,07% 7 INDEPENDANT OLIVIER 4 2,01% 8 INDEPENDANT RA-LOLOT 7 3,52% 9 TIM 70 35,18% Total des voix 199 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: SOAVINANDRIANA Commune: AMBATOASANA