ESSAIS S RIMB MIER Intro Exp12-17
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Best Western Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud
Arthur Rimbaud Hôtel Littéraire 6, rue Gustave Goublier, 75010 PARIS Tél. +33 (0)1 40 40 02 02 www.hotel-litteraire-arthur-rimbaud.com 1 « …Et d’ineffables vents m’ont hélé par instants. » Arthur Rimbaud, notre premier poète ; celui qui bouleverse les adolescences paisibles, renverse notre vision de la littérature et nous ouvre les yeux sur un monde saturé de couleurs, d’émotions, de vie. Arthur Rimbaud, celui qui, par son souffle épique, a emporté notre jeunesse ; nous aussi nous avions 17 ans et avec lui, nous allions « sous le ciel », nous descendions « les fleuves impassibles » et avec lui, nous avons su « …les cieux crevant en éclairs, et les trombes Et les ressacs et les courants... » Il faut se laisser emporter par le rythme, la fulgurance des mots, le chatoiement des images et du style de Rimbaud pour découvrir dans un seul poème, voire un seul vers, le génie du plus précoce et du plus important des poètes. « Ce n’était ni le diable ni le Bon Dieu, c’était Arthur Rimbaud, c’est à dire un très grand poète, absolument original, d’une saveur unique ». (Verlaine). C’est ce bouleversement que nous voulons partager avec vous, à travers 42 chambres, des éditions originales, une bibliothèque de 500 livres, des dizaines de références, de clins d’œil. Retrouver ensemble, l’émotion de Rimbaud : il est celui, disait François Mauriac « qui ne se retourne même pas pour regarder la trace que ses pas d’enfants ont laissée sur le monde ». Arthur Rimbaud, our first poet; the poet who disrupts the peaceful years of adolescence, turns our vision of literature upside down and opens our eyes to a world full of colour, emotions and life. -

Rimbaud, Entre Le Parnasse Et La Prose — Parcours Du Signifiant
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CfflCOUTIMI MÉMOIRE PRÉSENTÉ À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAÎTRISE EN ÉTUDES LITTÉRAIRES OFFERTEÀ L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI EN VERTU D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES par Jocelyn Lord Rimbaud, entre le Parnasse et la prose — parcours du signifiant 20 février 1995 UIUQAC bibliothèque Paul-Emile-Bouletj Mise en garde/Advice Afin de rendre accessible au plus Motivated by a desire to make the grand nombre le résultat des results of its graduate students' travaux de recherche menés par ses research accessible to all, and in étudiants gradués et dans l'esprit des accordance with the rules règles qui régissent le dépôt et la governing the acceptation and diffusion des mémoires et thèses diffusion of dissertations and produits dans cette Institution, theses in this Institution, the l'Université du Québec à Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) est fière de Chicoutimi (UQAC) is proud to rendre accessible une version make a complete version of this complète et gratuite de cette œuvre. work available at no cost to the reader. L'auteur conserve néanmoins la The author retains ownership of the propriété du droit d'auteur qui copyright of this dissertation or protège ce mémoire ou cette thèse. thesis. Neither the dissertation or Ni le mémoire ou la thèse ni des thesis, nor substantial extracts from extraits substantiels de ceux-ci ne it, may be printed or otherwise peuvent être imprimés ou autrement reproduced without the author's reproduits sans son autorisation. -

Arthur Rimbaud
Arthur Rimbaud Jean Nicolas Arthur Rimbaud (/ræmˈboʊ/[2] or las Frédéric (“Frédéric”), arrived nine months later on 2 /ˈræmboʊ/; French pronunciation: [aʁtyʁ ʁɛ̃bo] ; 20 Oc- November.[3] The next year, on 20 October 1854, Jean tober 1854 – 10 November 1891) was a French poet Nicolas Arthur (“Arthur”) was born.[3] Three more chil- born in Charleville, Ardennes.[3] He influenced modern dren followed: Victorine-Pauline-Vitalie on 4 June 1857 literature and arts, and prefigured surrealism. He started (who died a few weeks later), Jeanne-Rosalie-Vitalie writing poems at a very young age, while still in primary (“Vitalie”) on 15 June 1858 and, finally, Frédérique school, and stopped completely before he turned 21. He Marie Isabelle (“Isabelle”) on 1 June 1860.[17] was mostly creative in his teens (17–20). The critic Ce- Though the marriage lasted seven years, Captain Rim- cil Arthur Hackett wrote that his “genius, its flowering, [4] baud lived continuously in the matrimonial home for less explosion and sudden extinction, still astonishes”. than three months, from February to May 1853.[18] The Rimbaud was known to have been a libertine and for be- rest of the time his military postings – including active ing a restless soul. He traveled extensively on three con- service in the Crimean War and the Sardinian Campaign tinents before his death from cancer just after his thirty- (with medals earned in both)[19] – meant he returned seventh birthday.[5] home to Charleville only when on leave.[18] He was not at home for his children’s births, nor their -
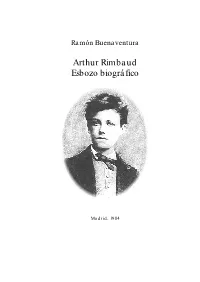
Arthur Rimbaud Esbozo Biográfico
Ramón Buenaventura Arthur Rimbaud Esbozo biográfico Madrid, 1984 © Copyright Ramón Buenaventura, 1985 © Copyright de las características de esta edición: EDICIONES HIPERIÓN, S.L. Salustiano Olózaga, 14 - 28001 Madrid ISBN: 84-7517-142-7 Depósito Legal: M - 7979 - 1985 1 Este librito es resultado de mi caída, a gravedad suelta, en una trampa de la devoción. Había previsto que cada tomo de las obras de Arthur Rimbaud fuera acompañado de un mero cuadro cronológico que orientara el lector por los momentos clave. Al repasar, para leve modificación, el cuadro cronológico que había in- cluido en Una temporada en el infierno, me pareció de pronto despreciable, por mi parte, no sacarme un esfuerzo más, y escribir una corta noticia bio- gráfica. Apunté a treinta o cuarenta folios —y han salido ciento dos. Buen ojo, como de costumbre1. De todas formas, no se entienda que esta sobreabundancia ensoberbece la modestia del proyecto inicial. Si tenemos un libro, en vez de un añadido a la edición de las Iluminaciones, es porque todas las reliquias que colocaba en el altar del santo se me antojaban pocas. Me he metido a traducir docu- mentos de la vida de Rimbaud que aparecen por primera vez en castellano, casi todos ellos. Pero, como me tenía firmemente prometido, he sobrado la tentación de hacer literatura a costa de Rimbaud. Lo que he escrito es un breve informe con datos. Sin adornarme más que en las cuatro o cinco inevitables ocasio- nes en que a uno se le distraen los dedos sobre las teclas y, zas, hace una frase. Los modernos inventos electrónicos facilitan en grado sumo tales devaneos. -

Rimbaud Och Sekelskiftets Sverige
SAMLAREN TIDSKRIFT FÖR SVENSK LITTERATURHISTORISK FORSKNING • NY FÖLJD. ÅRGÅNG 35 1954 UPPSALA 1966 SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel. UPPSALA 1955 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB 547565 Rimbaud och sekelskiftets Sverige. Av Helmer Lång. Enligt gammal biografisk tradition1 besökte Arthur Rimbaud Sverige 1877, som manager i Loissets cirkussällskap, vilket han skulle ha träffat på i Tyskland våren 1877 och följt på dess nordliga turné, lockad av cirkusdirektörens vackra döttrar. Enligt samma källa skulle Rimbaud ha blivit hemsänd genom Franska konsulatet i Stockholm på statens bekost nad. En engelsk forskare, miss Enid Starkie1 2, har emellertid genom hän vändelse till Franska konsulatet konstaterat, att den senare uppgiften är felaktig. I och för sig är det väl föga konstigt, om traditionen avviker från verkligheten just på den punkten: det var Rimbauds vanliga sätt att bli återbördad till fosterlandet efter sina utländska strövtåg; nya doku ment som bestyrker tekniken har nyligen framkommit.3 Värre är att Rimbaud icke, som traditionen uppger, kan ha följt med Cirkus Loisset från Hamburg. De biografiska dokumenten4 tyder på att han kommit hem från ett äventyr i holländsk militärtjänst på Java och därpå följande desertering i slutet av år 1876, varefter han en tid vista des i moderstjället. Annonser i Göteborgspressen visar nu, att Loissets sällskap redan i början av december 1876 slagit upp sina tält i rikets andra stad. Cirkusen gjorde sedan på våren en avstickare till Oslo, innan den drog till Stockholm i april.5 Rimbauds syster Isabelle, som jämte modern brukade få rapporter om vagabondens vistelseort, förnekar också (brev 30/12 1896) all kännedom om cirkusen och säger, att Rimbaud när han var i Sverige arbetade på ett sågverk. -

Paul Celan Traducteur Du Bateau Ivre Par Hermann H. Wetzel
Paul Celan traducteur du Bateau ivre par Hermann H. Wetzel 1. Si l'on ne se tient qu'aux traductions et aux essais de traduction, Paul Celan s'intéressait surtout aux œuvres poétiques de Rimbaud au sens res• treint. Dans l'édition des Poésies par H. de Bouillane de Lacoste (Paris, Mer• cure de France, 1939), que possédait le poète, il a marqué au crayon, à la « Table des matières », les titres suivants1 : Sensation, A la musique, Le Dormeur du val, Ma Bohême, Les Corbeaux, Tête de faune, Les Poètes de sept ans, Les Sœurs de charité, Voyelles, « L'étoile a pleuré rose », Les Cher• cheuses de poux, Le Bateau ivre. On peut présumer que Celan avait prévu de traduire ces poèmes-ci. Sauf deux poèmes supplémentaires (Larme ex Eternité), tous les textes traduits (ou dont la traduction a été commencée sous une forme ou une autre) font partie de cette liste : — [Le Bateau ivre] Das trunkene Schiff, essais de traduction en marge de l'éd. Bouillane de Lacoste, manuscrits dactylographiés à partir de juillet 1957, dernières corrections en septembre 1957, publié en édition bilingue, Wies- baden, Insel, 1958 ; — [« Elle est retrouvée »] Wiedergefunden, traduit entre la fin de 1957 (manuscrit autographe sans date et texte dactylographié daté du 26.12.57) et le 18.2.58 (dernières corrections), publié dans Almanach S. Fischer 74, 1960, p. 81 ; — [Sensation] Empfindung, deux feuilles autographes sans date et manus• crit dactylographié du 25.11.58 avec corrections ; — [Larme] Tràne, manuscrit dactylographié du 2.8.57 avec corrections du 3.8.57 ; — [Le Dormeur du val] Der Schlàfer im Tal, manuscrit dactylographié du 2,8.57 avec corrections ; — [« L'étoile a pleuré rose.. -

Arthur Rimbaud. Je Est Un Autre», Strauhof Zürich, 15.12
«Arthur Rimbaud. Je est un autre», Strauhof Zürich, 15.12. 2004 – 27. 2. 2005 Oder Rimbaud: Einmal mit dem ungestümen Herzen an der Sprache rütteln, dass sie göttlich «unbrauchbar» werde für einen Augenblick – und dann fortgehen, nicht zurückschaun, Kaufmann sein. (Rainer Maria Rilke, Das Testament, Berg am Irchel 1921) Kurze Vorstellung der Räume Raum 1 L'homme aux semelles de vent / Der doppelte Rimbaud – Der Mythos Rimbaud Die Welt ist sehr gross und voller wunderbarer Gegenden – das Leben von tausend Menschen würde nicht reichen, sie zu besuchen. [...] Aber immer am gleichen Ort zu leben, das wird mir immer eine grässliche Vorstellung sein. (Rimbaud an die Familie, Aden, 15. Januar 1885) «Ich bin ein Fussgänger, das ist alles», schrieb der siebzehnjährige Rimbaud in einem Brief. Später trugen ihm seine ausgedehnten Reisen die Spitznamen «der Mann mit den Windsohlen», «der verrückte Reisende», «der neue Ewige Jude» ein. Nachdem Rimbaud ganz Europa durchwandert hatte, überquerte er zu Fuss den Gotthard und fuhr mit dem Schiff von Genua nach Ägypten. Er begann ein neues Leben als Kaufmann in Arabien und Afrika. Der doppelte Rimbaud, ein Buchtitel von Victor Segalen, bezieht sich auf diese zwei Existenzen: sind Rimbauds Schweigen und seine Abreise aus Europa ein Verrat an seiner Dichtung oder deren logische Konsequenz? Rimbauds Leben und Werk regten die verschiedensten Phantasien und Deutungen an – Variationen eines «Mythos», die der Literaturwissenschafter Étiemble ironisch in mehreren Bänden zusammentrug. Sechs Vitrinen sind Rimbauds abenteuerlichem Leben gewidmet (Charleville, Paris, Europa, die Überquerung des Gotthard, Arabien/Afrika, Marseille). Die Wände widerspiegeln den Mythos Rimbaud, vom berühmten Bild von Fantin-Latour, Coin de table, bis zu modernen Portraits des Dichters (Giacometti, Picasso, Léger). -

No. 227 Seth Whidden, Arthur Rimbaud. London
H-France Review Volume 19 (2019) Page 1 H-France Review Vol. 19 (November 2019), No. 227 Seth Whidden, Arthur Rimbaud. London: Reaktion Books, 2018. 204 pp. Notes and bibliography. £11.99 (pb). ISBN 978-1-78023-980-4. Review by Caroline Ardrey, The University of Birmingham. It is perhaps unusual for a critical study—even a biographical one—to be described as a “page turner;” in the case of Seth Whidden’s recent study of Arthur Rimbaud, however, the epithet seems fitting. Published as part of Reaktion Books’ “Critical Lives” series in 2018, Whidden’s take on the much-studied enfant terrible of nineteenth-century French poetry is refreshing and captivating. Bringing his considerable expertise on Rimbaud to bear, Whidden adeptly unites the critical dimension of this particular series with the biographical demands of the “Critical Lives” format. The resulting book is both an illuminating introduction to Rimbaud and his works, and an insightful textual study that has already become an essential addition to reading lists on nineteenth-century French poetry for Modern Languages and comparative literature courses. In the introduction, Whidden sets out two broad questions that serve as starting points for the study: “What makes Rimbaud’s poetry important, and what makes his story so compelling that it needs to be told?” (p. 12). Throughout the book, Whidden’s detailed yet precise analyses of Rimbaud’s innovative poetics and his intricate yet vivacious delivery of the poet’s story makes for a convincing response to these questions, bringing that compelling narrative to the fore in a complete and sensitive reading of the poet and his oeuvre. -

Rimbaud D'outre-Tombe
TOUS LES JOURS, TOUTE L’INFO Rimbaud d'outre-tombe Par Jérôme Dupuis, publié le 13/04/2010 C'est une première dans l'édition : la publication de la correspondance échangée après la mort de l'auteur du Bateau ivre par des proches, des écrivains et même des explorateurs. Où l'on assiste à la naissance d'une légende. C'est la revue La Plume qui, la première, révèle le "scoop" : "Nous avons le triste devoir d'annoncer au monde littéraire la mort d'Arthur Rimbaud. Il a été enterré ces jours derniers à Charleville. Son corps a été ramené de Marseille. Sa mère et sa soeur suivaient SEULES le convoi funèbre. Au prochain numéro, détails complets." Ce mardi 1er décembre 1891, la disparition de l'auteur du Bateau ivre n'occupe encore que trois maigres lignes dans la presse. Pourtant, cet enterrement intime d'un poète, qui n'a pas vendu le moindre exemplaire de son vivant, marque moins la fin d'une destinée que la naissance d'une légende. Dans les jours, les mois et les années qui vont suivre, une nuée de poètes, faussaires, parents, anciens compagnons de beuverie, explorateurs abyssins, sans même parler d'un célèbre amant, vont dessiner les contours du Rimbaud que nous connaissons aujourd'hui. C'est cette métamorphose que dévoile l'incroyable recueil intitulé Sur Arthur Rimbaud. Correspondance posthume 1891-1900, qui sort aujourd'hui. Après un premier volume de Correspondance "anthume" du poète, paru en 2007, les éditions Fayard et le grand rimbaldien Jean-Jacques Lefrère se sont en effet lancés dans une entreprise folle et, semble-t-il, sans équivalent dans la littérature mondiale : publier l'intégralité des lettres échangées par des proches, des hommes de lettres et des témoins, à propos d'un poète, Rimbaud, à compter du jour de sa mort. -

Dévotions Ou Deux Rimbaud
ANNE-MARIE FORTIER Université McGill Dévotions ou deux Rimbaud haque lecture du texte de Rimbaud semble comme Cune tentative simultanée de donner un sens à une vie, d'une part, c'est-à-dire à une série de faits biographiques aussi épars qu'incertains, et à une œuvre, d'autre part, dont les retournements et les contradictions irritent et empê chent l'embrassement et la compréhension tout en laissant, par cela même qu'offrent le multiple et l'incomplet, une grande latitude d'interprétation. S'il va s'accentuer à mesure que passeront les années séparant Rimbaud de ses lecteurs, ce fait apparaît dès l'origine, c'est-à-dire déjà au cours des deux dernières décennies du XIXe siècle, sur lesquelles nous nous attarde 1 rons ici • Plus précisément, notre analyse des premières lectures de Rimbaud couvrira la période 1883-1899, alors que la première édition des textes de Rimbaud se prépare et se réalise, à l'insu d'un Rimbaud pourtant vivant jusqu'en 1891. Si une même vigueur anime Verlaine et Isabelle Rim baud, les chefs de file des courants d'interprétation domi nants de cette période, il est possible de mettre cette vigueur sous le même signe (et substantif} de la «dévotion». Elle sera littéraire et connotative pour Verlaine, selon ses pro pres termes, filiale et dénotative pour Isabelle Rimbaud. 2 Ce qui fondamentalement sépare leurs «préfaces» , ce n'est peut-être pas tant leurs intentions respectives que le public à qui elles s'adressent, celui de Paris et celui de Charleville. Littératures n° 14 1996 81 ANNE-MARIE FORTIER À cause de cela, le même discours, celui de Rimbaud, ne révèle pas les mêmes enjeux : la valeur de son œuvre au sein d'un débat littéraire qui cherche à circonscrire l'auto nomie de la poésie le dispute à la valeur d'exemplarité, éthique et morale, de sa vie, qui sert d'argument à la réhabilitation du «citoyen» ardennais. -
Arthur Rimbaud Hôtel Littéraire
Arthur Rimbaud Hôtel Littéraire 6, rue Gustave Goublier, 75010 PARIS Tél. +33 (0)1 40 40 02 02 www.hotel-litteraire-arthur-rimbaud.com 1 « …Et d’ineffables vents m’ont hélé par instants. » Arthur Rimbaud, notre premier poète ; celui qui bouleverse les adolescences paisibles, renverse notre vision de la littérature et nous ouvre les yeux sur un monde saturé de couleurs, d’émotions, de vie. Arthur Rimbaud, celui qui, par son souffle épique, a emporté notre jeunesse ; nous aussi nous avions 17 ans et avec lui, nous allions « sous le ciel », nous descendions « les fleuves impassibles » et avec lui, nous avons su « …les cieux crevant en éclairs, et les trombes Et les ressacs et les courants... » Il faut se laisser emporter par le rythme, la fulgurance des mots, le chatoiement des images et du style de Rimbaud pour découvrir dans un seul poème, voire un seul vers, le génie du plus précoce et du plus important des poètes. « Ce n’était ni le diable ni le Bon Dieu, c’était Arthur Rimbaud, c’est à dire un très grand poète, absolument original, d’une saveur unique ». (Verlaine). C’est ce bouleversement que nous voulons partager avec vous, à travers 42 chambres, des éditions originales, une bibliothèque de 500 livres, des dizaines de références, de clins d’œil. Retrouver ensemble, l’émotion de Rimbaud : il est celui, disait François Mauriac « qui ne se retourne même pas pour regarder la trace que ses pas d’enfants ont laissée sur le monde ». Arthur Rimbaud, our first poet; the poet who disrupts the peaceful years of adolescence, turns our vision of literature upside down and opens our eyes to a world full of colour, emotions and life. -

W 10Et Rimbaud
Charbogne Les étapes de la vie Arthur RIMBAUD et ses ancètres de Charbogne "Cardin COUET - Nicole NAMUR" et "Jean LAMBIN - Gilette DEHAYE" Sextisaïeuls ( Louis XIII 1610 - 1643 ) ASCENDANCE Naissance Mariage Décès Activité H COUET 01/01/1630 29/05/1661 18/04/1702 Cardin Charbogne NAMUR 09/11/1642 12/04/1689 Nicole Charbogne Charbogne H LAMBIN 01/01/1634 27/03/1694 Jean Charbogne DEHAYE 01/01/1635 02/03/1693 Gilette Charbogne Charbogne G LAMBIN 06/07/1670 26/01/1694 27/10/1709 Jean Charbogne Charbogne Charbogne COUET 07/04/1671 03/04/1724 Marson Charbogne Charbogne F LAMBIN 13/02/1700 16/10/1724 01/01/1772 Nicole Charbogne Charbogne ROLAND 04/02/1700 21/03/1772 laboureur Jean Saint-Lambert Charbogne E ROLAND 12/08/1725 15/01/1760 frère de Catherine ROLAND marié Pierre Charbogne Charbogne avec Jean-Baptiste Nicolas CUIF POSTAL Marguerite Charbogne D ROLAND 06/02/1764 10/01/1801 08/08/1828 Jeanne-Catherine Charbogne Tourteron Charbogne FAY 19/05/1775 27/11/1841 cultivateur Pierre Robert Tourteron Charbogne C FAY 17/04/1804 29/05/1823 09/06/1830 Marie-Louise Félicité Tourteron Charbogne Roche CUIF 01/05/1798 05/071858 cultivateur Jean-Nicolas Roche Charleville B CUIF 10/03/1825 08/02/1853 01/08/1907 agricultrice Marie-Catherine Vitalie Roche Charleville Roche RIMBAUD 07/10/1814 17/11/1878 capitaine d'infanterie Frédéric Dole (Jura) Dijon (Côte d'Or) A RIMBAUD 02/11/1853 21/01/1885 02//07/1911 voiturier à Attigny Jean Nicolas Frédéric Charleville Roche Vouziers JUSTIN 18/04/1866 divorcé 08/02/1901 Blanche Rosa Maria Roche RIMBAUD 20/10/1854