ENCOUNTERING the WHITEMAN in JAMES BAY CREE NARRATIVE HISTORY and MYTHOLOGY Colin Scott
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Indigenous Peoples, Political Economists and the Tragedy of the Commons
559 Indigenous Peoples, Political Economists and the Tragedy of the Commons Michel Morin* In “The Tragedy of the Commons,” Garrett Hardin implicitly moved from bounded commons — a pasture or a tribe’s territory — to the case of boundless commons — the ocean, the atmosphere and planet Earth. He insisted on the need for imposing limits on the use of these resources, blurring the difference between communal property and open access regimes. The success of his paper is due in great measure to his neglect of economic, scientific, legal and anthropological literature. His main lifelong focus was on limiting population growth. He could have avoided the conceptual confusion he created by turning to well-known political economists such as John Locke and Adam Smith or, for that matter, jurists, such as Blackstone. Instead, he simply envisioned indigenous lands as an unbounded wilderness placed at the disposal of frontiersmen. Though he eventually acknowledged the existence of managed commons, he had little interest in community rules pertaining to resource exploitation. For him, these were simply moral norms which inevitably became ineffective after a community reached a certain level of population. He also took economists to task for failing to include in their analysis the true environmental and social costs of public decisions. Still, the famous example of the indigenous people of Northeastern Quebec illustrates a shortcoming of his analysis: community members did not act in total isolation from each other. On the contrary, communal norms * Full Professor, Faculty of Law, University of Montreal. The author would like to express his gratitude to the Social Sciences and Humanities Research Council, to his colleagues Jean Leclair and Ejan Mackaay, to Dr Edward Cavanagh, to the participants of the conference “The Tragedy of the Commons at 50: Context, Precedents and Afterlife,” as well as the editors of this issue, for their comments on earlier versions of this paper. -

Temps Des Sociétés Qu'ils Évangélisent
Des missionnaires-narrateurs à contre- temps des sociétés qu’ils évangélisent MADELEINE SAVART Université Jean Monnet Saint-Étienne/Université de Montréal [email protected] RÉSUMÉ Lorsque les missionnaires français arrivent en Nouvelle-France au XVIIe siècle, ils rencontrent des populations indigènes à la culture et à l’imaginaire social très distincts des modèles européens, et ce premier contact est empreint d’une violence tant physique et culturelle qu’idéologique et symbolique. Le traitement lexical et narratif de l’expression autochtone du temps illustre le paradoxe d’un apprentissage de la part des missionnaires teintés de méconnaissance et d’incom- préhension. Cet article vise à étudier la représentation déformée de la temporalité autochtone dans la Relation de la Nouvelle-France du père jésuite Paul Lejeune (1634) et la Nouvelle Relation de la Gaspésie du père récollet Chrestien Leclercq (1691). Après avoir envisagé quels sont les repères temporels (cycles lunaires et saisonniers) que les missionnaires identifient, l’analyse de la traduction et de la description de ces repères permettra de souligner que les retranscriptions des missionnaires-narrateurs oscillent entrefine compréhension, biais idéologique et dénégation. Le temps social cyclique paraît étranger aux hommes d’Église, imprégnés d’une vision historique linéaire et eschatologique. Alors même qu’ils en maîtrisent les vocables, ils n’en présentent qu’une simple image, sans en saisir les implications ontologiques et sociales, ou du moins, sans les rapporter à leurs lecteurs européens. MOTS-CLÉS langue, temps, traduction, missionnaire, Nouvelle-France 40 ABSTRACT When French missionaries arrived in New France in the seventeenth century, they discovered several indigenous cultures very different from their European models : a violence both physical and cultural as well as ideological and symbolic marked this first contact. -

ORAL and RECORDED HISTORY in JAMES BAY TOBY MORANTZ Mcgill University
ORAL AND RECORDED HISTORY IN JAMES BAY TOBY MORANTZ McGill University Introduction The purpose of my presentation is to show that a blend of documentary and oral history is essential to writing honest, thor ough histories of Algonquian peoples. My concern here is with histories developed for the non-Indian public. We must ensure that these histories agree with our sense of credibility, integrity and relevance. The particular combination or blend of oral and documentary history for use by individual Algonquian groups must be their decision to suit their needs (in the school setting, for example) . What we produce as ethnohistorians would be a local or re gional history, broadly categorized as "social history". Fortu nately, now in the 1980s, one does not have to justify to every historian the validity of social histories that concentrate on the events connected with the lives of ordinary individuals in far- flung regions, rather than on nation state centered political, mil itary, administrative, diplomatic and ecclesiastical themes that are promulgated, instituted and documented by an elite. How ever, it seems to me that we still have to prove to historians and to ourselves the validity of the oral tradition, of folk history, particularly for Algonquian history. In our area of interest much of Vansina's pioneering promotion of oral history, based as it is 172 TOBY MORANTZ on African chiefdoms with long-standing established oral tradi tions, does not apply. Having myself completed a first attempt at writing an Algonquian regional history based on documentary sources (Francis and Morantz, 1983; Morantz 1983) , I feel it be hooves me to demonstrate the richness and accuracy of the oral tradition by showing how the documentary and oral accounts complement each other to form a more complete, vital portrayal of events. -
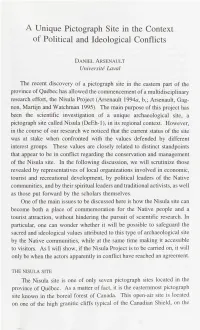
A Unique Pictograph Site in the Context of Political and Ideological Conflicts
A Unique Pictograph Site in the Context of Political and Ideological Conflicts DANIEL ARSENAULT Universite Laval The recent discovery of a pictograph site in the eastern part of the province of Quebec has allowed the commencement of a multidisciplinary research effort, the Nisula Project (Arsenault 1994a, b,; Arsenault, Gag- non, Martijn and Watchman 1995). The main purpose of this project has been the scientific investigation of a unique archaeological site, a pictograph site called Nisula (DeEh-1), in its regional context. However, in the course of our research we noticed that the current status of the site was at stake when confronted with the values defended by different interest groups. These values are closely related to distinct standpoints that appear to be in conflict regarding the conservation and management of the Nisula site. In the following discussion, we will scmtinize those revealed by representatives of local organizations involved in economic, tourist and recreational development, by political leaders of the Native communities, and by their spiritual leaders and traditional activists, as well as those put forward by the scholars themselves. One of the main issues to be discussed here is how the Nisula site can become both a place of commemoration for the Native people and a tourist attraction, without hindering the pursuit of scientific research. In particular, one can wonder whether it will be possible to safeguard the sacred and ideological values attributed to this type of archaeological site by the Native communities, while at the same time making it accessible to visitors. As I will show, if the Nisula Project is to be carried on, it will only be when the actors apparently in conflict have reached an agreement. -

Innu (Montagnais) in Newfoundland
Innu (Montagnais) in Newfoundland CHARLES A. MARTIJN Ministere des Affaires culturelles, Quebec Introduction A number of years ago in an article with the intriguing title "A Nice Place to Visit, But . .", Tuck and Pastore (1985) outlined how during the course of prehistory various native groups, Amerindians as well as Paleo-Eskimo, moved from the mainland, across the Strait of Belle-Isle into Newfound land. Due to the "closed" nature of food resources on this island, there appears to have been a cycle of extinctions with each prehistoric group be ing successively replaced by new immigrants. Not surprisingly, such native population movements, although on a reduced scale, also continued to take place during post-contact times. The present discussion1 will focus on voyages made during the past three centuries by Montagnais Indians (or Innu as they call themselves) from Quebec and Labrador. They travelled to Newfoundland to hunt, to trap furbearers and to trade, and in some instances to settle there perma nently. This constitutes a chapter in Montagnais history which nowadays is largely forgotten.2 Few old people survive who were actually born there, JI am indebted to Moira T. McCaffrey for her invaluable suggestions and editing services. My sincere thanks are extended to Jose Mailhot, Ingeborg Mar shall, Toby Morantz, Ralph T. Pastore, Francois Trudel and Sylvie Vincent for commenting on earlier versions of this paper presented at the First Labrador Straits Studies Conference in Forteau, Labrador, September 15-17, 1988 and at the Twenty-First Algonquian Conference in St. John's, Newfoundland, October 27-29, 1989. I also wish to express my appreciation to Ed Dahl of the National Archives in Ottawa, and to R. -

Cree Perceptions of Custom and Administration
TELLING A MESSAGE: CREE PERCEPTIONS OF CUSTOM AND ADMINISTRATION Ronald Niezen Department of Anthropology Harvard University William James Hall 33 Kirkland Street Cambridge, Massachusetts U.S.A., 02138 Abstract/Résumé This article considers some of the ways that "custom" is being used to reform formal administrations in James Bay Cree society. It points to a number of problems of administrative adjustment associated with regional autonomy that accompanied the implementation of the James Bay Agreement, especially in dealing effectively with the increased incidence of suicide, drug and alcohol abuse, family violence and juvenile crime. Cree perceptions of customary ways to overcome problems of self-destructiveness and violence are found to vary both within and between communities, yet they have the potential to be used productively in the strategies of autonomous institutions. Cet article examine quelques-uns des moyens qu'on emploie de "coutume" pour réformer les administrations officielles dans la société Cree de James Bay. Il indique un nombre de problèmes d'adaptation administrative, associés à l'autonomie régionale qui ont accompagné la réalisation de l'accord James Bay, surtout en venant efficacement à bout de l'accroissement de la fréquence du suicide, de l'abus des drogues et de l'alcool, de la violence familiale et du crime juvénile. On trouve que les perceptions des Crees des moyens habituels de surmonter les problèmes de l'autodestruction et de la violence varient dans une seule communauté et dans des autres, pourtant elles ont le potentiel d'être employés efficacement dans les stratégies des institutions autonomes. 222 Ronald Niezen Introduction Talking to Cree elders in Mistassini, Quebec1 about the community lifestyle between the 1930s and 1960s, I was surprised to find that nobody could recall an instance of suicide or even alcohol abuse. -

Aboriginal Peoples, Fact and Fiction
Writing and iconographic research Pierre Lepage Education and Cooperation Supervision Maryse Alcindor, director Education and Cooperation Collaboration Project coordination : Nicole Pothier Word-processing : Lucie Laliberté Education and Cooperation Consultation on graphics, layout, and printing Marie-Denise Douyon, Jean-François Lejeune Proof-reading and correction : Robert Sylvestre Communications Collaboration on the writing of chapter seven Musée de la civilisation (Québec) Translation Jan Jordon Additional translation and text revision Tom Carter Maps Serge Ashini-Goupil for Communications Totem Graphic design and production, and cover page illustration Line Hervieux Communications Totem The production and distribution of this publication have been made possible with the financial assistance of the Coordination des affaires autochtones of the ministère de l’ Éducation of Quebec, of the Indian and Northern Affairs Canada, Quebec Region, and of the ministère du Conseil exécutif of Quebec. The ideas expressed in this document are those of the author and do not necessarily represent the official position of either the Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse or of the partners that helped make this publication possible. Production and publication Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Québec) In collaboration with Institut culturel et éducatif montagnais Printing Imprimerie provinciale Inc., March 2009 A French version of this book is available under the title Mythes et réalités sur -

France and the St. Lawrence Mission Villages in War and Peace, 1630-1730
IN EACH OTHER’S ARMS: FRANCE AND THE ST. LAWRENCE MISSION VILLAGES IN WAR AND PEACE, 1630-1730. by JEAN-FRANÇOIS LOZIER A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Graduate Department of History University of Toronto © Copyright by Jean-François Lozier (2012) In Each Other’s Arms: France and the St. Lawrence Mission Villages in War and Peace, 1630-1730 Jean-François Lozier Doctor of Philosophy Department of History University of Toronto 2012 Abstract Beginning in the late 1630s, a diversity of Algonquian and Iroquoian peoples established under the auspices of Jesuit and, later, Sulpician missionaries a string of village communities in the St. Lawrence Valley. A diversity of peoples, whom the French lumped under the rubrics of “Algonquins”, “Montagnais”, “Hurons”, “Iroquois”, “Abenakis” and “Loups”, migrated to these villages in the hope of bettering their lives in trying times. This dissertation retraces the formation and the early development of these communities, exploring the entangled influence of armed conflict, diplomacy, kinship, and leadership on migration, community-building, and identity formation. The historiography of the St. Lawrence Valley – the French colonial heartland in North America – has tended to relegate these Aboriginal communities to the margins. Moreover, those scholars who have considered the formation of mission villages have tended to emphasize missionary initiative. Here, these villages are reimagined as a joint creation, the result of intersecting French and Aboriginal desires, needs, and priorities. The significance of these villages as sites of refuge becomes readily apparent, the trajectories of individual communities corresponding with the escalation of conflict or with ii its tense aftermath. -

Colonial French Insights Into Early 18Th-Century Algonquians of Central Quebec
Colonial French Insights into Early 18th-Century Algonquians of Central Quebec TOBY MORANTZ McGill University Some 284 years ago, on October 27, 1706, a quasi-judicial hearing, presided over by the Intendant Jacques Raudot, took place in Quebec City, which saw a merchant/trader, Francois Hazeur, plead his case for compensation from the directors of the Compagnie de Colonie for losses he incurred in his trade, or at least to excuse him from paying the last three years rent.1 It was a case as unspectacular as it sounds but judicial procedures then, are similar to those now, and this case generated some 131 folios of testimony, much of it repetitious. Unspectacular as legal precedent, perhaps, but in the domain of ethnohistory, it provides us with some unusual insights into the history and functioning of several early 17th-century Algonquian societies in the Tadoussac-Lac St. Jean area. Social historians thrive on notarial records because they often contain all sorts of extraneous information on which social history is constructed. This series of documents is the closest one comes in the French colonial records for a region that was not settled by Europeans and therefore lacks the notarial accounts so valuable for the St. Lawrence River settlement. Thus, an incident related to a territorial dispute in 1705 and elaborated on in the various written petitions, permit us to ask several questions about group distinctiveness and contact, land use and Indian responses to fur trade competition. This limited body of early historical data also challenges previously written portrayals of eastern subarctic Algonquian society. -

Aboriginal Quality of Life Under a Modern Treaty: Lessons from The
I R P P c hoi Vcol. 14, no. 9, Auguste 2008 ISSNs 0711-0677 www.irpp.org Aboriginal Quality of Life under a Modern Treaty Lessons from the Experience of the Cree Nation of Eeyou Istchee and the Inuit of Nunavik Martin Papillon ounded in 1972, the Institute for Research on Public Policy is an independent, national, F nonprofit organization. IRPP seeks to improve public policy in Canada by generating research, providing insight and sparking debate that will contribute to the public policy decision-making process and strengthen the quality of the public policy decisions made by Canadian governments, citizens, institutions and organizations. IRPP's independence is assured by an endowment fund established in the early 1970s. ondé en 1972, l’Institut de recherche en politiques publiques est un organisme canadien, F indépendant et sans but lucratif. L’IRPP cherche à améliorer les politiques publiques canadiennes en encourageant la recherche, en mettant de l’avant de nouvelles perspectives et en suscitant des débats qui contribueront au processus décisionnel en matière de politiques publiques et qui rehausseront la This publication was produced under the qualité des décisions que prennent les gouvernements, direction of F. Leslie Seidle, Senior Research les citoyens, les institutions et les organismes Associate, IRPP. The manuscript was copy-edited by Mary Williams, proofreading was by Barbara canadiens. Czarnecki, production was by Chantal Létourneau, art direction was by Schumacher L’indépendance de l’IRPP est assurée par un fonds de Design and printing was by AGL Graphiques. dotation établi au début des années 1970. Copyright belongs to IRPP. -
Beckett, Jason A. (2005) the End of Customary International Law? : a Purposive Analysis of Structural Indeterminacy. Phd Thesis
Beckett, Jason A. (2005) The end of customary international law? : a purposive analysis of structural indeterminacy. PhD thesis. http://theses.gla.ac.uk/2756/ Copyright and moral rights for this thesis are retained by the author A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the Author The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the Author When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given Glasgow Theses Service http://theses.gla.ac.uk/ [email protected] University of Glasgow French Department November 2005 Repossession of a Cultural Space in Francophone Native Literature from Quebec Marion Bernard ýW- Thesis submitted in partial fulfilment of the requirementsfor the degreeof Doctor of philosophy Abstract Francophone Native literature from Quebec is a relatively recent phenomenon. The first anthology' of this literature was published in 2004. Although Native writing started as early as the 18th century with the teaching of missionaries, it is only since the 1970s that Native authors from Quebec began to write fictional works increasingly. Due to their historical past, social and economic situation, Native authors have only recently slightly moved away from political issues. These authors have adopted and adapted Western literary forms so that they would be able to express the specificities of their cultures and beliefs. -

Reaching Andhonouring Treaties with Indigenous Peoples
Thematic section Living Together with the Land: Reaching and Honouring Treaties with Indigenous Peoples Sylvie Poirier Université Laval Clinton N. Westman University of Saskatchewan Introduction on reserves and compulsory attendance at residential schools before the new revival and mobilisations of the Canada is founded on an act of sharing that is almost unimag- 1960s (Alfred 1999, 2005; Coulthard 2014; Kapesh 1976, inable in its generosity. The aboriginal peoples shared their 1979; Manuel and Derrickson 2017). Then in 1975 came food, hunting and agricultural techniques, practical knowl- the first modern treaty: the James Bay and Northern edge, trade routes and geographic knowledge with the needy Quebec Agreement (JBNQA), which was negotiated and newcomers. signed between the Cree nation and the Canadian and 62 James Tully (2008, 244–245) Quebec governments. Modern treaties and the modalities 2 of their negotiation and implementation are still in force 10.3138/anth-2020-0037 Our treaty obligations are solemn commitments, today, notably under the Comprehensive Land Claims not policy options. Policy (1976).2 Michael Asch (2014, 164) Thus, of all the forms of relationship between Indigenous people, the Crown and non-Indigenous Our sovereignty does not come from a document. Our sov- people in Canada, treaty relationships have existed ereignty comes from an abundance of healthy, responsible, from the beginning. From east to west and from north respectful relationships with all our relations. to south, the nature and forms of treaty relationships Leanne Betasamosake Simpson (2015, 22) and their impact on people’s relation to the land have varied according to regions and historical specificities, From the earliest contacts to the present, treaties, in- as demonstrated by the contributions to this issue.