MAESTRIPIERI Nicolas, LAFITTE Jérôme
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bodacc Bulletin Officiel Des Annonces Civiles Et
o Quarante-quatrième année. – N 236 A ISSN 0298-296X Lundi 6 et mardi 7 décembre 2010 BODACCBULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES ANNEXÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIRECTION DE L’INFORMATION Standard......................................... 01-40-58-75-00 LÉGALE ET ADMINISTRATIVE Annonces....................................... 01-40-58-77-56 Accueil commercial....................... 01-40-15-70-10 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15 Abonnements................................. 01-40-15-67-77 www.dila.premier-ministre.gouv.fr (8h30à 12h30) www.bodacc.fr Télécopie........................................ 01-40-15-72-75 BODACC “A” Ventes et cessions - Créations d’établissements Procédures collectives Procédures de rétablissement personnel Avis relatifs aux successions Avis aux lecteurs Les autres catégories d’insertions sont publiées dans deux autres éditions séparées selon la répartition suivante Modifications diverses........................................ BODACC “B” Radiations ............................................................ } Avis de dépôt des comptes des sociétés ....... BODACC “C” Banque de données BODACC servie par les sociétés : Altares-D&B, EDD, Extelia, Questel, Tessi Informatique, Jurismedia, Pouey International, Scores et Décisions, Les Echos, Creditsafe, Coface services, Cartegie, La Base Marketing, Infolegale, France Telecom Orange, Telino et Maxisoft. Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 17 mai 1984 relatif à la constitution et à la commercialisation d’une banque de données télématique des informations contenues dans le BODACC, le droit d’accès prévu par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès de la Direction de l’information légale et administrative. Le numéro : 2,80 € Abonnement. − Un an (arrêté du 19 novembre 2009 publié au Journal officiel du 21 novembre 2009) : France : 398,60 €. Pour l’expédition par voie aérienne (outre-mer) ou pour l’étranger : paiement d’un supplément modulé selon la zone de destination ; tarif sur demande Paiement à réception de facture. -

Cause Animale, Luttes Sociales
Cause animale, Ernest Cœurderoy (1825-1862), Louise Michel Souvent réduite à un régime alimentaire ou à la lubie « Plus l’homme est féroce envers la bête, (1830-1905), Marie Huot (1846-1930), Charles Gide passagère d’une époque déboussolée, la cause animale plus il est rampant devant les hommes qui (1847-1932), Élisée Reclus (1830-1905), Léon Tolstoï est de plus en plus médiatisée mais aussi instrumentalisée, le dominent. » (1828-1910), Henry Stephens Salt (1851-1939), récupérée et dépolitisée. Dans ce e anthologie, Roméo Cause animale, lu es sociales Louise Michel, 1886 Séverine (1855-1929), Octave Mirbeau (1848-1917), Bondon et Elias Boisjean explorent ses racines historiques avec des textes de pour mieux souligner le non-sens d’un engagement « Je veux ici plaider la cause d’une classe Georges Butaud (1868-1926), Sophie Zaïkowska Charles Gide, Marie Huot, (1847-1939), Louis Rimbault (1877-1949). animaliste qui se passerait d’une remise en cause du particulière de travailleurs et de salariés : classe capitalisme. Louise Michel, Octave Mirbeau, Élisée Reclus, nombreuse, car ses membres se comptent par Bien avant l’invention du concept d’antispécisme, des Louis Rimbault, Séverine, Léon Tolstoï, millions ; classe misérable, car pour obtenir de hommes et des femmes ont conjugué leurs convictions quoi ne pas mourir de faim, ils sont assuje is au socialistes et libertaires avec une sensibilité particulière Georges Butaud, Sophie Zaïkowska, travail le plus dur, à la chaîne et sous le fouet ; pour ces « autres exploités » que sont les animaux. Ernest Cœurderoy, Henry S. Salt classe qui a d’autant plus besoin de protection Dénonciation de la corrida, de la chasse, de l’élevage ou es sociales animale, lu Cause qu’elle est incapable de se défendre elle-même, Roméo Bondon et Elias Boisjean Bondon et Roméo de l’aba age industriels, défense du végétarisme… Loin n’ayant pas assez d’esprit pour se me re en d’être désuets, leurs propos témoignent de l’urgence de grève et ayant trop bonne âme pour faire une bâtir une société résolument écologiste et animaliste. -

Des Carrières Militantes Animalistes Abolitionnistes. L'engagement Dans Le Groupe Lyonnais De L'association L214 Éthiq
Des carrières militantes animalistes abolitionnistes. L’engagement dans le groupe lyonnais de l’association L214 Éthique & Animaux Mata’i Souchon To cite this version: Mata’i Souchon. Des carrières militantes animalistes abolitionnistes. L’engagement dans le groupe lyonnais de l’association L214 Éthique & Animaux. Sciences de l’Homme et Société. 2018. dumas- 01950282 HAL Id: dumas-01950282 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01950282 Submitted on 10 Dec 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Mata’i SOUCHON Année universitaire 2017-2018 Des carrières militantes animalistes abolitionnistes. L’engagement dans le groupe lyonnais de l’association L214 Éthique & Animaux Mémoire de recherche soutenu le 21 septembre 2018 (mention bien) Sous la direction de Montserrat EMPERADOR Version publiquement diffusable Stand d’information (Lyon, 25 juin 2016) Crédit : L214 – Éthique & Animaux Membres du jury : Montserrat EMPERADOR, Camille HAMIDI, Sandrine LÉVÊQUE Université Lumière Lyon 2 UFR d’Anthropologie, de Sociologie et de Science politique Master 2 de Science politique Parcours Sociologie politique, enquêtes et analyses des processus politiques Résumé Depuis le début des années 1990 et la parution de la traduction française de l’ouvrage de Peter Singer La Libération animale, le mouvement antispéciste s’est développé en France. -

Programme EPIVEGE
ÉPIPHANIES VÉGÉTARIENNES / VEGETARIAN EPIPHANIES Prise de conscience et transition alimentaire / From Realization to Changing Eating Habits 26 & 27 novembre 2020 RENNES Organisation : Émilie Dardenne, Romain Espinosa, Renan Larue Programme général / General program Colloque en ligne / Online conference Jeudi 26 novembre 2020 / Thursday November 26, 2020 09.15 - 09.30 [English] Mots d’introduction / Welcome and opening address 09.30 - 11.00 [English] Session #1 11.00 - 11.30 Pause / Break 11.30 - 12.30 [English] Keynote #1 - Nicolas Treich 12.30 - 14.00 Pause déjeuner / Lunch break 14.00 - 15.30 [Français] Session #2 15.30 - 16.00 Pause / Break 16.00 - 17.00 [Français] Keynote #2 - Florence Burgat Vendredi 27 novembre 2020 / Friday November 27, 2020 09.30 - 11.00 [English] Session #3 11.00 - 11.30 Pause / Break 11.30 - 12.30 [Français] Keynote #3 - Laurent Bègue 12.30 - 14.00 Pause déjeuner / Lunch break 14.00 - 15.30 [Français] Session #4 15.30 - 16.00 Pause / Break 16.00 - 17.00 [Français] Session #5 Programme détaillé / Detailed Programme Colloque en ligne / Online conference Jeudi 26 novembre 2020 / Vendredi 27 novembre 2020 / Thursday November 26, 2020 Friday November 27, 2020 Session #1 : [English] Session #3 : [English] Mots d’ouverture / Opening remarks – Emilie Stefanoni Chiara, Université de Bergame (Italie), Dardenne, Romain Espinosa études animales critiques - “The Eye of the Crocodile”: Nicolas Salliou, Rallou Thomopoulos, Patrick Val Plumwood's epiphany and critical animal studies Taillandier, ETH Zürich (Suisse), INRA, Agrosystèmes, Fernandez Laura, Université Pompeu Fabra écosystèmes et environnement, informatique, (Espagne), information-communication - "It's there, intelligence artificielle - What role for arguments in unavoidable". -

Animail: April 2017 1
Animail: April 2017 1 Animail: April 2017 Dear AASA Members, Things are becoming decidedly Adelaideian around here: We’re all really excited about the Adelaide conference coming up very soon and this edition contains news from our organizers…. Page 2 is a report from our Conference Organisers and page 4 features an update from Victor Krawczyk about the Arts events planned for alongside the conference. The Executive Committee of AASA also had the difficult task of deciding the winners for our Travel Scholarships for the conference. We received over 2 dozen applications and after our rankings and deliberations, the committee decided on 4 clear winners. CONGRATULATIONS to: • Esther Alloun (Domestic PG): 'The promised land for vegans': identity, culture and place in the making of Israeli animal activism' • Sarah Bezan (International PG): Crace's 'The Devil's Larder' and the edibility of human, animal, and vegetable bodies' • Andrea Conner (Independent scholar): ‘Urban Ibis agency’ • Gonzalo Villanueva (Independent scholar): ‘Animals and Law - an Australian history’ Thank you to everyone who applied - the standard of submissions was very high. This edition of Animail contains profiles of 3 AASA members – Zoei Sutton, Victor Krawczyk and Rowena Lennox. A reminder about our Facebook page where you can keep up to date with activities in the field https://www.facebook.com/AASA-Australasian-Animal-Studies-Association- 480316142116752/ and also a reminder about our website with its up to date stream of information (thanks largely to the amazing Lynn Mowson: http://animalstudies.org.au/archives/category/news/call-for-papers. Big thanks to Annie Potts for this month’s new book release section and to Rick De Vos for his member profiles. -
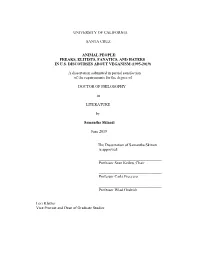
Freaks, Elitists, Fanatics, and Haters in Us
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ ANIMAL PEOPLE: FREAKS, ELITISTS, FANATICS, AND HATERS IN U.S. DISCOURSES ABOUT VEGANISM (1995-2019) A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in LITERATURE by Samantha Skinazi June 2019 The Dissertation of Samantha Skinazi is approved: ________________________________ Professor Sean Keilen, Chair ________________________________ Professor Carla Freccero ________________________________ Professor Wlad Godzich ______________________________ Lori Kletzer Vice Provost and Dean of Graduate Studies Copyright © by Samantha Skinazi 2019 Table of Contents LIST OF FIGURES IV ABSTRACT V DEDICATION AND ACKNOWLEDGEMENT VII INTRODUCTION: LOVING SPECIES 1 NOTES 21 FREAKS 22 RIDICULE: THAT JOKE ISN'T FUNNY ANYMORE 28 EMPATHY AND SHAME: OMNIVORE DILEMMAS IN THE VEGAN UTOPIA 41 TERRORS: HOW DO YOU KNOW IF SOMEONE'S VEGAN? 64 CONCLUSION: FROM TEARS TO TERRORISM 76 LIST OF FIGURES 79 NOTES 80 ELITISTS 88 LIFESTYLE VEGANISM: GOOP AND THE WHITE WELLNESS VEGAN BRAND 100 BLINDSPOTTING VEGANISM: RACE, GENTRIFICATION, AND GREEN JUICE 112 DEMOCRATIC VEGANISM: OF BURGERS AND PRESIDENTS 131 CONCLUSION: THE SPECTER OF NATIONAL MANDATORY VEGANISM 153 NOTES 156 FANATICS 162 WHY GIVE UP MEAT IN THE FIRST PLACE? 170 MUST IT BE ALL THE TIME? 184 WHY TELL OTHERS HOW TO LIVE? 198 CONCLUSION: MAY ALL BEINGS BE FREE FROM SUFFERING? 210 NOTES 223 CONCLUSION: HATERS 233 NOTES 239 REFERENCES 240 iii List of Figures Figure 1.1: Save a cow eat a vegetarian, bumper sticker 79 Figure 1.2: When you see a vegan choking on something, meme 79 Figure 1.3: Fun prank to play on a passed out vegan, meme 79 Figure 1.4: How do you know if someone's vegan? 79 Don't worry they'll fucking tell you, meme iv Abstract Samantha Skinazi Animal People: Freaks, Elitists, Fanatics, and Haters in U.S. -

« Tirer L'homme De La Classe Des Animaux Carnassiers. » : Rousseau
Document généré le 27 sept. 2021 16:39 Sens public « Tirer l’homme de la classe des animaux carnassiers. » Rousseau et les preuves scientifiques de notre nature végétarienne Renan Larue Écrire les communs. Au-devant de l’irréversible Résumé de l'article 2019 Dès l’époque du Discours sur l’origine de l’inégalité, Jean-Jacques Rousseau accorde une place importante à ce qu’il juge être le régime naturel de l’espèce URI : https://id.erudit.org/iderudit/1067463ar humaine, en l’occurrence le frugivorisme. Cet intérêt, à peine relevé par la DOI : https://doi.org/10.7202/1067463ar critique, s’explique aisément par la nécessité que perçoit Rousseau de chercher dans le corps même des hommes des preuves de leur bonté naturelle. Pour que Aller au sommaire du numéro l’homme soit bon naturellement, il faut en effet qu’il ait des tendances végétariennes et un système digestif comparable à celui des paisibles animaux frugivores. Sans cela, nous serions des carnivores, nous serions nécessairement méchants et sourds à la souffrance des êtres sensibles. Ce type Éditeur(s) de réflexions a des échos de plus en plus nombreux dans les débats Département des littératures de langue française contemporains sur notre rapport aux animaux. ISSN 2104-3272 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Larue, R. (2019). « Tirer l’homme de la classe des animaux carnassiers. » : rousseau et les preuves scientifiques de notre nature végétarienne. Sens public. https://doi.org/10.7202/1067463ar Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) Sens Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. -

PUF ART SOC Oct Nov Dec 2020
Art & Société Programme des parutions (événementiel) Août-Septembre 2020 Responsable événementiel : Sarah Dubriont [email protected] 01.55.42.72.78 Chargée événementiel : Eva Cara [email protected] 01.55.42.84.24 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ La pensée végane POINTS FORTS 50 regards sur la condition animale Ouvrage de référence sur un thème RENAN LARUE (DIR.) d’actualité (et qui le restera longtemps) : le véganisme 50 entrées écrites par les meilleurs spécialistes français, suisses, belges, Nourrir le débat sur le véganisme américains et canadiens Sujet incontournable depuis plusieurs Le véganisme prend de plus en plus d'ampleur en Occident. Il s’inscrit dans une riche années et la médiatisation tradition philosophique et traduit deux dispositions psychologiques partagées par la d’associations comme L214. plupart d’entre nous : la répugnance à faire souffrir les animaux et le désir de préserver la planète (l’élevage constituant aujourd’hui une grave menace sur l’environnement). PUBLIC Dans la mesure où il reste minoritaire et contrarie des habitudes profondément ancrées, Tous publics sensibilisés à la le véganisme essuie toutefois une foule de critiques de la part des représentants de condition animale l’industrie agroalimentaire comme d’intellectuels. Or, les débats ne sont pas toujours à la hauteur des enjeux ; les désaccords entre partisans et adversaires reposent même souvent sur des malentendus. Cet ouvrage comble les lacunes et nourrit un débat de société devenu incontournable. Renan Larue est professeur de littérature à l’Université de Californie à Santa Barbara. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux questions végétarienne et végane, notamment Le Végétarisme et ses ennemis (Puf, 2015) pour lequel il a reçu le prix La 9782130819004 DU MÊME AUTEUR Bruyère de l’Académie française. -

Richard Parry
by Richard Parry THE BONNOT GANG The story of the French illegalists Other Rebel Press titles: Dynamite: A century of class violence in America, Louis Adamic Ego and its Own, The, Max Stirner On the Poverty of Student Life Paris: May 1968 Quiet Rumours, various Revolution of Everyday Life , The, Raoul Vaneigem Untying the Knot, Freeman and Levine THE BON NOT GANG by Richard Parry REBEL PRESS, 1987 Published by Rebel Press in 1987 © Richard Parry, 1986 Photographic work by Matthew Parry and Herve Brix ISBN 0 946061 04 1 Printed and typeset by Aldgate Press 84b Whitechapel High Street, London El 7QX Contents Preface5 One From illegality to illegalism Making virtue of necessity9 ii Saint Max15 Two A new beginning Libertad21 ii City of thieves28 iii State of emergency 30 Three The rebels i· Brussels33 ii Paris42 III Blood on the streets 44 iv Strike! 45 Four Anarchy in suburbia The move47 ii The Romainville commune 51 iii' Collapse of the Romainville commune 57 iv Paris again60 Five Bonnot I The 'Little Corporal' 64 ii In search of work65 III The illegalist66 IV Accidental death of an anarchist70 Six The gang forms A meeting of egoists 73 11 Science on the side of the Proletariat75 iii Looking for a target 76 Seven The birth of tragedy I The first ever hold-up by car 80 ii Crimedoesn't pay84 111 Jeux sans frontieres 88 iv Victor's dilemma89 Eight Kings of the road i Drivin' South 94 ii The left hand of darkness 97 iii Stalemate 99 Nine Calm before the storm 1 'Simentoff' 103 ii Of human bondage 104 iii Dieudonne in the hot seat 108 iv Garnier's challenge 109 Ten Kings of the road (part two) 1 Attack 113 ii State of siege 117 Eleven The Suretefights back To catch an anarchist 120 11 Hide and seek 123 iii Exit Jouin 126 Twelve Twilight of the idols The wrath of Guichard 129 11 Shoot-out at 'The Red Nest' 133 iii Obituaries 137 iv To the Nogent station 139 v The last battle 142 Thirteen In the belly of the beast 1 Limbo 147 ii Judgement 152 iii Execution 159 Fourteen The end of anarchism? 166 Epilogue 175 Map of Paris c. -

Curriculum Guide. Grade 8. Louisiana State Dept. of Education, Bato
DOCUMENT RESUME ED 296 931 SO 019 166 TITLE Acadians of Louisiana: Curriculum Guide. Grade 8. Bulletin 1780. INSTITUTION Louisiana State Dept. of Education, Baton Rouge. Div. of Academic Programs. PUB DATE [873 NOTE 237p.; Acadian Odyssey Bicentennial Commission and the Council for the Development of French in Louisiana co-sponsored the development of this publication. PUB TYPE Guides Classroom Use Guides (For Teachers) (052) EDRS PRICE MF01/PC10 Plus Postage. DESCRIPTORS Course Content; Cultural Awareness; Cultural Background; *Cultural Education; Cultural Influences; Curriculum Development; Folk Culture; *Grade 8; History; History Instruction; Information Sources; Instructional Materials; Junior High Schools; Learning Activities; Program Content; Resource Units; *Social Studies; State Curriculum Guides; *State History; State Programs; Units of Study IDENTIFIERS *Acadians; Cajuns; *Louisiana ABSTRACT This document, a supplement to the "Louisiana Studies Curriculum Guide," was designed to enhance junior high school students' appreciation for the Acadian settlers impact on Louisiana history and culture. A course outline presents four units of study that include: (1) early history; (2) life in Louisiana; (3) social and cultural life; and (4) the evolving and modern Cajuns. Each unit is divided into specific sections that contain: (1) generalization, concept, and learner outcome statements; (2) a content outline; and (3) suggested activities. A 50-item bibliography and glossary of terms are provided. Appendices include: (1) a suggested teaching timetable; (2) a teacher's reference entitled, "Louisiana French Heritage"; (3) student handouts; (4) maps; (5) Acadian music and dances; (6) suggested French language learning objectives and activities; (7) an overview of Louisiana French oral literature; (8) an exploration of the role and history of Cajun music in Louisiana French society; and (9) a selected collection of Acadian recipes. -

L'éléphant Dans La Pièce
L’éléphant dans la pièce∗ Pour une approche économique de l’alimentation végétale et de la condition animale Romain Espinosa CNRS, CREM - Université de Rennes I 10 janvier 2019 À paraître dans la Revue d’Économie Politique Résumé Cet article propose une discussion sur l’alimentation végétale et la condition animale comme objets d’étude pour la science économique. Il répond à trois questions : Pourquoi les économistes devraient-ils s’intéresser à la question de la consommation de produits d’origine animale ? Quelle peut être la contribution de l’économie aux discussions académiques existantes ? Quelles raisons peuvent expliquer le peu d’intérêt porté jusque-là par les économistes à cette problématique ? Ce travail expose tout d’abord trois arguments pour lesquels la science économique devrait prendre en compte la consommation de produits d’origine animale : une raison environnemen- tale, une raison sanitaire et une raison éthique. Il présente ensuite l’analyse comportementale de la consommation de viande développée en psychologie, puis discute comment l’économie pour- rait contribuer à ce champ de recherche (économie comportementale, économie des politiques publiques, économie industrielle et économie politique). La dernière partie propose une discus- sion plus exploratoire sur le faible intérêt porté jusqu’à aujourd’hui par les économistes à ces questions. Mots Clefs : Alimentation végétale, condition animale, animal studies, veganomics. 1 Introduction Cette dernière décennie a vu naître et s’épanouir de nombreux travaux scientifiques autour de la nécessité de réduire significativement la consommation de viande, et plus généralement la consommation de produits d’origine animale. De multiples articles en sciences naturelles publiés dans de prestigieuses revues telles que Nature, Science ou the National Proceedings of the Academy of Sciences ont établi un constat alarmant sur les dommages environnementaux et sanitaires associés à la consommation de viande. -

Thèse Et Mémoire
Université de Montréal Le véganisme au Québec : cartographie d’un mouvement par Alexia Renard Faculté des arts et des sciences Mémoire présenté En vue de l’obtention du grade de Maîtrise ès sciences (M. Sc.) en environnement et développement durable Option enjeux sociaux et gouvernance 23 août 2019 © Alexia Renard, 2019 Université de Montréal Faculté des arts et des sciences Ce mémoire intitulé Le véganisme au Québec : cartographie d’un mouvement Présenté par Alexia Renard A été évalué par un jury composé des personnes suivantes Sara Teitelbaum Présidente-rapporteure Pascale Dufour Directrice de recherche Laurence Bherer Membre du jury Résumé Dans un contexte d’intérêt croissant pour le véganisme en Occident, cette recherche exploratoire se propose de brosser le portrait des acteurs collectifs du mouvement végane québécois. Loin d’être une pratique individuelle seulement, le véganisme est porté, au Québec, par différents groupes (groupes de base, organisations à but non lucratif et organismes de charité) qui défendent aussi bien les droits des animaux que la nécessité de se tourner vers une alimentation végétale pour la santé et l’environnement. À l’aide d’une analyse de réseaux, nous définirons, sur le plan organisationnel, la configuration du mouvement et ses frontières, montrant la présence d’une structure fragmentée. La recherche se proposera par la suite de cerner les éléments constitutifs de l’identité collective du mouvement, qui repose sur une idée revendiquée plus ou moins frontalement : l’abolition de l’exploitation animale. Cette identité s’incarne dans des actions diverses, non violentes et la plupart du temps légales, qui ciblent tant la culture dominante, c’est-à-dire la consommation normalisée de produits animaux, que les sphères politiques et juridiques, malgré l’absence relative du mouvement dans l’arène politique conventionnelle.