La Planification Du Commerce Extérieur : L'exemple Polonais
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rapport Au Ministre Des Affaires Étrangères M. Dominique De Villepin Du Comité Indépendant De Réflexion Et De Propositio
1 Rapport au Ministre des affaires étrangères M. Dominique de Villepin du Comité indépendant de réflexion et de propositions sur les relations Franco-Haïtiennes Janvier 2004. 2 3 I Constats Une singulière absence p. 5 Quelle sorte de dette ? p. 11 Saumâtre bilan… p. 17 Une nouvelle donne ? p. 25 Pistes pour un décollage (économique) p. 35 École et culture : main dans la main p. 42 II Propositions Diplomatie/sécurité p. 51 État de droit/Institutions p. 59 Économie/Coopération p. 65 Éducation/Culture p. 75 III Annexes « Réparation pour l’esclavage » ? p. 84 « Restitution de la dette de l’indépendance » ? p. 89 Situation religieuse p. 92 Pandiassou : une communauté originale p. 95 Les prêts sans remboursement du capital p. 97 4 AVERTISSEMENT Ce rapport concerne le devenir des relations franco- haïtiennes dans leur ensemble. Il ne relève pas d’un geste partisan. C’est un acte d’amitié envers tout un peuple, y compris envers ceux qui n’ont pas voix au chapitre. Aucun côté en Haïti, opposition ou pouvoir, ne saurait donc s’en prévaloir, ni s’en offusquer. La conjoncture politique de ce pays a fait ou fera l’objet d’autres types d’intervention de la part des membres du Comité. Il s’agit ici de la transcender, pour contribuer à un avenir distinct et en tout cas meilleur. 5 I CONSTATS Une singulière absence « Pas de pétrole, pas d’uranium ni de pierres précieuses, nulle arme de destruction massive, pas de détroit stratégique, pas de terroristes à l’exportation, guère de plages avenantes, un sida endémique et des milliers de boat-people que les courants poussent vers la Floride ou les Bahamas. -

Programme Detaille
Liberté I Justice I Enfant I Protection I Égalité I Femme Droits I Fraternité I Homme I Solidarité I Démocratie Éducation19 et I Travail 20 octobre I Liberté 2012 I Justice I Enfant I Protection Égalité I FemmeUzès - Gard I Droits I Fraternité I Homme Solidarité I Démocratie I Éducation I Travail I Liberté Justice I Enfant I Protection I Égalité I Femme I Droits Fraternité I Homme I Solidarité I Démocratie I Education Travail I Liberté I Justice I Enfant I Protection I Égalité Femme 1I èresDroits Rencontres I Fraternité CharlesI Homme GideI Solidarité Démocratie I Éducation I Travail I Liberté I Justice Enfant I Protection« Économie I Égalité Sociale I Femme et I SolidaireDroits I Fraternité Homme I Solidaritéet Droits I Démocratie de l’Homme I Éducation » I Travail Liberté I Justice I Enfant I Protection I Égalité I Femme Droits I Fraternité I Homme I Solidarité I Démocratie Éducation I Travail I Liberté I Justice I Enfant I Protection Égalité I Femme I Droits I Fraternité I Homme I Solidarité Uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Démocratie PR OI ÉducationGRsdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjAMM I TravailE DET I LibertéAILLE I Justice Enfant I Protectionklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc I ÉgalitéDossier I Femme de presse I Droits I Fraternité Homme I Solidaritévbnmqwertyu I Démocratie iopasdfghjklzxcvbnm I Éducation I Travail Liberté I Justice I Enfantqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert I Protection I Égalité I Femme yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop Droits I Fraternitéasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg I Homme I Solidarité I Démocratie ères Rencontres -

Langages Et Communication
Langages et communication 139e congrès des Sociétés historiques et scientifiques Nîmes du 5 au 10 mai 2014 Programme Exposée au Musée archéologique national de Florence, la statue de l’Arringatore du iie siècle av. J.-C., en bronze et grandeur nature, fut découverte près de Pérouse en 1446 et rapidement acquise par Côme de Médicis, dont elle orna l’appartement au palais Pitti. On pensa alors qu’elle représentait Scipion l’Africain en train de haranguer ses troupes – d’où son nom. Il s’agit en réalité d’une œuvre étrusque qui représente un magistrat local dont le nom, Aule Metelis fils de Vel, figure dans l’inscription, rédigée en étrusque, visible sur le bord inférieur de la toge. Le personnage porte les insignes de sa fonction : toge à bande de pourpre, anneau d’or, hautes chaussures montantes. Le geste du bras droit levé a reçu des interprétations diverses : appel au silence de l’orateur avant de s’adresser au peuple ou, étant donné le caractère votif de la statue qui porte une dédicace au dieu étrusque Tece Sans, geste de prière. Table des matières Ouverture .....................................................................................................................5 Conférence de presse ....................................................................................................5 Conférence plénière ....................................................................................................31 Table ronde des sociétés savantes ................................................................................38 Présentation -

L'organigramme Du Parti Socialiste
vaillent dans les. dix-huit grandes commissions grandes écoles:, je Me donnais les moyens du parti, dissimulés parfois derrière des pseu- d'accéder aux dossiers et à Une certaine culture donymes. Pour expliquer leur engagement, on dans cette société, dbime le droit à la avancera - que, sentant les vents changer, ils parole. » préparent leur avenir. Comme dit un « expert » Collaboratenr de François Mitterrand 'depuis qui a mauvais esprit : « Un énarque de gauche janvier 1974, il est très Vite devenu son homme est moins différent d'un énarque de droite que de confiance. C'est lui qui : a 'coordonné la mise d'un militant socialiste. » là n'empêche qu'en au Point du plan .écononrlique du Candidat de bûchant pour le P.S., la plupart ontdélibéré- la. gauche lors dé l'élection présidentielle: C'est ment sacrifié leir carrière . administrative. encore lui que Mitterrand enVoya alors négo- Le cas de Jacques Boniface — c'est un cier discrèteniènt; avec le secrétaire d'Etat pseudonyme — est; à cet égard, éclairant. Doc- allemand .atiX Finances, lâ 'conséquences d'une teur en sciences de gestion, la trentaine un arrivée de la gauche au pouvoir .en France. • brin chevelue, il végète dans une administra- . tion après un passage aux Finances. Ancien Dans une enquête de « l'Expansion » militant P.S.U., membre du P.S., qu'il a rejoint Philippe Lefournier le diasSait, avec Fran#is avec Michel Rocard aux Assises du Socialisme, Perretix et Lionel Stoleru, darts la catégorie des il ne peut espérer monter en grade, et il s'en économistes radicaux »,(a.0 sens anglo-saxon), moqué. -

L'analyse Lexico-Sémantique Comparative Des Mots Et De La Notion ''Etat/Gosudarstvo'' Dans Les Langues Fran
L’analyse lexico-sémantique comparative des mots et de la notion ”Etat/gosudarstvo” dans les langues francaise et russe Valentina Toujikova - Caillat To cite this version: Valentina Toujikova - Caillat. L’analyse lexico-sémantique comparative des mots et de la notion ”Etat/gosudarstvo” dans les langues francaise et russe. Linguistique. Université de Lorraine, 2012. Français. NNT : 2012LORR0140. tel-01749224 HAL Id: tel-01749224 https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01749224 Submitted on 29 Mar 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. AVERTISSEMENT Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie. Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci implique une obligation de citation et de référencement lors de l’utilisation de ce document. D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite encourt une poursuite pénale. Contact : [email protected] LIENS Code de la Propriété Intellectuelle. articles -

FONDS PRIVE De ROBERT PONTILLON 8 FP Série 3 Parti
FONDATION JEAN-JAURES - CENTRE D’ARCHIVES SOCIALISTES FONDS PRIVE de ROBERT PONTILLON 8 FP Série 3 Parti socialiste 1971-1992 Robert Pontillon et Pierre Mauroy au Congrès extraordinaire de Dijon – mai 1976. Coll FJJ-MPG. Inventaire Fonds Robert Pontillon, série Parti socialiste 8 FP 3 INTRODUCTION Conservée au Centre d’archives socialistes (CAS) de la Fondation Jean-Jaurès, 6 Cité Malesherbes, la série 8 FP 3, du fonds privé Robert Pontillon, rassemble les dossiers politiques de Robert Pontillon, membre de la direction du Parti socialiste (1971-1992). Licencié de droit, Robert Pontillon a eu une longue carrière journalistique et politique. Journaliste à Franc-Tireur et au Populaire en 1948, chef de cabinet puis directeur de cabinet du secrétaire d’État à la Présidence du conseil chargé de l’information (1956-1957), il a ensuite été membre du cabinet de Gérard Jaquet, ministre de la France d’Outre-Mer (1957- 1958). Robert Pontillon a également été directeur général de la Radiodiffusion française en Afrique puis de l’Office de coopération radiophonique (1957-1964). Enfin, il a été directeur des activités éducatives de la Compagnie Thomson Houston à partir de 1964. Ayant fait parti des Faucons rouges durant sa jeunesse, Robert Pontillon adhère à la SFIO dès 1937. Il a été responsable du Centre international de presse (CIP) socialiste et membre du Comité directeur de la SFIO, du Nouveau Parti socialiste puis du Parti socialiste à partir de 1963. Il a également été responsable aux Relations internationales de la SFIO, puis du Parti socialiste jusqu’en 1979, représentant le PS aux réunions de l’Internationale socialiste. -
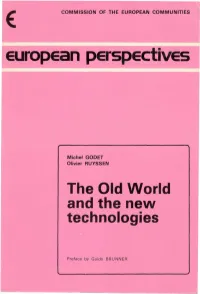
The Old World and the New Technologies
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES The Old World and the new technologies Challenges to Europe in a hostile world by M. GODET and O. RUYSSEN In collaboration with the other members of the FAST team: Riccardo Petrella, Mark Cantley, Olav Holst, Roland Hiiber THE EUROPEAN PERSPECTIVES SERIES BRUSSELS This publication was prepared outside thc Commission of the European Communities. The opinions expressed in it are those of the authors alone; in no circumstances should they be takcn as an authoritativc statement of thc views of the Commission. The French original version is published under the titte: L'Europe en mutation. The English édition is a version adapted by Christopher Huhne. This publication is also availablc in DA ISBN 92-825-1724-1 DE ISBN92-825-1725-X FR ISBN 92-825-1727-6 IT ISBN 92-825-1728-4 NL ISBN 92-825-1729-2 ES ISBN 92-825-1730-6 GR ISBN 92-825-1731-4 PT ISBN 92-825-1732-2 Cataloguing data can be found at the end of this publication Luxembourg: Office for Officiai Publications of the European Communities, 1981 ISBN 92-825-1726-8 Catalogue number; CB-3O-8O-I!6-EN-C © ECSC - EEC - EAEC, Brussels. Luxembourg, 1980 Printed in Iialy Préface We are living in an âge ofincreasing uncertainty, and its dangers are no more clearty demonstrated tkan by the energy issue. Forecasting is more necessary than ever as we hâve to take décisions today that will condition the future. The report 'The Old World and the new technologies ' attempts to iden- tify the future prospects and problems that could qffect the long-terni de- velopment of the Community. -

Dossier: Economie Et Gouvernance
Institut Cedimes LES CAHIERS DU CEDIMES Université Valahia de Târgoviște Publication semestrielle Vol. 8 - No2 - 2014 Articles du numéro précédent des Cahiers du Cedimes Vol. 8, No 1, 2014 EDUCATION, FORMATION 4 201 Quelle éducation dans la mondialisation : les défis de l’hybridation de – l’éducation en Afrique centrale. Le cas du Cameroun et du Congo-Brazzaville 2 (B. A. InstitutMankou, CamerounCEDIMES) CEDIMES Paris CEDIMES Târgovişteo N Dossier: – Education, composition de la main d’œuvre et productivité 8 des entreprisesCampus duindustrielles Jardin Tropical au Cameroun de Paris Faculté d’Administration et Faculté des Sciences Economiques 45 bis Avenue de la Belle Gabrielle d’Echanges Internationaux Université Valahia de Targoviste (P. M. Nga Ndjobo, Y.A. Abessolo, Cameroun) Vol. Vol. 94736, Nogent sur Marne, France Université Paris XII Rue Lt. Stancu Ion, no., 35 De l’utilitéTél: du(33 savoir 1) 43 transversal 94 72 4a2 : un renversement61 de paradigmeAvenue du Général de 130105, Targovişte, Romania Economie et (B. RousselFax: , (33C. Sapta, 1) 43 France 94 72) 48 Gaulle, 94010 Tél: (40 245) 211 809 www.cedimes.org Créteil cedex, France Fax: (40 245) 213 920 Pour une formation continue et une gestion prévisionnelle des carrières gouvernance dans la police Congolaise : Prospective d’un modèle managérial (W. M. B. Bongoye, Congo) CITOYENNETÉ ET RELIGION Citoyenneté et religion. Approcher l’altérité par une double contextualisation (A. Hammouche, France) CEDIMES du Cahiers Les VARIA La croissance économique de l’économie turque aux -
Afrique + Art Moderne & Contemporain
Afrique + Art moderne & Contemporain MERCREDI 19 MAI 2021 PIASA CONTACT ART CONTEMPORAIN AFRICAIN Co-Directrice Olivia Anani Tél. : +33 1 53 34 10 18 [email protected] Co-Directrice Charlotte Lidon Tél. : +33 1 53 34 10 04 [email protected] Afrique + + Afrique Art moderne moderne Art Contemporain & Vente N° 1924 Enchérissez en direct sur www.piasa.fr Afrique + Art moderne & Contemporain Vente / Auction Mercredi 19 mai 2021 à 16h Wednesday May 19th 2021 at 4:00 pm Lieu de vente / Location PIASA 118 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Exposition publique/ Public Viewing Vendredi 14 mai de 10h à 18h / Friday May 14th from 10.00 am to 6.00 pm Samedi 15 mai de 11h à 18h / Saturday May 15th from 11.00 am to 6.00 pm Lundi 17 mai de 10h à 18h / Monday May 17th from 10.00 am to 6.00 pm Mardi 18 mai de 10h à 18h / Tuesday May 18th from 10.00 am to 6.00 pm Mercredi 19 mai de 10h à 12h / Wednesday May 19th from 10.00 am to 12.00 am Téléphone pendant l'exposition et la vente / Contact during viewings and the sale T. +33 1 53 34 10 10 Enchérissez en direct sur www.piasa.fr Bid live on www.piasa.fr AFRIQUE + ART MODERNE & CONTEMPORAIN : (1) © Xavier Defaix : (1) © Xavier Photos Introduction Il est un proverbe africain qui dit qu’il faut un village pour élever un enfant. En ce sens, ce catalogue est le fruit de réflexions et enseignements acquis tout au long d’années passées auprès des artistes, des commissaires d’exposition, des marchands et, bien entendu, de collectionneurs passionnés. -

La Transparence Nécessaire Des Données De Santé
Quatrième colloque d'économie de la santé organisé par la MTRL et l'Association Charles-Gide Samedi 4 octobre 2014 Musées Gadagne (petit théâtre) sur le thème : La transparence nécessaire des données de santé *** Intervenants : Didier SICARD , professeur de médecine, président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique, président du comité d'experts de l'Institut des données de santé François PESTY , expert conseil en médicaments Patrick GUÉRIN , docteur vétérinaire, président du Celtipharm Thomas LAURENCEAU , rédacteur en chef de 60 Millions de consommateurs Jean MATOUK , professeur honoraire de sciences économiques Jean-Louis TOURAINE , professeur d'immunologie, député de Lyon François BLANCHARDON , président du Collectif interassociatif sur la santé Rhône-Alpes *** INTRODUCTION Denis Tardy : Bonjour à tous et bienvenue au musée historique de la ville de Lyon, le musée Gadagne, où va se dérouler aujourd'hui le quatrième colloque d'économie de la santé, organisé par la MTRL et l'association Charles-Gide, sur le thème de la transparence nécessaire des données de santé. L'accueil pour la Ville de Lyon – nous sommes là dans un musée de la ville de Lyon – va être fait par Jean-Louis Touraine. Jean-Louis Touraine : Si je suis ici avec vous pour discuter des données de santé, je représente aussi quelques instants le maire de Lyon, Gérard Collomb, pour vous dire le plaisir que la municipalité a de vous accueillir en ces lieux. Je vais être très bref, puisque ce n'est pas ce que vous avez envie d'entendre de façon longue, mais simplement que vous sachiez le plaisir que les Lyonnais ont d'accueillir des personnes d'horizons variés, en particulier dans le domaine de la santé, qui est un des secteurs phares, avec la gastronomie et quelques autres spécialités lyonnaises, de la ville de Lyon. -

En Politique
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris 193.54.67.93 01/12/2016 09h26. © Presses Sciences Po (P.F.N.S.P.) L’« ECONOMISTE´ » EN POLITIQUE LES EXPERTS SOCIALISTES FRANÇAIS DES ANNÉES 1970 Mathieu Fulla e 11 février 1976, François Mitterrand est l’invité de « C’est-à-dire » sur Antenne 2. Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS) profite de l’occasion pour répondre ver- L tement aux accusations d’incompétence économique proférées la veille dans Le Monde par le ministre des Finances Jean-Pierre Fourcade. Qualifiant ce dernier de « spécialiste du déficit », en référence à l’échec de la relance par l’investissement du gouvernement Chirac, il lui propose un débat télévisé que le ministre s’empresse d’accepter1. Après quelques ter- giversations dans l’un et l’autre camp, l’émission est diffusée en direct le 2 mars sur Antenne 2. Quoique fort ennuyeux de l’avis général des observateurs, ce débat constitue un jalon impor- tant dans la quête socialiste de crédibilité économique : Jean-Pierre Fourcade ne parvient pas à prendre l’ascendant sur François Mitterrand dans un domaine où sa famille politique jouit pourtant d’un avantage comparatif historique. Le ministre sort furieux des studios de télévision après avoir constaté que son adversaire disposait des mêmes dossiers que ceux fournis par ses services pour préparer l’émission2. Peu suspects de sympathies socialistes, Les Échos renvoient les duettistes dos à dos, relevant même les progrès du chef de file de l’oppo- sition dans la maîtrise du raisonnement et du langage économiques orthodoxes3. -

Lionel Jospin Nestlé, Ford, Merrill Lynch, Sie- Gentes »
LeMonde Job: WMQ0605--0001-0 WAS LMQ0605-1 Op.: XX Rev.: 05-05-00 T.: 11:06 S.: 111,06-Cmp.:05,11, Base : LMQPAG 14Fap: 100 No: 0439 Lcp: 700 CMYK www.lemonde.fr 56e ANNÉE – No 17193 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE SAMEDI 6 MAI 2000 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI L’Europe ILOVEYOU, virus planétaire qui doute b Le virus informatique le plus destructeur de l’histoire a envahi des centaines de milliers a L’Union peine d’ordinateurs b CIA, Pentagone, Chambre des communes, Nestlé, Ford ont été touchés sur plusieurs b Un milliard de dollars de dégâts aux Etats-Unis b L’ère Internet face à un défi majeur ILOVEYOU, le virus informatique ropéennes auraient perdu la totalité dossiers : institutions, le plus virulent et le plus destructeur de leurs archives photographiques. de l’histoire, a endommagé, jeudi Les dégâts sont estimés pour les élargissement, 4 mai, des centaines de milliers seuls Etats-Unis à 1 milliard de dol- d’ordinateurs en Asie, en Europe et lars. défense... en Amérique. Venu apparemment Les virus pourraient devenir la des Philippines, le virus peut modi- plaie de l’informatique du prochain a fier la page de garde du logiciel de siècle. Après le peu de consé- SIPAPRESS L’euro n’a pas navigation Internet Explorer, créer quences du bogue de l’an 2000, la EXCEPTION FRANÇAISE plusieurs programmes sur le disque menace que font planer ces minus- entraîné le « big bang » dur, se propager via Internet à l’aide cules programmes se révèle au- du carnet d’adresse des victimes et jourd’hui autrement plus sérieuse.