Mpinaultdef.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fondements Scientifiques En Vue De La Création D'une Zone De Protection
Asters - CEN Haute-Savoie 84 route du Viéran PRINGY 74370 ANNECY Tél. 04 50 66 47 51 www.cen-haute-savoie.org Fondements scientifiques En vue de la création d’une zone de protection d’habitat naturel du Mont-Blanc - Site d’exception ● Rédaction Bernard Bal, Olivier Billant, Jean-Baptiste Bosson et Lisa Wirtz 28 avril 2020 ● NOTE RÉALISÉE AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE de la Haute-Savoie Table des matières Remerciements 4 Préambule : Protéger le toit de l’Europe 4 1. Éléments de contexte 5 1.1. Un concentré de superlatifs 5 1.2. Un massif sous pression à l’Anthropocène 5 1.2.1. Un bouleversement climatique sans précédent dans l’Histoire 5 1.2.2. L’enjeu de la fréquentation 8 2. Analyse topographique de la zone de protection proposée 9 3. Patrimoine géologique et hydrologique 11 3.1. Géologie 11 3.2. Géomorphologie et hydrologie 12 3.2.1. Formes et processus glaciaires 13 3.2.2. Formes et processus périglaciaires et gravitaires 21 3.2.3. Formes et processus torrentiels et lacustres 25 3.3. Richesse, état et enjeux de conservation du patrimoine géologique et hydrologique 27 4. Patrimoine biologique 30 4.1. Habitats 30 4.1.1. Sources de données 30 4.1.2. Liste des habitats / commentaire 31 4.1.3. Cartographie / analyse 32 4.1.4. Etat de conservation /menaces / sensibilité 33 4.2. Flore 36 4.2.1. Sources de données 36 4.2.2. Liste des espèces / commentaires 36 4.2.3. Cartographie / Analyse 37 4.2.4. Etat de conservation / menaces / sensibilité 37 4.3. -

Shots from the Backwoods C. Douglas Milner 78
ALASKA AND THE YUKON-PT III the Park Service has restricted airdrops in the parks) some 35 miles from Kantishna over McGonagall Pass and up the heavily crevassed Muldrow Glacier to the 2750 level, a 237 5m gain in elevation. ~hher mushers cross the Brooks Range in spring and sortie into the Wrangells and lesser peaks frequently. For Outsiders, a mountain trip to Alaska is often the costly culmination of several years' training in other ranges, so a major climb consistent with the rite de passage that an Alaskan expedition represents is chosen, some peak or place either well known, revered for its obscurity, or representing a major new demonstration ofgrande alpinisme in the great ranges. The limited geographic information available to Outsiders also tends to constrict their climbing creativity to a few well-known areas now heavily travelled. The result is a crisis of wilderness consciousness, an effort to ply 'trade routes' in a land held sacred precisely because of its condition of uncertainty. It is a demonstration of a curious 'uniqueness paradox' of mountain eering in Alaska: because of its unique frontier social milieu and relatively virgin climbing environment, mountaineers are drawn in large numbers; and, as a consequence of their concentration in limited areas, their presence erodes the very atmosphere that drew them there in the first place. The American character and mountaineering experience is founded on the exploration of wilderness, and the subsequent creation of new frontiers in technique and the spirit to replace those passed by. A dramatic shift in individual attitude about the act of climbing in an area of wilderness is now urgently necessary to preserve the interaction of innocence, uncertainty, and discovery that characterizes the expansive wilderness expedition experience in a place like Alaska. -

Les Clochers D'arpette
31 Les Clochers d’Arpette Portrait : large épaule rocheuse, ou tout du moins rocailleuse, de 2814 m à son point culminant. On trouve plusieurs points cotés sur la carte nationale, dont certains sont plus significatifs que d’autres. Quelqu’un a fixé une grande branche à l’avant-sommet est. Nom : en référence aux nombreux gendarmes rocheux recouvrant la montagne sur le Val d’Arpette et faisant penser à des clochers. Le nom provient surtout de deux grosses tours très lisses à 2500 m environ dans le versant sud-est (celui du Val d’Arpette). Dangers : fortes pentes, chutes de pierres et rochers à « varapper » Région : VS (massif du Mont Blanc), district d’Entremont, commune d’Orsières, Combe de Barmay et Val d’Arpette Accès : Martigny Martigny-Combe Les Valettes Champex Arpette Géologie : granites du massif cristallin externe du Mont Blanc Difficulté : il existe plusieurs itinéraires possibles, partant aussi bien d’Arpette que du versant opposé, mais il s’agit à chaque fois d’itinéraires fastidieux et demandant un pied sûr. La voie la plus courte et relativement pas compliquée consiste à remonter les pentes d’éboulis du versant sud-sud-ouest et ensuite de suivre l’arête sud-ouest exposée (cotation officielle : entre F et PD). Histoire : montagne parcourue depuis longtemps, sans doute par des chasseurs. L’arête est fut ouverte officiellement par Paul Beaumont et les guides François Fournier et Joseph Fournier le 04.09.1891. Le versant nord fut descendu à ski par Cédric Arnold et Christophe Darbellay le 13.01.1993. Spécificité : montagne sauvage, bien visible de la région de Fully et de ses environs, et donc offrant un beau panorama sur le district de Martigny, entre autres… 52 32 L’Aiguille d’Orny Portrait : aiguille rocheuse de 3150 m d’altitude, dotée d’aucun symbole, mais équipée d’un relais d’escalade. -

53 ASCENSIONS ET AVENTURES EN MONTAGNE CHOISIES Par Pierre-André TOUTTAIN PRÉFACE De Claude METTRA ILLUSTRATIONS De Georges BEUVILLE
COLLECTION Trésor des Jeunes CENT ET UN CONTES Préface de Maurice Fombeure DEUX CENT CINQUANTEPréface de René POÈMES Poirier DE FRANCE SOIXANTE-QUINZE AVENTURES VÉCUES DEPréface LA deTERRE, Pierre MacDE Orlan,LA MERde l'Académie ET DU Goncourt CIEL CENT VINGT HISTOIRES DE BÊTES Préface du Dr F. Méry IMAGES ET ÉPISODES DE CENT GRANDES FIGURES FRANÇAISES Préface de Georges Duhamel, de l'Académie française CENT CINQUANTE AVENTURES DE CHASSE ET DE PÊCHE Préface de François Edmond Blanc SOIXANTE RÉCITS DU NOUVEAU MONDE Préface de A. t'Serstevens CINQUANTE EXPLOITSPréface de Etienne ET RÉCITSLalou SPORTIFS CINQUANTE-CINQ HISTOIRES EXTRAORDINAIRES FANTASTIQUESPréface de Marcel ET INSOLITESAymé SOIXANTE-CINQPréface VOCATIONS de Luc Bérimont DE MUSICIENS SOIXANTE-DIX BEAUX MÉTIERS Préface de Charles Vildrac CINQUANTE-SEPT AVENTURES, VOYAGES ET COMBATS SUR MER Préface de Georges-G. Toudouze, de l'Académie de Marine QUATRE-VINGT-CINQ RÉCITS ET AVENTURES DE L'AIR Préface de Didier Daurat CINQUANTE-DEUX NOUVELLES ET RÉCITS POUR ELLES Préface de Marianne Monestier Des premiers voyages au Mont-Blanc à la conquête de f Annapurna 53 ASCENSIONS ET AVENTURES EN MONTAGNE CHOISIES par Pierre-André TOUTTAIN PRÉFACE de Claude METTRA ILLUSTRATIONS de Georges BEUVILLE GRUND PARI S « Sans doute, d'autres iront-ils affronter des pics peut-être moins hauts, mais plus redoutables encore. Lorsque le dernier aura succombé, comme hier sur les Alpes et aujourd'hui sur les Andes, il restera à conquérir les faces et les arêtes. Non, au siècle de l'aviation, le terrain de jeu des meilleurs grimpeurs n'est pas prêt de trouver ses limites. » Lionel TERRAY (Les Conquérants de l'Inutile) Aux futurs 64 conquérants de l'inutile". -

21 Juillet → 4 Août 2020
POUR 6e TOUS ! ÉDITION PROGRAMME 4 AOÛT 2020 21 JUILLET → Savoie Mont Blanc - Val d’Aoste 32 Géorandos Une Conférence itinérante Autour du Mont-Blanc www.geofestival2020.com COMMENT S’INSCRIRE LA CONFÉRENCE AUX GÉORANDOS ? ITINÉRANTE ! ENTRÉE GRATUITE C’est très simple ! À partir du 21 mars 2020, inscription et paiement en ligne depuis notre site : www.geofestival2020.com D’OÙ VIENNENT BIENVENUE À LA 6E ÉDITION DU GÉOFESTIVAL ALPIN ! Pour toute question ou renseignement, écrivez-nous à : [email protected] LES ALPES ? Voyage dans le temps et l’espace, L’Association Beaufortain Géo Découvertes et tous ses partenaires vous proposent un Toutes les activités du Géofestival alpin nouveau « Voyage au centre de la pierre » autour du Mont-Blanc dans sa partie sud. 2020 sont proposées « à la carte ». à travers les climats du passé ! Un programme sur 15 jours pendant l’été 2020, avec une conférence itinérante d’introduction Conférence d’introduction grand public organisée en soirée, dans les 6 communes accueillant → Les 32 géorandos sont payantes. Les places sont géologique animée par cette année la 6e édition du Géofestival alpin. Chaque conférence limitées à 30 participants. Inscription obligatoire avant Gilles De Broucker et Une réelle le 15 Juillet. sera suivie pendant 2 à 6 jours de randonnées adaptées à tous Yves Siméon. valeur ajoutée Le Géofestival niveaux et offrant des paysages spectaculaires, en Savoie ® : → La conférence itinérante dans 6 communes est avant de participer un évènement nature et Une approche grand public aux Géorandos ! Mont Blanc et Val d’Aoste. Nous vous proposons donc un grand public, festif, culturel et gratuite et sans inscription, dans la limite des places disponibles. -

Proquest Dissertations
Climbers' Perceptions Toward Sustainable Bouldering at the Niagara Glen Nature Reserve Jeremy R. Thompson, BRLS Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Applied Health Sciences (Leisure Studies) Supervisor: Garrett Hutson, PhD Faculty of Applied Health Science, s, Brock University St. Catharines, Ontario Jeremy R. Thompson © May 2009 Library and Archives Bibliothèque et ?F? Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de l'édition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A0N4 OttawaONK1A0N4 Canada Canada Your file Votre référence ISBN: 978-0-494-68175-6 Our Me Notre référence ISBN: 978-0-494-68175-6 NOTICE: AVIS: The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant à la Bibliothèque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par télécommunication ou par l'Internet, prêter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des thèses partout dans le loan, distribute and sell theses monde, à des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non- support microforme, papier, électronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriété du droit d'auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protège cette thèse. Ni thesis. Neither the thesis nor la thèse ni des extraits substantiels de celle-ci substantial extracts from it may be ne doivent être imprimés ou autrement printed or otherwise reproduced reproduits sans son autorisation. -

Università Degli Studi Di Torino Facoltà Di Scienze Della Formazione Dissertazione Finale
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE CORSO DI STUDIO TRIENNALE IN DISCILINE DELLE ARTI DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO DISSERTAZIONE FINALE LA DANSE ESCALADE: UN RECENTE FENOMENO ARTISTICO CULTURALE Relatore: ch.mo prof. Candidato: Alessandro Pontremoli Michele Fanni matr. n°715076 Anno accademico 2011 - 2012 1 INDICE I ORIGINI STORICO-CULTURALI 1. Introduzione ……………………………………………………………………….. 3 2. I Pionieri. L’arrampicata libera agli albori del Novecento ………………………... 4 3. Paul Preuss: «punto di partenza e punto di arrivo» ……………………………….. 6 4. Audaci arrampicatori “liberi” nell’epoca dell’artificiale ………………………….. 9 5. Pierre Allain: l’importanza del gesto ……………………………………………… 10 6. Gaston Rébuffat: azione e cultura …………………………………………………. 11 7. Georges Livanos: la “Nuova Era” giunge dal mare ……………………………….. 12 8. La reazione dei Puristi all’artificiale . ……………………………………………... 12 9. “Nuova Visione” …………………………………………………………………... 14 10. “Nuovi Mattini” …………………………………………………………………… 15 11. Evoluzione o tradimento? L’arrampicata nel passaggio tra anni Settanta e Ottanta……………………………………………………………………................ 16 12. Arrampicata Sportiva e non solo: dall’alpinismo solipsistico alle performance…... 18 13. La Nuova Danza Francese negli anni Ottanta: affinità e divergenze ……………… 20 14. La nascita della Danse Escalade …………………………………………………... 21 II L’EVENTO SPETTACOLARE ………………………………………………………… 23 1. Introduzione………………………………………………………………………... 23 2. Lo spettacolo di Danse Escalade: composizione e messa in scena ……………….. 24 3. Il -
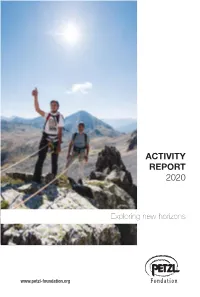
Activity Report 2020
ACTIVITY REPORT 2020 Exploring new horizons www.petzl-foundation.org Our mission CONTENTS Making a positive contribution Exploring new horizons to society Whether climbing a distant summit or exploring the depths below, our desire p. 4-5 The global pandemic and the climate crisis have made to access the inaccessible inspires an enduring passion to fulfill our dreams. Petzl employees volunteers each of us question the way we live and how the products we consume are produced. Driven by their customers and The mission of the Petzl Foundation is to support or initiate projects that serve p. 6-7 employees, a growing number of companies are integrating the public interest. These projects shall seek a harmonious balance between The Petzl Foundation and Corporate Social social and environmental concerns into the conduct of their human activities in the mountains and the vertical world relative to their impact Responsibility business activities. on our natural, cultural and economic environments. p. 8-9 In a global market that is still dominated by competition and Accident prevention The Petzl Foundation: the perpetual race for economic growth, there would seem Mountain medicine training in the Andes - Encourages education in risk management techniques designed to be little place for a viable company that aims to reduce to prevent accidents Work-at-height training for Bolivian mountain guides its impact on people and the environment. - Promotes the conservation of ecosystems which have difficult Improving safety in climbing federations Since 2020, our Corporate Social Responsibility (CSR) or vertical access Rockfall in the Goûter Couloir: new knowledge department has expanded its scope with four commitments - Supports discovery of our vertical world and the acquisition to better prepare for an ascent of Mont Blanc that have been designed to make a concrete contribution of new knowledge. -

La Saga Des Écrins La Saga Des Écrins La
François Labande François Labande François La Saga des Écrins La Saga des Écrins La 290 Première édition : © Éditions Guérin, 2014 © Éditions Paulsen, 2021 Guérin, Chamonix – guerin.editionspaulsen.com Les éditions Paulsen sont une société du groupe Paulsen Media. François Labande La Saga des Écrins À mes parents, qui ont su m’insuffler la passion pour les montagnes, la vallée de la Guisane, et le massif des Écrins. « La lune nous accueillit quand nous atteignîmes l’arête. Nous remontâmes solennellement l’arête immaculée, un pied dans l’ombre, un pied dans la clarté. Nous arrivâmes au sommet. Le gigantesque porte-à-faux du Doigt de Dieu se dressait contre le couchant où s’attardait encore une bande écarlate. Il semblait désigner dans le firmament une planète merveilleuse : Vénus peut-être. » Pierre Dalloz, première hivernale de la Meije orientale, 1927 préface par Lionel Daudet Vu d’en bas avec ses pics acérés aux cimes perdues, le massif des Écrins semblerait un îlot de liberté émergeant d’un océan douloureusement légiféré, embrassant un espace d’autant plus précieux qu’il est devenu rare au milieu de nos contrées urba- nisées. Il est curieusement resté intact, authentique, sauvage dit-on même, comme figé par les glaces. Comme à l’époque des premiers ascensionnistes, le regard peut tutoyer l’horizon sans qu’un pylône anachronique et malséant, ou une indécente sarabande d’hélicoptères ne viennent troubler une séculaire sérénité. Là-haut peut encore s’exercer la liberté d’être, un face- à- face(s) sans fard entre soi et les montagnes. Le massif des Écrins est scellé d’un temps à double tranchant : le premier, celui des pierres muettes, s’emploie à préserver le caractère originel de ces montagnes à l’accent méridional. -
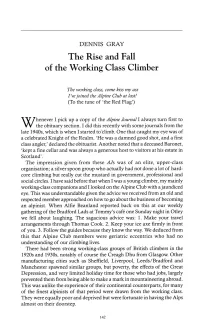
The Rise and Fall of the Working Class Climber
DENNIS GRAY The Rise and Fall of the Working Class Climber The working class, come kiss my ass I've joined the Alpine Club at last! (To the tune of 'the Red Flag') henever I pick up a copy of the Alpine Journal I always turn first to W the obituary section. I did this recently with some journals from the late 1940s, which is when I started to"climb. One that caught my eye was of a celebrated Knight of the Realm. 'He was a damned good shot, and a first class angler,' declared the obituarist. Another noted that a deceased Baronet, 'kept a fine cellar and was always a generous host to visitors at his estate in Scotland'. The impression given from these AJs was of an elite, upper-class organisation; a silver spoon group who actually had not done a lot of hard core climbing but really cut the mustard in government, professional and social circles. I have said before that when I was a young climber, my mainly working-class companions and I looked on the Alpine Club with a jaundiced eye. This was understandable given the advice we received from an old and respected member approached on how to go about the business of becoming an alpinist. When Alfie Beanland reported back on this at our weekly gathering of the Bradford Lads at Tommy's cafe one Sunday night in Otley we fell about laughing. The sagacious advice was: 1. Make your travel arrangements through Thomas Cook. 2. Keep your ice axe firmly in front of you. -

Technologie ESCALADE
Olivier VINCENT ([email protected]) LIVRET STAGE ASPI SECTION MONTAGNE ASRUC Partie 1 : Escalade I. UN PEU DE CULTURE ALPINE II. BIOMECANIQUE ET PHYSIQUE III. LES NŒUDS IV. TECHNOLOGIE DES SUPPORTS : GEOLOGIES V. TECHNIQUES DE PROGRESSION VI. LA TACTIQUE VII. DICTIONNAIRE FRANÇAIS ANGLAIS I. Un peu de culture alpine Définition : Le libre, c’est quoi ? "Escalade de parois rocheuses où le grimpeur utilise uniquement son corps pour progresser, et donc sans recourir à des moyens artificiels pour la progression elle-même. L’utilisation de moyens artificiels pour se protéger est prévu uniquement dans le but de réduire au minimum les risques en cas de chute." Escalade Libre signifie escalade loyale, acceptation d’un défi sans compromis A. À partir des années 1860 pour trouver les racines (bloc ou en falaise). Fontainebleau en 1897. Falaise : Anglais (1886) et Allemands de l'est (1864) pour trouver les premiers exploits verticaux Donc Fontainebleau en France, le Lake District en Angleterre et Dresde en Allemagne de l'est sont les berceaux de l'escalade rocheuse. deux périodes se distinguent sur le plan international. • La première période s’étale sur les trois premières décennies du siècle avec l’émergence : D’un intérêt prioritaire pour l’escalade rocheuse, du débat à propos de l’usage des moyens artificiels de progression et de protection. • La seconde période (à partir des années 50) s’achève sur une homogénéisation apparente des manières de grimper en libre, dans les pays anglo-saxons, d’abord en Angleterre puis aux Etats-Unis. A l’issue de cette période l’escalade libre cesse d’être une des techniques possibles à disposition des pratiquants pour devenir une activité distincte. -

Les Aiguilles De Chamonix, by Henri Isselin. Paris: Arthaud, 1960
Les Aiguilles de Chamonix, by Henri Isselin. Paris: Arthaud, 1960. 267 pages, 38 photo-illustrations (including a 6-page panorama), 2 route sketches, an orientation map, and a folding contour map (1:20,000) of the aiguilles W . of the Mer de Glace. Price N.F. 16 ($3.25). The title brings to the mind’s eye one of the most astonishing massifs of the Alps. The exceptional quality of its rocks and the variety of its climbs have brought it world-wide fame. The walls of the Blaitière and the fissures of the Grépon demand mastery of technique. In 1810 the Pole, Malczeski, gained the north summit of the Aiguille du Midi and, 135 years later, the brothers Lesueur triumphed on the northeast arête of the Dent du Caïman. Between these years the history and conquest of the spires unfold in more than a century of struggle and danger, coupled with the great names of Mummery, Fontaine, Knubel, Young, Ryan, Lépiney, Allain and many others. This book brings to life the drama as well as the progressive development of alpinism. Between 1870 and World War I the most important climbing was done by the British. James Eccles (1838-1915) is credited with devising the first effective roped party of three, and E. R. Whitwell (1843-1922), who made the first ascent of the Aiguille de Blaitière in 1876, is noted as the first amateur who could undertake difficult expeditions on an equal footing with his guides. As Coolidge considered this effort as the last word in the mountaineering of the time, it is of interest to see how these older efforts are now graded (Lucien Devies in Alpinisme, 1933) : The expedition of the Comte de Bouille on the Aiguille du Midi does not attain the first degree, "easy.” The routes of the Victorians, north summit of the Blaitière and Aiguille du Plan do not exceed second degree, although the south and central summits of the Blaitière approach third degree.